[parution/réception dans la presse] Aragon, Lettres à André Breton 1918-1931, édition établie, présentée et annotée par Lionel Follet, Gallimard, 2011, 470 p.
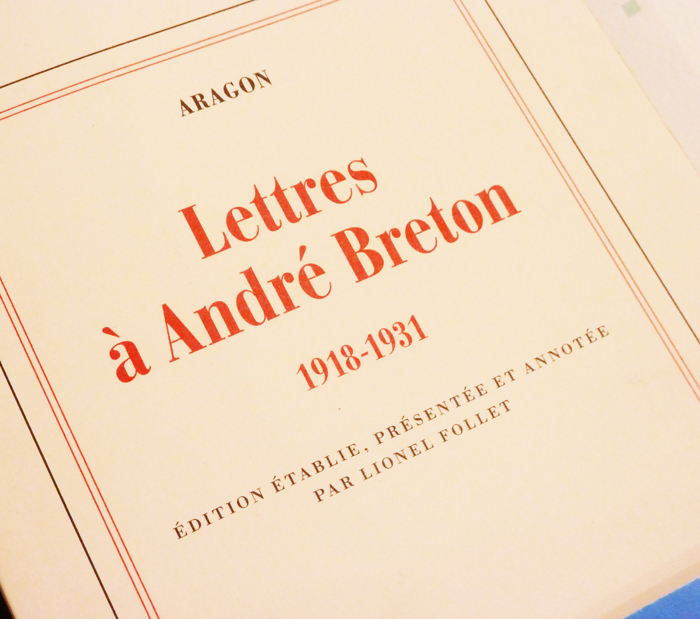
Articles parus dans la presse à l’occasion de la publication d’Aragon, Lettres à André Breton 1918-1931, édition établie, présentée et annotée par Lionel Follet, Gallimard, 2011, 470 p.
1. Philippe Lançon, « Louis Aragon, fou de Breton. Le surréalisme au plus intime, lettres inédites », Libération, 8 décembre 2011. à lire ci-dessous
2. Gaëlle Obiégly, « Aragon. Lettres à André Breton (1918-1931) » , FloriLettres, Revue littéraire de la Fondation La Poste , numéro 130, édition décembre 2011. à lire ci-dessous
3. Francis Matthys, « Aragon, Breton, Paulhan, épistoliers », La Libre Belgique, supplément, 5 décembre 2011. à lire ci-dessous
4. Nicolas Mouton, « Aragon/Breton, le rapport intérieur », Le Magazine littéraire, n° 515, janvier 2012, p. 44. à lire ci-dessous
5. Thierry Clermont, « L’Ogre et l’illusionniste », Le Figaro Littéraire, 5 janvier 2012 – en pdf à la fin de la page.
6. Henri Béhar, « Aragon – Breton, au temps de l’amitié stellaire », à lire dans Europe, janvier-février 2012, p. 311-316.
7. Olivier Barbarant, « Et écris-moi, je suis si nu ! », Les Lettres françaises, février 2012, page IV (supplément à L’Humanité du 2 février) – en pdf à la fin de la page ou à lire sur le site des Lettres françaises.
9. Jacques Henric, « Lettres d’Aragon à Breton », ArtPress, mars 2012
10. Daniel Bougnoux, « Aragon, Lettres à André Breton (1918-1931), édition établie et présentée par Lionel Follet (Gallimard 2011) », La Vie des idées, 14 mai 2012 – à lire ci-dessous ou sur le site de La Vie des idées
11. Stéphane Guégan, « Aragon, Breton et Drieu sont sur un bateau… », 11 décembre 2011, paru dans Moderne à lire ci-dessous ou sur Mots dits blog Le Monde
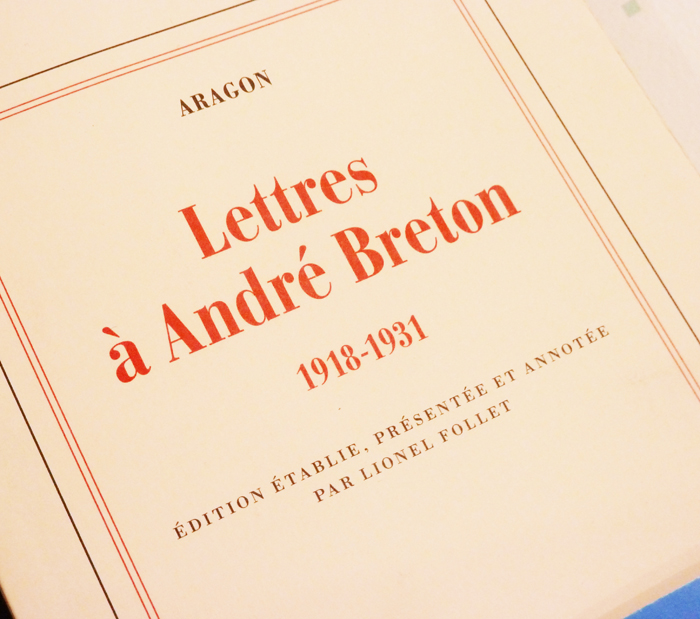
Photo Shige Gonzalvez
1. Philippe Lançon, « Louis Aragon, fou de Breton. Le surréalisme au plus intime, lettres inédites », Libération, 8 décembre 2011.
Aragon à 20 ans ? Un pur-sang. Tout le fouette. Il en souffre, il aime ça. Il a tout lu, il faut tout changer, voici le programme : «Des modèles. Simplement ? Nous ambitionnons plus haut. Les modèles finissent par devenir des raisons d’être. Et il ne faut pas. Tâche d’écrire sans penser à Rimbaud, pour voir. Tu comprendras le danger. Il n’y a qu’un homme que nous n’avons jamais imité ni l’un ni l’autre : c’est Reverdy. En aurais-tu envie ? Moi pas. Il faut repartir. Mais pas tellement de l’horizon des autres. Du nôtre.» (Paris, 24 mai 1918).
Le pur-sang est insolent et soumis ; il est amoureux : «Il y a en moi quelque méchanceté nerveuse. J’ai BESOIN d’éprouver ton amitié. Et tu ne réponds pas à mes lettres, il y a trop de temps entre nous. ALORS je voudrais te BATTRE comme on fait les femmes rebelles.» (Vémars, 14 septembre 1918). Ou : «Si tu n’as rien me dire pense que je suis la plus belle femme du monde et écris-moi.» (Fort-Louis, décembre 1918.) A qui s’adresse-t-il ? A André Breton.
Lyrisme sec.
Ces lettres, inédites et annotées avec le soin propre à Lionel Follet, sont l’atelier d’un génie qui se cherche par son plus intime ami, à l’orée du bois surréaliste. Rimbaud, Larbaud, Valéry, Apollinaire sont partout. Ce ne sont pas des citations, mais le sang même du poète. Il se révolte, il bout : «Il n’y a pas assez de mépris sur la Terre pour ceux qui singent la pureté avec des doigts merdeux.» (Oberhofen, 27 janvier 1919.)
Aragon et Breton se rencontrent en novembre 1917 au Val-de-Grâce. Très vite, l’amour et l’amitié se fondent pour devenir autre chose, plein de mots et sans nom : «Il est un jaune plus jaune que les champs de colza, celui des boîtes de conserves./ Il est un bleu plus bleu que celui des Maries de village, celui des yeux des poupées […]/ Mais il est un ami plus ami que toutes les couleurs de l’Arc-en-Ciel[…]/ C’est André Breton qui ne m’écrit jamais.»La lettre vient du front, où Aragon, médecin auxiliaire, danse en 1918 au «bal des mitrailleuses».C’est là, surtout, qu’il écrit à son aîné, dresseur qu’il dresse.
Il lit Rimbaud sous le masque à gaz. Il compose dans la boue ses premiers romans, explique ses poèmes. Il crie sous les obus ceux que lui envoie Breton, les corrige pendant les accalmies : formidables leçons de rythme, d’euphonie, de lyrisme sec. On l’enterre trois fois, il ressuscite, les derniers arbres lui rappellent ceux de Cézanne. Qu’il analyse ou qu’il voie, Aragon emballe sa vitesse de réaction, de description, d’association : Arlequin de courts-circuits. Caserne des pompiers des Batignolles, 15 juin 1918 : «Tout rougeoie ici de façon insolente. Mon seau de toilette est sanguin. Et quelqu’un chante l’air du Chant du départ. Tout cet écarlate me fait désirer ardemment ces vers de Jean Cocteau où des langoustes fleurissent un parterre. Il faudrait avoir la mémoire immédiate.»
Jaloux.
Quand il décrit la capitale, c’est déjà le Paysan de Paris : «Il est un quartier entre le Palais-Royal et les boulevards, dont les maisons sont hautes, étroites et ventrues, à force de gîter des héros romantiques. Il y a parallèlement aux boulevards un peu plus haut des rues entières qui font les mystérieuses. Portes battantes, volets clos, elles ont la douceur des choses secrètes.» Il rend visite à Apollinaire : «Je l’ai trouvé couché avec des ventouses : un paquet de mou sous des méduses.» Il apprend sa mort au front: «Elle vient à point : il est mort avec la guerre. Il n’avait plus rien à dire, commençait à mal tourner. Sa dernière image, ce combatif de chez lui au ministère, il nous l’aurait gâtée, mais elle est heureusement très miraculeuse. Qu’aurions-nous tiré de lui ? Rien.» Mais les vers d’Apollinaire marquettent ses paragraphes. Il est jaloux de ceux que Breton choisit.
Dénonciation.
Ces lettres ne sont malheureusement pas accompagnées de celles, inaccessibles, de leur destinataire. On les lit comme des tirades sans échos, éprouvant jusqu’au bout le désir d’Aragon : «Il faut te battre pour que tu cries.» Telles quelles, elles sont le laboratoire d’une aventure totale. Vers la fin des années 20, Aragon pressent son destin :«J’aime infiniment mieux le jeu que les gens. Je crois qu’il est bien inutile de penser à ce qu’on devient. D’une façon comme d’une autre, on continue à se ressembler. Seulement le portrait se momifie. On sèche.»Et plus loin :«Je crois qu’une certaine insatisfaction qui ne saurait cesser s’est mêlée à l’idée que j’ai de toi, par un détour ou par un autre.» (Monte-Carlo, 26 décembre 1926). L’insatisfaction, mêlée à tout, ne cessera plus. Breton et Aragon rompent sans retour en 1932. Aragon a signé une dénonciation du surréalisme à Moscou-la-gâteuse, d’où il écrit en 1930. Dernières lettres : «Moralement, il y a quelque chose de prodigieusement exaltant dans l’air d’ici, de très Fouquier-Tinville […]. La dictature du prolétariat commence. Au loin retentit le bruit de la fusillade : ce sont les saboteurs qui crèvent.» Le pur-sang rue toujours, sa violence a rejoint le paddock stalinien.
A lire en ligne sur le site de Libération
2. Gaëlle Obiégly, « Aragon. Lettres à André Breton (1918-1931), FloriLettres, Revue littéraire de la Fondation La Poste, numéro 130, édition décembre 2011
Sur la couverture, le nom du destinataire est plus grand que celui de l’auteur. Et au fil de la lecture de ces lettres de Louis Aragon la stature de celui à qui il s’adresse se fait toujours sentir ; inspirante, ou pénible. Par rapport à Breton, qui a noué de fortes relations et amitiés littéraires, Aragon est seul. Son enthousiasme pour Breton est immédiat, et réciproquement, semble-t-il. Lionel Follet, qui a établi cette édition, l’introduit avec une précision remarquable. Les notes, abondantes, pallient pertinemment l’absence des lettres du destinataire. Ainsi, grâce à un extrait d’une lettre de Breton citée dans la présentation, on perçoit l’emballement de celui-ci pour Aragon « vraiment un poète, avec des yeux levés très haut ». L’admiration d’Aragon pour Rimbaud a fait naître leur amitié et l’a entretenue.
Les lettres d’Aragon sont traversées de phrases de Rimbaud. Faire siennes les phrases d’un autre, s’approprier une parole admirée, s’y reconnaître, pourquoi ne pas l’appeler un geste politique. Car « je » parle toujours au sein du « nous ». N’importe quel poète est obligé de se servir des mots des autres pour exprimer sa singularité. Aragon, sa solitude, sa vie aux armées, ses Illuminations et sa Saison en enfer au front, c’est ce qui se lit dans les phrases d’un autre. Les allusions rimbaldiennes disent le « je » qui les utilisent et le « nous » qu’elles concernent. Ces citations sans guillemets instaurent l’intersubjectivité que ces lettres donnent à penser. Qui est l’autre auquel Aragon s’adresse ? On le suppose dominateur, cinglant. Ou bien c’est la position que lui donne Aragon qui nous conduit à ces déductions. Imaginant, d’après les lettres, quelques propos et reproches de Breton, on conçoit chez lui de la mesquinerie. Aragon a des préciosités, mais surtout de la fraîcheur. Ce qui, sans doute, plait à Breton qui louait les textes de Soupault pour leur liberté et leur fraîcheur.
Cette influence de Rimbaud sur ce qu’il écrit, Aragon, ne s’en cache pas. « C’est assez de vouloir faire du Rimbaud », avoue-t-il à Breton auquel il dit, dans une lettre du 24 mai 1918, qu’il vient de déchirer un poème qu’il travaillait depuis trois semaines. Et Aragon « propose d’être dieu », c’est-à-dire autonome, libéré de « tous les autres et de Rimbaud ». N’est-ce pas cela prendre possession de son génie ? Pas de lyrisme, mais une rage, alors, s’entend dans ce commandement qu’il s’adresse « il est grand temps de faire du soi. » Ces lettres, par moments, ressemblent à un journal intime. Comme si Aragon se parlait à lui-même. Elles sont pourtant sans intimité, ou plutôt elles montrent un homme entièrement habité par l’écriture, et la politique.
Les lettres du début sont des lettres de jeune homme ; désinvoltes et chaotiques. On en voit quelques-unes, telles qu’elles sont arrivées à Breton, calligraphiées, sans la couleur. Il y est question des amis, de textes qu’ils se donnent à lire. Et l’on comprend que leur esthétique est leur morale. Des jugements portés sur les artistes qu’il rencontre, celui sur Poulenc, dit beaucoup sur l’arrogance des surréalistes. Poulenc, écrit Aragon à Breton dont il cherche souvent la complicité, est « extraordinairement jeune et tu sais que je ne prise rien tant que cette qualité ». Et, plus tard, en novembre 1919, Aragon ayant appris la mort d’Apollinaire, n’exprime, alors, aucun chagrin. Car celui-ci « n’avait plus rien à dire, commençait à mal tourner » et il conclut « qu’aurions-nous tiré de lui ? »
Il y a cette phrase célèbre d’Apollinaire « Ah, Dieu, que la guerre est jolie », cette phrase frivole qui dégoûte Aragon. De toute manière ceux qui nomment la guerre lui font horreur. Il est au front. Une bonne partie des lettres qu’il adresse à Breton sont écrites du front. Il lui parle très peu de ce qui s’y passe. Pas grand-chose de racontable immédiatement, sans doute. Il n’y comprend rien, il en fera un vers, un fameux, plus tard. Mais à Breton, il ne dit pas grand-chose de la guerre, parce qu’il veut être autre chose à ses yeux qu’un soldat. Ce dont il lui parle c’est de la vie intérieure, pas du rôle qu’il est censé tenir, pas des refrains de marche, mais de la puissance extraordinaire d’Ibsen sur son système nerveux. Aragon à la guerre lit et écrit et frôle la mort et le dit à peine ou en feignant d’en rire. « On est un héros d’écrire par telles circonstances, et littérairement. » Des circonstances, on ne sait rien. Car Breton n’a pas à les savoir. Tandis que s’adressant à Jean Vergnet-Ruiz, un ami avec lequel il a étudié la médecine, Aragon n’a pas le même ton. Là, il dit les faits, dit qu’il a failli mourir trois fois, que des obus ont éclaté contre lui, à ses pieds, dans la cuvette où il se lavait. Qu’il aime cette vie, qu’il aime cette guerre, qu’il n’a jamais été aussi heureux, cela il ne peut le confier à Breton. Cette lettre à Jean Vergnet-Ruiz, placée en appendice, nous donne une autre version de son existence au front. Elle est moins rimbaldienne. Il est hâbleur quand il parle à Breton, son aîné. C’est de la pudeur, c’est le dandysme, il cache sa guerre. Je ne crois pas qu’il ait le désir de plaire à Breton, mais celui de l’atteindre. Et cela repose sur le son, l’image, la couleur. On l’a tué trois fois, ce qui lui vaudra « un ridicule ruban vert et rouge », il annonce ainsi sa citation à Breton et lui garantit qu’il ne parlera pas de la mauvaise compagnie dans laquelle il est, ni « des obus bzzz ». C’est le mois de juillet 1918, Aragon n’en revient pas « du plaisir de crier très haut dans les tranchées. »
Bien plus tard, en août 1926, séjournant à Biarritz il écrit à Breton au sujet de Lise Deharme. Peu importe. Là encore, ce n’est pas tellement l’objet qui compte mais le sujet auquel cela s’adresse. Il y a eu une dispute entre Breton et Deharme. Aragon relate un échange qu’il a eu avec Lise Deharme. Sans doute veut-il les réconcilier, ne se sentant pas en rivalité avec une femme. Elle est triste, écrit-il, triste « d’être fâchée avec tout ». C’est un lapsus. L’éditeur a corrigé en bas de page. Le « tout » à la place de « toi » nous renseigne sur ce que représente alors Breton pour Aragon. Son langage est perturbé par le destinataire, ce destinataire-là. Il s’adresse rarement à lui en le nommant, mais l’appelle son ami, son cher, son cher enfant. A ce moment-là, leur amitié n’a plus que quatre ans à vivre. Le ton n’est plus celui des débuts, il est maintenant plus affectueux et moins allusif. Sans doute parce qu’entre eux plus rien ne va de soi.
Dans les dernières années de la correspondance de Breton et d’Aragon se manifeste leur enthousiasme pour la révolution marxiste. Celle-ci est mise en rapport avec la révolte surréaliste. Les lettres d’Aragon attestent d’une réflexion ardente vis-à-vis de la révolution. Il déclare, le 7 septembre 1925, à celui qui est encore son cher ami, qu’une révolution n’est jamais accomplie. Ses positions politiques sont exprimées avec honnêteté. Il s’engage, alors, fermement dans l’action politique. La voix du poète fait place à une manière de chef de parti, dans la dernière partie de cette lettre-ci. Malgré le témoignage d’une soumission à l’autorité de Breton dont il partagerait les avis, « sans examen », Aragon s’avance vers d’autres horizons, d’autres dogmes.
Voir sur le site de la Fondation la Poste
3. Francis Matthys, « Aragon, Breton, Paulhan, épistoliers », Libre Belgique supplément, 5 décembre 2011
D’Aragon, les lettres adressées à André Breton entre 1918 et 1931. Et la correspondance échangée entre Paulhan et Gallimard, de 1919 à 1968.
Écrire des lettres – manuscrites – est un art en voie de disparition. Depuis quelques années, à la plume l’on préfère le téléphone, ou expédier des SMS et des courriels où l’on ne se soucie guère du style. Quant à l’orthographe… Comment n’y pas penser à l’heure où paraissent deux recueils de lettres : les unes d’Aragon à Breton, les autres de Jean Paulhan à Gaston Gallimard ? Par les soins de Lionel Follet (qui appartient à l’Equipe de Recherche Interdisciplinaire sur Elsa Triolet et Aragon et qui a rédigé l’impressionnante introduction du volume), voici rendues publiques, pour la première fois, les quelque 170 lettres qu’Aragon (Paris, 3 octobre 1897 – 24 décembre 1982) adressa entre 1918 et 1931 à André Breton (Tinchebray, dans l’Orne, 18 février 1896 – Paris, 28 septembre 1966). Point n’est besoin de rappeler qu’avec Philippe Soupault (Chaville, 2 août 1897 – Paris, 12 mars 1990), Breton et Aragon furent les fondateurs du surréalisme, ce mouvement – issu du dadaïsme – qui exercera une incalculable influence sur l’art et la pensée au sortir de la Première Guerre mondiale. Première Guerre que Breton et Aragon vécurent en tant qu’infirmiers militaires (« médecins-auxiliaires »), tous deux ayant commencé des études de médecine qu’ils ne poursuivront pas. C’est au Val-de-Grâce, l’école du Service de santé des armées, à Paris, qu’en septembre 1917 se rencontrèrent les deux jeunes poètes, André Breton exerçant vite un certain ascendant sur son cadet appelé, pourtant, à devenir l’écrivain français le plus étourdissant et virtuose depuis Victor Hugo. De ce séducteur « qui subjuguait les hommes comme les femmes », Bruno de Cessole dit, dans Le Défilé des réfractaires, qu’ « il disposait d’une arme absolue : un orchestre à faire pâlir les rossignols ». C’est parler d’or qu’ainsi parler.
Les chemins d’Aragon et Breton divorceront néanmoins. Au lendemain du Congrès de Kharkov, en 1930, Aragon adhérera au Parti communiste dont il ne se détachera que lorsque bourgeonnera le Printemps de Prague qui précéda l’invasion de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques à la fin d’août 68. Et l’on se souvient de son amer ultime éditorial des Lettres françaises (qu’il dirigea longtemps) où le poète avoue : « Je ne suis pas le personnage que vous prétendez m’imposer d’être ou d’avoir été. J’ai gâché ma vie et c’est tout ». Cette adhésion à la Moscou de Staline provoquera donc la rupture avec l’auteur de Nadja. Impossible d’ici résumer ces lettres d’Aragon dont les réponses d’André Breton, lit-on page 64, « ne pourraient évidemment figurer ici, en vertu de son testament. Il faut ajouter que très peu d’entre elles ont été retrouvées, après le décès du destinataire ». Déplorons-le.
Ces lettres, souligne Lionel Follet qui les présente et les annote, sont « la chronique d’une amitié passionnée puis violemment rompue, en même temps qu’elles jalonnent un moment essentiel de la modernité du XXe siècle ». Des pages d’abord écrites du front en 1918 et d’Alsace et de Sarre, après l’armistice. Elles livrent ensuite des échos de l’histoire du groupe surréaliste – entré dans la vie politique en 1925, un an après la retentissante publication du pamphlet Un cadavre, publié à la mort d’Anatole France. Des lettres où apparaissent, naturellement, Rimbaud et Lautréamont – deux des dieux d’Aragon et Breton – ou bien Apollinaire et Reverdy.
Information intéressante, page 61 : « Ces lettres d’Aragon à André Breton sont entrées en 1937 à la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, par le don de Mme Louis Solvay, collectionneuse belge bien connue, membre de la Société des Amis de la Bibliothèque. Nous ignorons dans quelles conditions, éventuellement par quels intermédiaires, elle les avait acquises, quand Breton s’en fut dessaisi après sa rupture avec Aragon ». […]
http://www.lalibre.be/culture/livres/article/704484/aragon-breton-paulhan-epistoliers.html
4. Nicolas Mouton, « Aragon/Breton, le rapport intérieur », Le Magazine littéraire n° 515, janvier 2012, p. 44.
Un jour de mars 1919, longeant le jardin des Tuileries, deux jeunes poètes éperdus de Rimbaud, de Jarry et parlant couramment le Maldoror, scellent un pacte secret dont le souvenir dominera toute leur vie : il exprime leur répugnance à faire carrière, la peur de plaire, le refus des compromissions et l’impératif de décevoir. Déjà se formule l’aboutissement nécessairement tragique de leur complicité. Et pourtant rien n’a plus de feu, d’enthousiasme, que cette amitié passionnelle fondée sur l’ambition de bâtir plus beau un monde que la guerre et une littérature compromise viennent de mettre à bas.
Les quelques cent-soixante-dix lettres d’Aragon à André Breton, récemment retrouvées à la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, ne peuvent cependant se réduire au simple récit d’une exaltation. C’est un événement majeur, tant pour l’histoire du mouvement surréaliste – et ce qui en découle – que pour cette part toujours dérobée de l’Histoire des hommes : un langage en pleine aventure. Le miracle de cette édition, qui s’inscrit dans la logique de Papiers inédits[[Aragon : Papiers inédits 1917-1931, de Dada au surréalisme (Gallimard, Les Cahiers de la NRF, 2000), édition établie par Lionel Follet.]], doit à la savoureuse érudition de Lionel Follet de s’accomplir autant pour le familier d’Aragon que pour le lecteur allant à sa rencontre. Tout est ici dévoué au plaisir du texte. Et si les réponses de Breton manquent (chacun sait qu’elles ne peuvent être publiées avant 2016), peut-être ce silence donne-t-il une unité, une intensité et une émotion d’autant plus grandes aux pages d’Aragon.
Comment rester insensible au charme de ce jeune homme, si cruellement doué, à son humour, son insolence, son amour sans mesure de la poésie, cherchant sans répit dans les mots de son ami l’empire de la préférence ? En lui, s’incarnent les contradictions et les itinéraires du surréalisme : la vertu des lettres d’Aragon n’est pas d’illustrer trois moments qui balisent son histoire (la guerre et l’occupation de la Sarre, l’évolution du groupe vers l’action politique, et le Congrès de Kharkov dont les conséquences seront le prétexte d’une rupture éclatante), mais d’introduire des précisions, de la nuance, des dates, des textes jusqu’alors inconnus. Bref, de mettre à mal les idées schématiques qu’une critique paresseuse véhicule encore trop souvent sur lui. Ainsi doit-on reconsidérer les circonstances de la découverte de Lautréamont, la chronologie de la guerre, le rapport à Reverdy et Apollinaire, la question du roman, l’apprentissage de la politique et de ses nécessaires compromis (avec la décision, venant de Breton lui-même, de se soumettre à l’internationale communiste), la difficulté infinie de démêler le détail, les enjeux ce qui s’est passé en URSS en 1930, où Aragon et Sadoul pensant plaider la cause du surréalisme comme avant-garde révolutionnaire se trouvent contraints de signer une autocritique qui, aux yeux de Breton aura valeur de trahison.
Les lettres d’Aragon ne sont donc en rien un document, mais bien un ensemble de textes qu’il nous faut très précisément faire raisonner avec ses autres écrits (tous genres mêlés), en usant scrupuleusement de la chronologie, pour que chaque pas prenne valeur de trace.
La question de l’écriture est au cœur de la relation avec Breton, dont Aragon ne cesse d’érotiser (dangereusement) l’expression. Toujours sur le fil, il provoque et se retire : « Alors je voudrais te battre comme on fait les femmes rebelles. » Chaque texte s’élabore contre lui-même, invente sa propre critique, engendre une conduite morale. Et si la relation d’Aragon et de Breton est jalonnée de projets d’écritures communes qui n’aboutissent pas, c’est bien le signe (et cela est sensible dès les premières lettres) que ni leur morale ni leur psyché ne pouvaient s’épouser. « L’étrange parenté du plaisir, des pleurs, et du plaire. On ne s’entend pas. On ne s’entend pas. »[[Théâtre/Roman (Gallimard, 1974)]]
Il faut relire aujourd’hui le grand article de juin 1967 Lautréamont et nous[[Réédité aux Editions Sables en 1992, et en 2008 dans la nouvelle édition de la Pléiade Lautréamont.]], pour mesurer la fidélité d’Aragon à la morale de sa jeunesse. Ce qui surprendra peut-être nombre de lecteurs… Au début de 1970, filmé par Pierre-André Boutang, Aragon déclarait : « Presque tout ce que j’ai écrit est incompréhensible au fond si on ne se reporte pas à Lautréamont et à la contradiction fondamentale qui existe en lui. Même des choses qui ont l’air de n’avoir avec cela aucun rapport, qui n’ont aucun rapport extérieur. »
–> à lire en pdf ci-dessous.
10. Daniel Bougnoux, « Aragon, Lettres à André Breton (1918-1931), édition établie et présentée par Lionel Follet (Gallimard 2011) » à paraître dans La Vie des idées, mai 2012
Comment devient-on Aragon ? Un biographe rêverait d’isoler une rencontre ou d’énumérer telles circonstances, comme si une personnalité singulière pouvait jamais s’y ramener. Il est certain pourtant que ses Lettres à André Breton (1918-1931) jettent sur ses années de formation un éclairage dont on ne pourra plus se passer : ni pour lire ses premiers écrits, Feu de joie notamment et Anicet, ni pour débrouiller, aux racines de son érotique, les affinités obscures de l’amitié, de l’amour, de la guerre et d’une écriture qu’il ne sépare jamais de la lecture.
Le dénivelé de leurs conditions saute aux yeux dès la couverture : André Breton typographié en grosses lettres rouges, Aragon (amputé de son prénom comme il en a imposé l’usage depuis 1928) en petites capitales noires. A la fin de septembre 1917 de fait, moment de leur rencontre au Val-de-Grâce, Aragon marche sur ses vingt ans ; il connait Rimbaud par cœur et, dira Breton dans ses Entretiens, « il a vraiment tout lu », mais il se trouve encore très isolé malgré ses dons étincelants ; André, de vingt mois son aîné, fréquente Valéry, Apollinaire, Reverdy, et joue naturellement auprès de lui les mentors, ou l’intercesseur capital – figure ambivalente à suivre dans Les Aventures de Télémaque.
« En lui alors, peu de révolte », précise Breton dans ses Entretiens (1952), ce que confirme Adrienne Monnier qui apprécie dans son cabinet de lecture les visites de ce grand jeune homme sage. Nous n’avons pas les lettres de Breton en miroir de cette correspondance, elles ne seront lisibles qu’en 2016, et pour celles qui concernent Aragon d’un accès sans doute très lacunaire, en raison du pillage de sa bibliothèque. On peut douter néanmoins, au vu des fragments qu’il en a lui-même recopiés (notamment dans Lautréamont et nous), qu’elles témoignaient de la même chaleur, de la même brûlante passion. Le premier charme de ce volume, c’est d’y découvrir un très jeune homme transi, pétri par son aîné : la flamme qui monte dans Anicet – ou dans Feu de joie – éclaire pareillement ces lettres, qui expriment toute la ferveur, la fraîcheur et la confiance du disciple. Aragon-Anicet s’arracherait les yeux et les dents pour interpréter dorénavant le monde avec les sens d’André – rebaptisé dans le roman Baptiste Ajamais. Car tel est l’ascendant d’André : « Il comprit qu’il ne ferait que suivre encore une fois la direction donnée, qu’il était sous l’influence de Baptiste. (…) Quelle puissance avait donc sur lui cet être autoritaire ? Dans l’ombre, on devinait la fascination du regard et le froncement des sourcils. Il n’y avait pas à s’en dédire : Baptiste subjuguait Anicet, et à quelle fin ? » (Œuvres Romanesques Complètes volume I, page 85). C’est bien le cas d’anticiper ici la leçon du Fou d’Elsa : qui j’aime me crée. Et de se demander avec Anicet « comment ne pas s’éprendre de celui qui nous donne à tout instant l’équivalent humain des choses extérieures ? » (ibid., page 120).
Si Louis voue son être à André, celui-ci en retour semble jouer sur lui de son autorité, ou de l’attachement qu’il suscite. Nous voyons dans ces lettres, au moment de la « rupture » de décembre 18-janvier 19, le cadet perdre contenance, supplier, endurer les affres de la jalousie ou de la trahison – mais aussi se reprendre, persifler, murir, tendre à son correspondant le miroir virtuose et moqueur d’un « Rondeau de l’omnipotence » (page 269, lettre du 19 avril 1919), en bref user des armes de la féminité dans un combat roué, où le marivaudage côtoie la tragédie.
Ces missives qui se veulent primesautières, pudiques ou faussement détachées offrent une archive de premier ordre, moins sur l’homosexualité d’Aragon comme diagnostiquerait une analyse superficielle, que sur les tourments d’une formation, morale, artistique, politique. Nous lisons ici, en marge d’Anicet, de Télémaque ou du Libertinage, le roman d’apprentissage de leur génial auteur. Et cela tient parfois de la possession ou du vaudou ; Aragon est chevauché, engrossé par Breton : « Mais je t’aime tant que tu ne sais pas à quoi tu t’engages » (écrit-il au plus fort de la crise le 24 janvier 19, en ajoutant à cette déclaration une allusion équivoque au couple Verlaine-Rimbaud), ou encore ce sonore alexandrin pour clore la lettre du 22 septembre 18 : « Et je t’honore, André qui veut dire HOMME en grec » (page 200), ou encore : « Si tu n’as rien à me dire pense que je suis la plus belle femme du monde et écris-moi. Ou bien le plus grand poète » (29 décembre 18)… Mais le pur-sang fier d’affirmer sa jeune vitalité sait aussi ruer à ce rodéo, et retourner la situation à son profit : « Il y a en moi quelque méchanceté nerveuse. J’ai BESOIN d’éprouver ton amitié. (…) ALORS je voudrais te BATTRE comme on fait les femmes rebelles » (14 septembre 18, page 200) ; ou dans un moment de dépit – Breton vient de lui refuser sa collaboration promise pour écrire à deux mains le roman de Matisse (qui deviendra Madame à sa tour monte) – : « Tu te mets à faire des mines. FILLE, va » (17 novembre 18).
L’abandon du roman caressé est très significatif d’un désaccord profond entre les deux écrivains, au-delà de ce croisement manqué. Il est éclairant, au fil de cette correspondance passionnée, de voir Aragon prendre acte des réticences de son mentor, et choisir de tracer sa propre route ; malgré le transfert massif, et l’emportement véritablement amoureux dont témoignent quelques lettres, un écrivain se construit et gagne son indépendance : « Il est temps de faire du soi. (…) Il faut repartir. Mais pas tellement de l’horizon des autres. Du nôtre » (24 mai 18) – ce qui est reconnaître encore son allégeance à Breton ; il y revient quelques lettres plus loin : « Je me suis déjà expliqué à ce sujet (être soi) » (31 mai). Les suivantes le montrent encore sous l’empire persistant de Breton : « Je travaille à rendre présentable ce que tu appelles ma Saison en enfer, et ce sous le titre : Roman. Est-ce faisable ? Si tu m’en donnes l’ordre, je cesserai ce travail. Je m’en remets à toi » (3 juin 18) ; et deux lettres plus tard : « Je n’écrirai pas Roman puisque tu penses que c’est inopportun ».
Nous ne savons pas ce qu’était l’entreprise ainsi baptisée, le projet du roman d’Anicet ne naîtra qu’à l’automne ; mais l’emprise de Breton est manifeste. Pourtant, quelles que soient les réserves de celui-ci sur le genre romanesque, nous voyons Aragon, du moment où il tient son sujet, prendre le mors au dent : « Mais sois tranquille, mon roman est fait dans ma tête (…). Je continue à faire un livre laborieux, mon premier roman, traditionaliste. (…) Dispense-toi de menacer » (24 avril 19) ; et de citer à la suite l’injonction assez exorbitante proférée par André à son endroit : « Entends bien que je veux être seul juge de ce que tu pourras entreprendre dans un nouvel ordre d’idées » (même phrase rapportée par Aragon dans Lautréamont et nous). Extravagante prétention : Breton s’annexe la pensée d’Aragon au point de lui interdire d’inventer ! A quoi son ami en voie d’émancipation lui oppose, ironiquement : « Mais je n’entreprends rien, je continue. On n’a pas de nouveaux ordres d’idées sur commande » (page 277).
Passe d’armes édifiante, et combien éclairante sur le travail de libération et de construction de soi du cadet ! Or ceci suit de près une péripétie décisive, sur laquelle pivote la narration de Lautréamont et nous (récit rétrospectif de 1967), le fameux épisode touchant « ce que nous avons dit un certain soir » : déambulant rue de Rivoli le long des grilles des Tuileries, les deux amis ont comploté un pacte terroriste, qui inspirera le poème « Programme » de Feu de joie, puis le conte très noir, et prémonitoire, du Libertinage intitulé « Lorsque tout est fini ». Fondée sur l’épuration, la logique terroriste ne peut que se retourner contre ses promoteurs, et c’est ce duel final qu’envisagent avec perspicacité ce poème et ce conte – et que réalisera, par exemple, l’élimination méthodique des vieux bolcheviks par Staline. Sans anticiper sur une histoire – une Histoire – autour de laquelle pivotera par l’esquive ou la rationalisation une bonne part de l’œuvre d’Aragon, il est frappant de rencontrer les germes de la guerre et de la terreur au cœur de cette amitié pour lui fondatrice ; et par exemple de lire, dans la lettre du 20 avril 19 consécutive à la conversation exaltée des Tuileries, ce condensé de passions contradictoires : « Non tu n’as rien à craindre POUR LE MOMENT parce que pour le moment rien ni personne ne m’est plus cher que toi, et ce qui fait le prix de cette amitié c’est la dramatique certitude qu’UN JOUR nous nous tuerons à mort. (…) Je vais te maintenir dans l’inquiétude, et sache que ce ne sera pas gratuitement, car si tu as trouvé un moyen d’établir ton pouvoir sur le monde, j’en ai moi, un pour établir le mien sur toi. Ainsi je t’aurai à ma merci. (…) Ô mon ami qu’importe le monde entier quand j’ai une lettre de toi » (cette phrase finale de la lettre dans une graphie plus large).
On s’explique mieux par ces antécédents l’objection d’Aragon aux divers gauchistes qui mèneront campagne contre le P.C.F. : « Il leur a manqué un mouvement dada ». Il aurait pu ajouter, et il y pensa certainement : il leur a manqué de faire deux guerres – où lui-même excella. Ou encore, il leur manqua d’en passer par une amitié aussi ravageuse que celle d’André Breton. « HAUTE ECOLE », résume Anicet. Il y a des amitiés, ou des amours, qui valent en effet des guerres – comme dit le docteur Decoeur à Aurélien, qualifiant sa femme Rose Melrose de « ma grande guerre à moi »… Au fil de ces cent soixante-douze lettres où se pratique à cœur ouvert la vivisection d’une passion, on apprendra ainsi à distinguer les enchevêtrements de l’amour et de la haine, du masochisme et du sadisme, de l’admiration et du meurtre – qui n’ont rien, à bien considérer, que d’assez ordinaire.
La fin de la correspondance concerne l’engagement communiste des surréalistes, et singulièrement le congrès de Kharkov de novembre 1930, qui précipitera la rupture. Péripéties bien connues, où nous voyons Aragon prendre sur Breton une position d’éclaireur, puis de représentant du surréalisme auprès des Soviétiques ; que ceux-ci aient abusé de sa bonne foi jusqu’à l’amener à commettre l’irréparable vis-à-vis de Breton, n’infirme pas le mouvement général : nous avons par étapes, lettre après lettre, suivi la maturation du jeune homme qui prend conscience de son génie propre, et règle ses distances. Mais sans jamais renoncer à servir. Toujours solidaire, Aragon semble n’écrire que par émulation ou par amour, engagé dans un service courtois ou la présentation d’une offrande. Ce sens du service, si évident ici, touche à l’expérience de la guerre dont on sent bien qu’elle sépare les deux amis. Dans ses Entretiens, Breton fera remarquer en manière de reproche qu’Aragon a toujours supporté les obligations militaires « avec allégresse ». En 1918 comme en 1940 en effet, sa conduite héroïque fait l’admiration de ses supérieurs. De toute évidence, il y a chez lui un amour de la chose militaire, ou plus exactement du service, et il demeurera sa vie durant un militant, un soldat ou un homme qui sert : l’armée, le Parti, Elsa, autant de cadres qui structurent cette personnalité aux dons et aux tentations multiples, mais qui le désorientent. Le service lui donne un rail, il fonctionne aussi comme un sacrifice expiatoire en rachetant la faute de la naissance. Or cette guerre est intime, jusque dans le travail, jusque dans l’amour même, vécu par lui comme un combat de tous les instants. Toute sa vie, Aragon n’aura cessé de se battre.
Anarchiste plus que militant, Breton inversement demeure rebelle à une discipline extérieure ; très propice à enflammer le désir, son verbe peut bien déclencher en passant la révolte des étudiants d’Haïti lors de sa mémorable conférence de 1945 à Port-au-Prince, mais lui n’a cure d’organiser durablement une avant-garde, encore moins un parti. Son goût pour l’astrologie ou la magie l’oriente vers une ontologie fixiste, que révèle aussi sa curiosité pour les spectacles de la nature, finalement préférés aux mouvements sociaux, aux événements de l’actualité et à l’histoire. Sa pratique des horoscopes et des tables tournantes, sa haine du roman et du journalisme s’équilibrent : poète, Breton s’éprouve traversé voire transi par le message automatique, sans prendre la patience de tresser longuement un récit, ni de donner naissance à des personnages susceptibles de partager durablement son existence ou de mettre en jeu son identité ; ses flâneries au marché aux puces, les déambulations de Nadja ou l’aventure de « la nuit du tournesol » semblent moins déboucher sur des rencontres véritables, ou qu’on dirait de l’ordre du monde réel, que relever du principe de plaisir ou d’un coup de miroir spéculaire. Le hasard objectif comme le Witz (le mot d’esprit analysé par Freud) tournent dans un cercle : il y a de l’esprit (du fantôme) dans ces rencontres, ces objets. « Beau comme la rencontre… » : l’activité surréaliste aura beau se définir comme l’art des rencontres, donc par le choc de l’altérité, elle s’en évade dans une surréalité qui mime plus qu’elle n’affronte le principe de réalité, et les turbulences de l’histoire. À la recherche d’extases intenses, le surréalisme se moque de la durée, il préfère la nuit des éclairs à l’argumentation des Lumières ; la construction raisonnée d’un sens ou d’un logos partagé ne retient guère Breton, ni ceux qu’inspire son magistère.
Journaliste, romancier, poète et militant, Aragon lui tourna le dos pour se diriger vers cette mentalité élargie dont Kant fit crédit à l’homme des Lumières, qui me semble avoir inspiré son action et sa réflexion, quelles que soient ses propres zones d’ombre. Dans le couple Aragon-Breton, dont on n’a pas fini de sonder la fécondité pour l’histoire du surréalisme, l’exigence de démystification, d’explication, d’organisation ou de critique (historique, technique, sociologique…) fut incontestablement du côté du cadet. Dédaigné par ses anciens amis qui purent le trouver à la fois trop cérébral et trop sentimental, et longtemps suspect dans son propre parti, Aragon est une fête pour celui qui cherche la critique au cœur de la création, et qui ne sépare pas l’exercice de l’intelligence de l’expérience orageuse des passions.
11. Stéphane Guégan, « Aragon, Breton et Drieu sont sur un bateau… », 11 décembre 2011, paru dans Moderne, Mots dits blog Le Monde
Aragon avait la plume agile, le coup de patte facile, et l’amitié fragile… Formules que tout ça ? Allez-y voir par vous-même. Ses Lettres à André Breton, qui viennent de paraître dans l’impeccable édition de Lionel Follet, nous livrent le spectacle amusant et excitant, pitoyable aussi, d’un jeune poète en marche vers la reconnaissance. Haute et basse politiques… Entre 1918 et 1931, des dernières tranchées à l’apostasie stalinienne, Aragon a beaucoup écrit à son « ami » André Breton, avant de trahir leurs convictions communes en couchant avec « Moscou la gâteuse ». Belle expression, la sienne, qui nous rappelle qu’il eut le verbe dur, pur, pendant une douzaine d’années. Puis il entra dans les ordres. Contrairement à celle de son « ami » Drieu La Rochelle, l’après-guerre d’Aragon ne cesse pas en février 1934 ou en septembre 1938. Bien avant la flambée nationaliste et les reluisants accords de Munich, elle s’achève dès le congrès de Kharkov de 1930, théâtre humiliant d’une autocritique qui condamna pour longtemps le plus doué des surréalistes aux servitudes idéologiques les plus écœurantes. Glissement ou glissade que Drieu, l’homme qui a le plus « aimé » et le mieux percé à jour Aragon, avait pronostiqué dès 1924. On y revient, bien sûr, plus loin.
Au départ, donc, un faux médecin et un vrai poète. Aragon en soldat de vingt ans, infirmier plutôt. Drieu, son aîné de quatre ans, a connu lui le feu. La marque, au fer rouge, en sera profonde ; le brancardier Aragon, avec courage apparemment, en recueille les dernières étincelles, éclats de boue, de sang, d’horreur et de frissons. Fils de famille, rompu aux non-dits de l’hypocrisie bourgeoise, ce poilu imberbe demanda quelques secousses salutaires à la guerre finissante. Souvenons-nous de Feu de joie, avec un Picasso en couverture, le premier volume de poèmes d’Aragon en septembre 1919. S’ils sont indemnes du moindre héroïsme cocardier, ils ne pratiquent pas le grisâtre cafardeux ou contrit pour autant. Lionel Follet note justement : « Le masque du second degré à la fois nargue la guerre haïssable et avoue l’exaltation vécue. » Drieu l’avait précédé, sur un mode plus claudélien que rimbaldien, avec Interrogation (Gallimard, 1917). Aragon rendra compte en 1920 du deuxième recueil poétique de son « ami », Fond de cantine, dont Follet méconnaît la vigueur. Aragon prise chez Drieu ce mélange d’électricité sexuelle et de désespérance racée : « Nous avons aimé la guerre comme une négresse. » Ce « nous » n’est pas de majesté. Et d’ajouter : « Le soleil de la peur est un punch incomparable. La guerre, malgré les petits mortels, a la grandeur du vent. » Les Lettres à Breton, dont le courage physique n’était pas le fort, confirment.
Le 27 septembre 1918, façon Jarry : « La machine à décerveler marche à merveille. De temps à autre elle me passe la main dans les cheveux. » Superbe. À Jean Vergnet-Ruiz, qui devait faire une belle carrière dans les musées plus tard : « Cette vie, cette guerre : je n’ai jamais été aussi heureux. » Cela suffirait pour justifier la publication de cette correspondance qui reste orpheline des lettres de Breton (pas fou, on le sait, ce dernier en a interdit la diffusion après sa mort, de peur que son aura posthume en souffrît !). L’essentiel du volume actuel fait revivre les années 1918-1919, et traite de littérature ou de peinture (Follet lui prête une moindre attention). L’art, les arts, en découdre, en débattre, y appartenir surtout, voilà la grande affaire pour ces soldats assez protégés. En matière de poésie, l’heure est au grand reclassement, à l’inventaire des modernes d’avant-guerre. Aragon dévore au front. Lorsqu’il fait part de ses lectures à Breton, sa verve frise la boulimie des enfants ou des moteurs enfin débridés. L’autel sacré de la modernité rayonne de trois dieux, évidemment. Rimbaud et Lautréamont, d’abord. Qui complètera la sainte trinité ? Aragon et Breton justement en devisent sous les bombes ou presque… On connaît la réponse de l’histoire littéraire. Ce troisième homme ne saurait être qu’Apollinaire. La réponse d’Aragon et de Breton, à chaud, est différente.

