Compte rendu par Hervé Bismuth de Nelly Wolf, Le Juif imaginé. D’Elsa Triolet à Romain Gary
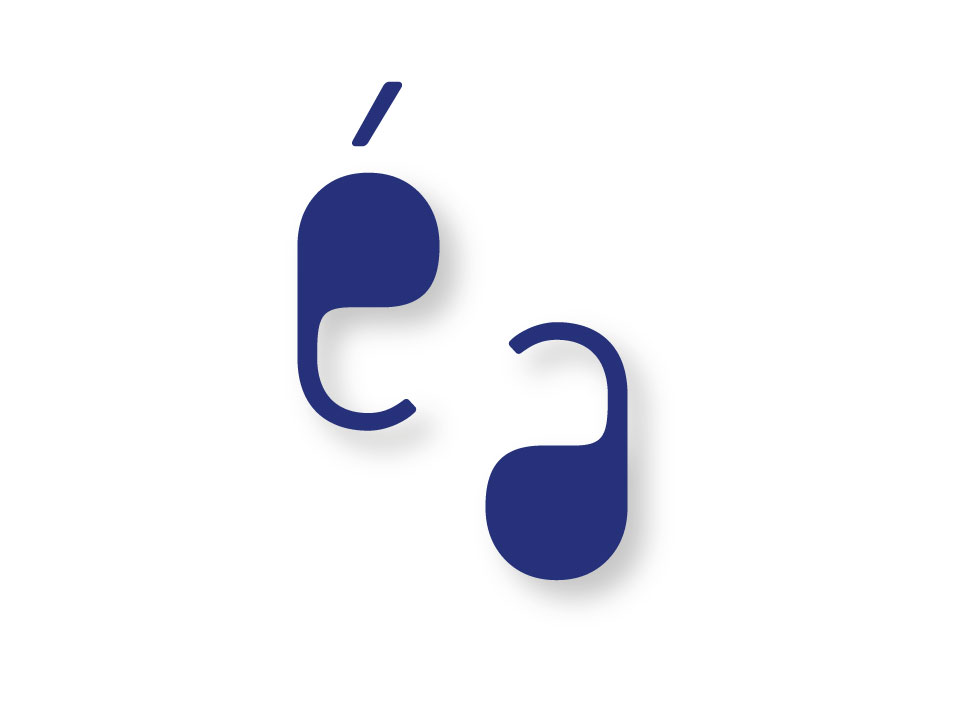

Nelly Wolf, Le Juif imaginé. D’Elsa Triolet à Romain Gary, CNRS Éditions, « Culture et Société », septembre 2023, 396 pages, 26 euros.
Ce livre se présente à partir d’un constat certes provocateur, en tout cas paradoxal : « la littérature juive de langue française n’existe pas » (p. 17) – qui peut étonner en cette année 2023 où elle existe assez comme champ d’études labouré depuis déjà plusieurs années par Maxime Decout et… Nelly Wolf. Ce mode d’existence plutôt schrödingerien motive à lui seul le contenu – et le titre ! – du premier chapitre de l’ouvrage : « La littérature juive française est-elle une blague juive ? ». Dans les deux notions recouvertes par ce champ d’études : « littérature juive », « judéité littéraire », on aurait tort de chercher la moindre assignation à résidence communautaire ou ethnique : l’écrivain étudié ici n’est pas l’« écrivain juif », mais l’écrivain « dont la judéité produit des effets dans le champ littéraire ». D’où le titre de l’ouvrage, inspiré par les réflexions d’Albert Memmi : un « juif imaginé » est un juif dont l’identité juive constitue une partie de l’imaginaire, façon pour Nelly Wolf d’évacuer d’emblée des débats stupides, tel celui qui ouvre l’introduction de cet essai et qui concerne Patrick Modiano : si le prix Nobel français est – ou non – un écrivain juif, ce n’est pas dans son patrimoine familial qu’il faut le chercher. Mais c’est bien d’auteurs juifs dont il s’agit ici : la littérature juive à l’étude n’est pas une « littérature sur les Juifs ». L’étude de Nelly Wolf se constitue ainsi en une étude générale de la présence de la judéité auctoriale à l’œuvre dans la littérature française du XXe siècle, sous la forme d’une histoire littéraire s’appuyant sur quelques rappels d’histoire de la judéité française depuis la Révolution.
La première qualité de cet ouvrage est de présenter un état des lieux et un historique richement documentés de cette littérature dont la naissance remonte aux années 1920 sur le terreau du « réveil juif » lié à une revendication identitaire consécutive à l’Affaire Dreyfus. Elle prendra certes de nouveaux contours après la Shoah – Nelly Wolf parle à ce propos de « nouveau “réveil juif” », voire de « renaissance », avant d’être envahie par la question israélo-palestinienne dans les années 2000 (Nathalie Azoulai, Les Manifestations, 2016). Parallèlement à cet état des lieux est dressé celui de la critique de cette littérature, parfois émanant des auteurs juifs eux-mêmes (Henri Raczymow, entre autres), à mesure que se discutent et se définissent les contours de cette littérature aux frontières discutables – mais n’est-ce pas le cas de tout genre, de tout sous-genre, littéraire ou non ? –, mais dont l’intérêt n’est pas tant l’exactitude de ses frontières que justement les discussions qu’elles soulèvent. Sa seconde qualité est de ne pas présenter cette histoire littéraire de façon historiographique en dehors des quelques éléments de chronologie historique nécessaires, mais de la problématiser en chapitres. Passé le premier chapitre qui développe finement les enjeux de la question soulevée par la conception d’une « littérature juive », le deuxième chapitre :« Être (ou ne pas être) un écrivain juif de langue française » traite de la question de l’identité juive à l’œuvre, et un cinquième chapitre étudie ce marqueur linguistique de la judéité qu’est le yiddish :« Usage du yiddish ».
Ces deux chapitres encadrent deux chapitres présentant deux étapes importantes dans les fluctuations de cette littérature. Le chapitre 3, « Les “Goncourt juifs” », est exclusivement consacré aux prix Goncourt attribués à des auteurs juifs de littérature juive dans les quinze années qui ont suivi la Libération. Si Nelly Wolf cite les Goncourt décernés aux livres des auteurs juifs que sont Elsa Triolet (Le Premier Accroc coûte 200 francs, 1944) Maurice Druon (Les Grandes Familles, 1948), Romain Gary (Les Racines du ciel, 1956), ce n’est que pour les écarter, et à juste titre : la judéité de ces trois auteurs ne fait pas pour autant de leurs œuvres des représentants d’une littérature juive. Les « Goncourt juifs » à l’étude ici sont les deux sagas Les Eaux mêlées de Roger Ikor (1955) et Le Dernier des Justes d’André Schwarz-Bart (1959) ainsi que le récit à la première personne Les Bagages de sable d’Anna Langfus (1962). Ces trois œuvres et les débats qui leur sont liés, en particulier les polémiques autour des deux premières, sont un moyen de noter le glissement rapide en quelques années à peine de ce qui définit la judéité : dans l’ancien monde une histoire familiale et une religion, dans le nouveau monde la réalité de la Shoah. Elles sont aussi l’occasion de noter le « statut paradoxal » du Goncourt dans ces années-là : il « fait apparaître dans la lumière médiatique l’histoire d’un peuple qui a disparu et couvre d’honneur des porte-parole qui ne sont jamais que des vestiges ou des rescapés » (p. 230). La seconde étape importante, celle du chapitre 4, « Le tournant mémoriel », concerne les générations suivantes d’auteurs juifs, une génération d’auteurs « témoins distants » de la Shoah parce qu’enfants pendant la guerre ou « héritiers [directs] de la mémoire » : Perec, Cixous, Modiano, Raczymow… et plus récemment la génération suivante des auteurs qui nous sont contemporains : Karine Tuil, Ivan Jablonka, Nathalie Azoulai…
Certaines – rares – lectures d’œuvres présentées dans cette étude peuvent néanmoins être sinon problématiques tout au moins discutables. On peut ne pas adhérer à la lecture proposée des Choses (1965) de Perec, une lecture nourrie par les « hors-d’œuvre » épitextuels que sont sa correspondance et la publication de quelques entretiens, nourrie surtout de l’œuvre postérieur, en particulier W ou le Souvenir d’enfance (1975) : cette lecture amène ainsi Nelly Wolf à mettre en lumière le passé traumatisant de l’enfance de l’auteur dans ce récit qui se révèle ainsi bien plus signifiant qu’une simple « histoire des années 60 ». Cette question met également en tension la définition patiemment tissée au début du livre d’une « littérature juive » : s’il est vrai que dans Les Choses « Perec enfouit […] sa judéité » et que l’on peut lire dans cette œuvre la « judéité cryptique » de son auteur (p. 253), la « judéité littéraire » de l’auteur des Choses ne résulte en ce cas que d’une lecture, ce qui nous renvoie aux questions connues des 3 intentio[s] qu’Umberto Eco définissait dans Limites de l’interprétation. Cette question se pose de façon plus globale s’agissant d’Elsa Triolet.
C’est dans le deuxième chapitre, « Être (ou ne pas être) un écrivain juif de langue française », consacré à l’identité juive, qu’est questionnée l’appartenance des écrits d’Elsa Triolet à la « littérature juive ». Dans ce chapitre est posée la question du refoulement de la judéité et de sa résurgence dans la stigmatisation générale liée à la Seconde Guerre mondiale. Cette double question donne l’occasion d’aborder les cas de figure représentés par les écrivains Nathalie Sarraute et Bernard Franck avant de développer celui d’Elsa Triolet. Sarraute représente le cas de figure de l’écrivaine refusant constamment de parler à partir de sa judéité – ce qui n’empêche pas Nelly Wolf de penser que c’est cette judéité qui s’exprimera dans son soutien à l’État d’Israël à la fin des années 60. Bernard Frank, juif laïque brutalement confronté à la violence de l’antisémitisme sous Vichy, assume à l’inverse les caricatures de l’antisémitisme pour les prendre en charge dans ses narrations à la première personne et en retourner sur l’Autre l’agressivité dans une ironie violente et bouffonne. Le troisième cas de figure est développé sur une trentaine de pages sous le titre « Elsa Triolet, la judéité sous camouflage », titre repris de celui du dernier roman écrit en russe par l’écrivaine, Camouflage (1928)[1]. Ce « camouflage », « qui réactualise la figure du marrane » (p. 123), est celui d’une romancière qui dès sa jeunesse russe évoque dans son journal une judéité inconnue de l’entourage antisémite dans lequel elle évolue, même si l’essentiel de ses relations de jeunesse appartient à la société juive de Moscou. Ce camouflage, cette identité, sont ici mis en relation les indignations ultérieures de la romancière sur l’antisémitisme et le destin des Juifs d’Europe tant dans ses écrits intimes que dans ses romans Le Cheval blanc (1943) et Le Rendez-vous des étrangers (1956). C’est de façon pertinente que Nelly Wolf relie le « camouflage » de l’écrivaine au refus dans les années qui ont suivi la Libération de singulariser les Juifs comme victimes spécifiques des camps, en particulier dans les discours communistes et par conséquent dans les discours des communistes et de leurs compagnons de route juifs – ce qu’était Elsa Triolet. Je contesterai personnellement – même si ce point est tout à fait secondaire – l’affirmation d’une « obéissance volontaire » (p. 144) de la part d’Elsa Triolet à l’idéologie communiste en 1956, qui semble peu conforme à ce qu’on sait de la romancière. Mais il est vrai que cette volonté communiste de l’époque de fondre la question juive dans la multiplicité des crimes nazis était assez répandue même chez les Français juifs pour qu’on la retrouve jusque dans les années 1960 dans les paroles de « Nuit et brouillard » (1963) de Jean Ferrat (Tenenbaum), compagnon de route du Parti communiste. Était aussi vrai le désir de porter face aux crimes nazis non pas une réponse identitaire mais une réponse universelle : cette position a longtemps été défendue par le journaliste communiste André Wurmser, l’auteur de L’Éternel, les Juifs et moi (1972)[2]. Autre point secondaire : l’absence de mention par Nelly Wolf, lorsque la question du sionisme est abordée dans Le Rendez-vous des étrangers, de sa condamnation répétée en écho par les deux interlocutrices Olga et Élisabeth : « Et exterminer les malheureux Arabes[3]… ». Hormis ces deux points secondaires, l’analyse détaillée du parcours personnel et littéraire d’Elsa Triolet est documentée et passionnante, et confirme bien le mutisme de la romancière sur sa judéité en dehors de quelques écrits intimes. Reste que dans de telles conditions l’on peut s’interroger, comme cela a été le cas plus haut pour Les Choses de Perec, sur la pertinence de la présence d’Elsa Triolet dans une étude sur la littérature juive française, en particulier sur sa présence dans le titre même de cette étude, associée à celle de Romain Gary. C’est ici, encore une fois, la question de la frontière de ce sous-genre littéraire qui est posée.
Cet ouvrage n’est pas seulement remarquable par son éclectisme et sa précision documentaires ainsi que par la finesse de certaines études. Il l’est tant par les réflexions de poétique qu’il ouvre que par les discussions qu’il suscite – j’ai déjà commencé – qui en font une véritable thèse. Le seul regret de la lecture passionnée qui a été la mienne porte sur un point éditorial : l’index final ne comporte pas les noms des auteurs critiques extérieurs au corpus et n’englobe pas une bibliographie pourtant riche de quinze pages. Je formule le souhait, certain d’être rejoint sur ce point par d’autres, que les prochaines éditions reviennent sur ce choix.
Hervé Bismuth
[1] Traduit du russe par Léon Robel et publié par Gallimard en 1976.
[2] En particulier à l’occasion d’un entretien que nous avions eu autour de son livre en 1975.
[3] Elsa Triolet, Le Rendez-vous des étrangers (1956), rééd. 1967, Œuvres romanesques croisées tome 28, Robert Laffont, 1967, p. 153.

