Marianne Delranc-Gaudric et Josette Pintueles, « Entretien avec Nicolas Devers-Dreyfus, 11 juillet 2012 »
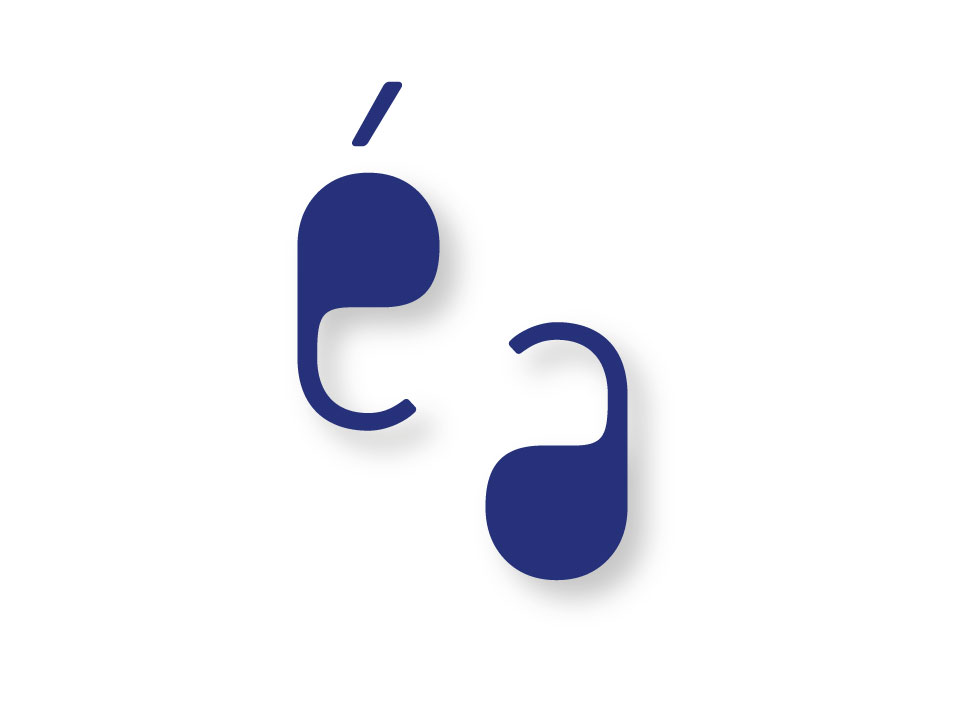
Pour télécharger ce document en format pdf
Nicolas Devers-Dreyfus a fréquenté Aragon, d’abord en tant que jeune militant et responsable communiste, puis dans ses différentes fonctions éditoriales : de 1971 à 1974, aux Éditeurs Français Réunis, auprès de Madeleine Braun, en tant que chef de fabrication notamment ; à partir de 1980, il a été directeur général adjoint des éditions Messidor.
Entretien avec Nicolas Devers-Dreyfus, 11 juillet 2012
Josette PINTUELES et Marianne DELRANC GAUDRIC, Paris
Marianne Delranc Gaudric: Comment as-tu connu Aragon ?
Nicolas Devers-Dreyfus: Mettons à part la lecture de ses œuvres, commencée trop jeune, comme celle de beaucoup d’auteurs, découverts prématurément à l’adolescence. La Semaine sainte (1958) m’avait fait une forte impression, tout comme la poésie de la Résistance. Puis, la lecture des Communistes, succédant à celle du cycle des Thibault de Roger Martin du Gard et des grands romans de Malraux, a certainement contribué à la formation d’une conscience politique, plus que les brochures d’éducation de l’époque.
À quinze ans, en octobre 1961, j’ai adhéré à la Jeunesse Communiste puis au Parti communiste dans le quartier de Paris où j’habitais, c’est-à-dire le quartier Bac, rue de Verneuil dans le septième arrondissement.
D’un côté des Invalides, le quartier Bac et de l’autre, le quartier Cler. Aragon habitait rue de Varenne, je faisais partie de la cellule voisine de la sienne.
Participant au comité de section Bac dès 1962, je militais aux côtés de mon amie et cousine par alliance Madeleine Braun. Nous étions donc tous voisins. Deux fils me rattachent à Aragon : le premier fil est militant puisque, après l’activité à la Jeunesse communiste, je suis devenu secrétaire du VIIe arrondissement ; alors, j’ai continué de rencontrer Aragon en participant aux réunions de sa cellule, la cellule Sevens. Quelques camarades de l’époque habitent toujours le quartier.
À ma grande honte, nous étions au milieu des années soixante un groupe de jeunes fort irrespectueux. Avouons que, pour un jeune biberonné au marxisme comme à la lecture des Temps modernes, il y avait deux couples qui agaçaient, présentés comme trop emblématiques, le couple « Simone de Bavoir/Jean-Sol-Partre », comme le pastichait leur ami Boris Vian, et le couple Aragon/Elsa Triolet… Simone et Elsa, dont nous ignorions la vie fort libre qu’elles avaient menée, et dont on mésestimait l’immensité des œuvres et la qualité des parcours de vie, avaient toutes deux une austère coiffure, ramenant les cheveux en natte sur la tête.
On nous les présentait comme des couples christiques, admirables dans leur vie comme dans leurs œuvres. Nous avions du mal à révérer ces figures de légende, saintes bien que laïques. À quinze ou vingt ans, dans ces années, c’était un peu exaspérant !
D’autre part, la révérence autour d’Aragon, l’admiration qu’on lui portait, tout à fait justifiée, faisait qu’à la cellule Sevens, à chaque remise de cartes, il y avait ceux qui faisaient des gâteaux, et Aragon qui signait ses livres, dans notre vieux local de la rue Amélie. J’avais pour principe de ne solliciter aucune dédicace d’Aragon ; je n’en possède aucune ; la démarche me paraissait désagréable. Voilà : ce sont des trucs de gamin.
Hormis ces caprices de jeunesse, sur plus d’une dizaine d’années, j’ai milité en vraie convivialité avec Aragon, dans ce quartier du centre de Paris. Admiration et respect n’ont fait que s’affirmer à l’âge adulte.
L’interlocuteur d’Aragon était principalement Roland Leroy, alors responsable à la culture (Roland a déposé sa correspondance aux Archives ; j’en ai consulté certains dossiers). D’autres dirigeants étaient également proches de lui, après la mort de Maurice Thorez en juillet 1964.
Sur le plan local, Madeleine Braun et son mari Jean Braun tenaient ce rôle, veillant amicalement à ce qu’on n’embête pas le grand homme de façon déraisonnable.
Aragon répondait avec beaucoup de gentillesse aux sollicitations venues des militants du VIIe arrondissement, un arrondissement intellectuel, que ce soit par la composition des cellules locales ou celles des cellules d’entreprises, qui comptaient nombre de hauts fonctionnaires.
MDG : Et que faisait-il au plan local, par exemple ?
NDD : Il était déjà âgé, mais ne refusait jamais son concours pour une vente signature de livres, payait très régulièrement ses timbres, ses vignettes de la Fête de L’Humanité ; il participait très régulièrement aux réunions de cellule lorsqu’il était à Paris. Il était là, il était présent. Il était un membre actif du Comité Central mais également « à la base », avec sérieux et bonne humeur; parce que, en même temps, la cellule Sevens était une cellule du centre de Paris où régnait une ambiance amicale, animée par Madeleine et Jean Braun, avec un architecte, avec de jeunes universitaires, le cuisinier de l’ambassade de Suisse, de la rue de Grenelle… On se réunissait en général chez Madeleine et Jean Braun, rue de Martignac, au-dessus des d’Estienne d’Orves, dans un appartement très, très vaste.
Le deuxième fil, c’est que j’ai choisi de travailler dans l’édition, d’abord chez Fernand Hazan en 1967 – 1968.
Un temps, on m’a demandé de m’occuper de Loisirs et Vacances de la Jeunesse, et lorsque j’ai souhaité revenir dans l’édition, Madeleine Braun, m’a proposé de rejoindre les ÉFR, en septembre 1971. Or, le président des Éditeurs Français Réunis, c’était Aragon, Madeleine Braun en étant la directrice générale.
Aragon avait des discussions d’orientation avec elle, mais surtout inspirait le domaine poétique et le domaine soviétique, en coordination avec la collection qu’il dirigeait chez Gallimard ; ce qui permettait, selon l’opportunité, que tel ou tel roman qui arrivait d’Union Soviétique, soit publié chez l’un ou l’autre ; cela se faisait en bonne entente. D’ailleurs les traductrices étaient les mêmes ; je me souviens bien, par exemple, de Lily Denis. Tout cela était arbitré par Gallimard et les ÉFR, selon l’opportunité et l’équilibre entre les deux et Aragon pilotant les deux aussi… Il y avait ce commerce vers le monde intellectuel soviétique, avec des phases d’ouverture et de fermeture.
Voilà comment j’ai très modestement connu Aragon par les ÉFR, où il venait très souvent, de façon amicale.
MDG : Vers quelle année ?
NDD : De 1971 à 1974 puisque, après les élections présidentielles, je suis parti habiter dans les Pyrénées-Orientales; donc, c’est très clair : du 15 septembre 1971 à juillet 1974. Et Aragon, je l’ai fréquenté, en tant que jeune militant communiste, de 1962 à juillet 1974 ; après, j’étais loin, et la deuxième époque, malheureusement, ce sont les dernières années d’Aragon.
Les éditions communistes et progressistes ont traversé une grave crise économique, qui a éclaté à la fin des années soixante-dix. Dans le même temps qu’on a recherché les moyens de résorber des pertes abyssales, décision a été prise de concentrer les différentes maisons d’édition, les trop nombreuses structures de distribution et de diffusion dans un groupe d’édition, avec une gouvernance économique et commerciale unique. Cela a sans doute eu des inconvénients quant à la créativité des différentes structures devenues en fait des départements éditoriaux, mais a eu l’avantage de sauver une activité éditoriale à la veille de la faillite, de permettre une économie contrôlée, une politique de développement militante et commerciale cohérente, dynamique, pour ce qui allait devenir le dixième groupe d’édition en France.
Seules les Éditions du Cercle d’Art, dirigées par Charles Feld, avaient choisi de continuer sur le chemin de l’indépendance. Philippe Monsel, aux commandes depuis trente ans, a magnifiquement réussi à pérenniser l’activité en traversant toutes les tempêtes et les bouleversements de l’édition d’art.
C’est dans ce contexte que je suis revenu à Paris à la fin de l’été 1980, à la demande de Claude Compeyron, pour participer à la direction du nouveau groupe d’édition qui était en train d’être constitué sous sa responsabilité, et sous celle, économique, de Lucette Thomazo.
Je n’avais pas cessé, bien qu’étant dans les Pyrénées-Orientales, de rester en contact avec le dispositif d’édition, d’une part vu ma grande amitié avec Madeleine et la petite équipe des ÉFR, et d’autre part ma proximité avec les responsables des autres éditeurs amis, également avec les dirigeants du CDLP (Centre de Diffusion du Livre et de la Presse). Le PDG du CDLP, Christian Échard, avait été auparavant secrétaire général du Mouvement de la Jeunesse Communiste lorsque je fréquentais la rue Humblot, siège du Mouvement.
Depuis Perpignan, j’avais par goût continué une petite activité éditoriale avec d’autres éditeurs. Donc, en septembre 1980, j’ai rejoint Messidor, qui s’appelait encore la SOGEDIL. Après quoi, j’en suis devenu un des deux directeurs généraux adjoints deux ans plus tard. J’animais, entre autres, avec ce qu’on nommait depuis les années cinquante, et le rôle éminent qu’y avait joué Elsa Triolet, « la Bataille du livre », le petit secteur éditorial des beaux livres et des livres « de commande », et la responsabilité des structures de distribution et de diffusion.
Pour mémoire, celles-ci comportaient la gestion des stocks et la distribution assurée par la SODIS, filiale de Gallimard, le pilotage du réseau de la trentaine de Librairie de la Renaissance, la gestion et le développement des ventes militantes avec deux clubs de ventes directes, le Livre politique d’aujourd’hui et l’Abonnement lecture CGT, un réseau de représentants dans les collectivités et un autre dans les grandes librairies. Après le départ d’Alain Leroy, directeur du Livre-Club-Diderot (LCD) qui vendait L’Œuvre Poétique, ce département particulier de vente par courtage avec sa centaine de représentants a également intégré la direction de la diffusion.
MDG : Pour revenir aux premières années, côtoyais-tu Aragon uniquement au Parti, ou bien allais-tu le voir ?
NDD : Non, je n’avais pas de raison d’aller chez Aragon, rue de Varenne… Peut-être y suis-je passé deux ou trois fois pour des raisons factuelles. Je côtoyais Aragon au Parti et puis à partir de 1971, aux ÉFR.
MDG : Avais-tu des conversations avec lui, par exemple sur sa façon d’écrire?
NDD : Oui. Si l’on résume, ces conversations sont de trois ordres. Le premier, d’ordre éditorial : Aragon ne demandait rien pour lui aux ÉFR ; l’essentiel d’Aragon était publié chez Gallimard. Mais il est arrivé deux choses : le prix Nobel de Neruda, alors que je venais d’arriver, et j’étais dans une difficulté extrême, parce qu’en tant que chef de fabrication, il fallait multiplier par dix tous les tirages, et quand on arrive et qu’on ne connaît pas les imprimeurs, et qu’il faut que tout soit sorti très vite … Nous sommes allés voir Pablo Neruda avec Madeleine Braun, à l’ambassade. Et en ce qui concerne Aragon, c’était pour Jean Ristat ; on a publié L’Entrée dans la Baie et la prise de la ville de Rio de Janeiro ; là, il y a eu les épreuves : celui qui était derrière mon épaule, c’était Aragon et non Jean Ristat. Il m’expliquait: « Petit, voilà comment on doit placer un rejet… » Il m’a appris la conception aragonienne du rejet ; après, nous avons réalisé un « tirage de tête » avec une gravure de Masson.
MDG : Peux-tu préciser cette conception « aragonienne » du rejet ?
NDD : Tu n’as pas une « Petite sirène » ? J’aurais dû les apporter… (MDG apporte quelques livres de la collection) Voilà… On va prendre un Aragon ; ça, c’est l’édition originale, orange… Dans le grand bureau de Madeleine, on se serait cru chez Coco Chanel ; on passait des heures – c’était charmant – à décider (la vie au Mercure de France chroniquée dans le Journal de Paul Léautaud, ce n’était rien à côté), avec des fous rires terribles (mais Madeleine dans le même temps prenait cela au sérieux), à choisir le nuancier, le grain de la toile de la reliure, car ils n’ont pas tous le même grain… Il y avait des grains encore plus gros, que j’aime beaucoup… Tiens, celui-ci, du recueil de Marc Delouze, ce n’est pas le même grain… Il y avait le choix du grain et de la nuance. Et la couleur. Ce n’est pas de l’encre, c’est de la pâte. On pouvait y passer des journées. Plus que pour un tailleur de grand couturier.
Concernant le rejet, regarde : le décalage est à gauche ; pas à droite. Tout le monde ne fait pas comme ça. Traditionnellement, on le met à droite. Je me souviens de ça et de l’édition de l’Électre d’Antoine Vitez. Deuxième problème : pour ce qu’on appelle l’édition de tête, il y avait une gravure d’André Masson, qui vivait encore, grand papier, et lui voulait du papier de Chine ; mais à Paris, on pouvait trouver du papier du Japon, mais je n’ai jamais trouvé le moindre papier de Chine chez les papetiers, notamment les fournisseurs des éditions pour bibliophiles. J’ai fait tout Paris, tous les papetiers, tous les importateurs de papier pour les éditions de luxe… Il n’y avait décidément pas, fin 1971, de papier de Chine sur la place de Paris. On a pris, finalement du vélin d’Arches pour l’intérieur et du vélin de cuve comme pour les couvertures. Ensuite, Madeleine, par souci d’économie, a ré-imposé l’impression de la Petite Sirène sur grand papier sans qu’on puisse faire une recomposition typographique, et j’en étais très déçu. Parce que quand même, imprimer sur un coûteux vélin, adjoindre une gravure signée de Masson, tout cela pour arriver à avoir une typo… C’était l’époque de transition de la typo vers l’offset (il vérifie le nom de l’imprimeur). Labadie, je pense que c’était encore en typo – je trouvais que c’était une faute de réimposer une composition aussi commune sur un aussi beau papier.
Quant aux discussions principales avec Aragon, ce dont je me souviens, et je n’en suis pas fier, c’est en réunion de cellule d’avoir contrarié un développement, certes infini, sur l’avant-garde en littérature, parce qu’il fallait vraiment parler de la vente de la vignette de la Fête de L’Humanité ! J’en ai honte, mais, au bout d’un quart d’heure, je lui coupais aimablement la parole pour en revenir aux « tâches » à accomplir.
La deuxième discussion dont je me souviens, c’est de ne pas avoir compris la pertinence de l’opinion qu’il défendait quant au Programme Commun de Gouvernement au moment où il s’est conclu.
Lors de cet échange (et j’étais très respectueux d’Aragon, il ne faut pas exagérer dans l’autre sens), il a parlé avec moi, c’est-à-dire avec son secrétaire d’arrondissement — j’avais alors vingt-deux ou vingt-trois ans —, de cette stratégie d’union à laquelle il adhérait tout à fait, mais cet encagement dans un texte, avec tout ce que cela pouvait avoir de dérive de sommet et de dérive forcément planificatrice, tout cela ne lui paraissait pas de bon augure.
Aragon ne plaidait pas pour une stratégie alternative : il essayait seulement de m’expliquer que nous étions trop cartésiens et pas assez politiques au sens fondamental, que la mobilisation autour d’un programme fort détaillé, couché sur le papier, c’était une stratégie assez peu réaliste. Je me souviens qu’à l’époque, il se portait fréquemment critique implicite sur les affaires du Chili, où il n’y avait pas de programme de ce genre. Il se disait parfois, que peut-être si les masses avaient à disposition des éléments programmatiques partagés sur lesquels s’unir et lutter, plutôt que d’avoir à inventer à chaque moment de lutte les objectifs à atteindre, cela favoriserait les succès. C’était évidemment inexact. Le problème du rapport des forces ne dépendait pas uniquement de l’affichage des objectifs, voire de leur planification…
Cette contradiction a été résolue sur le plan intellectuel quelque temps après par les réflexions sur la « cohérence des seuils », développées par Félix Damette, dirigeant politique et géographe quelque peu oublié de nos jours. La question demeure entière : jusqu’où, dans une société complexe doit-on fixer des objectifs pour permettre la mise en mouvement ?
La stratégie du Programme Commun n’était pas ridicule. Les communistes à l’époque ne pensaient pas que tout se déciderait au sommet par une sorte de démocratie de délégation. Non, ils faisaient ce qu’ils pouvaient pour susciter l’intervention populaire, à la fois moteur et garante des changements.
C’était plutôt une certaine conception de l’économie, qui allait moins vite qu’aujourd’hui dans ses transformations, incontestablement ; mais cette conception où tout doit être écrit jusqu’à la dernière ligne, c’est le contraire du mouvement de la vie, de l’évolution du mode de production, des rapports sociaux… Cela, Aragon, le voyait très bien. Et moi, beaucoup moins. J’ai écouté Aragon, sans appréhender la profondeur de ses remarques.
C’était une période, les années 73-74, où tout le monde était très optimiste et, en effet, le Programme Commun a permis à la gauche d’avancer et de devenir majoritaire dans le pays, mais en même temps, Aragon voyait tout à fait les limites de l’exercice, les insuffisances théoriques. Je ne crois pas qu’il ait écrit quelque texte à ce sujet. Peut-être aussi ressentait-il avant tous le retournement de conjoncture idéologique qui allait se produire avec la dégénérescence d’un système socialiste qui pourtant paraissait en phase ascendante, du Vietnam au Chili.
MDG : Mais il parle de l’Histoire dans beaucoup de ses romans et d’une forme de hasard qui intervient, de ce que les choses ne se déroulent pas comme prévu ; je pense, en ce sens, aux Beaux Quartiers par exemple… L’as-tu entendu évoquer, de ce point de vue, l’Union soviétique ou la Tchécoslovaquie ?
NDD : Cette discussion m’avait beaucoup frappé à l’époque. Ensuite, on ne parlait jamais de sa relation à la régression soviétique : je pense qu’il en parlait avec Madeleine, mais il ne nous en disait rien ; il ne voulait pas « désespérer Billancourt ». Je dis « nous » car il y avait également Pierre Gamarra, Pierre Abraham, Charles Dobzynski et Rouben Melik. On parlait de tout très librement. Rouben et moi partagions le même bureau; on faisait vie commune pendant toute cette période et nous sommes restés très amis après ; dans le bureau à côté, il y avait Dobzynski et Gamarra. Une conversation avec Aragon n’était pas une conversation en tête-à-tête ; ce n’était pas vis-à-vis de moi seul, mais de ce petit collectif, qu’il ne disait rien ; mais je sais qu’il était absolument désespéré, comme l’était Madeleine Braun. Je garde le souvenir des conversations au téléphone de Madeleine avec Lili Brik, qui paraissaient fort tristes. J’étais très lié à Madeleine, donc elle me disait d’autres choses ; elle ne se gênait pas avec moi ; c’était la famille. Et j’ai bien vu qu’à partir d’un moment, après la désillusion des années Khrouchtchev et de la suite, elle ne croyait plus vraiment à la possibilité pour le régime soviétique de s’amender.
Auparavant, il y avait eu en 1966, un vrai coup de tonnerre : l’article d’Aragon dénonçant le procès fait à Siniavski et à Daniel.
En vérité, pour que le réquisitoire d’Aragon sur un sujet aussi sensible figure en encadré à la Une de L’Humanité, il avait bien fallu que ce fût décidé par le directeur du journal, à l’époque Étienne Fajon, avec l’accord de Waldeck Rochet, secrétaire général du Parti. J’avais vingt-et-un ans, au service militaire à ce moment-là… Je me rappelle bien l’événement et le débat qui s’en est suivi.
Puis, après mai 68, j’ai passé tout l’été en Tchécoslovaquie. Participant à la direction des séjours organisés par Loisirs et Vacances de la Jeunesse, j’avais demandé à partir en Tchécoslovaquie plutôt qu’à Cuba, parce que fin juin, à l’examen des réactions face au Printemps de Prague, je croyais fatale une intervention soviétique et désirais observer les événements. Nous éprouvions une vive sympathie pour le « socialisme à visage humain » proposé lors du Printemps de Prague. Un concept qui faisait écho a nos propres aspirations d’un socialisme démocratique pour la France, et de plus laissait espérer une évolution positive des pays de l’Est européen, dont nous regardions les réalités avec une inquiétude plus ou moins consciente.
MDG : Je me souviens qu’Aragon avait menacé de se suicider si le parti français ne condamnait pas l’intervention soviétique…
NDD : Oui, je ne l’ai pas vécu puisque j’étais à Prague. À Prague, nous attendions ce qu’allait dire le Parti ; prêt à faire le dernier carré, comme douze ans auparavant pour la Hongrie, ou bien, ce qui nous a soulagés, que cela se passe autrement. L’ambiance était tellement étrange en Tchécoslovaquie, qu’on ne savait que penser ; le « printemps de Prague » était une ouverture extraordinaire, mais à la brutalité annoncée de Brejnev et des pays du Pacte de Varsovie, à la gravité des nuages qui s’amoncelaient répondait une sorte de légèreté de l’équipe Dubček.
Je lisais un peu le russe… Je ne sais pourquoi aucune mise en garde n’a été donnée à la population quant au danger qui menaçait. Il y avait pourtant de gigantesques manœuvres militaires au-dedans et autour du pays, le départ vers l’URSS, les uns après les autres, de Bilak, d’Indra et des dirigeants néo-staliniens ; pléthore de déclarations menaçantes !
Lorsque nous avons pris connaissance des termes du communiqué de Cierna nad Tisou[[Ville frontière entre la Slovaquie et l’URSS où eut lieu une négociation fin juillet 1968 entre les gouvernements tchèque et soviétique.]], j’ai dit : ils vont intervenir. Or, dans la presse tchécoslovaque, jamais le gouvernement Dubček n’a mis en garde en déclarant: nous sommes menacés par une intervention, nous refusons cette intervention. Le tiers du Bureau Politique tchèque était déjà passé avec les futurs occupants, en URSS, mais personne ne disait rien.
Quand, vers le début de septembre, je suis revenu à Paris, le Parti était très divisé, n’est-ce pas ? Il faut dire la vérité : deux tiers contre l’intervention, dont je faisais partie, et un tiers pour, exprimé par Jeannette Vermeersch etc.… Profondément, dans le Parti, c’était la première fois qu’il y avait condamnation de la politique soviétique.
Le Parti a maintenu cette distance critique jusqu’à la mort de Jean Kanapa, en septembre 1978. En témoignent les lettres de protestation du Comité Central du PCUS adressées à plusieurs reprises à la direction du Parti français de 1971 à 1977. Elles concernent aussi bien les conceptions de la démocratie, les affaires internationales, la politique intérieure française, la force de frappe.
Aragon, écrivain passeur de culture, membre du comité central, était plus que concerné par l’évolution tumultueuse de ces relations.
MDG : Quand Madeleine Braun et Lili Brik se parlaient au téléphone, était-il question d’antisémitisme ?
NDD : Je ne le crois pas, sans en être certain. On savait que ça existait, mais on a peut-être cru qu’avec Khrouchtchev les choses allaient changer … Jusqu’en 1965, 1966… Les déclarations de Khrouchtchev sur la culture n’étaient pas une merveille, si vous vous en souvenez, mais bon ; après, sous Brejnev, c’était le désespoir ; on continuait à soutenir, et Madeleine soutenait, la position internationaliste de l’URSS vis-à-vis de la Guerre du Vietnam ; mais sur le reste, il y avait plus que des craintes : une morne constatation que l’on était reparti sur un triste chemin. Si bien que les ÉFR publiaient Aïtmatov[[Tchinguiz Aïtmatov (1928-2008), écrivain kirghiz, auteur de Djamilia (1958), dont la traduction aux ÉFR (1959) fut préfacée par Aragon, qui popularisa cet auteur en France et d’autres romans, dont Il fut un blanc navire (1970 ; ÉFR, 1971) ou Une Journée plus longue qu’un siècle (Temps Actuels, 1983) dénonçant le stalinisme.]], et les écrivains soviétiques qui décrivaient la réalité.
MDG : Et les auteurs russes, c’était donc Aragon qui proposait leur publication, mais qui les faisait connaître au départ, Lili Brik, Elsa Triolet…?
NDD : Elsa Triolet s’était éteinte en 1970. Je ne saurais répondre à cette question. Je me souviens des discussions, mais je ne savais pas comment les choix s’opéraient. Il y avait Lili Brik ; pour le domaine espagnol, c’était un très grand agent littéraire, Carmen Balseys, depuis Barcelone, à l’époque sous Franco, qui était la grande découvreuse des écrivains de langue espagnole. Elle venait aux éditions de temps en temps. Quant au domaine soviétique, il y avait Lily Denis, mais aussi la belle Irène Sokologorsky, épouse de Claude Frioux, et Léon Robel. C’était le petit monde des passeurs de la littérature soviétique.
J’ai découvert une partie de la littérature progressiste mondiale grâce aux ÉFR. J’y ai lu tout le fonds, de 1945 à nos jours. Auparavant Proust et Joyce m’étaient familiers, et quantité d’écrivains progressistes, inconnus.
MDG : Et le LCD ? L’Œuvre Poétique était en cours ?
NDD : Oui, il en était question lorsque Jean Ristat et Aragon venaient aux ÉFR. Quand Édouard Ruiz passait, il en parlait avec notre petite équipe, entre professionnels, exposant la marche du projet, avec ses succès et ses aléas.
MDG : Il y a eu des difficultés financières ; je m’en souviens…
NDD : Pour L’Œuvre Poétique, je l’ai lu dans votre thèse[[Josette Lefaure Pintueles, L’Œuvre au défi : Aragon et la constitution de L’Œuvre Poétique, thèse sous la direction de Nathalie Piégay-Gros, Université de Paris 7- Diderot, 2012.]]… Mais cela s’est produit un peu plus tard. Succédant à François Billoux, Guy Hermier était responsable de la commission des Éditions à la fin des années 70. En vérité, Jean Jérôme continuait d’exercer non un magistère intellectuel, mais un magistère économique. Il n’y avait d’ailleurs pas de magistère intellectuel. D’autant que succédant à Guy Besse, qui n’avait pas eu, paraît-il, une appétence particulière pour l’activité éditoriale, Lucien Sève avait pris la direction des Éditions Sociales. Avec sa gentillesse si attachante mais aussi sa forte personnalité, il y manifestait la belle ambition de mettre à disposition aussi bien les grands textes marxistes augmentés d’un appareil critique de qualité que les livres politiques correspondant à une période d’essor de la pensée progressiste.
Malheureusement le dispositif éditorial d’ensemble souffrait de deux maux : une dispersion des responsabilités, où la création éditoriale était coupée de la responsabilité économique et commerciale, jusqu’à générer concurrence et conflits entre les dépositaires d’une partie de la décision. Une forme d’irresponsabilité économique, sans doute pas toujours due au primat du politique, mais plus à un défaut rédhibitoire de l’organisation du « groupe ».
MDG : C’était Aragon qui décidait du contenu de L’Œuvre Poétique : or, elle ne comporte pas que des poèmes, mais aussi des articles, des textes de statut différent, voire d’autres auteurs… Et cette collection, après les Œuvres Romanesques Croisées, s’adressait à un grand public ; que peux-tu dire de cette diffusion populaire de collections d’une haute qualité ?
NDD : Je suis lecteur de L’Œuvre Poétique mais c’est une période où, jeune cadre aux ÉFR, je n’étais en aucune façon mêlé à ce type de décisions ; d’autant que les ÉFR n’étaient pas éditeurs de L’Œuvre Poétique. À l’époque, il y avait une cellule éditoriale du Livre-Club-Diderot au sein du CDLP.
Plus tard, lorsqu’ont été rassemblés les différents éditeurs et les sociétés de diffusion au sein de Messidor, la responsabilité éditoriale des grandes collections du Livre-Club-Diderot a été confiée, selon le thème, littéraire ou historique, au département éditorial de Messidor correspondant.
C’est ainsi que, quand il s’agissait d’Histoire, Claude Mazauric, le nouveau directeur des Éditions Sociales, suivait avec Michel Vovelle la réalisation de la nouvelle grande collection, précédant le bicentenaire : La Révolution Française, images et récit. Il y avait un pilote dans l’avion : c’était les Éditions Sociales pour l’Histoire. « Temps actuels » pour l’excellente Histoire de la musique de Brigitte et Jean Massin, dont on a acheté à Claude Durand, PDG de Fayard, les droits pour une édition reliée vendue exclusivement par courtage. En fonction du sujet, les éditeurs de Messidor – Claude Mazauric pour les Éditions Sociales ; Christian Échard puis Francis Combes pour Temps Actuels – étaient responsables du projet.
Mais le poids économique de ces grandes collections était tel, les investissements à mobiliser si importants, les études de marchés préalables pour valider les choix éditoriaux si obligatoires, le plein engagement des équipes de vente si nécessaire, que la décision et le suivi des opérations étaient l’affaire de toute la direction de Messidor. Nous parlons d’un temps lointain où les ventes par Internet n’existaient pas !
Depuis les années cinquante, il existait des clubs du livre, fonctionnant par une sorte d’abonnement en vente par correspondance. Le Club du livre progressiste, géré par le CDLP, était l’un d’eux, et a suscité de fort belles éditions.
Il semble bien que le concept qui a donné naissance au Livre-Club-Diderot, ait été défriché par des partenariats avec un grand éditeur extérieur : Robert Laffont.
Il y eut tout d’abord l’association d’Aragon et d’André Maurois pour Les Deux géants, histoire parallèle de l’URSS et des USA, publié entre 1962 et 1964 aux Éditions du Pont-Royal (crée en 1956 avec Cino Del Duca, filiale dictionnaires, encyclopédies et beaux livres des éditions Robert Laffont).
S’appuyant sur ce premier succès, Robert Laffont entreprit l’édition des Œuvres Romanesques Croisées d’Elsa Triolet et d’Aragon, 42 volumes, publiés jusqu’en 1974.
Ces deux collections rencontrèrent le public communiste, progressiste, via des accords passés avec le CDLP, dans une période d’essor de la pensée critique et révolutionnaire, qui, jusqu’en 1980, a porté les initiatives éditoriales. Les œuvres d’Aragon comme chroniqueur puis comme auteur ont donc été au cœur de la genèse, puis de l’aventure éditoriale du Livre-Club-Diderot.
Un concept prit donc forme à la fin des années soixante : les éditions progressistes disposaient d’un public naturel, composé de milliers d’acheteurs et de lecteurs potentiels, prêts à acquérir des collections de caractère encyclopédique, pour autant que les thématiques permettent de faire vivre, de valoriser les racines révolutionnaires, nationales et universelles de leur engagement, et de transmettre ce patrimoine à de nouvelles générations.
Sur les sujets comme les grands moments de mobilisation populaire dans l’histoire, ou les œuvres littéraires progressistes, ce public était disponible pour tout ce qui servirait l’éducation des jeunes, tout ce qui porterait témoignage des luttes sociales et plus généralement du mouvement de l’émancipation humaine.
Il était prêt à consentir l’investissement que supposait l’achat de collections coûteuses à l’aide d’un système de crédit, parce que celles-ci, bien en vue dans la maison, « faisaient patrimoine », affirmaient tout à la fois engagement dans le récit collectif du combat émancipateur et acheteur de beaux livres, investissement d’un bien culturel. Dans des limites raisonnables, le prix n’était pas l’élément déterminant. La fierté de posséder une belle collection, tant par son contenu que par sa forme, primait.
Le LCD était né et furent mises en chantier de grandes collections dont la qualité des textes et la riche iconographie font encore référence : La Résistance, chronique d’Alain Guérin, best-seller avec plus de 80 000 collections vendues ; la Grande histoire de la Commune et Guerre et révolutions en Espagne, de Georges Soria ; l’Histoire de la France contemporaine et l’Histoire Littéraire de la France ; La Révolution française, images et récit, L’Œuvre Poétique d’Aragon. Plus de 17 000 collections de L’Œuvre Poétique ont été diffusées, ce qui est considérable.
Bien sûr, pour atteindre les « prospects », cela appelait un travail efficace, permanent, sur les fichiers des organisations communistes et du « mouvement démocratique », au plus près du local, dans les quartiers et les villages par les représentants du LCD, ce qui avait quelque chose de déplaisant.
Dans le monde de l’édition, l’économie d’une activité de vente par courtage, c’est à dire via une force de vente visitant les clients potentiels, les « prospects », au porte à porte, était très particulière : le cycle long de gros investissements éditoriaux, comparable à celui de la publication des grandes encyclopédies et des dictionnaires ; la politique de « produits » et la gamme nécessaire pour rémunérer et faire vivre le réseau par de nouvelles offres aux clients fidélisés ; la gestion d’un réseau d’une centaine de représentants, d’un système de rémunération motivant, des frais de déplacement, d’un encadrement calculé au plus juste ; les études de marché en amont… Bref, en matière de supposés profits, la roche Tarpéienne était proche du Capitole ; les erreurs de gestion et management se sont payées très chers lors de la crise de la fin des années soixante-dix.
MDG : Peux-tu nous en dire plus sur Aragon en 1968 ?
NDD : Tu as vécu cette période aux premières loges comme moi… Aragon, homme courageux, acceptait de se faire un peu maltraiter, si cela devait lui permettre de parler avec la faction de la jeunesse en révolte ; quitte à ne pas être entendu par les jeunes « gauchistes ».
MDG : Tu étais encore dans le VIIe ?
NDD : Oui, j’étais certes un militant du VIIe arrondissement, mais mon activité principale s’exerçait à la Jeunesse Communiste. À partir de 1969, j’ai quitté graduellement la JC pour devenir en 1971 le secrétaire d’arrondissement du VIIe.
MDG : Je me souviens que les étudiants communistes n’étaient pas contents qu’Aragon aille apporter une sorte de caution à ceux qu’ils considéraient comme gauchistes…
NDD : Cela peut se comprendre dans un moment de dure confrontation politique. Aujourd’hui, je trouve qu’il a été courageux ; quand on parcourt le contenu des Lettres françaises de l’année 68 : il a gardé un cap.
MDG : Elsa Triolet aussi.
NDD : Oui. En même temps, mai 68, ce n’est pas ce qu’on en raconte aujourd’hui ; pour avoir réalisé en 2008 une chronologie détaillée des événements et avoir conservés les textes de l’époque… Les textes sont très différents : il y a pour une part un mai 68 mythifié, tandis qu’on obère le mouvement social et politique des ouvriers, des salariés!
MDG : Que peux-tu nous dire sur la dernière période d’Aragon ?
NDD : il y avait dans la dernière période des négociations de façon à assurer à Aragon les moyens économiques de sa fin de vie, les frais de l’appartement de la rue de Varenne et du Moulin. Étaient principalement concernés Lucien Marest pour le Parti, Lucette Thomazo, directrice générale des Éditions Messidor, et Gallimard, détenteur de nombreux droits. Jean Ristat, aux côtés d’Aragon, en a certainement le souvenir. Aragon, dans sa grande vieillesse, avait un chauffeur mis à disposition, je crois, par le Parti, et pratiquait un mode de vie un peu dispendieux. Jean Ristat en parle bien…
Sa mort est survenue le 24 décembre 1982. Nous sommes tristement allés rue de Varenne, par un froid de gueux.
C’est alors que dès janvier 1983 se sont engagées de difficiles discussions avec Jack Lang et le gouvernement, pour la préservation du patrimoine aragonien, par la création d’une fondation. Guy Hermier y a joué un grand rôle, avec Lucette Thomazo et Lucien Marest. Gallimard était évidemment de la partie. Jean Ristat, Michel Apel-Muller, Lucette Thomazo, Lucien Marest, et Jack Lang lui-même, vous informeraient de la chose avec plus de pertinence.
Antoine Gallimard, lui, n’a pris les commandes des Éditions qu’en 1988. Nous avons été, avec Lucette Thomazo, faire l’inventaire de ce qui se trouvait au Moulin à Saint-Arnoult en Yvelines, alors que ne savions pas encore si celui-ci pourrait être sauvegardé. Le bâtiment, désert, était bien triste et aussi humide et froid que le sont les moulins au mois de janvier. Si le Moulin a pu être préservé, cela n’a malheureusement pas été le cas de l’appartement de la rue de Varenne et de son décor, si émouvant pour la mémoire d’Elsa et d’Aragon. Les émissions réalisées par Raoul Sangla l’ont immortalisé, et deux expositions, l’une au musée de La Poste, l’autre au Moulin l’ont fait revivre.
La négociation avec le Gouvernement, pourtant de gauche, s’est déroulée dans un véritable rapport de force. On m’a dit que le Président, François Mitterrand, homme de grande culture, n’avait pas joué un rôle très positif dans l’affaire. Mais au final, le minimum a été accompli pour la mémoire d’Aragon et d’Elsa, et pour la situation de ses exécuteurs testamentaires.
MDG : Et selon toi, quelle est l’actualité d’Aragon ?
NDD : Voilà une question qui me dépasse quelque peu ! En premier lieu, l’œuvre dans toute sa richesse, toujours avec l’élégance incomparable du style, en vers et en prose. Grand écrivain du dernier siècle, son parcours de vie, homme engagé, courageux, homme passionné, homme lucide et parfois désespéré des avatars de la condition humaine. Au débit de l’homme, citons la malheureuse préface au numéro spécial d’Europe consacré à Lyssenko, ou certaines compromissions avec le culte de la personnalité, dont les petits esprits ne l’ont d’ailleurs pas crédité, par exemple avec l’affaire du portrait de Staline.
A contrario, une formidable indépendance d’esprit, fortifiée par le dialogue permanent avec Elsa. En témoignent d’innombrables pages des Lettres françaises. Par exemple, celles consacrées, à la une, en 1956, à l’écrivain rebelle Tibor Tardos, réfugié à Paris après la révolte de Budapest. Il fallait le faire, et dans les conditions d’un pic de guerre froide, cela va très au-delà de ce qu’on a pu nommer l’« activité de contrebande » d’Aragon, que l’on redécouvre maintenant!
Au-delà du sens politique donné à la publication le parti pris est net : s’il faut rendre compte de la qualité de l’œuvre d’un écrivain ou d’un plasticien, on le fait, sans censure ni tabou.
Dès la première lecture, les Hors d’œuvre de L’Œuvre Poétique m’ont fait grand effet ; je n’avais pas saisi, avant de lire votre thèse[[Josette Lefaure Pintueles, op. cit.]], et avant de visiter l’exposition au Musée de la Poste, à quel point les illustrations faisaient partie de l’ensemble. C’est évident, mais il fallait le montrer… Les références savantes à tel ou tel peintre… J’avais été frappé de découvrir sur les murs rue de Varenne comme dans l’iconographie choisie par Aragon pour accompagner L’Œuvre Poétique, nombre de peintres inconnus de moi, en voisinage avec des peintres de grande notoriété. Vous montrez bien la force de la trace surréaliste dans votre recherche.
Le poète est fabuleux, bien sûr, maniant tout type de versification. Écrivain majeur de la littérature française, Aragon, tout à la fois classique et avant-gardiste, laisse également sa marque dans l’Histoire intellectuelle. Victor Hugo du vingtième siècle, il nous laisse une œuvre considérable, mais aussi l’empreinte de ses engagements pour la définition d’une politique culturelle émancipatrice, de son action inlassable de guetteur, de découvreur, de passeur de cultures.
Reste à explorer le rôle qu’ont joué Aragon et Elsa, le pont qu’ils ont représenté pour les échanges, la découverte des écrivains et des artistes du monde multiforme des républiques soviétiques.
Josette Pintueles: Et les articles qui ne sont pas encore accessibles ?
NDD : Et les correspondances ! Avec Breton, qui vient de paraître ; celle d’Elsa avec Lili Brik… J’ai du retard de lecture!
JP : Et concernant les documents sur L’Œuvre Poétique et la disparition des documents liés au LCD, comment l’expliquer ?
Aux deux moments de disparition des archives, je n’étais pas présent : lorsque le LCD quitte ses locaux du Boulevard Bourdon à la faillite du CDLP, et lors de la liquidation de Messidor, groupe dont j’avais démissionné à l’automne 1988. Après 1994, peu de monde s’est inquiété de ce que devenaient des archives tombées en possession d’un administrateur judiciaire, qui aurait sans doute fait peu de difficultés à des historiens décidés à les sauvegarder. Ce serait certainement différent aujourd’hui ; la conscience partagée de l’importance de la sauvegarde des archives de l’édition est fort récente.
Je regrette de ne pas avoir conservé plus de documents. J’ai par exemple photocopié les cahiers du personnel du CDLP avant-guerre. Tout responsable que j’étais, le service du personnel ne voyait sans doute pas d’un si bon œil mon intérêt « historique » pour ces documents, ce qui m’a dissuadé de reproduire ceux d’après 1945. En 1980, Alice Eterstein, ancienne des Éditions depuis les années trente, faisait encore la compatibilité des Librairies de la Renaissance, quasi bénévolement. Je m’en veux de ne pas avoir recueilli ses souvenirs.
Et René Hilsum ! Je suis allé l’interroger, lorsqu’il habitait un bel appartement rue de Seine. Nous avions travaillé de concert dans les années 70 : lui, âgé, dans la position quelque peu surprenante de directeur de fabrication des Éditions Sociales, alors qu’il avait été le grand éditeur surréaliste dès 1919, l’ami d’enfance d’André Breton, l’éditeur des Champs magnétiques puis le directeur du Bureau d’Éditions communiste ! Au-delà de la fonction qui importait peu, il fallait certainement y voir la passion intacte pour les livres et leur réalisation. Et moi, responsable de la fabrication aux ÉFR. Nous nous concertions parfois quant aux achats de papier, au choix des imprimeurs. J’ignorais alors l’éditeur du Sans-Pareil ! Lorsque je suis revenu à Paris dix ans plus tard, j’en savais un peu plus sur l’histoire des éditions ; mais cela restait peu connu. Tous vos travaux n’étaient pas sortis… Claude Willard, son beau-frère, a recueilli le témoignage de René Hilsum dans Les Cahiers d’Histoire : l’aventure du Sans-Pareil, Dada puis le surréalisme, le dispositif des éditions communistes dans les années trente. Il serait utile de poursuivre le travail engagé par Marie-Cécile Bouju sur les maisons d’édition du Parti communiste français de 1920 à 1968[[Marie-Cécile Bouju, Lire en communiste : les maisons d’édition du Parti communiste français 1920-1968, Presses Universitaires de Rennes, 2010.]] et la problématique qui se profile derrière tout cela.
Pour télécharger ce document en format pdf

