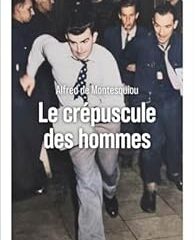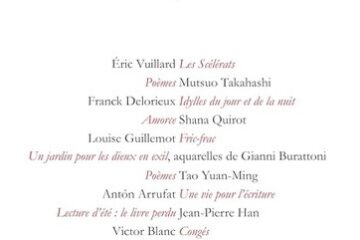Compte rendu, par Hervé Bismuth, d’André Breton le grand indésirable, d’Henri Béhar, Classiques Garnier, 2024
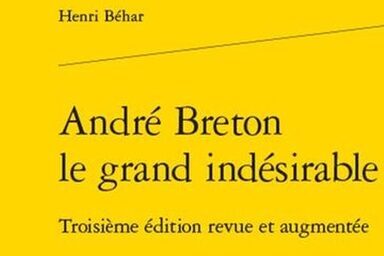
Depuis 2022, Henri Béhar réorganise ses archives en les augmentant et en les commentant, recomposition qui a donné lieu à trois anthologies de travaux divers, parcourant plus d’un demi-siècle d’articles, de préfaces, de conférences diverses1. Cette salve s’achève avec la seconde réédition2 de sa biographie d’André Breton. Cette mise à jour intègre un état des lieux et une bibliographie méthodique des ouvrages et manifestations portant sur Breton, y compris les plus récentes – état des lieux qui permet à Henri Béhar d’affirmer que si André Breton n’a jamais connu d’éclipse dans le champ des études et des manifestations littéraires, il a acquis au XXIe siècle une « notoriété nouvelle » (p. 30). Ce renouveau méritait certes qu’Henri Béhar remette une nouvelle fois son ouvrage sur le métier de biographe du grand surréaliste, en intégrant des apports récents comme la publication en 2011 des lettres d’Aragon à Breton éditées par Lionel Follet3.
L’ouvrage suit la tradition du récit biographique en retraçant le parcours d’André Breton de façon chronologique, en six « parties » (nom officiellement donné à ces six étapes), depuis ses années de jeunesse (« L’éveil à la beauté moderne ») jusqu’aux vingt dernières années allant de l’après-guerre à la mort de Breton (« Une morale effervescente, 1946-1966 »). Chacune de ces parties est découpée en deux à quatre (appelons-les) « chapitres », eux-mêmes divisés en plusieurs liasses que nous appellerons aussi bien des « sections ». Ainsi la première partie, « L’éveil à la beauté moderne », s’ouvre-t-elle avec le chapitre « Saisons (1896-1915) », qui commence par une section portant le très logique titre « Familles ». On le voit : cette biographie n’est pas seulement un récit de vie agrémenté d’un très attendu livret intérieur d’images – peintures et photographies (p. 269-88) ; c’est également un ouvrage destiné à une consultation facilitée par le triple jeu de la table des matières, d’un index des noms et d’une liste comptant pas loin d’une centaine de titres. Il est ainsi pratique, pour quiconque connaît ne serait-ce qu’un peu l’histoire de la genèse du surréalisme, de retrouver les événements cités dans les étapes qui ponctuent le temps de quelques pages, par exemple l’année 1917 : « L’année terrible » ; « Le cortège d’Apollinaire » ; « Les trois mousquetaires ».
Le récit est construit à partir d’un savoir biographique remontant au Directoire et recense le résultat de tous les travaux de recherche entrepris sur la famille Breton : ces travaux, à la charge d’André Breton lui-même, ont été vérifiés par Henri Béhar. L’aventure commence évidemment non pas à la naissance, ni à la communion de Breton, mais à partir de son amitié avec Théodore Fraenkel depuis les années de collège, amitié partagée dès le lycée avec René Hilsum. À compter de ces années, le récit met en place une narration éclairée par une fin à l’avance connue – telle est l’inévitable stratégie des biographies : mention est faite de l’incontournable jugement de l’institution scolaire sur l’adolescent, et le biographe risque déjà des rapprochements entre les sujets proposés au baccalauréat et certains aphorismes tenus dix ans plus tard par le poète. L’apparition d’Aragon dessine la perspective d’une lecture comparatiste des biographèmes respectifs établis entre les récits de vie de ces deux poètes à peu près du même âge – Breton naît en février 1896, Aragon est supposé naître en octobre 1897 –, deux amis et deux compagnons d’armes, pendant une quinzaine d’années, deux écrivains français du XXe siècle qui ont chacun été l’objet d’un grand nombre de biographies, alimentées par les récits rétroactifs de leur propre vie. Reprenons les jalons de leur parcours commun, telle que la très documentée biographie d’Henri Béhar les éclaire :
Les positions pacifistes de Breton datent de l’avant-guerre, bien avant qu’Aragon n’exprime les siennes – et l’on peut ici rêver de l’influence politique que Breton aura pu exercer sur son cadet. Breton accepte de faire des études de médecine, comme ensuite Aragon, parce que sa famille le lui demande, qu’il ne se voit pas d’autres vocations, sinon l’écriture, que pourrait d’ailleurs lui permettre le métier de médecin. Il prépare son PCN4 en 1913-14, quand Aragon le fera deux ans plus tard, en 1916-17. Ses lectures et ses coups de cœur, Mallarmé, Rimbaud, sont partagés avec Fraenkel, quand ceux d’Aragon, également grand admirateur de Rimbaud, sont a priori solitaires jusqu’à sa rencontre avec Breton, qui s’inscrit en médecine à l’automne 1914 et fera partie de la « classe 16 » quand Aragon appartiendra, lui, à la « classe 17 ». Les modalités de la rencontre sont connues : Aragon explique (« Lautréamont et nous », 1967) comment au Val-de-Grâce Breton lui rappelle qu’ils se sont déjà rencontrés dans le cabinet de lecture d’Adrienne Monnier, qui a consigné de son côté le souvenir de sa première rencontre avec chacun des deux garçons5. C’est un peu par les fréquentations de la Maison des amis des livres qu’André Breton, comme Aragon, apprend à connaître et à fréquenter ses aînés. Mais si Aragon cesse d’être un solitaire, c’est grâce à Breton qui lui présente Fraenkel, Soupault, Vaché et surtout Apollinaire, qui commandera un article sur lui-même à Breton avant de demander à Aragon un article sur ses Mamelles de Tirésias, celui dont on parle le plus en raison de la naissance dans la préface auctoriale de cette pièce d’un néologisme qui fera fortune… Aragon, lui, ne présente guère que Mallarmé à son aîné, et ce n’est pas peu, vu l’importance que prendra Mallarmé dans les premiers poèmes de Breton.
En 1918, « le groupe des trois mousquetaires » ainsi que l’appelait Valéry est enfin formé – même si l’importance acquise par deux d’entre eux dans l’histoire littéraire française laissera par la suite Soupault dans l’ombre. 1918 est également l’année des enterrements : de la Grande Guerre, de l’Europe telle qu’on la connaissait, de l’ancien monde, mais aussi d’Apollinaire et de Jacques Vaché. C’est au début de l’année suivante que Breton, enthousiaste à la lecture du Manifeste Dada 1918, contacte Tristan Tzara à Zurich – un Tzara appelé, selon Henri Béhar, « à prendre la place du frère trop tôt disparu et trop mal connu [Vaché] » (p. 105). Pendant ce temps, le trio met en place la revue Littérature (titre soufflé par Valéry), où cohabitent aussi bien les écrits des jeunes plumes que le « Cantique des colonnes » de Valéry, fier certainement de se voir ainsi reconnaître par la nouvelle génération comme étant des leurs. Aragon y tient chronique ; Gide y écrit ; on publie Isidore Ducasse, Mallarmé, Reverdy ; on publie des inédits : un d’Apollinaire et même un de Rimbaud, acheté à la famille au prix fort (« Les mains de Jeanne-Marie ») ; Éluard en fait également partie, qui entre dans le groupe des amis comme il entre à Littérature. La longue période qui commence en 1918, celle où ces jeunes gens se disent dadaïstes avant de se réclamer du surréalisme et qui s’achève à la mort de Breton, le seul d’entre eux à porter jusque dans les années 1960 le flambeau du surréalisme, est un terrain longuement labouré par Henri Béhar, grand spécialiste de dada et du surréalisme. C’est aussi la période où le jusqu’auboutisme de Breton l’amènera à annoncer qu’il « a cessé d’écrire ». Les travaux commencent avec l’écriture automatique et la publication conjointe des Champs magnétiques (1919), recueil de proses écrites à deux mains par Breton et Soupault — Soupault dont Aragon rappellera en 1968 la nécessaire présence dans la réalisation de ce projet6, texte que Béhar désigne comme « l’acte fondateur du surréalisme » (p. 117). C’est après cet ouvrage et la parution de Mont de piété, qui regroupe les poèmes de Breton parus entre 1913 et 1919, que la biographie pratique une césure pour ouvrir une nouvelle partie.
« De Dada au surréalisme » : le titre de cette période, qui couvre les événements et parutions situées entre 1919 et 1924, indique bien un trajet et non une simple succession ; Les Champs magnétiques disent assez que le surréalisme se pratiquait concurremment aux postures dada, ceci compliqué du fait que Breton « n’a pas alors totalement renoncé au modèle mallarméen (p. 123) ». Dada d’abord (1919-1922) : le récit ponctue la geste des scandales Dada et mentionne la première tentative conjointe de Breton et Aragon d’entrer au Parti socialiste, la SFIO d’avant le congrès de Tours, ainsi que l’accueil rebutant qui leur est fait alors. Simone Kahn et Denise Lévy font leur apparition la même année que le mécène Jacques Doucet et ses projets de collection littéraire. La brouille publique entre Breton et Tzara sur l’identité, voire la paternité de Dada, consacre en 1922 la séparation avec Tzara… qui reviendra dans le groupe en 1929 mais pour cinq ou six ans seulement. Entre cette date et 1924, date officielle de la création du mouvement surréaliste, appuyée sur le manifeste de Breton, s’étend une période qu’Henri Béhar nomme « Le mouvement flou » (p.165), cette période où le groupe plonge, loin des tapages, dans le silence des « sommeils » ; c’est avec eux que naissent les premiers désaccords théoriques entre Breton et Aragon, qu’Aragon résumera dans Une Vague de rêves, l’autre Manifeste de l’automne 1924, paru avant celui de Breton, que la postérité consacrera – et isolera de Poisson soluble, que pourtant « il éclaire et justifie » (p. 201), nous dit Henri Béhar. De nouvelles figures s’affirment : Péret, Desnos…
Les deux parties suivantes reproduisent, l’une à la suite de l’autre, les deux périodes correspondant aux deux manifestes du surréalisme, deux périodes définies par leur titre : « La révolution surréaliste » et « Vigilance révolutionnaire (1930-1940) ». « La révolution surréaliste » : outre d’être le nom de la revue qui parcourra les années 1924-1929, ce titre est également le propos central qui définit à présent les orientations du groupe en faisant de Breton un chef de file non seulement littéraire mais aussi politique, et qui provoquera les premières dissensions et les premiers départs. Pendant ce même mois d’octobre où les publications des deux manifestes se suivent, Anatole France meurt et des funérailles nationales sont organisées, à quoi le groupe répondra par Un cadavre, tract en deux pages et en six contributions, dont « Refus d’inhumer » d’André Breton et « Avez-vous déjà giflé un mort ? » d’Aragon. Le trio de l’après-guerre a désormais laissé la place à un nouveau « triumvirat » (p. 205) composé de Breton, Aragon et Éluard. La biographie tient chronique des relations du groupe avec la revue communiste Clarté et de son évolution de l’antimilitarisme au pacifisme, puis vers le communisme et le soviétisme. Commencent alors les exclusions : Vitrac, Artaud, Soupault… Breton lit à la fois les ouvrages communistes – dont ceux de Trotski – et ceux de Freud sans se douter des incompatibilités qui s’affirmeront plus tard. Et il poursuit, outre ses aventures amoureuses, ses relations tant amicales que marchandes avec les artistes : c’est lui qui fait acheter en 1924 par Jacques Doucet Les Demoiselles d’Avignon de Picasso, qu’il reproduit dans La Révolution surréaliste (n°4, juillet 1925) pour exemplifier son article « Le Surréalisme et la Peinture ». C’est la période de la brève liaison avec Nadja (octobre 1926), la femme du premier roman (osons le mot) d’André Breton, puis de Suzanne Muzard. Aragon, Breton, Éluard, Peret, Unik adhèrent au parti communiste ; de cette première vague ne resteront, jusqu’à leur mort, qu’Aragon et Unik. Éluard, lui, en sera exclu en 1933 et demandera à y revenir au moment de l’Occupation. En 1928, Aragon et Breton écrivent à deux mains – et dans le plus pur style hugolien – Le Trésor des jésuites qui paraîtra l’année suivante. 1929 : Trotski, exclu du PCUS puis exilé, devient un sujet de débat à l’intérieur du groupe. Breton publie son Second Manifeste du surréalisme, appel clair à une révolution marxiste violente pour laquelle le surréalisme doit s’engager, mais surtout copieuses insultes contre « tous ceux qui s’écartent de la morale surréaliste » (p. 261), politique ou esthétique : Desnos, Soupault, Vitrac, Politzer, Naville, Masson, Limbour, Delteil… La réponse est connue : parution d’Un cadavre, chapelet de pamphlets et d’injures reprenant le titre que Breton avait donné en 1924 à propos de la mort d’Anatole France, signé par Desnos, Bataille, Prévert, Queneau… Breton gagne à cette occasion le titre désormais notoire de « Pape du surréalisme », Le reste du groupe soutient fermement Breton, notamment Aragon qui adresse en retour à Desnos sous le titre « Corps, âme et biens » dans le premier numéro de Le Surréalisme au service de la révolution (SASDLR) des insultes qu’il n’osera pas rééditer dans sa – presque – exhaustive L’Œuvre poétique (1974-81) testamentaire. Ce règlement de comptes est ainsi l’occasion de remplacer la revue précédente ou, comme on voudra, de changer son nom et ses orientations7. Et d’ouvrir pour le surréalisme une nouvelle ère– qui sera presque immédiatement conflictuelle.
« Vigilance révolutionnaire (1930-1940) » : le titre de cette partie vise aussi bien la nouvelle revue SASDLR – le biographe rappelle qu’elle doit son titre à Aragon et sa direction à un Breton désormais seul à la barre – que les diverses manifestations contre la montée des fascismes en Europe. Le groupe accueille de nouveaux venus : Char, Buñuel, Ponge, Bousquet… et le premier numéro de la nouvelle revue publie le fameux télégramme rédigé par Aragon et Breton et envoyé au PCUS en réponse à un télégramme envoyé d’Union soviétique, affirmant qu’en cas de conflit entre les deux pays ils prendront leurs ordres de Moscou. Ici, le biographe pose la question de l’« illusion lyrique » (p. 292) de Breton, paradoxale à l’aune du regard critique de Breton sur les publications de L’Humanité et de sa position favorable à Trotski. Les archives des correspondances du PCF consultées par Henri Béhar n’aident pas à comprendre cet « engagement total » (p. 293). Ici, c’est aussi l’engagement sans réserve d’Aragon qu’il interroge en creux, Aragon ayant, lui aussi, participé aux discussions autour de l’éviction de Trotski. On notera que les exclusions à l’œuvre dans le groupe depuis le premier Manifeste soulèvent au bout du compte la même double question que celle de l’exclusion de Trotski, question posée également par le paradoxe de l’« illusion lyrique » des surréalistes de la revue SASDLR, celle de la fidélité sans réserve et de son ombre, la distance critique. La véritable crise commence lorsqu’il faut choisir entre surréalisme et communisme, et est initiée par Aragon. En juillet 1931 paraît « Front rouge » d’Aragon, prélude à ce qu’on appellera à la suite de Breton « l’affaire Aragon » : le poème conduit à l’inculpation d’Aragon en janvier 1932 ; Breton publie « Misère de la poésie » pour défendre le droit d’Aragon de s’exprimer en tant qu’artiste et recueille 300 signatures de soutien à un appel ; L’Humanité attaque les positions des surréalistes, éloignées, quoi qu’ils en disent, de la véritable lutte révolutionnaire et Aragon publie dans L’Humanité une mise au point dans laquelle il se désolidarise du contenu de cette brochure. La réponse en sera le pamphlet insultant Paillasse ! publié par l’Association des écrivains révolutionnaires, qui fait en outre le compte des griefs contre la solidarité soumise d’Aragon et de Georges Sadoul avec les conclusions du Congrès de Kharkov contre le groupe surréaliste l’année précédente. Breton ne figure pas au nombre des signataires de Paillasse !,mais la faille est désormais ouverte entre Breton et Aragon et la séparation est pour bientôt : SASDLR attendra même 1933 pour faire paraître simultanément ses deux derniers numéros avant de s’arrêter définitivement, numéros dont Aragon et quelques autres sont désormais absents. Le groupe n’en est pas moins admis après avoir dû patienter à l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR), et ses membres retrouvent leurs anciens amis, Aragon, Sadoul, Unik. Breton est toujours membre du Parti communiste et multiplie divergences et initiatives individuelles entreprises en qualité de dirigeant du groupe surréaliste, jusqu’à son exclusion du parti, fin 1933, avec celles d’Éluard et de Crevel. La dernière rencontre entre Aragon et Breton, qu’Aragon relatera deux fois8, a lieu le jour de l’émeute antifasciste du 9 février 1934. En même temps que le mouvement surréaliste s’internationalise, les départs se poursuivent à mesure que Breton affine et explicite tant son point de vue esthétique que son point de vue politique, notamment ce qu’il pense des rapports entre l’art et la politique : Tzara, Char, Crevel s’en vont tandis que s’affirment les divergences avec le parti communiste. En juin 1935 se tient à Paris le Congrès international des écrivains pour la défense de la culture. C’est Éluard qui lira en fin de soirée le discours de Breton privé de son droit à la parole, certainement pour avoir giflé Ilya Ehrenbourg quelques jours avant. Ce discours se perdra dans le brouhaha des auditeurs à qui on faisait quitter la salle en prétextant l’extinction imminente de l’éclairage. Quelques mois plus tard, Éluard décide de rompre avec Breton, même s’il ne mettra que trois ans – Breton ne l’y aidera pas peu – à le faire : en 1938, les derniers liens amicaux du temps des débuts du groupe n’existent plus désormais, et le mouvement surréaliste continue de se développer et de connaître une fortune internationale, mais sans ses fondateurs – à l’exception de Breton.
La partie consacrée à la période de la guerre et de l’après-guerre, « L’exode et l’exil. 1940-1946 », commence avec l’installation provisoire à Marseille avec une partie du groupe au début de l’Occupation et s’achève avec le retour de Breton en France. Entre cet exode marseillais et le retour parisien se déroule un long séjour de quelques années à New-York, avec une escapade à Montréal, où, sous la direction de Pierre Lazareff, Breton est un des speakers de La Voix de l’Amérique parle aux Français. Depuis New-York, il ne reçoit aucune nouvelle du groupe surréaliste La Main à Plume qui vit pendant ce temps l’Occupation à Paris. L’arrivée à New-York est précédée d’une escale à la Martinique, qui lui donne l’occasion de passer un mois avec Aimé Césaire. À la Libération, Breton dira qu’il a rencontré Sartre à New-York, qui lui aurait déclaré que « ses anciens amis Aragon, Éluard, Picasso tiennent le haut du pavé [et qu’]Aragon fait régner la terreur dans les lettres, et il serait périlleux d’émettre la moindre critique à son endroit ». Le biographe poursuit en épousant la parole rapportée de Breton : « les staliniens s’emparent des réseaux d’information et de distribution de la presse. Breton en déduit que son retour en Europe serait grandement prématuré » (p. 441). Cet état de fait, joint à l’invitation de Pierre Mabille pour un cycle de conférences, incite Breton à retarder son retour en France par l’étape – qui sera mouvementée – de six mois à Haïti. Lorsqu’il revient enfin en France, l’heure est à « la toute-puissance du CNE (Comité National des Écrivains) » et au règlement de comptes avec les surréalistes : « Aragon ne leur passera rien, et sans doute pas ce pamphlet qu’avec une belle inconscience Benjamin Péret a consacré au Déshonneur des poètes pour fustiger la poésie de la Résistance retombée dans les formes régressives de la litanie patriotique » (p. 456). Ici, le biographe épouse en les confondant les paroles rapportées de Breton puis de Péret – qui attaque un recueil dont pourtant plus de la moitié des poèmes sont écrits en vers libres ou en prose (Francis Ponge)9. Toujours est-il qu’Henri Béhar rappelle combien l’air du temps trouvé en France six ans plus tard est devenu étranger à un Breton dénigreur tant de l’existentialisme sartrien « à la remorque du parti communiste » (p. 457) d’après lui que des poètes adulés par la nouvelle jeunesse – dont d’anciens amis : Prévert, Queneau, Vian.
Le titre : « Une morale effervescente. 1946-1966 » clôt cette biographie, qui se passe de conclusion, par les vingt dernières années de la vie de Breton. Dès son retour, l’activité parisienne de Breton se manifeste par des conférences, des entretiens, des retrouvailles (parfois ratées : Artaud) et de nouvelles rencontres (Alain Jouffroy, Yves Bonnefoy, plus tard Joyce Mansour, future égérie des surréalistes, et peu de temps avant sa mort Georges Perros). Il organise une nouvelle exposition internationale du surréalisme, chahute une conférence de Tzara. Le renouvellement et le rajeunissement du groupe comportent à nouveau leur lot d’exclusions. Le seul ancien ami à être resté auprès de Breton est Benjamin Péret, revenu du Mexique en 1948 – il lui restera fidèle jusqu’à sa mort en 1959. Les années 1950 voient Breton devenir en quelque sorte le seul animateur et théoricien du surréalisme, en même temps qu’il en est déjà l’historien, notamment dans des entretiens radiophoniques. Il polémique avec Camus, avec Les Lettres françaises « où Aragon serine la doctrine du réalisme socialiste » (p. 495), selon le biographe ; Breton dénonce cette doctrine comme une « imposture » et, ajoute le biographe, « on sait aujourd’hui qui avait vu juste » (p. 495). En 1956, il prend publiquement parti à la fois contre le gouvernement français dans la Guerre d’Algérie, fidèle aux positions anticolonialistes exprimées dès leurs débuts par les surréalistes, et contre l’invasion de la Hongrie « au nom de la démocratie » (p. 514) ; il appelle « à la formation d’un Cercle international des intellectuels révolutionnaires, qui se donne pour mission la recherche de la vérité à l’Est comme à l’Ouest » (p. 515). Cette même année paraît la revue Le Surréalisme même qu’il dirige et qui durera jusqu’au printemps 1959 ; la revue est éditée par Jean-Jacques Pauvert, que Breton soutiendra dans le procès intenté contre l’éditeur de Sade. La rencontre, puis l’amitié avec Léo Ferré10 se soldent violemment à partir du refus de Breton en 1956 de préfacer le premier recueil poétique de Léo Ferré, Poète… vos papiers !, et son conseil au jeune poète « de ne rien publier » (p. 516), refus qui aura comme conséquence le texte « Préface », que Léo Ferré écrit et publie cette année-là avant de le populariser plus tard sur disque en 1973.
Ce récit de vie se termine sur une citation provenant d’un entretien que Breton avait eu avec Madeleine Chapsal paru dans L’Express en 1962, dans lequel il affirmait : « je n’ai pas transigé avec les trois causes que j’avais embrassées au départ et qui sont la poésie, l’amour et la liberté » (p. 538).
Cette biographie bien documentée, soignée et empathique prétend aussi tordre le cou à certains clichés, et s’en donne les moyens. Henri Béhar affirme que, malgré sa précoce et clairvoyante dénonciation du stalinisme, Breton n’était en réalité en rien trotskiste (p. 369) et le montre, tout comme il rappelle les tensions qui ont opposé les deux hommes lors de la longue visite mexicaine de Breton à Trotski. Et les regards posés sur la rivalité mais également les divergences esthétiques entre Aragon et Breton, clairement lisibles dans la lecture attentive des deux manifestes de 1924, sur l’individualisme de Breton et sur la fidélité sans partage d’Aragon à Breton, puis au communisme représenté par son parti, devraient définitivement ringardiser le cliché stupide prétendant expliquer la brouille entre les deux amis pour la raison que l’un serait plutôt « stalinien » et l’autre plutôt « trotskiste ». Autre cliché, celui consistant à opposer, dès la fin des années 1930, un « prétendu retrait [de Breton] dans une tour d’ivoire à l’engagement militant d’Aragon » (p. 379). Elle épouse en revanche, et de façon non dissimulée, les prises de parti de Breton contre les solidarités des autres artistes, au premier chef Aragon mais aussi Picasso, avec ce que l’on peut résumer sous le terme de « stalinisme », en politique comme en art.
Cette biographie enfin est un élément important dans les études aragoniennes. Pas seulement pour ce qu’elle indique des rapports amicaux et artistiques qui ont uni et désuni ces deux combattants du réel et de la poésie qu’ont été Aragon et Breton – et de ce point de vue il faudrait la compléter par les deux textes écrits par Aragon après la mort d’André Breton, à propos de Lautréamont (1967)[11] et à la suite du spectacle de Bob Wilson Le Regard du sourd (1971)[12]. L’importance de cette biographie est qu’elle rend compte, sous un autre éclairage que celui habituellement présenté par les biographies d’Aragon, du contexte dans lequel évolue le jeune Aragon et des options qu’il aura refusées.
Hervé Bismuth
PS: Le choix du compte rendu de cet ouvrage riche et exhaustif aura été de laisser de côté tant les amours de Breton que ses relations avec les artistes non-écrivains. C’est à ce prix qu’il était possible de ne pas noyer ce qui fait l’objet de ce compte rendu : son intérêt pour les études aragoniennes.
Henri BÉHAR, André Breton le grand indésirable, troisième édition revue et augmentée, Classiques Garnier, « Biographies » n° 7, août 2024, 588 pages, 35 euros.
- Ces 3 ouvrages ont été recensés sur le site de l’ERITA et dans la revue Textes et contextes. On consultera :
* Henri Béhar, Essai d’analyse culturelle des textes (2022): https://preo.ube.fr/textesetcontextes/index.php?id=4672 ;
* Henri Béhar, Histoire des faits littéraires (2023) : https://preo.ube.fr/textesetcontextes/index.php?id=5124
* Henri Béhar, Lumières sur Maldoror (2023) : https://louisaragon-elsatriolet.fr/2023/12/16/compte-rendu-par-herve-bismuth-de-lumieres-sur-maldorordhenri-behar/ ↩︎ - Éditions précédentes :1990, 2005. ↩︎
- Aragon, Lettres à André Breton 1918-1931, édition établie, présentée et annotée par Lionel Follet, Gallimard, « NRF », 2011. ↩︎
- Le PCN est le Certificat d’Études Physiques, Chimiques et Naturelles, préalable obligé aux études de médecine. ↩︎
- Voir Adrienne Monnier, Rue de l’Odéon, Albin Michel, 1960. ↩︎
- Aragon, « L’Homme coupé en deux », Les Lettres françaises, no 1233 du 9 mai 1968, rééd. in Aragon, Essais littéraires, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2025, p. 1463-88. ↩︎
- Quarante ans plus tard, Aragon affirmera qu’André Breton a décidé de changer le titre de la revue « au lendemain de la mort de Maïakovski », voir Aragon, « Maïakovski et ce qui s’en suivit », L’Œuvre poétique, Livre Club Diderot, rééd. Messidor, 1989, tome 2, p. 458. ↩︎
- Une première fois dans France nouvelle du 10 septembre 1973, voir Pierre Daix, Aragon. Une vie à changer, Seuil 1975, p. 276-77 ; une seconde fois dans L’Œuvre poétique, rééd. 1989, tome II, p. 823-24. ↩︎
- Voir Hervé Bismuth, « L’Honneur des poètes » in N. Piégay et J. Pintueles dir.,Dictionnaire Aragon, Champion 2019. ↩︎
- Étrangement absent de l’index final. ↩︎