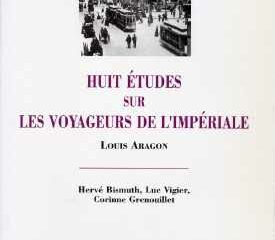Luc Vigier, « L’écriture de la nausée dans Les Voyageurs de l’impériale », 2002

Luc Vigier
L’Ecriture de la nausée
dans les Voyageurs de l’impériale
de Louis Aragon
Ou le ventre mou de l’individualisme
Journées d’étude de l’Université de Poitiers
1er et 2 février 2002
Mise en bouche (1) : contexte éditorial
Il est toujours très délicat de s’avancer sur le terrain intertextuel aragonien et encore plus délicat sans doute d’y pénétrer avec Sartre dans ses bagages. Disons que je ne m’y avance pas seul. Daniel Bougnoux, dans un article du Monde de 1997 avait tenté un parallèle intellectuel rapide et général entre les deux auteurs, sans évoquer particulièrement Les Voyageurs. Plus récemment, Philippe Forest, dans son analyse de la place de John Law dans les Voyageurs ( Annales n°3, 2001) rappelle quelques traits communs à La Nausée et aux Voyageurs, tout en écartant l’hypothèse d’une superposition ou d’une reprise. Il me semble qu’on peut aller plus loin, justement parce qu’il est possible qu’Aragon fasse un certain nombre d’efforts pour que son exploration – jusqu’aux extrêmes- de l’individualisme ne coïncide surtout pas avec ce que Sartre fait de la quête existentielle de Roquentin, justement parce que l’individualisme chez Aragon se développe dans une atmosphère nauséeuse comparable et qu’elle poursuit simultanément une logique démonstrative diamétralement opposée : l’individu ne peut pas devenir, dans Les Voyageurs de l’impériale une porte d’accès à la plénitude molle de « l’existant », une sorte de portail vers la dilution transitoire de la conscience, récoltant à ce titre une sorte de « positivité » démonstrative. Le passage de l’autre côté des choses s’effectue chez Aragon au prix de l’épreuve du réel (Pascal) ou de la folie ( Dora). Cette disjonction des deux œuvres, précisément autour de la figure fortement politisée de l’individu, comme une attraction commune pour les perceptions flottantes du réel, suffisent à mes yeux à justifier cette brève suggestion d’une piste de lecture qui, à défaut de révéler la présence de x dans y, permettra d’apercevoir l’intérêt d’une étude de la « nausée » aragonienne.
Quelques éléments permettent tout d’abord d’établir la proximité éditoriale des deux romans. La Nausée de Sartre paraît, avec le succès que l’on sait, en avril 1938 chez Gallimard, après huit années de travail, dont la dernière passée sous la férule de Brice Parrain et de Jean Paulhan, par ailleurs en contact régulier avec Aragon et Elsa Triolet à partir de 1939, justement à propos des Voyageurs. Quand Paulhan aide Aragon, il sort donc à peine de la fébrilité déclenchée par La Nausée. En 1938, Aragon a certes d’autres chats à fouetter. Qu’on se reporte à la correspondance entre Elsa Triolet et Lili Brik, où il n’est jamais question de Sartre à cette date dans les lettres dont nous disposons (alors que Céline y avait fait, en 1932-1933, grand bruit). Pourtant Annie Cohen-Solal, biographe de Sartre, rapporte un « salut officiel » du journal Ce soir, alors dirigé par Aragon et Jean Richard Bloch, sous la plume de Paul Nizan, alors qu’Aragon célèbre justement La Conspiration de Nizan, dont Annie Cohen-Solal rappelle qu’il fut le « frère » d’étude et en quelque sorte le « double » de Sartre. Choisir Nizan contre Sartre, ou laisser Sartre à Nizan, pour Aragon, c’est peut-être un choix qui ne relève pas seulement de la division des tâches dans un quotidien, ni de l’idéologique ou du politique. Il y a quelque chose d’étrange dans ce silence sur Sartre, qui frappa pourtant d’étonnement la plupart des collatéraux d’Aragon à l’époque. Il faut en effet noter que, si Aragon ne semble avoir fait aucun commentaire sur La Nausée, il n’a pas pu ne pas entendre le concert de louanges qui se déverse, de manière parfaitement orchestrée (et sans aucun doute méritée) dans toute la presse, y compris sous la plume d’un Jean Cassou , d’un Camus ou d’un Gabriel Marcel. Succès écrasant, vraiment, qui suit de près l’autre succès des nouvelles du Mur parues quelques mois auparavant, qui abordent le rapport de l’individu à l’Histoire, la montée de l’antisémitisme…Certes, Sartre n’est pas le seul, dans les années trente, à proposer le personnage de l’intellectuel reclus, de l’individu « étranger en son pays lui-même ». Louis Guilloux le fait en 1935 avec Le Sang noir. Quelqu’un d’autre le fait également, c’est Nizan, avec Le Cheval de Troie, roman qui suit un personnage de professeur de lycée en province, Monsieur Lange, individu particulièrement désespéré, négatif et anarchisant. Aragon en parle rapidement dans l’article qu’il consacre à La Conspiration de Nizan, « Le roman terrible ». Mais pas la moindre trace de Sartre. Non qu’Aragon n’ait pas voulu qu’on en parle puisqu’en tant que directeur de Ce Soir il autorise que des articles fassent la louange du roman. Mais Aragon n’écrit pas sur Sartre. C’est pour moi un mystère d’autant plus grand que Les Voyageurs de l’impériale me semble dialoguer avec certains aspects de La Nausée, comme plus tard certains aspects des derniers romans dialogueront avec certains textes de L’Etre et le néant. Et dussé-je me tromper du tout au tout, le résultat de cette confrontation entre les deux romans ne me semble pas totalement inutile pour éclaircir certains aspects du roman.
Mise en bouche (2) : d’un tramway l’autre
Outre l’évident terreau commun de la fragilité de la notion d’individu, annoncé par Sartre à travers l’épigraphe célinien de L’Eglise ( « C’est un garçon sans importance collective, c’est tout juste un individu ») et sur lequel je reviendrai, d’autres indices confirment à tout le moins que les deux écritures et les deux pensées se croisent. Glanés sans souci d’exhaustivité au fil de la lecture, certains éléments du roman de Sartre peuvent être rapprochés des Voyageurs de l’impériale, comme la présence chez l’un comme chez l’autre du leitmotif insistant de « l’aventure individuelle », dissolvante chez Sartre, « négative » chez Aragon ; la thématique du voyage dont Roquentin et Mercadier reviennent l’un et l’autre sans grand enrichissement personnel ; la contemplation de la statue de Gustave Impétraz (page 47 dans l’édition Folio) qui rappelle celle du Coleone par Pierre Mercadier à Venise, l’écriture d’un ouvrage inachevé sur le Marquis de Rollebon avec lequel Roquentin entretient des rapports complexes d’identification et de rejet qui n’est pas sans rapport avec l’inachèvement de l’étude de Pierre Mercadier sur John Law, ou encore, plus improbable, l’irruption discrète d’un « Jeannot, Jeannot, veux tu bien » dans le roman de Sartre qui fait étrangement écho au Jeannot des Voyageurs. L’étude de ces grandes convergences thématiques ou problématiques demanderaient une place et surtout un temps dont je ne dispose pas. On peut se concentrer avec plus de profit, surtout à quelques semaines de l’agrégation, sur quelques éléments concrets et pour commencer sur l’étonnant voisinage d’écriture du trajet urbain, non en omnibus à impériale mais en tramway, aux pages 530-533 chez Aragon, aux pages 175-178 chez Sartre. Je ne parlerai pas de la dimension proprement descriptive, non seulement parce que mon exposé porte davantage sur la dissolution de l’individu que sur ce qu’il voit, mais aussi parce que cela a déjà été exploré, hier, par Alain Trouvé et Frank Merger, l’un pour la « fange », l’autre pour la peinture. Mais il faut tout de même souligner que l’une des mises en situation de projection métaphorique de l’être (comme on peut en rencontrer dans les chapitres consacrés à Sainteville pour Pascal), je veux parler de ce tramway qui entraîne Dora vers son rêve de Garches, pourrait rentrer en contact avec le tramway de Saint-Elémir chez Sartre. Voyons cela de plus près, notamment en ce qui concerne les conséquences de ce transport sur la description du paysage extérieur :
Les Voyageurs de l’impériale
(pp. 531-534)
La Nausée
(pp.175-178)
Quand Mme Tavernier émerge sous le soleil de verre gaufré à l’entrée majolique du métro Maillot, c’est à elle que les crieurs tendent leurs journaux maculés, les petits camelots proposent des lacets ou des jouets mécaniques, les aboyeurs lancent leur : « Vingt sous Longchamp ! », la poussière mêlée d’essence apporte l’avant -goût étouffant du Bois jonché de papiers gras. Rarement Jules l’accompagne. Il faut bien avoir une vie à soi, une vie privée. Celle de Dora commence dans cette foire automobile de la sortie de Paris. Au -delà du chemin de fer de ceinture dont le petit panache blanc grimpait entre les grilles d’une fosse incurvée de gare en gare. Au -delà du monument Panhard -Levassor qui emprisonne une course d’autos en bas -relief dans un portique Louis XVI orné de lierre. Derrière le monument, se garent les tramways jaunes revenant, débarrassés de leurs voyageurs, retrouver Dora patiente au milieu des chaînes avec le peuple qui se rend à Suresnes ou à Saint -Cloud, dans l’avenue d’arbres par quoi débute le Bois de Boulogne, sans prévenir, avant les fortifications, en plein Paris.
Ce tramway jaune ! Elle en rêve, Dora, toute la semaine pour ce qu’il représente pour elle de dépaysement progressif, de distance prise avec la vie, les Hirondelles, Jules, la réalité. Le rêve naît de cette boîte de fer mal peinte, mal suspendue, bringuebalante, et d’une rapidité brutale, qui l’emporte sur sa banquette, encore pas débarbouillée de ses soucis, vers cette songerie qui prend corps de l’autre côté de la Seine, et qu’elle a bercée en elle toute une longue vie de fille et de maquerelle, enfant phénoménalement porté pendant plus de trente ans.
Vide ou plein, le tramway l’entraîne le long d’un restaurant au jardin de petit gravier, puis en contrebas dans une tranchée, hors du bois, contre les grilles, par le boulevard Maillot, secouant Dora jusqu’à lui faire perdre sens de la continuité de sa vie. L’odeur du tramway est suffocante. Au -dehors, les arbres petits et biscornus font à se pencher les uns vers les autres un toit précaire au -dessus d’une herbe parcimonieuse, des orties et des boîtes de conserve. On aperçoit de temps à autre un chemin cycliste où roulent des jeunes filles raides et des garnements coutumiers de l’excès de vitesse. De l’autre côté, sur le boulevard, des maisons désertes s’alignent derrière des bouts de jardin, comme des dames à un bal de sous -préfecture… Dora ne voit rien de tout cela. Ni ses voisins vulgaires et bruyants. Ni le contrôleur auquel elle tend son billet machinalement dans un monde de nuages. Elle ne voit rien que ses pensées. Reprise par ses pensées, elle est leur proie, leur domaine. Ses pensées de toujours, ses pensées d’enfant. Celles qui ne l’ont abandonnée qu’en apparence. Ses pensées cahotantes, ses espoirs, ses mélancolies. Un chant montant en elle, que rien dans la vie n’a pu faire taire. Un chant qui l’envahit, une romance jamais oubliée, un refrain…
On suit par la route verte un Neuilly gris et blanc comme une cervelle. Le boulevard Richard -Wallace succède au boulevard Maillot. Un petit lac sur la gauche. À droite, le château de Madrid. Des équipages à chevaux, des automobiles électriques. Puis l’ombre épaissie du Bois se troue de ciel. On perd confiance dans l’immensité forestière. Comme si l’on s’était approché de la mer. Bagatelle, et des champs d’herbe foulée coupés de voies blanches. Là -bas, on devine déjà la Seine soulignée d’arbres. Des chars à bancs passent avec des tentures rayées blanches et rouges, les mirlitons d’une noce. Et des fumées d’usine, au -delà du fleuve avec le dégradé bleuâtre des coteaux de Suresnes. Dora rêve. Tout converge vers une lumière dans les coteaux, où c’est enfin la campagne et non plus ce parc majestueux qui prolonge la capitale. Le brouillard d’or vers lequel elle a orienté toute sa misérable et sale vie, sa jeunesse trahie et maculée, le temps de sa force asservie à la passion payante des hommes, son déclin grippe -sou, ses veilles de patronne inquiète sur des livres trop lents pour un avenir trop prochain. Ici s’ouvre le pays des contes. Tout ce pour quoi Mme Tavernier a vécu, s’est survécu. Elle passe en triomphatrice le long de la Promenade du Bord de l’Eau du pont de Puteaux au pont de Suresnes, au milieu des cris d’enfants joueurs, du bondissement des ballons dans l’herbe, tandis que tournoient au loin les joueurs de polo. Elle franchit la Seine au -dessus des bateaux-mouches et des chalands avec des sentiments d’impératrice et regarde avec douceur le Pavillon Bleu où elle est venue en landau sous Félix Faure. Traversant Suresnes et Saint -Cloud, elle sent autour d’elle la présence du menu peuple, et elle éprouve l’orgueil de son rang et sa supériorité de propriétaire. Mais avec un bonheur qui la rend bonne. Une indulgence apaisée, qui fait qu’elle donnerait facilement des pourboires. Le tramway monte une côte assez rapide. Des guinguettes bordent la route aux grands arbres. À nouveau, la campagne, les villas de pierre meulière. En haut de la montée, des grilles : l’hippodrome de Saint -Cloud. Dora sent alors lui monter aux lèvres une vieille chanson, irrépressible, qu’elle a de la peine à ne pas entonner :
Et je m’disais, la voyant si gentille :
Qu’est -c’ qu’elle a donc qu’ell’ boit’ comm’ ça
La pauv’ fille ?
Le champ de courses est pour elle le signal d’une démangeaison. Elle ramasse ses affaires, son boa de plumes, son sac, son en -cas. Ne tient plus en place. Se lève. S’approche de la porte de la plate -forme, puis se rassied sur le bord de la banquette. Il y en a pourtant pour cinq bonnes minutes avant d’arriver à la Porte Jaune. On glisse au -dessus du parc de Saint -Cloud, épais et profond comme un songe, avec ses ramures bleues, ses charmilles négligées, ses ronds -points. Des affiches déshonorent les maisons de la route, des cabanes dans les champs cultivés. Puis le lotissement reprend. Des murs. Des bicoques. Du linge séchant au vent sur une corde dans une allée d’arbrisseaux. De petites villas bègues, bancroches et borgnes. Des champs. Des murs. Une sorte de ferme d’Ile -de -France comme un vestige du passé. Des affiches. De la poussière. De la poussière. Dora se lève. Se rassied. Le tramway s’est peu à peu vidé. La voilà presque seule avec le contrôleur et ses rêves. Le contrôleur traverse de bout en bout la voiture pour changer en l’air la pancarte indiquant la direction. En remorque, le tramway traîne une baladeuse qui a l’air de la queue d’un cerf -volant, s’envoyant à droite, à gauche. Dora bout littéralement, son en -cas tombe par terre, son boa pend, ses idées dansent à la façon de la baladeuse. Si elle avait oublié la clef ? Elle fouille dans son sac pour le vérifier. La Porte Jaune ! Tout le monde descend.
Voilà le tramway de Saint-Elémir, je tourne sur moi-même et les choses tournent avec moi, pâles et vertes comme des huîtres. Inutile, c’était inutile de sauter dedans puisque je ne veux aller nulle part. Derrière les vitres, des objets bleuâtres défilent, tout roides et cassants, par saccades. Des gens, des murs ; par ses fenêtres ouvertes une maison m’offre son cœur noir, bleuissent ce grand logement de briques jaunes qui s’avancent en hésitant, en frissonnant, et qui s’arrête tout d’un coup en piquant du nez. Un monsieur monte et s’assied en face de moi. Le bâtiment jaune repart, il se glisse d’un bond contre les vitres, il est si près qu’on n’en voit plus qu’une partie, il s’est assombri. Les vitres tremblent. Il s’élève, écrasant, bien plus haut qu’on ne peut voir, avec des centaines de fenêtres ouvertes sur des cœurs noirs ; il glisse le long de la boîte, il la frôle ; la nuit s’est faite, entre les vitres qui tremblent. Il glisse interminablement, jaune comme de la boue, et les vitres sont bleu de ciel. Et tout d’une coup, il n’est plus là, il est resté en arrière, une vive clarté grise envahit la boîte et se répand partout avec une inexorable justice : c’est le ciel ; à travers les vitres, on voit encore des épaisseurs et des épaisseurs de ciel, parce qu’on monte la côte Eliphar et qu’on voit clair des deux côtés, à droite jusqu’à la mer, à gauche jusqu’au champ d’aviation. Défense de fumer même une Gitane. // J’appuie ma main sur la banquette, mais je la retire précipitamment : ça existe. Cette chose sur quoi je suis assis, sur quoi j’appuyais ma main s’appelle une banquette (…) Ils ont porté ça ici, dans cette boîte et la boîte roule et cahote à présent, avec ses vitres tremblantes, et elle porte dans ses flancs cette chose rouge. [suit un délire sur la banquette avec son énorme « ventre tourné en l’air, sanglant, ballonné, boursouflé avec toutes ses pattes mortes, ventre qui flotte dans cette boîte…(…) Je suis au milieu des Choses, les innommables. [puis le furoncle du passager. Il fuit et bouscule le receveur, avant de faire l’expérience du marronnier].
Ce passage des Voyageurs, tel qu’en lui-même, est porteur d’une charge symbolique stratégique qui vient appuyer (mais en même temps faire contrepoint à) la parabole des « voyageurs de l’impériale ». Bien avant la découverte du manuscrit de Pierre Mercadier qui, tout en se positionnant comme source du point de vue et de l’expérience, propose une vision d’ensemble d’un collectif, d’une société, il trace les contours de cette « mélancolie » individuelle qui emporte Dora vers son rêve plus nettement que ne le fait la métaphore appliquée du professeur d’histoire aux pages 674 à 676. On peut donc considérer ce début du chapitre chez Aragon comme l’une des amorces de la parabole des voyageurs dont la portée doit cependant être examinée pour elle-même et pas nécessairement en inféodation à la métaphore-titre.
Or, la proximité des éléments thématiques mais aussi stylistiques ne laisse pas de frapper un lecteur qui passerait du roman de Sartre à celui d’Aragon et d’un texte d’anthologie à l’autre. Plusieurs motifs communs apparaissent : le choix commun d’un trajet en tramway pour la saisie interne d’un personnage isolé ( avec la forte différenciation du point de vue narratif, certes, mais que l’on retrouvera, justement, dans la parabole terminale sous la plume de Mercadier), le tramway lui-même, cette « boîte » le décor qui défile, certaines couleurs ( le jaune, qui semble « passer », dans l’hypothèse intertextuelle, du décor chez Sartre au tramway lui-même chez Aragon), la banquette, le voisin, le contrôleur d’un côté et le receveur de l’autre. On remarquera également un préambule (si je puis dire) incluant l’idée du dégoût et de la nausée ( les « papiers gras »), relayée par des notations évocatrices ( « On suit par la route verte un Neuilly gris et blanc comme une cervelle.») assez proches du « pâles et vertes comme des huîtres » chez Sartre. Chacun trouvera entre ces deux passages bien d’autres liens que ceux que j’indique ici rapidement. Globalement, on retiendra cependant que ces deux textes font du tramway (qui n’est pas encore nommé « désir » chez Dora ) le lieu brinqueballant d’un « transport » cérébral déstabilisant où la conscience s’égare et dialogue mollement avec le monde réel au point de transférer la qualité du mouvement au décor et non au tramway lui-même qui devient en quelque sorte une figure de monade à fenêtres.
Seulement, et même si la parabole des voyageurs de l’impériale vient à son tour reprendre le point de vue narratif de l’écriture sartrienne ( la première personne, le regard autobiographique), il n’échappe à personne que la pensée des deux auteurs, qui se frôlent en ces instants transitoires et descriptifs, n’ont pas les mêmes objectifs. Dora représente une forme de type social, elle a une existence sociale et la pesanteur de sa vie frôle chaque jour la catastrophe et l’écroulement : le trajet qu’elle emprunte grâce au tramway lui fait quitter la densité du monde réel et la porte vers la puissance de ses rêves. Chez Roquentin, c’est l’inverse, le tramway est le prélude à une clarification du statut de l’existant dans le réel. Le véhicule transporte l’être vers la prise de conscience de son appartenance au réel et à la contingence qui lui est inhérente. L’une va vers une déréalisation puérile du monde tandis que l’autre se laisse transporter vers une réification irréductible de son être-dans-le-monde. L’un s’y dissout, l’autre s’en échappe. Roquentin confirme le réel, Dora le nie. De même pour Pierre Mercadier, autre égaré, le monde dans lequel il s’est englué lui remonte à la gorge jusqu’à la nausée.
Gêne, nausée et malaise
On est frappé en effet de la « gêne », du « malaise » et des quelques « nausées » dont Pierre Mercadier est la victime tout au long du roman, ensemble qui s’articule assez évidemment avec la « mélancolie » du personnage. Seulement, l’usage de la nausée chez Aragon s’avère beaucoup plus concret que chez Sartre et ne semble pas de prime abord viser la dimension du concept qui qualifierait l’existant. On la trouve dans la pensée (et l’estomac) de Pierre Mercadier en des occasions qui justifient son emploi, par exemple lorsqu’il considère, dans la nouvelle et pauvre vie qui est la sienne après son retour en France, ces habitudes insupportables de la femme enceinte :
« Mercadier surveillait à table la femme enceinte. Quand elle avait des nausées, il se disait : ah, voilà ! Quand elle demandait brusquement quelque chose, il se disait : une envie…il la détestait et il s’intéressait à la fois à cette sujétion physique de la créature. » (494)
Cela dit, il arrive que la nausée contribue à une vision générale de l’existence, relativement courante cependant et peu accentuée :
« Quand le corps ne fonctionne plus très régulièrement, on se réveille comme si on n’avait pas dormi. On retrouve des nausées de la veille, des pesanteurs. Tout devient difficile, les petites choses… » ( 502-503)
Les allusions à la nausée, on le voit, sont plutôt minces, à ne considérer strictement que le mot. Mais il faut, si l’on veut se convaincre de la présence d’un malaise existentiel plus profond, porter son regard sur ce que le roman charrie de propos sur la « gêne » qui se glisse comme un tissu conjonctif entre les personnages de cette petite société et qui implique un flottement de conscience chez Pierre Mercadier précurseur de son dégagement ultérieur. Gêne démultipliée que résumé bien ce passage du chapitre XXXIX, au moment où l’on cherche désespérément Suzanne dans les marais :
« Tout cela se mêlait de gênes différentes qui se croisaient. Gêne de Pascal et d’yvonne parce qu’il ne voulait pas dire qu’ils étaient restés deux heures dans la nuit de la grange. Gêne de Pierre et de blanche, à cause du mobile qu’il connaissaient à Suzanne pour s’enfuir. Gêne de Monsieur de Sainteville et de sa sœur, à cause de la scène du pavillon. Dans tout cela, Paulette était la seule avec M. Pailleron à parler de l’événement comme d’une aventure sans importance. Et pourtant ni l’un ni l’autre ne croyait à leur propre désinvolture. » (244)
Le « chœur antique » des domestiques (244) stigmatise cette gêne palpable, étouffante qui relie ces êtres au prix d’une accumulation de petits mensonges, comme l’a très bien montré Wolfgang Babilas dans son article sur la mise en mots du mensonge. Par ailleurs, les réactions prononcées de Madame d’Ambérieux à l’immoralité devinée puis avouée de la situation, pousse l’idée de la gêne morale vers celle de la gêne respiratoire :
« Madame d’Ambérieux, qui étouffait, rouge, gênée pour respirer, la poitrine sifflante, rejetait sur son frère toutes les injustices de la vie, toutes ses rancoeurs à elle. » (246)
Mais un peu auparavant, Madame d’Ambérieux avait déjà manifesté les symptômes conjugués de la gêne, du malaise et de la nausée :
« Mme d’Ambérieux, rentrée dans sa chambre, avait posé sa canne, enlevé son chapeau ; bien qu’elle fût fatiguée de sa course du pavillon au château, et inquiète de Pascal, ce qui l’emportait en elle c’était un sentiment confus du manque de tenue de sa fille. « Elle fait des grâces à cette créature… », marmonna–t–elle. Les oreilles lui bourdonnaient. Les tempes lui battaient. Elle se sentait mal à son aise. Qu’est–ce que c’était ? On aurait dit qu’elle allait vomir. Elle regarda l’image de la Vierge au-dessus du lit, avec un bénitier de faïence bretonne, et une vieille branche de buis flétri. Tout tourna. Elle eut juste le temps de se traîner jusqu’à son lit, où elle tomba sur le dessus de macramé, sans souci de le salir, avec ses chaussures et la pluie dans ses cheveux.
« Ça y est, – se dit–elle, – Dieu me rappelle à lui… »
Cela se perdit dans une marée confuse d’images, de flots d’ombres et de lumières dans ses yeux ; elle respirait difficilement. Du temps passa. Puis les choses s’éclaircirent. Il y eut encore des éclairs au-dehors. L’orage ne se décourageait aucunement. La vieille femme, toute barbouillée, avec sa transpiration de travers, parvint à s’asseoir sur le lit. » (231, nous soulignons)
Emblème tragique du manque d’air et de transparence, le personnage de Madame d’Ambérieux meurt de cette nausée spécifique de l’être qui ne comprend ni ne supporte plus le monde dans lequel il vit. Tout au long de la lecture du roman, le lecteur lui-même doit subir cette impression confuse et presque flaubertienne d’une relation inachevée de l’être au monde, cette asphyxie graduelle qui se joue également au niveau des repères romanesques, subtilement décalés, qui entravent. tout phénomène d’identification ou de simple empathie prolongée. A ce malaise existentiel de Madame d’Ambérieux, partagé par la quasi-totalité des personnages du roman, semble répondre le malaise final de Pierre Mercadier, sa « sueur », sa respiration difficile et son dégoût général pour le dernier rêve de Dora :
« Faire plaisir… Il en était à faire plaisir à cette vieille bique comme à la mère Meyer. Toujours la frousse, rien que la frousse. Il se sentait mal à l’aise avec une petite sueur et les idées brouillées. Il fallut subir le tour du propriétaire. Quelle horreur, quelle absolue horreur que cette turne ! À vomir de bonne volonté, de patience, de faux luxe et d’économie mesquine. Et, trois fois, elle lui fit grimper et descendre les deux étages. Il y avait des bibelots qu’il n’avait pas vus, le cabinet de toilette qu’elle avait oublié. L’air humide et lourd, aggravé par les ombres de la maison, tombait sur eux comme une serviette chaude. Est–ce qu’il n’allait pas enfin pleuvoir ? enfin y avoir une bourrasque d’air frais ? Non. » (694)
L’apothéose tragi-comique du dégoût mercadien vaut aussi par ses conséquences et notamment par ce corps qui se vide peu à peu de sa substance par le ventre, ce ventre mou de l’individu, étouffé, liquéfié.
Ventre mou
C’est peu dire que Les Voyageurs est le roman de pesanteur, du malaise, de la nausée de soi et de l’autre. Les premiers indices de cette pesanteur du pour-soi de Pierre Mercadier me semblent lisibles ( j’allais dire risibles) dans cette attention particulière à l’égard de son corps et en particulier, siège du nombrilisme, à son ventre mou.
« Dans le bain, Pierre songeait. La mousse de savon sur ses bras maintenant, il se disait que c’était étrange, ce cérémonial immanquable qu’il suivait pour se nettoyer. Dans l’eau son corps s’allongeait, velu. Il était assez fier de son pelage, bien qu’il eût remarqué avec chagrin récemment qu’il lui venait quelque poils sur les épaules. Quarante et un ans… Jusqu’à cette année, il se sentait encore un tout jeune homme, il ne prenait pas garde au temps qui passait. Mais, dans les derniers mois, il avait senti des changements en lui. Les transformations de la quarantaine, la peau moins jeune, le ventre qui commençait à se marquer.
Il se leva dans la baignoire pour mieux s’astiquer. La carrure de ses épaules contrastait avec ses bras peu développé d’intellectuel. Il bomba le torse, et rentra le ventre. Est–ce que je peux plaire encore ? Bien sûr que je peux plaire. Heureusement que les dents sont bonnes. Il pensait malgré lui à la bouche édentée de la vieille Marthe, il se frappa les cuisses, comme pour s’assurer de leur force. Il était bien solide sur ses pattes. Malgré, pourtant, ce petit dessin bleu qui apparaissait sous la peau des mollets, pas vraiment des varices. Ses fixe -chaussettes le serraient probablement. Probablement.
C’est drôle. Quarante et un ans déjà. Quelle vie gâchée… Il pensait à Paulette soudain, avec humeur.
Comme une existence s’émiette sans qu’on y ait pris garde… Il faisait beau, un ciel bleu dans la fenêtre, coupé par cette branche plongeante. On rêve d’une vie pleine, éclatante, qu’un sentiment profond emplit, une sorte de coquetterie perpétuelle entre un homme et une femme, publiquement liés sans doute, mais pour qui le plaisir est un grand secret à deux… On rêve…
Il faut que je me surveille, j’ai des plis maintenant là, sur les reins… Pierre tout en sachant qu’il n’aurait pas le courage quotidien de la gymnastique, en caressait régulièrement le projet à la vue de ces plis sur les reins. Oh, ne rien exagérer : en se redressant… La complaisance qu’on peut avoir de son corps. Il est comme il est, après tout. Incroyable que les autres sortent de leurs habits, et soient comme ça eux aussi. Les hommes… Les femmes, Pierre les voyait toujours nues, les imaginait. Mais les hommes, c est répugnant. Tenez, l’oncle. Joli spectacle, pour sûr. » (167-168)
Le ventre, support ici d’un nombrilisme inquiet, prendra par la suite une importance au moins égale aux varices du mollet, partie du corps elle-même fréquemment évoquée, non seulement pour sa vraisemblance anatomique et biologique mais également pour cette mollesse qu’elle contient en son nom, concept ( la mollesse) que Sartre utilise à foison dans un univers à la Dali. Il y a quelque chose de tout à fait programmatique dans cette amollissement lent du corps qui englue Mercadier en lui-même. Il annonce cette figure terrible d’un être qui atteint les limites internes de la conscience et de l’existant tout d’abord en devenant cet être mou, en se réduisant ensuite de fait aux « limbes de la poussière et de l’inconscience », enfin, en se vidant par le ventre, justement.
Cette disparition lente de la chair, la réduction de l’être moral et physique à sa plus simple expression rejoint l’idée d’une destruction de l’individualisme, ce qui ne se divise pas et qui pourtant disparaît ici lentement. On sait également, mais il est bon de le rappeler, que l’un des angles d’attaque de La Nausée, ce roman de la phénoménologie pratique, est l’idée de l’individu, elle-même soumise à dissolution dans le réel. L’individu est-il soluble dans l’existant ? C’est ce que semble décrire l’aventure du pour-soi de Roquentin dans le monde réel. L’épigraphe de La Nausée, emprunté à Céline (L’Eglise), dépose au fronton du journal de bord la frappe de la réflexion sur l’individu :
« C’est un garçon sans importance collective, c’est tout juste un individu »
annonçant le phénomène de la dissolution de l’être dans le réel, ou tout au moins le processus du glissement et de l’effacement, dans le contexte de cette mélancholia, titre originel du roman de Sartre, et caractérisation des humeurs de Pierre Mercadier chez Aragon. Il faut rapprocher cette approximation de l’individu chez Céline dans l’épigraphe Sartrien de cet épouvantable chapitre où cette dissolution du corps de l’existant se fait sous nos yeux, se ramassant vers le noyau de conscience.
« Il ne distingue presque plus les choses et les gens qui sont ce monde extérieur haï, il est le dernier souffle d’un être, un vagissement, l’extrême vagissement d’un individu » (737)
Il faut également noter que le même phénomène a lieu chez Elvire Manescù et Pierre Mercadier, que le désespoir ramène vers la déchéance de la conscience et la poussière de l’être, vers le bas, dans ce même mouvement qui entraîne Roquentin vers la racine de la nausée :
« La déchéance. Cette insensible infiltration en elle. Cette mollesse. Cette torpeur. Le roman d’une noyée. » (691)
Conclusion
Roman de la pesanteur du vivant, de la gêne, et du malaise, Les Voyageurs de l’impériale développe en de multiples ramifications l’idée d’une nausée existentielle qui ne poursuit pas les mêmes objectifs que le roman de Sartre paru en 1938. Elle sert ici la représentation d’une société à l’agonie, fragile et incapable d’agir ou de s’engager véritablement dans le monde réel. La rareté des exemples contraires ( Pascal, du reste, en est-il un ?) tend à empêtrer l’existant dans les boues et les fanges des marais du monde.
Luc Vigier
(ERITA)