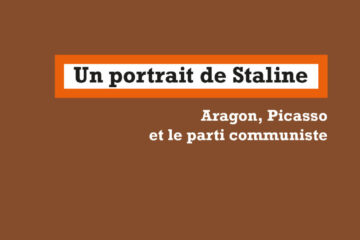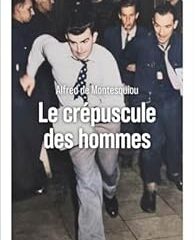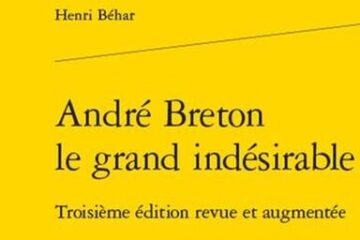Compte rendu d’Hervé Bismuth: Johanne LE RAY, Aragon poète : écrire pour croire. Du Crève-cœur au Fou d’Elsa (1939-1963)
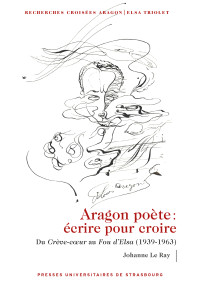
Johanne LE RAY, Aragon poète : écrire pour croire. Du Crève-cœur au Fou d’Elsa (1939-1963), Presses Universitaires de Strasbourg, « Recherches croisées Aragon/Elsa Triolet », décembre 2024, 442 pages, 28 euros.
Le sujet d’Aragon poète : écrire pour croire est paradoxalement neuf : la question de la « croyance » chez Aragon, notamment dans son aspiration à ce qu’il nomme « l’infini » et dans son rapport au communisme, est certes évidente pour quiconque a fréquenté tant soit peu cet auteur, mais elle n’a jamais été étudiée en tant que telle. Il est vrai que la question de l’adhésion au communisme touche à d’autres domaines que celui de la critique littéraire, domaine a priori légitime des études portant sur les textes d’Aragon, et que le choix fait dans les vingt premières années de la recherche sur Aragon après la mort de l’auteur a souvent consisté à éviter de traiter la relation au politique en tant que tel, et à se contenter de travailler sur la littérarité des écrits d’Aragon : façon pour la critique littéraire de se protéger tant des prises de parti que des procès d’intention.
L’originalité de l’ouvrage de Johanne Le Ray (issu d’une thèse effectuée sous la direction de Nathalie Piégay et soutenue à Paris 7 en 2018) est d’étudier la question de l’adhésion d’Aragon au communisme en la reliant à sa soif d’absolu, à ce « goût de l’absolu » qu’il attribue au personnage de la Bérénice d’Aurélien (1944), cet absolu dont le synonyme dans l’idiolecte aragonien est évidemment l’infini dont il s’est acharné à prendre la défense dans les années 1920. Cela ne va certes pas sans paradoxe, de la part d’un jeune auteur passionné, d’avoir rejoint en 1927 un parti qui est alors encore loin d’être un parti populaire et qui est encore imprégné d’un ouvriérisme et d’un militarisme dont il mettra du temps à se défaire. Associer la passion pour l’absolu et la décision d’adhérer au communisme, et faire de cette association un objet d’étude : cela ne pouvait se concevoir qu’à la condition de cibler un corpus, génériquement et chronologiquement. Le choix pratiqué par Johanne Le Ray a ainsi consisté à prendre comme objets d’étude les ouvrages poétiques, ceux dans lesquels, de l’aveu même d’Aragon, il parle le plus de lui-même, ainsi qu’il le rappelle dans la préface de 1964 aux Cloches de Bâle[1], et à choisir la période qui commence avec Le Crève-cœur (1939), premier recueil écrit par un poète parlant de son engagement non plus dans l’absolu, non plus concernant la révolution soviétique ou les révolutions à venir, mais dans sa vie quotidienne dans le pays dans lequel il vit, dans une période où commencent avec la guerre des années de bouleversements. Le terminus ad quem de ce parcours politique est Le Fou d’Elsa (1963), dernier ouvrage poétique d’Aragon à développer un discours politique.
Quant à la croyance, même si (ou parce que) ce terme est certes provocateur voire iconoclaste s’agissant de l’adhésion sans réserve d’un écrivain athée à un parti et à une doctrine engageant une vision d’un monde sans Dieu et de son devenir, Johanne Le Ray l’assume, et sous la forme de l’infinitif croire, qui permet autrement plus que le substantif croyance de parcourir la palette sémantique traversée par ses différentes constructions : croire à, croire en, croire que… Ce choix lexical interroge d’autre part l’analogie entre l’adhésion au communisme et la ferveur religieuse, et pas seulement du point de vue de la perspective, commune à l’une et à l’autre, d’un salut à venir par lequel l’humanité quitterait son Purgatoire. On connaît en effet la prégnance soudaine des images religieuses et de la sacralité qui s’empare de l’œuvre poétique d’Aragon au début des années 40 et pour quelque 25 ans, prégnance parallèle et sur la même durée de la présence d’Elsa et du chant amoureux qui lui donne corps. L’étude de Johanne Le Ray, (trop) modestement nommée « essai » (p. 17 sq.) par son autrice, se fait thèse dès le moment où ce qui est affirmé n’est pas seulement la prégnance du croire dans l’écriture mais aussi la fonction de ce croire comme moteur et même comme visée de l’écriture. C’est ce qu’affirme le titre donné à cette étude, Écrire pour croire. Au-delà en effet de la fonction attendue du poème de militant – le poème certes « dit et suscite la foi » (p. 401) – le poème aragonien met aussi cette foi en scène, en lui donnant l’occasion de se parler, de se clamer, la surenchère fonctionnant parfois comme « esthétique compensatoire » (p. 87), quitte à y prendre ce plaisir paradoxal consistant à rejouer soi-même la passion christique. Car ce n’est pas seulement « le besoin de croire [qui] travaille l’œuvre d’Aragon » (p. 20), c’est aussi celui de vivre passionnément ce croire en l’écrivant.
Le chemin emprunté par Johanne Le Ray pour retracer les avatars de ce « croire » dans les écrits d’Aragon est celui de la chronologie : ce chemin est ainsi jalonné par six parties suivies d’un « Épilogue », formant sept stations d’un chemin de croix qui aura duré quelque vingt-cinq ans. C’est sous le titre « Nécessité de la poésie en temps de détresse » que la première partie de l’ouvrage expose la nouvelle donne du parcours d’écrivain d’Aragon. Les années 1930 avaient consacré le renoncement à l’expression poétique, passé l’étape de la poésie militante des derniers recueils, cette poésie insupportable (Florian Mahot Boudias[2]). Johanne Le Ray explique comment les circonstances de la guerre, associées à un « besoin intime » (p. 33), ont changé la donne – on se permettra d’ajouter qu’il était difficile pour l’écrivain réaliste Aragon dans ces années-là de poursuivre son œuvre de romancier de façon nomade et loin de toute documentation. Reste que ce retour en poésie s’accompagne immédiatement du discours de « contrebande » initié avec « Vingt ans après », que permet justement le discours poétique, ainsi que d’une double « déliaison » (p. 45) : d’avec un parti jeté dans la clandestinité et désorganisé, d’avec une compagne que l’appelé Aragon laisse à Paris le temps de la « drôle de guerre ». Ici commence également la période où « [la] croyance engage » (p. 62) : il s’agit aussi pour le poète communiste de communiquer cette croyance et de regarder, faire regarder l’avenir en un présent incertain : c’est en ces termes que se pose la « contrainte d’optimisme marxiste » (p. 67), cet optimisme qui fait retentir dès mars 1940, avec le poème « Santa Espina », le référent religieux, associant foi et martyre communiste et chrétien, associant surtout l’avenir communiste au règne du « Fils de l’Homme ». La deuxième partie, « Du doute au prophétisme, un chemin original », porte essentiellement sur la période suivante, celle des premiers temps de l’Occupation, et sur les poèmes qui prendront place dans le recueil Les Yeux d’Elsa (printemps 1942), ce recueil où le matériau religieux est utilisé jusque dans l’expression de l’adoration pour Elsa, associée à la Vierge Marie et destinataire d’un cantique. C’est au cours de cette période que prend sens, dans cet ouvrage, la formule « Écrire pour croire », qui est au cœur de la thèse de Johanne Le Ray : l’écriture est le moteur et le soutien du « croire » d’Aragon. Il revient en effet « aux mots de combler la béance entre ce que l’on veut croire et ce que l’on peut croire » (p. 87), et c’est de ce clivage que proviennent la sacralité mais aussi l’outrance passionnée – passionnelle ? – de plus d’un poème de ce recueil. Quant au prophétisme, il n’est pas une image mais une posture chez le poète Aragon, et Johanne Le Ray a raison de rapprocher cette posture, jusqu’ici initiée et prise dans la poésie française par le seul Victor Hugo, de la présence de la statue d’Hugo dans la poésie de ces années-là : c’est bien là que commence l’expression récurrente de l’admiration pour le mage romantique, mais aussi ce jeu de miroir qui se brisera plus tard au moment du Roman inachevé (1956). Et c’est bien une voix de prophète qui se fait entendre en 1942 dans Brocéliande, un prophète prédisant un avènement en quelque sorte déjà réalisé en URSS. Dans un tel conditionnement sémantique, on conviendra avec Johanne Le Ray que l’enjeu du titre du texte « Les martyrs » (1942), écrit pour défendre la mémoire des otages assassinés à Châteaubriant en octobre 1941, dépasse largement celui d’un simple jeu de mots avec le poème de Chateaubriand.
À partir de 1942 et des « Martyrs », les « destinées de la poésie » d’Aragon prennent certes un tour nouveau : il n’est plus l’écrivain désemparé, isolé, qui se contraint à son travail de poète pour affronter l’entrée en guerre, la débâcle et l’adversité ; il est devenu dans l’ombre – la lumière, ce sera pour un peu plus tard – le poète reconnu, recevant l’« adoubement » (p. 155) de la direction d’un parti à présent réorganisé dans la clandestinité ; non pas encore un poète officiel, mais un écrivain sur le militantisme poétique duquel la direction du parti peut compter. Mais ce n’est pas l’histoire des « destinées de la poésie » d’Aragon que Johanne Le Ray développe dans la troisième partie de cette étude, mais celle de la fabrication de son matériau poétique, sous le titre « Dans la forge du sacré : l’ère effervescente ». Cette troisième partie étudie l’utilisation et la fabrique du mythe dans ces années de clandestinité, et se fait l’occasion d’une mise au point sur les rapports entre le poète Aragon et le philosophe Georges Politzer à propos de la question du mythe national. Ce travail du mythe par Aragon est une prise de parti culturelle de combat, telle celle qui dès 1941, dans « La leçon de Ribérac ou l’Europe française » le faisait déjà valoriser la figure du Perceval courtois, patrimoine de l’histoire littéraire de la France, en l’opposant au brutal Parsifal germanique. Le mythe est, pour l’Aragon de ces années quarante, l’occasion d’un « tressage […] entre légende et histoire » (p. 183), celui qui dans la « Comptine du quai aux fleurs », marie « la Bastille et la Commune », « Bouvines » et « Valmy », Jeanne d’Arc et Gabriel Péri – Péri dont Johanne Le Ray étudie le travail d’héroïsation sous la plume d’Aragon.
C’est Le Nouveau Crève-cœur (1948), avec les années qui suivent la Libération, ce « désenchantement » dont parlait Elsa Triolet, qui ouvre la quatrième partie, placée sous le double signe de l’« institutionnalisation du croire » et de la « posture du prêtre ». Dans ces années où le PC – à présent PCF – revient à la lumière et Aragon avec lui, le poète est devenu le chantre officiel du « parti des fusillés », un – sinon le – « poète du parti » (p. 204). La Guerre froide voit s’étaler la production d’une suite de poèmes composés entre 1948 et 1954, Mes caravanes, que Johanne Le Ray définit comme une « liturgie », au sens religieux mais aussi au sens étymologique du terme, celui d’une « œuvre du peuple […] nécessit[ant] la validation d’un collectif pour exister » (p. 205). Ces « caravanes », reliant, à la façon d’un « trait d’union » (p. 208), mémoire du passé et perspective de l’avenir, sont elles-mêmes le reflet des véritables processions pour la paix, menées alors sur ces nouveaux lieux de mémoire consacrés par la Résistance. Les rassemblements, la fétichisation des lieux de mémoire, la sacralisation de la politique sont ici étudiés sous l’angle d’une « religion civile à la française » (p. 213), conduisant Aragon jusqu’au projet d’écriture d’un véritable calendrier communiste.
Le passage attendu dans toute chronologie de l’œuvre d’Aragon est celui de la « crise » des années 1950, crise accompagnée sur le versant de l’écriture poétique par cette élaboration d’un mur d’illisibilité venant brutalement rompre avec le parler si clair – trop clair ? – du discours poétique depuis les années 1930. L’originalité – et la pertinence – du propos de Johanne Le Ray est d’aborder cette crise, cette illisibilité, sous le titre attendu de la cinquième partie : « Calcification et crise de la croyance : le poème au risque de l’illisible », cette fois non pas à partir de la crise idéologique de 1956, mais à partir de l’échec de l’écriture des Communistes, c’est-à-dire en 1949. L’« illisibilité », et même une double « illisibilité », qui qualifie habituellement les ouvrages poétiques s’étendant du Roman inachevé (1956) au Fou d’Elsa (1963), est attribuée cette fois au poème Les Yeux et la mémoire (1954), illisibilité du point de vue d’une « inéluctable obsolescence programmée » (p. 230), mais aussi au sens où la parole du poète proclamant une orthodoxie et une foi absolues ne montre finalement que les défaillance de ses certitudes ; ici, plus qu’ailleurs, le poète « écrit pour croire ». C’est ainsi en sixième partie de l’ouvrage et sous le titre « L’ébranlement de la croyance : de l’illisible à l’indicible » que l’étude traite de la période allant de 1956 à 1960 et des trois poèmes que sont Le Roman inachevé (1956), Elsa (1959) et Les Poètes (1960). Johanne Le Ray s’appuie sur la recherche aragonienne, notamment le colloque d’Aix-en-Provence Aragon 1956 (1991), pour repousser avec force le cliché faisant découler toute l’introspection autobiographique, toute l’écriture de l’intimité du seul Roman inachevé, l’introspection ayant en fait commencé bien plus tôt – dans Le Nouveau Crève-cœur (1948) par exemple, ainsi que le montre le poème « Vise un peu cette folle […] ». Comme elle l’affirme de façon très juste, « si l’année 1956 crève l’écran, elle est aussi en partie ce qui fait écran » (p. 293), d’autant que l’état actuel de la critique génétique fait remonter l’écriture de certains fragments du Roman inachevé à la fin de l’année 1954. Johanne Le Ray qualifie ainsi, sous l’éclairage de son étude, le XXe Congrès du PCUS d’« événement paradoxal » et le rapport Khrouchtchev qui s’ensuivit de « non-événement » (p. 297). Quoi qu’il en soit, ces années sont celles où le poète travaille une posture sacrificielle (p. 317), et où l’adorateur des poèmes des années 1940 laisse la place à une figure christique du dernier jour : celle de l’humiliation, du chemin de croix, de la crucifixion puis du don de soi jusqu’à la mort, en même temps que le reflux de la foi dans l’avenir redirige foi, passion, martyre et discours poétique vers l’amour, en particulier dans Elsa (1959).
Le Fou d’Elsa (1963) méritait bien à lui tout seul un chapitre de cette étude : c’est l’épilogue de l’ouvrage qui s’en charge, sous le titre « Faillite de l’utopie et désorbitation de l’objet de croyance ». Cette fois-ci, ce n’est plus la passion religieuse, la foi profonde ni même simplement le « croire » qui sert de moteur à l’écriture du poète, mais l’Histoire, envisagée sous l’angle d’une « perpétuelle tragédie » (p. 343), et si « l’ombre portée » (p. 346) de l’Histoire parallèle des USA et de l’URSS (1962) coécrite avec André Maurois, mais aussi le travail du romancier de La Semaine sainte (1958) dont la présence manque à cet épilogue, ont conduit Aragon à arpenter durablement le continent Histoire (Althusser), sa vision de l’histoire comme tragédie ne réfléchit, elle, que son propre regard sur son parcours personnel ; l’introspection commencée dans les années 1950 se poursuit encore en 1963. Dans ce « poème-roman » (Aragon) où les masques se superposent et finissent par tomber un à un, la nouvelle posture du poète est caractérisée par le « renoncement à la fonction de prophète » et la « dénonciation du camouflage lyrique » (p. 355). Il est vrai que c’est dans cette dernière période que le romancier-poète s’affuble de masques divers ; mais loin de le déguiser, ces masques ont pour fonction de lui permettre justement de se débarrasser des camouflages qu’étaient les précédentes postures. La foi est à présent entièrement tournée vers l’objet d’amour, en un « culte monstrueux » (p. 369) sacralisant autrement plus Elsa que ne le faisaient les métaphores religieuses des poèmes des années 1940. On pourra certes discuter de la thèse affirmée dans cette étude suivant laquelle Le Fou d’Elsa consacre une « faillite de l’utopie » dans la mesure où Aragon, loin de s’éloigner de l’utopie marxiste, la corrige et la redouble : nulle société sans classe ne saurait advenir qui ne lierait pas son avènement à celui de l’épanouissement du couple.
La conclusion de cet ouvrage rappelle en bilan de cette étude que le romancier-poète a été autrement plus auteur de sa « croix de croire » qu’il n’en aura été victime, et quelle que fût sa souffrance. Le recul sur la période 1939-1963 pris par cette conclusion lui permet, une fois Aragon reconnu comme le propre auteur de son « croire », d’éclairer tant le silence poétique des années 1930 (ne pas parler de soi) que le retour du « poète casqué » à la poésie « pour se remobiliser » (p. 398) ou encore la fadeur esthétique des textes du « devoir-dire » (p. 399), dans cette époque des années 1950 où « la catachrèse écrase le poème » et où le poète, passant de « prophète » à « prêtre », est alors devenu le « gardien du temple » de son parti (p. 399). De ce point de vue, Le Fou d’Elsa (1963) est le poème de l’épanouissement dans la mesure où, à rebours de Les Yeux et la mémoire (1954), il offre à son auteur « la possibilité de désassignation identitaire » (p. 401) et où son mysticisme d’emprunt lui permet de parler une foi et une passion dont il lui est « impossi[ble] de se déprendre » (p. 403), en toute liberté. On ne pourra que constater, une fois lues les dernières pages de ce livre, que le « croire » chez Aragon dans ces quelque vingt-cinq années d’écriture poétique est bien plus qu’un objet d’étude : il est un moyen d’éclairer non seulement l’association entre passion amoureuse, foi politique et image religieuse, mais également les flux et reflux de l’écriture poétique ainsi que ses avatars.
Ce livre propose ainsi une thèse originale solidement soutenue par une recherche de grande qualité, une connaissance fine et une lecture détaillée du corpus aragonien, une bibliographie abondante et méticuleusement classée, et sa lecture est facilitée par un index des noms et un index des poèmes cités. La rédaction en est élégante et précise et l’ouvrage confirme la promesse de la thèse dont il provient : voici bien un livre qui comptera dans les études aragoniennes.
Hervé Bismuth
[1] « Ma biographie, elle est dans mes poèmes, et à qui sait les lire, autrement claire que dans mes romans », in « C’est là que tout a commencé », 1964.
[2] Voir sur notre site le compte rendu par Roselyne Waller du livre de Florian Mahot Boudias Poésies insupportables, Politiques de la littérature dans l’entre-deux-guerres (Aragon, Auden, Brecht) Classiques Garnier, 2016 : https://louisaragon-elsatriolet.fr/2017/10/23/compte-rendu-par-roselyne-waller-de-florian-mahot-boudias-poesies-insupportables-politiques-de-la-litterature-dans-lentre-deux-guerres-aragon-auden-brecht-classiques-garnier-2016/