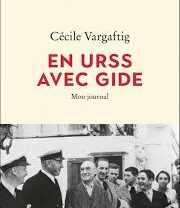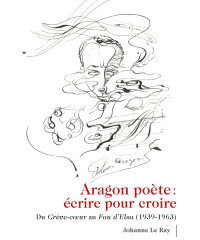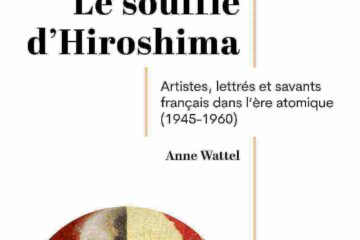Compte rendu par Reynald Lahanque de : En URSS avec Gide. Mon journal, de Cécile Vargaftig
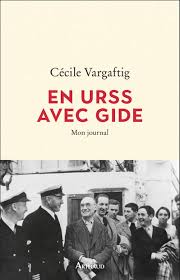
Cécile Vargaftig : En URSS avec Gide. Mon journal (Arthaud, 2021)
Cécile Vargaftig, scénariste et romancière, née en 1965, est la fille du poète Bernard Vargaftig (1934-2012), auteur d’une œuvre considérable, et dont on sait qu’il fut soutenu par Aragon dès ses débuts. Le sous-titre du livre, « Mon journal », ne doit pas nous induire en erreur : il ne s’agit pas d’un journal intime, mais d’une sorte de voyage dans le temps, dont l’enjeu est de chercher des réponses à bien des questions que l’auteure se pose. En prenant pour fil conducteur le voyage en URSS de Gide et le témoignage qu’il en donna, voyage effectué avec plusieurs de ses amis « compagnons de route » (en 1936), elle se demande : « Pourquoi Gide a-t-il été si peu écouté ? Pourquoi tant d’écrivains ont-ils choisi de se taire ? » : ou encore : « L’appartenance à une minorité sexuelle est-elle une arme de discernement ? » – l’auteure mettant en avant sa propre homosexualité. Mais c’est aussi cette question plus personnelle qui la taraude : « Pourquoi mon père est-il resté si longtemps communiste ? » (toutes ces questions sont reprises de la quatrième de couverture). Ajoutons que ce n’est pas tant Gide que Pierre Herbart, l’un des autres voyageurs, qui joue un rôle très important dans ce livre, Cécile Vargaftig l’érigeant en figure élective.
Il se trouve que c’est son père qui lui avait fait connaître cet écrivain à travers L’Âge d’or ; plus tard, c’est elle qui prêta à son père La Ligne de force, sans mesurer à quel point son incipit ne pouvait que le heurter : « J’ai commencé, comme tout le monde, par le communisme. Autant l’avouer aussitôt, les résultats de l’expérience furent décevants » (cité p. 13). En outre, ce livre donnait « le rôle du méchant » à Aragon. C’est donc à la lumière de ceux qui, un temps séduits par la grande espérance, ne purent jusqu’au bout « croire », qu’elle s’interroge sur l’énigme que fut pour elle l’enfermement durable de son père dans cette croyance. Un enfermement qui se mua en « folie » avérée dans ses dernières années.
Elle note que, comme Herbart et Aragon, son propre père eut aussi un père absent, et un même vide à combler, mais elle refuse d’assimiler roman familial et mentir-vrai, cette notion lui semblant « la négation même de la littérature, de l’imaginaire, et de la vérité » (p. 62). Ce qu’elle pointe est que le mentir-vrai a pu justifier bien des silences, quand il importait de ne rien cacher, ou, pour le moins, de s’abstenir de « parler sous une dictée » (comme le disait Gide). Elle fait l’hypothèse que l’effondrement final de son père est survenu quand ne fut plus supportable sa longue résistance à une vérité trop menaçante. L’engagement communiste avait été « par son enthousiasme assourdissant, le garde-fou de sa folie » (p. 114). Elle relève qu’une première épreuve douloureuse, qui s’est traduite par un divorce et une dépression sévère, coïncide en 1961 avec l’affaire de l’éviction de Servin et Casanova, suivie d’une purge au sein du Parti. A ce moment-là, « Aragon l’a réconforté, l’a soutenu, l’a aidé financièrement » (p. 127). Elle ajoute : « Aragon a aussi proposé à mon père de s’installer à Paris et d’entrer aux Lettres françaises, mais mon père a refusé parce qu’il ne voulait pas dépendre financièrement du Parti communiste, m’a-t-il confié bien plus tard ». Il craignait, en outre, « de devoir se plier aux exigences esthétiques du Parti et parlait souvent de ceux qui, autour de lui, multipliaient les articles et autres textes de complaisance, pour pouvoir bouffer » (p. 128).
Cécile Vargaftig revient ensuite, dans cette page, sur l’événement essentiel : « Aragon est donc l’homme qui a fait de mon père un poète aux yeux de tous, d’abord en publiant ses textes dans Les Lettres françaises, mais aussi en faisant éditer chez Gallimard son second livre, La Véraison, et surtout en l’invitant à participer à la soirée du Récamier, qui mit en valeur, en décembre 1965, six poètes et une musique de maintenant, comme on disait à l’époque. » Elle se souvient : « Mon père était très impressionné par Aragon, et très heureux de sa protection », alors que son propre père (juif immigré venu de Russie) « se moquait de lui du fait qu’il écrive des poèmes ». C’est pourquoi, estime-t-elle, « Aragon a su compenser certaines des blessures provoquées par ce père si peu aimant » (p. 129).
Quant à elle, après avoir évoqué les deux circonstances où elle a pu, en compagnie de ses parents, apercevoir Aragon, devenu un vieil homme à la fois malicieux et absent (lors du festival d’Avignon en 1977 et à la fête de l’Humanité en 1982), ), elle dit son admiration pour l’écrivain, et ce qu’elle lui doit en tant qu’auteure : « J’ai lu très tôt la plupart de ses livres. J’ai appris par cœur ses poésies de la Résistance, j’ai aimé passionnément Le Roman inachevé, j’aimais particulièrement qu’un livre de poèmes consente à s’appeler roman, et j’ai adoré ses romans, Aurélien, La Semaine sainte, mais aussi ceux de la fin, si libres, La Mise à mort et Blanche ou l’oubli. De tous les auteurs dont je parle dans ce livre, c’est peut-être celui que je connais le mieux, parce qu’il a accompagné mon enfance, mon adolescence, et que j’ai appris à écrire en le lisant » (p. 130-131).
Mais l’hommage tourne à l’aigre quand derrière l’écrivain virtuose se dessine la figure d’un homme à ses yeux faussement libre : en des termes très peu amènes, elle fustige, après bien d’autres, le « stalinien », le militant soucieux de toujours donner des gages de sa fidélité et de conforter sa position au sein du Parti, l’intellectuel qui préféra les arguments du combat aux exigences du débat. Disons que l’auteure laisse s’exprimer sa colère, et sa peine … De la violente apostrophe adressée à Aragon (que chacun aura le loisir de découvrir), retenons ceci : « […] tu n’as cessé de te renier pour conserver cette place grandiloquente de Grand Écrivain au sein du Parti, place que tu t’es construite patiemment, pas à pas, accumulant veuleries, flatteries, trahisons […] Tu as sacrifié ta liberté pour un peu de grandeur. » Relisant La Mise à mort, où est évoqué le voyage de Gide à Moscou, elle ne cache pas avoir été à nouveau emportée, et révoltée : « Ton livre est magnifique, et le plus troublant, c’est que non seulement tu y mens à chaque page, mais encore tu y dis la vérité à chaque ligne. Mais à quel prix, Louis ? Et pour quels renoncements ? » (p. 131).
Elle lui oppose la figure de Pierre Herbart, si semblable à lui (séduisant, intelligent, élevé sans père, bisexuel, en quête d’une famille), mais assumant d’être celui qu’Aragon a choisi de ne pas devenir, « un raté, un maudit, un pédé, un dandy », une image haïssable à briser « comme on brise un miroir » (p. 132). S’appuyant sur le témoignage rapporté dans La Ligne de force, elle ne cache pas son effroi à l’idée qu’Aragon ait pu aller jusqu’à tenter d’envoyer Herbart à la mort : fin 1936, dans le bureau de Koltsov à Madrid, Herbart assiste à un étrange appel téléphonique d’un Aragon dénonçant sa proximité avec Gide, au moment où le Retour de l’URSS va être publié. Herbart dit s’être précipité chez Aragon une fois revenu à Paris : il ne révèle rien de leur conversation, se contentant d’un allusif : « Sans doute a-t-il gardé le souvenir de cette visite ». Mais il adressera ensuite à Gide ce reproche ironique : « Vous avez manqué me faire fusiller » (cité p. 227). Au débit de l’homme de parti que fut Aragon, elle évoque aussi les déboires de Louis Guilloux, qui fut du voyage en URSS, sommé de produire un témoignage contraire à celui de Gide, et qui ne s’y résolut pas, ce qui mit un terme à sa collaboration à Ce Soir, huit mois après ses débuts dans ce journal en janvier 1937 (p. 239-241).
En évoquant ainsi la figure très contrastée d’Aragon, Cécile Vargaftig tente de dire quelque chose du destin de son père, l’enfant juif obligé de vivre caché sous l’Occupation, sauvé par la poésie, militant sincère, qui a « toujours choisi la vie contre la mort, le bonheur contre le malheur, l’avenir contre le passé », mais qui ne s’est épargné « ni le doute, ni le remords, ni la souffrance », depuis son adhésion en 1951 jusqu’à son éloignement au cours des années 80. Ce fut là après tout « une traversée » qu’elle estime « exemplaire », pour autant que l’essentiel était pour elle, non de juger, mais de chercher à comprendre, en mesurant mieux l’écart qui aura séparé le père et la fille, en affrontant enfin leurs différences, « peut-être pour ne plus en souffrir ». Ce très beau livre, limpide et exigeant, et dont on n’aura donné ici qu’une idée très partielle, elle choisit de l’achever de manière apaisante : « Chacun place son courage où il peut. Aucune vie ne peut juger aucune autre vie. Aucun temps ne peut juger aucun autre temps » (p. 255).