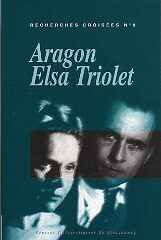Maryse Vassevière et Luc Vigier, « Entretien avec Michel Apel-Muller », Recherches croisées Aragon / Elsa Triolet n° 9, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, p. 107-147

Εntretien avec
Michel Apel-Muller
Réalisé par Maryse VASSEVIERE et Luc VIGIER
Maryse Vassevière. On pourrait commencer cet entretien par une approche un peu historique de ta relation avec Aragon et Elsa, en commençant par les circonstances de la rencontre et en arrivant jusqu’à aujourd’hui. Puis dans un deuxième et troisième temps, on pourra aborder la nature de cette relation et la dimension à la fois littéraire et politique de tes souvenirs et de ton témoignage sur Aragon et Elsa. Donc, dans ce premier temps, ce pourrait être le cadre historique de ta rencontre et de ta relation avec Aragon et Elsa. Quelques questions plus précises : dans quelles circonstances les as-tu rencontrés ? ou quels ont été tes premiers contacts avec eux ? Combien de temps ont duré ces relations ? Cela pourra être une sorte de récit que tu pourrais faire.
Michel Apel-Muller. La première chose que je dois dire, c’est que j’appartiens à une “génération”, une génération de gens qui sortent de l’enfance avec la fin de la guerre : c’est-à-dire qu’à la fin de la guerre, je suis un préadolescent qui sort de cinq ans de zone interdite. J’appartiens aux provinces de l’Est, l’enfermement y était total, et c’est ainsi que tout d’un coup les nouvelles du monde finalement vont m’arriver, les premières nouvelles culturelles, dans les années 46, 47, 48. C’est en 1947, si je me rappelle bien, que j’ai rencontré pour la première fois le nom d’Aragon sur un texte qui m’avait été présenté par un professeur, un professeur de ma classe de 4e. C’était un poème de La Diane française, « Marche française », vous savez… dans lequel on trouve ces vers : « Des hommes verts et des vautours vinrent obscurcir notre jour » etc. Ça m’avait intéressé, tout en me laissant très étonné par la structure non rhétorique du poème par rapport à ce que je croyais être la poésie, c’est-à-dire essentiellement la poésie de Victor Hugo. Je n’étais peut-être pas si loin en le comparant à Victor Hugo mais je n’y voyais pas assez de rhétorique. Je ne savais pas encore qu’Aragon était capable de beaucoup de rhétorique lui aussi… Mon premier contact c’est là, mais il appartient à ces contacts qui font de moi très vite un jeune passionné de poésie qui au cours de sa scolarité va vivre avec des découvertes successives qui s’appellent Apollinaire, qui s’appellent Baudelaire… Puis très vite ça devient une passion. C’est comme ça que dans les années 50 je vais me lier avec d’autres passionnés, cela aboutit à des amitiés qui durent toujours, celle de Bernard Vargaftig par exemple. La rencontre avec Aragon, elle se fait en 54 ; cette fois j’étais en khâgne et dans une période de l’année où nous étions las de gloser sur les textes classiques, nous avions supplié notre professeur, pour nous changer les idées dans la préparation du concours, de nous confier un texte moderne. Et il nous avait mis « Les lilas et les roses » à l’étude, ce qui avait provoqué entre lui et moi une discussion qui avait duré trois heures au lieu d’une, nous nous querellions sur l’interprétation notamment de la première strophe, vous savez, « Ceux qui vont mourir debout dans les tourelles entourés de lilas… » Mon professeur, en bon helléniste et latiniste qu’il était, y voyait un recours à la culture de l’Antiquité, au développement rhétorique, encore une fois, de la cérémonie du triomphe romain et au morituri des Latins. Finalement j’ai écrit à Aragon – parce qu’à vingt ans on ne doute de rien – et j’ai reçu une lettre dactylographiée sans interligne de trois pages qui était un commentaire des « Lilas et les roses » par Aragon. Alors jugez de l’effet produit sur un garçon qui a vingt ans et qui comme tout le monde a été éduqué dans la culture des grands écrivains comme des demi-dieux modernes. Il avait reçu la grande lettre d’Aragon ! J’ai publié ultérieurement cette lettre, dans La Nouvelle Critique. Voilà, les choses commencent ainsi, avec au fur et à mesure que le temps passe, l’image que les gens de ma génération – et là je peux parler au nom d’une certaine génération d’étudiants de gauche, d’étudiants communistes en particulier – avaient de gens comme Éluard ou Aragon. Je dois dire que dans cette adolescence qui était la mienne, Éluard avait une fonction, comment dire, pédagogique et humaniste plus forte qu’Aragon.
Maryse Vassevière. Ah oui. Michel Apel-Muller. J’ai été un éluardien inconditionnel, nous attendions les derniers livres d’Éluard, Une Leçon de morale, etc. comme de véritables manifestes à penser, comme vraiment la “leçon de morale”, parce que nous portions très haut, et souvent à tort, l’idée que notre communisme c’était aussi une façon d’être des hommes, de vivre son humanité… On était bien loin des tristes réalités qu’on a découvertes ensuite, mais notre pureté à nous était intégrale… Donc nous avions Éluard en face de nous et Aragon, mais dans cette période, disons de 47 à 54, Aragon n’écrit pas grand-chose en matière de poésie. Alors heureusement il y avait Éluard. D’Aragon, nous lisions évidemment les articles, tout le monde avait lu, car l’éducation de cette génération s’est faite beaucoup à travers un volume de cette collection, les « Poètes d’aujourd’hui », consacré par Claude Roy à Aragon avec une petite anthologie. On a fait l’éducation poétique de beaucoup avec la collection « Poètes d’aujourd’hui ». À quoi il faut ajouter tous les petits cahiers, « Poésie 50 », « 51 », « 52 », publiés par Pierre Seghers à l’époque. Ensuite il y a le développement de ma propre vie, le fait que je suis un jeune professeur qui entre dans l’équipe rédactionnelle de La Nouvelle Critique qui à l’époque, après les années 57, se renouvelle complètement et qu’un hasard va jouer, pas tout à fait un hasard dans la mesure où si j’ai rendu compte sur une longue note de lecture d’un premier travail sur Elsa Triolet c’est parce que tout de même je me sentais capable de le faire, donc que je connaissais les choses… Je rends compte une première fois d’Elsa choisie par Aragon, dans La Nouvelle Critique, puis il y a eu Roses à crédit, il y eu Les Manigances et enfin L’Âme. J’ai fait les articles après la parution de ces quatre ouvrages, avec évidemment la polémique qui avait entouré Les Manigances : quelque part dans Les Manigances, Clarisse Duval l’héroïne dit : « Qui donc a dit que la question du bonheur est posée ? Moi je ne connais que le malheur… etc. » Évidemment quelqu’un était visé : c’était mon ami André Stil qui à l’époque tenait la chronique littéraire dans L’Huma et André a réagi assez sèchement à la suite du roman à l’article d’Elsa, tendant à établir une confusion entre le personnage du roman et l’auteur du livre, ce qui peut emmener à des dérives assez sérieuses. Moi, quand on m’a demandé de rendre compte des Manigances dans ce contexte, je n’ai peut-être pas bien vu que le terrain était un peu miné… alors je m’en suis tiré par une note un peu longuette en bas d’une page, qui a fait qu’André s’est un peu fâché à mon endroit… Passons là-dessus, les choses vont jusqu’à L’Âme, je fais un article sur L’Âme et à ce moment-là c’est Elsa qui par une coup de téléphone à la rédaction de la revue : « Bon, ce garçon qui vient d’écrire cet article, j’aimerais le voir. » Un rendez-vous m’a été donné, c’était à la salle Jean-Pierre Timbaud, qui était la salle des métallos, de la CGT, pour une vente de livres comme il s’en faisait beaucoup à l’époque. Alors là j’ai des souvenirs extrêmement précis, j’entre un peu dans l’anecdote si on en a le temps…
Maryse Vassevière. Bien sûr… alors ça c’était exactement en quelle an¬née ?
Michel Apel-Muller. C’était l’année de L’Âme, c’est donc en 1963. Aragon d’ailleurs signait là Le Fou d’Elsa qui venait de sortir. Alors évidemment je les avais déjà vus, physiquement vus, je les avais vus aux diverses ventes du CNE, j’avais vu les yeux d’Elsa de loin, derrière la foule des acheteurs, et là je me trouve dans la foule des acheteurs ayant rendez-vous avec elle mais il y avait vingt mètres de queue. Alors je me mets dans la queue, avec mon petit carton et simplement mon nom, et je lui tends mon carton. Flash des yeux bleus vers moi, « Ah c’est vous ! », elle replie son stylo, se tourne vers la queue qui se reconstituait derrière moi : « C’est terminé. Excusez-moi, je m’arrête ». Elle se lève et je m’aperçois qu’Elsa marchait très mal, elle se pend à mon bras. Jugez si j’étais fier et confus, et elle me dit : « Nous allons aller boire une coupe de champagne. » C’est une salle à l’italienne avec un rideau, sur la scène les organisateurs avaient fait la buvette sur la scène. Nous arrivons là, il n’y avait qu’une personne à la buvette qui était Benoît Frachon. Elsa lui dit : « Benoît je vous présente un grand ami. » Ce n’était pas mal quand même pour la première rencontre ! On a bu le champagne et puis elle m’a dit : « Maintenant on va aller chercher Louis et je vous emmène au Moulin. »
Maryse Vassevière. Ah bon… dès la première rencontre.
Michel Apel-Muller. « Le chauffeur vous ramènera à Paris à l’heure que vous voudrez. » Bon, on traverse la foule, je vois encore des gens, Arthur Adamov baisant la main d’Elsa toujours à mon bras… tous les gens qui la saluaient et moi, fier comme Artaban et confus comme il n’est pas possible d’avoir à mon bras cette petite dame (elle était toute petite). Pour approcher Aragon qui signait Le Fou d’Elsa, la queue était de 60 mètres, les gens quand même s’écartaient quand elle criait de sa petite voix aiguë : « Louis ! » Et Aragon dit : « Bien écoutez, c’est terminé, vous voyez : Elsa m’appelle. » Et Elsa me présente à lui, autre flash du regard d’acier bleu : « Ah c’est toi, mon petit ! » C’était moi le petit… Alors on est sortis, Elsa, j’en ai le souvenir très net, emportait avec elle à Saint-Arnoult, c’était à l’automne, début novembre, des sacs d’oignons de jacinthes, de tulipes pour le parc. Et puis il y avait un brouillard épouvantable, Elsa devant, à côté du chauffeur, j’étais à côté d’Aragon, et j’étais saisi à ce moment-là d’un véritable tétanos, une sorte de paralysie de la timidité. Pour me mettre à l’aise, il me commentait le parcours nocturne par un temps de brouillard à couper au couteau, si bien que c’était véritablement surréaliste au second degré, me disant par exemple du côté de Jouy-en-Josas : « Tu vois mon petit, c’est ici que dans le temps, le jeune Victor Hugo amenait la petite Adèle qui allait devenir sa femme, à des rendez-vous dont le père Fouché ne savait rien, parce que, tu penses qu’il ne voulait pas entendre parler de ce dadaïste ! » Vous voyez, c’était Aragon ça… La première soirée au Moulin a été pour moi tout à fait passionnante parce que j’ai vu Aragon s’installer dans le bureau que vous connaissez, avec une veste d’appartement, mettant des charentaises, et se plongeant immédiatement dans la lecture. Elsa m’a emmené dans son bureau, il y avait la chienne Fifi qui me faisait un tas d’amabilités, ce qui agaçait Aragon qui lui disait : « Fifi, tu fais la putain ! » (Rires). Voilà j’ai passé deux heures à discuter de son livre avec Elsa.
Luc Vigier. Aragon était là ?
Michel Apel-Muller. Oh non, il était dans son bureau, non, il n’y avait pas de mélange, Elsa était farouchement sur la défense de son pré carré. Et puis nous avons dîné, c’est là que vraiment je n’arrivais pas à avaler tellement j’étais ahuri de la situation.
Luc Vigier. C’était allé un peu vite.
Michel Apel-Muller. Ça allait trop vite… Ensuite ça a été dans le grand salon, toute une soirée où il m’a soumis, lui, à une épreuve redoutable : c’était l’époque des Entretiens avec Francis Crémieux et ce soir-là la radio diffusait un de ces entretiens. J’étais assis près d’Elsa dans un fauteuil, Aragon marchait de long en large, le poste donnait les Entretiens et Aragon m’observait écoutant Aragon dans ses entretiens avec Francis Crémieux… Il m’a fait dans la vie quelques coups comme ça, ça a duré jusqu’à deux heures du matin et puis on m’a ramené à temps à Paris.
Luc Vigier. On se sert de quoi dans ces cas-là ? de critères, de réactions brutes ? Comment est-ce qu’Aragon considérait les gens qu’il testait comme ça ?
Michel Apel-Muller. Oh… ça je ne peux pas répondre. C’était une pratique constante d’Aragon, on la retrouve auprès de tous ses interlocuteurs, par exemple soumettre à la lecture à haute voix les textes qu’il était en train d’écrire à un public, alors il surveillait ce public, il guettait ses réactions, moins ses commentaires, il se foutait des commentaires, il guettait les réactions. Alors quelques réactions physiques : le type qui pouvait peut-être paraître s’ennuyer, enfin, je ne peux pas dire… vous comprenez, j’étais soumis comme tout le monde à cette pratique de la lecture, il testait l’auditeur.
Luc Vigier. Un public choisi, un public de grands lecteurs, de grands auditeurs…
Michel Apel-Muller. Oh, je crois que dès qu’il avait quelqu’un sous la main, il y avait droit. (Rires). Ensuite je suis rentré chez moi. Puis évidemment j’ai mis un certain temps à, comment dire, à digérer cette rencontre qui m’avait comblé. Je me sentais absolument privilégié, au point que je ne m’adressais plus du tout à eux m’estimant comblé précisément par le fait qu’ils m’avaient donné toute une soirée. Et puis un mois après j’ai reçu – j’habitais en province – une lettre où j’ai reconnu la grande écriture bleue qui commençait comme ça : « Cher ami vous ne paraissez pas très doué pour la correspondance ! » Du coup j’ai conclu que j’avais été reçu à mon examen et qu’Elsa souhaitait que nos rapports se perpétuent. C’est comme ça que les choses ont commencé, dirais-je pour paraphraser un texte que vous connaissez bien…
Luc Vigier. À l’époque, tu ne pouvais évidemment pas envisager la situation actuelle, être ici au Moulin. Quel est le regard que tu portes aujourd’hui sur ce que tu es devenu par rapport à l’œuvre d’Elsa et d’Aragon ?
Michel Apel-Muller. Je dis que ça fait longtemps, bientôt quarante ans, que tout ça se produisait. Il y a à la fois des concours de circonstances, mais qui ne sont pas tout à fait dus au hasard. Si j’avais moins travaillé dans la durée à la fois l’œuvre d’Aragon et d’Elsa, ça ne se serait pas produit. Je dois dire que dans les années 60, nous n’étions pas nombreux à nous être occupés de l’œuvre d’Elsa. Il y avait certes une critique littéraire, et on sait qu’Elsa était littéralement accablée par la critique littéraire, sauf quelques cas qui ont ceci de rassurant qu’ils étaient le fait de grands créateurs la plupart du temps : des gens qui ont su lire Elsa d’entrée de jeu, c’est Camus, c’est Max Jacob, c’est Martin du Gard et quelques autres…
Maryse Vassevière. Sartre aussi.
Michel Apel-Muller. Sartre aussi, le premier article, il est de Sartre. Mais cela dit, la haine, une sorte d’animosité de la critique à l’égard d’Elsa n’a pas cessé tout au long de sa vie. Ça se partageait, dans le contexte politique et social de la France dans les années 60, entre d’un côté la dérision et de l’autre côté l’hagiographie, ça ne pouvait pas servir d’étude littéraire. Il n’y avait pas d’études littéraires.
Luc Vigier. Mais le succès était là. Tu parlais des files de gens qui venaient acheter ses livres.
Michel Apel-Muller. Oui mais c’était salle Jean-Pierre Timbaud, ça n’est pas innocent… (Rires).
Luc Vigier. C’était un public très choisi…
Michel Apel-Muller. Un public qui choisit lui-même puisqu’il est chez lui salle Jean-Pierre Timbaud, mais c’est un public aussi qui correspondait à des forces sociales et culturelles plus fortes à l’époque qu’elles ne le sont au-jourd’hui. Dans ces années-là, par exemple, pour donner un fait parmi d’autres, le Parti communiste fait 25 % des voix, c’est une des grandes forces politiques et culturelles, pas seulement politiques mais aussi culturelles, de l’après-guerre en France.
Luc Vigier. Tu commences d’abord par être ce jeune homme qui est invité, à qui Aragon et Elsa parlent et puis aujourd’hui tu te retrouves à la tête d’une responsabilité morale importante, alors comment est-ce que tu as géré cela ces dernières années ?
Maryse Vassevière. Ou plus précisément quelles ont été finalement les étapes de ce parcours et qu’est-ce qui fait que tu as pu avoir ainsi la confiance d’Aragon, d’Elsa d’abord, d’Elsa et Aragon quand ils étaient ensemble et d’Aragon ensuite après la mort d’Elsa ? Michel Apel-Muller. Vous avez tous compris que le rapport se fait d’abord par rapport à Elsa. Et Aragon bien sûr, mais je travaillais sur Elsa. Après cette rencontre, j’ai continué à la fréquenter, c’est-à-dire à aller la voir de temps en temps, pas plus…
Maryse Vassevière. Et à écrire des articles sur ce qu’elle faisait.
Michel Apel-Muller. Je me suis trouvé par rapport à la revue qui était la mienne, embarqué presque automatiquement à toujours écrire dès qu’Elsa Triolet publiait quelque chose : c’était à moi qu’il appartenait d’en rendre compte. Alors j’ai rendu compte comme ça de tout de qu’elle a écrit depuis.
Maryse Vassevière. Je t’interromps un petit peu. Est-ce que par exemple tu trouves que ce serait intéressant de reprendre l’ensemble de ces articles que tu as écrits dans La Nouvelle Critique ?
Michel Apel-Muller. Je ne crois pas, parce que si j’avais envie d’écrire aujourd’hui, je ferais tout autre chose.
Maryse Vassevière. Non pas pour les réécrire, mais pour les donner comme un moment de la critique littéraire.
Michel Apel-Muller. C’est un moment… c’est comme on écrivait à l’époque, en tous cas dans La Nouvelle Critique, oui c’est un moment aussi de moi-même. J’habitais la province, et ça, ça crée un rapport sur lequel j’insiste d’entrée de jeu. Ni avec Elsa, ni avec Aragon, je n’ai participé en quoi que ce soit d’une vie mondaine qui était la leur. Quand je dis mondaine, je n’entends rien là de péjoratif, mais je n’ai pas participé à l’univers des rapports multiples qu’ils avaient avec Paris, le monde culturel, etc. Quand je venais, j’avais rendez-vous avec Elsa, elle me consacrait le temps qu’il fallait, ça durait également après avec Aragon, mais je ne les accompagnais pas au théâtre, à la rédaction des Lettres françaises, dans les dîners qu’ils donnaient, bon je n’étais pas là… Je me souviens d’ailleurs qu’Antoine Vitez avec lequel je me suis évidemment un peu lié puisque dès 1985 s’est constituée l’Association pour la Fondation, il était membre du Conseil d’Administration et j’avais la direction des choses, donc le lien s’établit avec Antoine – un lien d’ailleurs auquel je tiens beaucoup dans mon souvenir et dans mon affectivité. Et Antoine me disait : « Mais je ne comprends pas que nous ne nous soyons jamais rencontrés chez Elsa et Louis. » À quoi je lui répondais : « Moi, j’habitais en province, et je n’étais pas toujours fourré chez Aragon et Elsa. Quand j’allais les voir, ils me donnaient un rendez-vous et nous étions en général seuls. » Il va de soi que La Nouvelle Critique m’a fait un peu connaître comme quelqu’un qui apparaissait comme, on disait déjà ce mot-là, un spécialiste – je n’aime pas beaucoup ces mots-là. Ce qui a entraîné Pierre Abraham à me demander d’intervenir aussi dans Europe où j’ai fait un premier article, « Michel Vigaud c’est moi », puis ultérieurement j’ai pris en charge la responsabilité des numéros sur Aragon romancier, Aragon poète, Elsa Triolet et Aragon. Les choses se produisent comme ça, il y a un effet boule de neige qu’on ne voit dans sa constitution qu’après coup. Au moment où ça se produit, on vit sa propre vie, on écrit un article ici, voilà. Je veux dire donc que ma relation a été d’abord une relation avec Elsa. Mais attention, l’amitié avec Elsa, c’est l’amitié d’un jeune prof avec une grande dame qui est une vieille dame dont l’abord n’était pas facile dans les années 60. Elsa n’était plus cette jeune femme gaie dont parle Vladimir Pozner, qui aimait danser, qui aimait rire, c’était quelqu’un qui était d’aspect sévère et exigeant. Je crois qu’elle en avait vu assez pour s’éviter toutes les précautions oratoires, toutes les précautions de style dans les rapports avec les gens. À cet âge, à cette période, quand elle avait en face d’elle quelqu’un dont elle pensait qu’il était un salaud, elle lui disait : « Vous êtes un salaud, quittez ma maison et n’y revenez jamais. ». Ça ne la rendait pas toujours populaire, ces réactions… Donc ce n’est pas quelqu’un avec qui on pouvait se permettre d’être familier. Je l’appelais “Madame”, elle me disait : « Mais appelez-moi donc Elsa ! », je n’y arrivais pas bien entendu.
Luc Vigier. Et comment se passaient les entretiens ? Est-ce que c’était dirigiste ou vraiment très ouvert ?
Michel Apel-Muller. Eh bien, ça se passait en général dans son bureau, rue de Varenne essentiellement, dans le petit salon. Il y avait sa petite table, elle me faisait asseoir, elle appelait Maria, j’avais le choix entre le thé et le café, elle, elle prenait du thé, moi je prenais du café. C’est dire qu’il y a deux cultures là derrière. Et puis c’était une conversation apparemment à bâtons rompus, mais qui pouvait durer deux heures, sur son œuvre, car progressivement je m’engageais dans ce qui allait devenir une tentative universitaire, et je lui posais des questions, elle répondait, elle répondait en se dérobant quelquefois, c’était passionnant.
Luc Vigier. Sur quoi ?
Michel Apel-Muller. Sur une influence quelconque qu’elle ait reçu de qui que ce soit, surtout pas l’influence d’Aragon. Je pense qu’elle avait raison, elle se défendait de toute influence d’Aragon qui n’en exerçait aucune d’ailleurs. Ils n’écrivaient pas de la même façon. Je me souviens, ça faisait partie du rituel, j’arrivais rue de Varenne, Maria ouvrait la porte, m’emmenait à Elsa, j’avais rendez-vous avec Elsa, mais au bout d’une heure la porte de communication s’ouvrait, Aragon me disait bonjour, se mettait à marcher de long en large et il n’y en avait plus que pour lui, bien entendu…
Maryse Vassevière. Donc là c’était l’inverse de ce qui se passe dans les Entretiens : c’était “Aragon entre dans l’entretien”!
Michel Apel-Muller. Voilà ! Aragon entre dans l’entretien et ne laisse plus la parole à Elsa et évidemment les yeux d’Elsa s’assombrissaient et c’était là qu’elle produisait ce que je me plais souvent à raconter, cette irruption d’Aragon dans son soliloque : « Louis, attention tu es en train de me marcher sur le corps. » Alors il se retirait en riant, mais quand je prenais congé d’Elsa, comme la porte de son bureau se trouvait exactement en face de la porte de sortie, hop! il me rattrapait et j’avais droit à une heure d’Aragon dans son bureau, une heure où il me lisait en général des choses qu’il était en train d’écrire.
Luc Vigier. Quelle était la réaction d’Elsa par rapport au public universitaire ?
Michel Apel-Muller. Je m’étais posé à un moment le problème d’écrire un essai sur les romans d’Elsa qui aurait pu paraître, dans le contexte de l’époque, aux Éditeurs Français Réunis. Elle me dit : « Non je suis beaucoup plus intéressée par un projet universitaire. » Visiblement elle souhaitait que l’Université s’intéresse à elle, ce qui n’était pas le cas jusque-là, et dans une certaine mesure j’ai été le premier à la faire entrer à l’Université. Je dois quand même faire ici la place à la mémoire d’une jeune femme, qui s’était engagée dans une entreprise parallèle à la mienne, elle s’appelait Nicole Morel, elle avait aussi rencontré Elsa, elle m’avait écrit, elle préparait une thèse de troisième cycle et elle est morte dans un accident assez tragique – elle est tombée sous un train, une chose terrifiante et consternante – et je pense encore à elle aujourd’hui, car elle était une de ces pionnières. Et je crois même que dans le premier n° d’Europe sur Elsa Triolet et Aragon, il doit y avoir quelque chose d’elle. Donc, ce qu’il faudrait essayer de comprendre aussi c’est que dans ces années-là, la fin des années 60, après la réaction qui a suivi 68, quand je dis réaction, je dirais presque au sens de restauration, ce n’était pas le projet d’une grande carrière universitaire de choisir un sujet sur Elsa Triolet. Il y a une chose en moi qui était assurée, c’est que la rencontre d’Aragon et d’Elsa avait relativisé toute idée de carrière et par exemple j’étais devenu assistant à la fac de Besançon, parce que le contact avec les étudiants je l’aimais et puis ça me permettait de travailler autrement, mais moins pour réaliser le profil canonique de l’universitaire que ce que j’entendais faire avec des gens qui me montraient qu’évidemment la culture, elle se passait, allez je vais être méchant, pour l’essentiel ailleurs qu’à l’Université. J’avais vu Aragon écrire, et j’avais compris, d’abord intuitivement puis en analysant un peu mieux, que cette écriture-là n’était pas celle qui consistait à comptabiliser les pages de sa thèse pendant une durée donnée et qu’on pouvait exprimer en kilos. Dans les années 70, j’ai vu Aragon écrire l’essentiel de Théâtre/Roman c’était quelque chose d’absolument éblouissant !
Luc Vigier. Et est-ce qu’Aragon et Elsa t’ont invité à écrire toi-même ?
Michel Apel-Muller. Non… Je ne me présentais pas à eux comme un poète, comme un romancier, comme un créateur. J’étais quelqu’un qui faisait de la critique et des études littéraires. Bon, alors les choses sont allées ainsi jusqu’en 70, et puis Elsa meurt, prématurément. J’ai repris contact assez vite avec Aragon parce que j’ai appris qu’il souhaitait me voir. Je n’osais pas le déranger après la mort d’Elsa, et à l’époque c’est Guy Besse, qui était le responsable du Bureau Politique du Parti communiste français en charge des intellectuels, qui m’a passé un coup de fil en me disant : « Écoute, Louis souhaite te voir pour te parler, il t’attend. » Alors j’ai appelé Aragon, il m’a dit cela qui m’a beaucoup ému : « Quelques minutes avant qu’elle soit frappée par la crise cardiaque, elle me parlait de toi. Écoute, tu viens. » Et le contact avec Aragon seul commence vraiment le 14, 15 et 16 juillet 1970, ici au Moulin où je le rejoins et où il était en compagnie de Lili et de son mari Vassili Katanian. Il y avait aussi le petit Dominique Tron, qui était un jeune poète dont Elsa avait repéré la qualité et dont s’était entichée Lili après la mort d’Elsa. Il était là comme une sorte de petit elfe qui dansait autour du bassin. Et alors il se passe ce rapport tout nouveau qui va s’établir entre Aragon et moi et qui est différent de ce qu’il était jusque-là.
Maryse Vassevière. Est-ce que tu peux donner quelques précisions sur ce rapport nouveau qui est lié d’une part à l’absence d’Elsa et à ce que peut-être Aragon pense du rôle que tu pourrais jouer dans les affaires d’Elsa, la mémoire d’Elsa, le travail universitaire sur Elsa qui pourrait s’engager ?
Michel Apel-Muller. C’est exactement cela, Aragon me demande de venir le voir pour poursuivre le travail entrepris sur Elsa et pour m’aider dans ce que je fais sur Elsa et pour qu’éventuellement je l’aide lui aussi dans ce qu’il entreprenait à l’époque, un classement des archives d’Elsa dont Maryse, tu as été la première à me rappeler l’existence d’un texte écrit à cette époque-là, la lettre à Marc Delouze. C’est ainsi qu’il va me demander de prendre en charge un certain nombre de choses, notamment une exposition sur Elsa : un an après la mort d’Elsa, il y a eu deux expositions, une à la Bibliothèque Nationale dont vous avez pu voir le catalogue…
Maryse Vassevière. Oui, et l’exposition elle-même, ça c’était l’exposition de 72.
Michel Apel-Muller. Et une exposition d’un autre type, qui a été réalisée par moi et qui s’appelait « Écoutez-voir Elsa Triolet » présentée pour la première fois lors de l’inauguration de la Bibliothèque Municipale de Marseille, avec Gaston Defferre et Edmonde Charles-Roux, puis elle est passée à la chapelle du Palais des Papes pendant le Festival d’Avignon, puis de là elle a fait une tournée en France où dans la plupart des cas Aragon m’a accompagné, au Havre, par exemple.
Luc Vigier. On est toujours dans le cadre de la célébration, de la commémoration. Elsa en 72 est déjà quelqu’un qu’on commémore, qu’on considère comme un monument du siècle. Comment ça se passe ? Dans quel esprit c’est fait ? Michel Apel-Muller. Et bien quand il y a une initiative de la Bibliothèque Nationale, c’est l’hommage de la Bibliothèque Nationale à quelqu’un qui est considéré comme un écrivain qui compte. La Bibliothèque Nationale ne fait pas une exposition de n’importe quoi, n’importe comment. L’exposition à laquelle moi j’ai donné la main, est une exposition faite davantage par ses amis, au sens intime du mot, mais aussi au sens général, ses amis de la Résistance, ses amis de la politique, ses amis qui appartiennent au courant incarné par le Mouvement de la Paix, le Parti communiste, toute cette aire démocratique à laquelle elle avait donné beaucoup. La structure économique de l’exposition, c’était une ville communiste, Bobigny, et on m’avait fourni une équipe de décorateurs tout à fait remarquables. Il fallait trouver une idée et l’idée était ce que j’ai publié dans le n° spécial d’Europe, « Le labyrinthe » : c’est à partir de là que l’architecte a tiré la structure de l’exposition faite de 16 cellules triangulaires en forme de labyrinthe, si bien qu’on entrait dans l’œuvre d’Elsa Triolet, de cellule en cellule, comme dans un labyrinthe, qui correspondait à ce que mon analyse montrait de l’œuvre d’Elsa qui s’inscrit dans un univers volontiers labyrinthique.
Luc Vigier. Justement ça fait penser à l’exposition sur Aragon à la Fête de l’Humanité en 97. C’était structuré en labyrinthe aussi.
Maryse Vassevière. Oui je pensais justement à cela moi aussi.
Luc Vigier. Est-ce qu’on peut parler du rapport d’Elsa Triolet à l’architecture parce que c’était sa formation initiale ? Est-ce qu’il y avait un lien entre ce qu’elle écrivait et l’architecture, la construction, dans Le Monu-ment par exemple ?
Michel Apel-Muller. Elle ne m’en a jamais parlé en ces termes. Il est sûr que dans le quotidien elle était très très attentive à des aspects de la vie qui s’expliquent en partie par cette formation-là. Il y avait en elle un architecte décorateur de son intérieur. Il suffit de voir le grand salon du Moulin, il suffit d’avoir connu l’appartement de la rue de Varenne, pour voir partout la présence, le goût d’Elsa qui est un mélange de choses occidentales et orientales, comme le grand salon ici, n’est-ce pas.
Luc Vigier. Et l’architecture des colliers aussi, cette préciosité, cette minutie dans la construction, est-ce que ça faisait partie de ses pratiques d’écriture ?
Maryse Vassevière. Et en même temps cette modernité, parce que les colliers d’Elsa, ce sont des choses qui ensuite vont se faire à grande échelle pour le commerce dans les années 80. Et de ce point de vue-là elle est assez pionnière.
Michel Apel-Muller. Je ne pense pas qu’on puisse établir une homologie aussi nette, aussi rapide, entre les pratiques artistiques d’un certain type comme les colliers, la bijouterie et l’écriture. Il y a un acte de langage d’un côté et un acte d’une autre nature de l’autre côté. Que l’éducation et la culture d’Elsa l’aient rendue apte à pratiquer l’un et l’autre, c’est sûr, mais est-ce qu’on peut faire des transferts comme ça, je ne m’y aventurerais pas.
Luc Vigier. La responsabilité, l’héritage que tu as assumés jusqu’ici, l’héritage moral, ne sont venus donc qu’après la mort d’Elsa à travers Aragon.
Michel Apel-Muller. J’insiste sur un point ici, c’est qu’Aragon après la mort d’Elsa était dans la conviction absolue qu’il ne lui survivrait que de très peu. Je me souviens d’une conversation où il s’agissait de ce n° d’Europe, le deuxième, après la mort d’Elsa, et un n° comme ça se prépare un an à l’avance, et Aragon s’impatientait : « Dans un an ? Mais mon petit je ne serai plus là. Où serai-je en tout cas ? » C’est un propos qu’il tenait à moi, à d’autres, il était persuadé qu’il allait mourir. Cela s’accompagnait d’un phénomène de tachycardie qui lui donnait des crises inquiétantes, de suffocation, d’oppression, il se croyait plus gravement atteint qu’il ne l’était, parce qu’en réalité les cardiologues qui l’ont examiné ont dit que la tachycardie ça n’était pas bien méchant et le traitement a fait que tout cela finalement a disparu après.
Maryse Vassevière. C’est peut-être le contrecoup de la mort d’Elsa.
Michel Apel-Muller. Peut-être, encore que ça se produit déjà avant sa mort. Mais la maladie d’Elsa, la découverte dont témoigne Les Chambres qu’Elsa contrairement à tout ce qu’il avait imaginé et mis en scène, en bon machiste qu’il était, c’est-à-dire sa mort programmée devant Elsa, c’est une idée d’homme. Partir le premier, un jour tu verras mon visage…
Luc Vigier. Est-ce que la mort était un sujet de préoccupation d’Elsa ?
Michel Apel-Muller. Absolument.
Luc Vigier. Ils en parlaient tous les deux ?
Michel Apel-Muller. Sans doute. Enfin, j’en sais rien… À moi elle m’en a parlé. La dernière fois que je l’ai vue, que j’étais allé lui rendre visite, c’était peut-être un mois avant sa mort, il y avait six mois que je ne l’avais pas vue et je l’ai trouvée très atteinte, très fatiguée. C’était une toute petite vieille, amaigrie, qui marchait à tous petits pas, qui parlait avec une minuscule voix, j’avais perçu cela et elle m’a dit : « Mais je suis toujours malade, c’est un roman » et elle ajoute en me regardant : « D’ailleurs je vais mourir. » Alors quand quelqu’un produit cette affirmation, on est stupide comme tout, on tente de répondre quelque chose, de protester, je ne sais plus quel bégaiement j’ai produit et elle me dit : « Mais non, pas vous, allons, je vais mourir, et j’en suis bien contente, j’en ai assez. » La seule chose qu’elle a ajoutée et je vais vous le dire, c’est : « La seule chose qui me préoccupe est ce qu’il va devenir sans moi. » Toute cette année, tout cet automne 71-72, je l’ai passé chez Aragon : tous les jeudi et les vendredi. J’habitais la petite ville de Mâcon, j’enseignais à l’Université de Besançon, je quittais mon domicile le mardi matin, je faisais mes cours à Besançon, de Besançon je partais à Paris, j’habitais rue de Varenne, je rentrais le samedi chez moi. J’ai fait ça pendant un an. J’habitais donc chez Aragon, dans la chambre d’ami qu’il a appelée d’abord “La chambre de Lili” puis qu’il a appelée “La chambre de Rostropovitch” puisque c’est là que Rospropovitch a couché.
[Blanc. Michel Apel-Muller commence à parler du sort des manuscrits]
Pour ses papiers il ne voulait pas entendre parler de la Bibliothèque Nationale du fait de la durée trop longue entre le dépôt et la consultation, souvent un demi-siècle. Il voulait moins encore entendre parler du Fonds Doucet, mais pour des raisons qui tenaient à son passé, il n’avait pas de bons souvenirs du Fonds Doucet. De la même façon – c’est François Chapon qui m’a raconté ça – il allait voir de temps en temps le fonds qu’il avait laissé là-bas et comme il écrivait sur des papiers dont les supports commençaient à prendre de l’ancienneté, ces papiers s’effritaient, alors il se fâchait en disant que c’étaient les souris, François Chapon levait les bras au ciel, vous l’imaginez bien, comme si les souris avaient pu dévorer les papiers d’Aragon ! Donc ils ne voulaient ni l’un ni l’autre et les choses sont restées comme ça en suspens pendant un certain nombre d’années. Vous voulez savoir comment ça s’est produit cette idée de les confier au CNRS ?
Maryse Vassevière. Oui.
Michel Apel-Muller. Cela s’est produit à l’occasion d’une soutenance de thèse. Le déclic, il est là. C’est la soutenance de thèse de notre collègue Almuth Grésillon de l’ITEM. Font partie du jury Louis Hay et Jean Peytard qui était mon patron à la fac de Besançon, le professeur responsable de la section de Linguistique française à laquelle j’appartenais. Louis Hay, qui avait été lui-même assistant d’Allemand à Besançon, venait de prendre la direction d’un laboratoire qu’on créait, le CAM (Centre d’Analyse des Manuscrits) dont la visée était l’examen, qui jusque-là ne se pratiquait pas systématiquement, des manuscrits modernes et contemporains. Et, à l’occasion de la soutenance d’Almuth Grésillon, Louis Hay entretient Peytard de ce projet. Peytard évidemment pense à moi et à peine de retour il me dit : « Tu crois pas que ça intéresserait Aragon ? » Évidemment j’aperçois tout de suite l’intérêt de la chose. Louis Hay, j’avais fait sa connaissance au colloque de Cluny II – on en reparlera de ces colloques, j’ai été deux fois secrétaire général de ces colloques de La Nouvelle Critique, Cluny I et Cluny II – par conséquent je lui passe un coup de fil : « Est-ce qu’éventuellement le CNRS, et le CAM en particulier, seraient intéressés par un rapport à Aragon, parce que je sais, il me l’a assez dit, qu’il cherche une solution à l’existence de ses manuscrits et de ceux d’Elsa après lui, et ne veut entendre parler ni de la nationale, ni de Doucet. » Louis Hay très intéressé au bout d’un certain temps me dit : « Les premiers coups de sonde que j’ai lancés auprès du CNRS montrent que ça l’intéresserait beaucoup. » Alors je lui dit qu’il y aurait une petite contrepartie : « Aragon a un jeune collaborateur qui s’appelle Jean Ristat, qui n’a pas beaucoup de ressources et je pense qu’il souhaiterait qu’en échange le CNRS fasse quelque chose pour Jean Ristat. » Dès que Louis Hay m’a eu donné quelques garanties verbales sur la possibilité de la chose, je me suis rapproché d’Aragon et je me suis rapproché surtout de Jean, dont j’avais fait la connaissance quelques temps plus tôt – je vous raconterai comment, parce que là encore quand on veut connaître Aragon ça ne manque pas de sel cette affaire. J’ai dit à Ristat : « Voilà, si Louis acceptait de léguer ses manuscrits, il serait bien reçu par le CNRS avec des manuscrits aussitôt ouverts à la recherche avec un laboratoire qui vient de se créer et anecdotiquement, tu y trouverais une place. » Il ne faut pas croire qu’Aragon a dit oui tout de suite. Aragon affectait une surdité plus grande que sa surdité réelle quand il y avait des problèmes comme ça. Il aura fallu tout l’hiver pour que Jean Ristat arrive à le décider. Il disait non, et il jouait les sourds, au point qu’au restaurant, Ristat et lui échangeaient des petits billets pour qu’il lise la proposition Mais il ne voulait pas. Il est resté très longtemps dans cette position de refus.
Maryse Vassevière. Et pourquoi ? Est-ce qu’il donnait des raisons ?
Michel Apel-Muller. Non, il ne donnait pas de raisons… C’était non, et puis un jour ce fut oui.
Luc Vigier. Dans le texte du legs, il évoque des acheteurs, des gens qui voulaient lui acheter ses manuscrits et que ça le dégoûtait de faire ça. Est-ce que c’est vrai ?
Michel Apel-Muller. Bien sûr que c’est vrai ! Mais il faut dire aussi que tous les surréalistes étaient spécialistes de la vente des manuscrits, y compris des manuscrits faux, de ceux qu’on refabriquait et qui permettaient de rouler le bourgeois. Ça ce sont les arguments qu’il donne et ils sont réels. Il faut savoir quelles sont les mœurs dans cet univers des manuscrits. Quand Aragon préparait L’Œuvre poétique, il y a eu des marchands d’autographes qui sont venus le trouver en lui disant : « Je parie que vous l’avez oublié ce texte. » C’était un texte automatique des années 20 qu’Aragon avait complètement oublié. « Et ça fait tant… » Et Aragon a été obligé de racheter.
Maryse Vassevière. Ah ça c’est un peu fort…
Michel Apel-Muller. C’est un peu fort, oui. Aragon a racheté ce texte… Dans cette période il était un peu exaspéré par tous ces problèmes, c’est vrai. Ma conviction, mais c’est pas une preuve que je donne là, c’est une conviction, c’est que ce projet a rencontré en lui un autre, celui qu’il avait exprimé dans l’article que tu as retrouvé…
Maryse Vassevière. L’article des Lettres françaises.
Michel Apel-Muller. L’idée que les choses c’était ici, que les manuscrits d’Elsa devaient être dans la maison, il a écrit un très beau texte là-dessus. Toujours est-il qu’un matin Jean me prévient : « Il vient de dire oui, mais il veut que ce soit fait tout de suite maintenant. » Il était ainsi. Bon, les choses se sont faites de cette façon-là. Je suis allé le voir et nous avons rediscuté ensemble du projet : « Bon, je vais vous amener les gens du CNRS. » Il me dit : « Écoute, prépare-moi un petit texte. » Si bien que du texte de la donation, je suis l’auteur du brouillon au moins. C’est-à-dire que nous nous sommes retrouvés autour de la table de sa salle à manger. Il y avait Aragon, Jean Ristat, Louis Hay et moi-même. Et c’est là que sur le projet que je lui ai ap-porté, Aragon a fait des ratures, a fait ajouter « la Nation française » et la formule célèbre « quelle que soit la forme de son gouvernement ».
Par ce document que vous connaissez, le legs, Aragon établissait que pour ce qui était d’Elsa, j’avais à m’occuper des choses et il chargeait Jean de s’occuper de son œuvre.
Luc Vigier. Et matériellement, comment la transmission s’est-elle faite ? Est-ce qu’Aragon a fait un tri préliminaire ? Est-ce qu’il y a eu un classement à ce moment-là ?
Michel Apel-Muller. À ce moment-là, quand Louis Hay est venu, Aragon est allé chercher une boîte, une boîte d’archives, il me semble un fragment du manuscrit du Fou d’Elsa, en le lui montrant. Il en a apporté d’autres le jour de la cérémonie officielle au CNRS. Il est évident qu’il a fallu tout de même attendre un certain temps avant que le Fonds soit constitué. On ne pouvait pas de son vivant aller lui vider ses tiroirs. Les difficultés ont commencé avec le CNRS autour de cette chose. Mais on peut suspendre un peu la chronologie et revenir sur d’autres aspects.
Maryse Vassevière. Tu nous a parlé des circonstances de ta rencontre avec Jean Ristat, en nous disant qu’il faudrait faire une petite parenthèse. On pourrait la faire maintenant.
Michel Apel-Muller. C’est pendant que je travaille sur l’exposition. Je travaillais dans la journée dans la chambre dite “de Rostropovitch” qui fait face au bureau d’Aragon. Il faut avoir une idée de l’appartement de la rue de Varenne. Il se distribuait selon un immense couloir, il faisait 25 ou 30 mètres ce couloir et de part et d’autre il y avait différentes pièces. La chambre d’Aragon et d’Elsa se trouvait à l’autre bout, en face de la cuisine de Maria. Moi j’étais à un bout de l’appartement et je voyais à l’autre bout – Aragon allait de l’un à l’autre – un groupe de jeunes gens, ils étaient plusieurs dont Jean, qui travaillaient avec lui à d’autres choses, Les Lettres françaises étaient encore vivantes, et Aragon ne nous présentait pas. C’est une caractéristique d’Aragon d’avoir comme ça des zones où il intervenait sans du tout établir de pont entre les gens. Jean et moi nous nous sommes rencontrés et liés de notre propre initiative. Et le jour où nous sommes arrivés ensemble auprès de lui, il a éclaté de rire en disant : « Et bien voilà les deux complices ! » Vous voyez comme Aragon c’est un grand seigneur complexe qui organisait autour de lui son petit monde.
Luc Vigier. Le roi s’amuse, là…
Michel Apel-Muller. Oui, si on veut. Dans toute cette période, il n’y avait pas seulement le groupe des jeunes poètes auprès de lui, il y avait quand même un de ses amis fidèles, auquel je veux ici rendre hommage, c’est Jean Marcenac. Pendant toute cette période, de 70 à 73, Marcenac et sa femme Andrée, ont été auprès d’Aragon les amis les plus proches, les plus dévoués. Il faut savoir qu’Aragon s’ennuyait et qu’à n’importe quelle heure du jour ou quelquefois de la nuit, il téléphonait à Jean Marcenac : « Viens me rejoindre à Paris ou je viens vous voir. » Marcenac a été d’un dévouement constant, il habitait à Saint-Denis, il n’était plus tout à fait un homme jeune, ni toujours en bonne santé. Il a eu un grand dévouement amical à l’égard de Louis. Il a été un petit peu écarté par Louis d’une façon que j’ai trouvée moi, un peu douloureuse. Il arrivait à Jean d’être un peu maladroit, c’est vrai, mais… il aura été un ami très fidèle.
Maryse Vassevière. Est-ce qu’on peut parler aussi de ces nouvelles relations qu’Aragon noue à ce moment-là ? C’est un peu différent, ce n’est plus lié à l’historique de tes propres relations, des archives… Michel Apel-Muller. Aragon a toujours cherché ce qui dans la poésie, dans le roman, apparaissaient comme des voix nouvelles, des voix de qualité. Il suffit de se rappeler la manière dont il a salué des gens comme Sollers, Roubaud et tant d’autres… Il poursuit cette recherche des talents nouveaux après la mort d’Elsa, avec l’idée de continuer Elsa – il ne faut pas oublier le travail d’Elsa avec le groupe des jeunes poètes – avec l’idée aussi que les seuls êtres qui lui permettent de vivre sans trop s’ennuyer, ce sont les jeunes générations. Ça il me l’a dit dix fois : « Les gens des autres générations – [et c’était la mienne aussi qui était concernée] – ne m’intéressent plus guère, n’ont plus rien à me dire. Il n’y a plus que la jeunesse qui m’intéresse ». Alors autour de lui se constitue ce groupe de jeunes gens qui a fait jaser et dont les rapports à Aragon étaient entre eux des rapports d’extrême jalousie. Quant à lui c’étaient aussi des rapports un peu amoureux. Je vois pas ce que je peux te dire de plus. Je peux te dire une chose : on a parlé beaucoup – alors on va aborder ces problèmes – de l’homosexualité d’Aragon. Elle est réelle, comme finalement – et ce n’est pas une invention que je fais là, c’est un vieux poncif – elle est vraie en chacun d’entre nous. Mais un jour Aragon a cru nécessaire de m’en parler. Je ne lui avais rien demandé… Le propos qu’il m’a tenu m’a paru à la fois un peu court et un peu émouvant parce que c’était un acte de confiance envers moi. Il m’a dit : « Tu vois, ces jeunes gens il faut que je t’en parle. Je ne peux plus aimer une femme après Elsa, mais j’ai encore besoin d’aimer, voilà. » C’est assez beau en soi pour se dispenser d’aller plus loin.
Maryse Vassevière. Oui.
Michel Apel-Muller. C’est ainsi. Je pense qu’effectivement Aragon était un homme d’une affectivité à la fois complexe et immense. C’est un homme qui ne pouvait vivre qu’en aimant.
Maryse Vassevière. Beaucoup des amis d’Aragon, de ceux notamment qu’on a déjà interviewés, comme François Nourissier, Francis Crémieux ou d’autres, Joë Nordmann, ont dit que finalement à ce moment-là ils n’ont plus compris Aragon, qu’il leur a échappé mais que finalement Roland Leroy leur disait que ces jeunes gens c’était aussi ce qui l’aidait à vivre. C’est Francis Crémieux qui dit ça : Roland Leroy lui a permis de comprendre cela, que ces jeunes gens c’était aussi une manière de continuer à aimer en effet et une forme de survie. Il y a aussi toute l’analyse de ceux qui pensent que, avec cette pé-riode-là, c’est une manière de redevenir lui-même et donc de vivre dans l’authenticité ce qu’Elsa aurait refoulé. C’est peut-être beaucoup plus complexe que cela aussi.
Michel Apel-Muller. Oui. Qu’Elsa ait refoulé dans le rapport à quelqu’un avec qui elle vivait, un certain nombre de choses, c’est possible. Je vois mal d’ailleurs comment une femme pourrait ne pas le faire… L’Aragon de la jeunesse n’est pas tout à fait, quoi qu’on ait dit, celui de la vieillesse. Il y a eu, on le sait, certaines expériences dans la jeunesse…
Maryse Vassevière. Dont témoigne La Défense de l’infini.
Michel Apel-Muller. Oui et dont témoignent des anecdotes diverses…
Maryse Vassevière. Drieu…
Maryse Vassevière. …ou Breton ?
Michel Apel-Muller. Je sais qu’Aragon me disait, me parlant de l’homosexualité, que ce n’était pas en odeur de sainteté dans le groupe fondamental du surréalisme, ni l’homosexualité, ni la drogue. C’est le groupe ultérieur qui a analysé toutes ces choses.
Maryse Vassevière. Pourtant Claudel caractérisait les surréalistes en disant : « Tous des pédérastes. »
Michel Apel-Muller. Oui mais enfin Claudel… Bien, passons. Oui, ce que je vois avec ces jeunes gens et quelques autres qui étaient des artistes, des peintres, c’est qu’il y a eu une homosexualité d’Aragon dans sa grande vieillesse et qui est la forme que prend à la fois une exigence physique qui fait qu’Aragon est un vieil athlète et en même temps une exigence affective gigantesque. Je vais vous dire encore une autre chose un peu curieuse. Nos rapports n’étaient pas simples. Certains jours il me tutoyait, la plupart du temps, “Mon petit”, quelquefois tout d’un coup quand il s’agissait d’Elsa, il me disait “Vous”.
Luc Vigier. C’est intéressant cette rupture, cette scission entre les deux instances. Justement je voulais te poser la question du rapport qu’il avait avec ses spectateurs dont il s’entourait, les jeunes gens, toi et les autres. Est-ce qu’il les désignait un peu comme Matisse l’avait désigné comme témoin ? Est-ce qu’il y avait quelque chose d’explicite là-dedans ? Est-ce qu’il y avait un message qui serait : « Vous direz aux autres, aux futures générations ce qu’était le dernier Aragon » ?
Michel Apel-Muller. C’est à eux qu’il faut le demander. Il faut en parler à Jean Ristat.
Luc Vigier. Je te le demande à toi aussi.
Michel Apel-Muller. Oui, mais ce n’est pas à moi qu’il a dit des choses. Je me suis trouvé finalement au fur et à mesure que le temps passait, le seul représentant de ma génération en relation suivie avec lui. Il y avait quelquefois Elsa, et je me suis demandé, le jour où il m’avait fait cette confidence, qui était à la fois un acte de confiance et en même temps l’idée que quelque part je représentais un peu Elsa. Je ne sais pas, je me suis posé de ces questions mais allez répondre à des questionnements pareils… Ce qui est certain c’est que, y compris avec ces jeunes gens, il y avait des choses un peu amusantes. [Michel Apel-Muller raconte qu’Aragon avait fait la connaissance d’un de ses anciens élèves et que cela le gênait.] Pendant toute une soirée il m’a raconté sa rencontre avec Hamid Fouladvind. Ces jeunes gens partaient avec lui en vacances à Toulon, j’allais le voir à Toulon au milieu d’eux. Je ne vois pas ce qu’on peut ajouter de plus, sauf à dire très tranquillement qu’Aragon a fait tomber ce genre de préventions morales, les idées qui rêvent toujours d’un ordre moral qu’on porte toujours avec soi sans en être conscient et selon lesquelles en matière d’aimer il y a des choses qui sont permises et d’autres pas. Dans l’amour tout est permis : je crois qu’il a contribué beaucoup à cette idée-là et que là encore il a été en avance.
Luc Vigier. C’est pourtant de cette période-là que les contempteurs d’Aragon parlent de pathétique, de laisser-aller. C’est une des périodes sur laquelle on s’acharne, justement parce qu’elle est peut-être trop libre.
Michel Apel-Muller. Absolument. Et le propos relève toujours du même ordre moral qu’on peut trouver dans la parole des vieilles dames qui se présentent avec le ruban violet de la confrérie de Sainte-Anne… même certaines biographes.
Maryse Vassevière. À l’inverse, il y a un très bel hommage d’Antoine Vitez à ce vieil homme indigne.
Luc Vigier. À propos de vieil homme indigne – mais peut-être que c’est une question qui ne mérite pas qu’on y réponde – est-ce qu’Aragon parlait de sexualité ou est-ce que c’était un sujet tabou ?
Michel Apel-Muller. Oui il pouvait en parler sur différents modes et différents tons, et parfois quand il était de bonne humeur sur le ton de la gaudriole. On sait comment Aragon est un extraordinaire peintre de la relation masculine, entre les anciens combattants par exemple dans Aurélien. Il y a une finesse extraordinaire, il est au cœur de ce rapport entre les hommes, de leur conversation à la fin d’une table, etc. Mais il était volontiers comme ça, je crois qu’il aimait le rapport masculin. Il était très bien dedans. Luc Vigier. Caubère dit sur la publicité de son spectacle : « Tout m’intéresse chez Aragon, il manque justement le sexe. »
Michel Apel-Muller. Il ne faut pas exagérer… s’il ne l’a pas rencontré, c’est qu’il a fermé les yeux, Caubère, parce qu’il est partout le sexe. Pas seulement dans Le Con d’Irène. Luc Vigier. Mais dans Le Monde réel, il faut le chercher.
Michel Apel-Muller. Comment ça ? Carlotta et le père Barbentane et le bordel ?
Maryse Vassevière. Oui.
Michel Apel-Muller. Il est partout.
Luc Vigier. Par allusions.
Maryse Vassevière. Il est suggéré.
Michel Apel-Muller. Plus que par allusions quand même… Quelquefois d’ailleurs une allusion est bien plus terrible du point de vue de la sensualité et de l’érotisme qu’une description naturaliste. Je pense que la sexualité est très présente comme elle est présente dans l’œuvre de tous les surréalistes qui ont fait tomber les barrières.
Luc Vigier. C’est aussi la période des dessins.
Michel Apel-Muller. Il dessine surtout à partir du moment où l’écriture lui échappe. Il est arrivé un moment – comme chez Victor Hugo, les dernières années il n’écrivait plus – où Aragon a senti la somptueuse machine à penser et à écrire commencer à lui échapper. J’en ai eu d’ailleurs la révélation ultra-douloureuse à Toulon. J’étais allé le voir à Toulon, je l’avais trouvé très mal, il me dit : « Viens on va monter dans ma chambre. Je suis fatigué, j’ai des boutons dans le dos. » Il relève sa chemise et il me montre un dos qui était couvert d’énormes furoncles. Dans sa chambre, il s’est mis à me lire ce qu’il réécrivait sur Max Ernst, et trois fois de suite il m’a lu la même page sans s’en apercevoir, et au bout de la troisième fois il en a quand même pris conscience et je l’ai vu blêmir et j’ai senti que l’atteinte était là.
Luc Vigier. L’écriture était-elle malgré tout encore possible ?
Michel Apel-Muller. Oui, c’est les derniers moments de l’écriture, après il dessine, pour s’occuper. Je ne sais pas si vous avez vu une petite exposition qu’avait donnée Hamid Fouladvind au Palais-Royal. C’est une curiosité, ça n’a pas la qualité des dessins de Victor Hugo. C’est une activité de la fin de sa vie, de la même façon qu’il passe ses nuits à épingler, à s’entourer des témoignages de sa vie, ces lettres, ces cartes postales, ces poèmes, ces photos qu’il épinglait partout…
Luc Vigier. On se demande, lorsqu’on connaît le tourbillon de rencontres qu’il y avait ici à St-Arnoult et à Paris, à quel moment il avait encore le temps de travailler. Si on met bout à bout les témoignages qu’on a sur ces années 60, 70, on se rend compte qu’il recevait beaucoup, qu’il lisait beaucoup. Quand dormait-il ?
Michel Apel-Muller. Il dormait peu. C’était un monsieur qui pouvait dormir 5 heures par nuit tout en écrivant sans arrêter 15 heures par jour. Et qui a vu écrire Aragon – je l’ai vu écrire une grande partie de Théâtre/Roman – est toujours frappé par l’acte physique d’écrire qui laissait percevoir ce qui se passait à l’intérieur. On voyait la main galoper, galoper, galoper, et perdre la course perpétuellement contre la formulation mentale. Alors quand on peut écrire comme ça pendant 15 heures, vous voyez au bout d’une vie ce que ça donne comme volume. Cette prodigalité d’écriture qui était la sienne fait qu’il n’était pas économe de son écriture. Quand j’arrivais chaque semaine, comme je vous le racontais tout à l’heure, j’avais toujours droit à deux heures de lecture, ça se passait toujours dans son bureau, il y avait un grand fauteuil de cuir dans lequel on s’enfonçait jusqu’au cou et lui se mettait à marcher de long en large en lisant. J’ai le souvenir ainsi d’un chapitre destiné à Théâtre/Roman qui était une formidable méditation sur la rencontre entre Œdipe et Laïos sur la route de Thèbes, avant le meurtre. C’était quelque chose d’absolument somptueux. Et bien, je n’ai pas retrouvé ce chapitre dans le livre, ni dans le manuscrit, ça veut dire qu’il l’a détruit, je n’ai retrouvé dans le livre qu’une métaphore qui appartenait à ce chapitre et quelque part il parle des « violettes blanches du sperme ». C’est tout ce que j’ai retrouvé de ce chapitre. Je le voyais, ça ne lui plaisait pas, pouf au panier, je serais bien allé dans le panier, mais je pouvais pas ! Il aurait fallu être une sorte de rat pour aller chercher ce qu’il jetait.
Maryse Vassevière. Voilà la fin de la première partie de cet entretien, on pourrait maintenant l’orienter, si tu le souhaites, sur deux points : Aragon et le champ politique, Aragon et le communisme et relier cela aux différentes périodes.
D’une part Aragon dans le champ politique donc, enfin, le témoignage que tu peux apporter sur Aragon et le communisme dans la période où tu l’as connu ou même des choses qu’il a pu te dire relativement à des périodes antérieures, notamment de la guerre ou de la Libération, ce que tu évoquais tout à l’heure, l’après 45 et la politique nationale. Et puis un dernier axe qui serait Aragon et la littérature, évidemment. Et soit des témoignages que tu peux apporter sur la période où il écrivait Théâtre/Roman où donc tu l’as vu écrire et même où tu as pu parler avec lui, soit éventuellement de choses qu’il a pu te dire sur des périodes anciennes de son écriture et notamment sur la période surréaliste. Alors soit on commence par la politique, soit par l’écriture ?
Luc Vigier. Au niveau de l’engagement politique d’Aragon… Toi tu le rencontres donc vers 1954. Est-ce qu’il y a des divergences de point de vue entre vous deux ? Est-ce que vous parlez politique ? Est-ce que c’est de l’ordre de la conversation courante avec Elsa ?
Michel Apel-Muller.Avec l’un, avec l’autre, oui. Est-ce que c’était une conversation courante d’égal à égal, non. Là encore j’étais dans la position d’un monsieur qui écoutait plus qu’il ne proposait. Il faut dire – j’ai abordé cela tout au début de l’entretien – qu’il y a aussi un problème de génération. Disons que pour le jeune militant intellectuel que j’étais, compte tenu de la différence d’âge, de renommée, devant cet homme glorieux qu’était Aragon, j’étais un petit garçon, y compris politiquement. Pour moi Aragon était un grand monsieur de la politique du Parti communiste français. Et je ne dis pas là quelque chose d’original. Je crois que tout homme de mon âge ou même pas de mon âge aurait pu en dire autant, n’est-ce pas, de la fonction qu’a assumée Aragon dans la vie du Parti communiste, avec les moments forts et les moments bas ; je suis quand même d’une génération qui a très bien vécu – enfin, très bien vécu, il n’y a pas de jugement de valeur là – lucidement vécu par exemple l’affaire du Portrait où nous avons vu Aragon dans une difficulté terrible. Mais dans l’ensemble, au moment où je l’ai rencontré, physiquement, c’est-à-dire les années soixante, je peux dire qu’Aragon était au somment de sa gloire, c’est-à-dire de sa renommée personnelle et politiquement il avait acquis au sein du Parti communiste français un visage déjà de patriarche, de quelqu’un de très écouté. Je n’en prendrai qu’un exemple, un tout petit peu plus tardif : je me trouvai chez lui rue de Varenne le soir de la ratification du Programme commun et nous n’avons pas pu pendant toute la soirée et une partie de la nuit échanger une conversation dans la mesure où il était cons-tamment appelé. Je l’entendais au téléphone et il m’était facile d’imaginer que c’étaient ses camarades du Parti, sa délégation dans les discussions qui le consultaient sans cesse sur des terrains qui n’étaient pas que des terrains de littérature ! C’était sur les terrains de la politique et je l’entendais leur répondre, les réponses d’Aragon étaient extrêmement catégoriques, un homme sûr de lui, etc.
Luc Vigier. Sa position dans les années soixante est-elle réellement importante ? C’est quelqu’un que le Parti consulte ? Pour d’autres domaines que pour le domaine intellectuel ou culturel ? Cela m’étonne…
Michel Apel-Muller. Le moment où on voit Aragon tenir véritablement et pleinement son rôle, est caractérisé par une date et un acte profond du Parti communiste français, c’est 1966, c’est Argenteuil. C’est là qu’il y a une réunion centrale du PCF sur les questions de la culture. Le rôle d’Aragon, tout le monde sait qu’il a été capital dans l’élaboration de la position politique du Parti communiste français devant les choses de la culture. Aragon apportait avec lui toute son expérience, tout son passé, et notamment le passé qu’il avait assumé en 1936 et les années suivantes dans la Résistance, etc. Il emportait tout le vent d’Arles… Tout le vent d’Arles, tout Villeurbanne, tout ce qu’une longue histoire avait fait de lui, à la fois comme grand politique et comme grand écrivain. Evidemment d’autres gens que moi pourraient mieux parler de ces choses, je pense en particulier à Roland Leroy ou à Henri Krasucki ou même Jacques Chambaz qui étaient alors responsables de ces choses. Mais l’effet de soulagement qu’a constitué la perspective de 1966, a été un des grands moments de la vie d’un homme de ma génération. C’était quelque chose de très très libérateur. Voir éclater ces fausses barrières, voir rejeter ces conceptions étriquées d’un réalisme auquel finalement personne n’arrivait à donner forme ni visage… Enfin ! Mais en même temps, le souci de la responsabilité politique… Il ne faut pas oublier qu’à Argenteuil se situe – oh, je ne veux pas caricaturer Argenteuil – il y avait quand même deux pôles : il y avait d’un côté le pôle althussérien et de l’autre côté le pôle Garaudy, et la politique culturelle se dessine en référence à ces deux pôles, à ces deux positions. On sait en particulier comment Aragon a pu mettre en garde contre le danger qu’aurait représenté, transformées en pratique politique, les théories sur l’anti-humanisme théorique par exemple d’Althusser qu’il devait je pense à l’époque considérer comme plus dangereuses que les positions de Garaudy sur un « réalisme sans rivage », enfin… vous voyez ? Là, il y a eu de gros débats et Aragon avec ses Lettres françaises a joué un rôle considérable et ce rôle considérable, on le voit deux ans plus tard avec Prague et aussi avec le mouvement de mai… parce que c’est vrai que Cohn-Bendit à l’époque traite Aragon de “vieux schnock”, dans l’épisode fameux, mais cela dit, Aragon intervenant au milieu des jeunes, ça, il fallait le faire. Dans l’ambiance de l’époque, il fallait le faire.
Luc Vigier. Comme Sartre, il fallait qu’il soit là….
Michel Apel-Muller. Non, ce n’était pas obligé. Sans doute Sartre percevait-il plus psychologiquement, plus intimement la nécessité d’y être. Aragon, rien de l’y obligeait.
Luc Vigier. Pourtant il a organisé cela, ce rendez-vous…
Michel Apel-Muller. Il y est allé mais en même temps il engageait Les Lettres françaises dans le mouvement et il avançait plus vite là dessus que le Parti communiste en tant que formation politique quand il apportait publi-quement le soutien des Lettres françaises au mouvement étudiant, il ne disait pas tout à fait la même chose… il ne faut pas fermer les yeux sur la réalité, n’est-ce pas ? Que tout cela ait été plus ou moins bien reçu par les gens du mouvement de Cohn-Bendit, le mouvement du 22 mars, ça c’est autre chose. Aragon ne travaillait pas, je pense, pour des réponses immédiates.
Maryse Vassevière. Donc en faisant allusion au Comité d’Argenteuil, à la place qu’Aragon a prise dans ce débat, tu mets l’accent sur le fait que sur le plan de la politique culturelle du Parti, Aragon a eu une position d’avant-garde, enfin, si on veut, une position très nette, dans la lutte contre le stalinisme, d’une certaine manière, dans la critique des positions dogmatiques, du réalisme socialiste.
Michel Apel-Muller. C’était contre tous les dogmatismes, contre tous les sectarismes. En soulignant avec une force rarement atteinte jusque là la spécificité du champ de la littérature et de l’art : « Ah non, fini avec les vieilles conceptions de “l’écrivain ingénieur des âmes” et autres trucs. On sait où ça a mené. » Et Aragon là-dedans donne un grand coup de balai, finalement…
Luc Vigier. Mais le coup de balai est un peu tardif… Je ne sais pas comment tu le percevais à l’époque…
Michel Apel-Muller. Non, il n’est pas tardif parce qu’il a déjà été précédé d’une pratique par Aragon.
Maryse Vassevière. Oui, toutes les années cinquante…
Michel Apel-Muller. Y compris en 56. Car tout cela n’est pas forcément public mais les interventions d’Aragon en faveur des écrivains hongrois menacés dans leur liberté, sinon dans leur vie, ont été réelles. De la même façon qu’il interviendra en 1968, on sait comment, par ce texte extraordinaire, sur Prague, sur le « Biafra de l’esprit » etc. Cela dit, il ne faut pas croire que l’application par exemple des orientations données par les textes d’Argenteuil sont allées de soi comme ça. Je vois que dans le pré-questionnaire, Maryse, tu parles de désaccords éventuels, etc. Est-ce que j’ai eu des désaccords… Je ne me permettais pas de me poser en face d’Aragon, bien entendu. Mais il est vrai qu’il y avait un petit désaccord entre lui et moi qui touchait, j’en ai parlé un petit peu précédemment, au colloque de Cluny. Je rappelle donc que j’étais de l’équipe de La Nouvelle Critique et que, après 66, on avait vu un certain nombre de phénomènes nouveaux et qui occupaient la conjoncture intellectuelle française, notamment la tradition du structuralisme, enfin, je dis ça pour aller vite. Des évolutions à l’intérieur des courants ou mouvements littéraires. C’est ainsi que dans les années 1966-1968, on voit apparaître des questionnements en notre direction de la part d’une revue comme Tel Quel. À l’équipe de La Nouvelle Critique à laquelle j’appartenais – il y avait Claude Prévost, François Hinckert, Antoine Casanova – il nous était apparu intéressant à la fois de dialoguer avec des gens comme l’équipe de Tel Quel, mais aussi bien sûr avec d’autres et notamment avec l’Université alors que la linguistique prétendait devenir la science pilote de toutes les sciences humaines ! Il nous avait donc paru intéressant, et pour la revue et pour l’objet même de la discussion, d’ouvrir à une pratique qui n’existait pas jusqu’alors chez nous, qui était la pratique du colloque : rassembler, autour d’une problématique, sur le rapport littérature/linguistique les gens qui s’intéressaient à nous, au Parti, aux communistes, etc. Là-dessus, je crois que l’initiative n’a pas plu à Aragon. Je serais bien sommaire en disant que ça ne lui a pas plu parce qu’il n’en était pas l’initiateur (même s’il y a une petite part de vrai parce que ce grand monsieur était en même temps assez impérial), bon, il redoutait, je pense, que l’entreprise devienne une sorte de dialogue étriqué et forcément sectaire entre une équipe de La Nouvelle Critique dont il se méfiait toujours un petit peu par tradition parce que lui se refusait à se considérer comme marxiste, il l’a toujours dit, vous vous rappelez, et une revue qui s’affirmait encore un peu comme la revue du marxisme militant, il y avait été échaudé quelquefois et il s’en méfiait un petit peu: la préparation de ce premier colloque avait été très dure parce qu’Aragon était très sensible aux appréciations que donnait de toute cette aventure intellectuelle un ami proche d’eux qui était Jean-Pierre Faye et qui venait de se brouiller avec Tel Quel. Bref, je pense qu’Aragon et Les Lettres françaises ont tout fait pour nous isoler dans l’entreprise du colloque de Cluny pour faire en sorte que nous nous trouvions en tête à tête avec Tel Quel, ce qui a un peu réussi… Heureusement qu’il y avait des universitaires. Et ça permettait de dire ensuite eh bien vous voyez on avait raison puisque… Là je lui en voulais un petit peu quand même parce que j’avais essayé de lui expliquer mais il m’avait remis à ma place…
Maryse Vassevière. Ah oui ?
Michel Apel-Muller. Oui, et je pense que finalement, il voyait peut-être mieux que moi… parce que c’est vrai qu’il y avait ce danger d’un enfermement théorique, théoriciste que lui apercevait sans doute par l’immense pratique, et l’expérience qui étaient la sienne, mieux que nous… Et de ce point de vue là j’avais été un petit peu… je ne dis pas déçu mais mal à l’aise parce que je sentais qu’il ne soutenait pas. Il ne soutenait pas. Elsa non plus d’ailleurs.
Luc Vigier. Il y a eu un Cluny I et un Cluny II…
Michel Apel-Muller. Il y a eu un Cluny II deux ans après en 1970 : « Littérature et idéologie » qui a été un colloque dont je ne garde pas un très bon souvenir… Cette tension idéologique entre les gens, enfin, qui étaient prêts à en venir aux mains.
Luc Vigier. Elle existe toujours…
Michel Apel-Muller. Elle existe toujours, mais je ne pense pas que ce soit de la même façon, là c’était très très dur. Mais enfin ça avait eu un avantage c’est de faire d’une revue qui avait été jusque-là considérée comme une revue exclusivement militante ou presque, une revue de référence qui a eu sa place dans toutes les bibliothèques universitaires et qui avait fait là quelque chose, je crois, d’important. Alors bon il s’était trouvé que j’étais au centre des choses puisque si ça s’est fait à Cluny c’est parce que moi j’habitais Mâcon à l’époque. J’ai donc été l’organisateur, le promoteur, le secrétaire général de ces deux colloques deux ans de suite. Tout cela m’a donné une certaine expérience pour la suite de ce que j’ai fait.
Maryse Vassevière. Une autre question dans le domaine politique. Vitez a souvent parlé de la tragédie d’Aragon, et d’Aragon communiste et de son pessimisme à partir des années soixante et qui sont aussi les années de sa plus grande création, de sa dernière création romanesque, de son pessimisme face à l’utopie communiste. Et dans l’article écrit pour la mort d’Aragon repris dans un numéro de Faites entrer l’infini, Vitez dit qu’Aragon ne croyait plus que le système soviétique pouvait se transformer de l’intérieur. Est-ce que cela veut dire qu’Aragon dans les années soixante-dix avait pressenti ce qui allait se passer plus tard ?
Michel Apel-Muller. Je ne te répondrai ni oui ni non. À une question posée aussi directement, je ne peux pas répondre « il avait pressenti… ». Ce qui est certain, c’est qu’il faut distinguer dans les comportements politiques d’Aragon une attitude par rapport à l’URSS et une autre attitude par rapport au Parti communiste français qui était son parti. On ne peut pas les faire coïncider, cela ne marcherait pas. Il est sûr que depuis de longues années déjà, il avait perdu beaucoup de ses illusions sur l’URSS, aidé en cela d’ailleurs par Elsa qui était beaucoup plus clairvoyante et plus « impitoyable » que lui. C’est ce qui m’est apparu. Elsa était d’une très très forte sévérité à l’égard du monde soviétique… En 70 elle m’a dit, c’était un peu avant sa mort, qu’elle ne croyait même plus que les Soviétiques gardaient encore ce qui était le fondement même de leur existence d’anciens bolcheviks… ils ne croyaient même plus à la bataille pour la Paix… Et ce qu’elle redoutait à l’époque, c’était une agression soviétique contre la Chine. Quant à Aragon, la manière dont il parlait des Soviétiques était extrêmement sévère, très, très sévère. J’ai discuté de cela en séminaire. Il apparaît que les premiers doutes sont apparus chez eux d’abord par ce qu’ils pouvaient savoir de l’URSS (ils avaient quand même de la famille, des amis), sur ce qu’ils avaient vu ailleurs, faisait que, même s’ils ne le disaient pas forcément très haut, ils étaient très, très sceptiques sur un certain nombre de choses qui se passaient là-bas. Je sais qu’Aragon m’a raconté par exemple comment, au Congrès de Vienne (en 1952 je crois), il avait été question qu’Elsa entre dans le Bureau mondial du mouvement de la paix et que pendant les débats quelqu’un qui était évidemment un petit peu le porte-parole du pouvoir soviétique dans ce type d’instance, qui était l’écrivain Fadéev, un ami, était venu dire très embarrassé à Elsa et Aragon que ce n’était pas possible parce que Staline lui-même s’y opposait à cause du fait qu’Elsa était juive. Et ça c’est une chose qu’Aragon n’a jamais pardonnée et Elsa non plus d’ailleurs et qui a jeté certainement une lumière particulièrement crue sur une réalité qu’ils pressentaient déjà. Ils ne l’ont pas crié sur tous les toits mais bon… Mais enfin, moi j’ai vu un Aragon très ironique, très méprisant pour beaucoup des réalités de l’URSS.
Moi j’ai connu un Aragon, cet Aragon dont je parlais tout à l’heure qui était d’ailleurs considéré par ses pairs comme un dirigeant majeur du Parti quoiqu’il ait prétendu lui-même qu’il n’était pas un dirigeant communiste mais un écrivain, oui bien sûr. Reste qu’il était traité comme un membre du Bureau politique par l’ensemble du Parti y compris dans les petits détails de l’économie quotidienne. Et à l’égard du Parti communiste français, il se sentait d’une responsabilité totale. C’était un Parti auquel il avait adhéré très tôt et dont il était un des vieux témoins… Luc Vigier. Comme le dira Jean Marcenac…
Michel Apel-Muller. On arrivait à un certain moment avec cette extraordinaire figure emblématique : d’un côté le vieux dirigeant ouvrier Benoît Frachon et de l’autre côté, le grand intellectuel Aragon. C’était un couple extraordinaire, ça ! Aragon avait un attachement profond pour le PC français. Il ne voulait pas qu’on y touche. Ça n’empêchait pas qu’il était capable de grandes comédies. Je vais vous en raconter une, ce que j’appelle “mon examen de pas-sage”. Un jour, il a dû vouloir me mettre à l’épreuve et je n’ai pas dû être le seul à être mis à l’épreuve, il m’a fait asseoir dans un de ces fauteuils profonds dont l’appartement de la rue de Varenne était plein et là pendant une heure et demi, marchant de long en large, il s’est mis à dire pis que pendre du Parti et dans des termes incroyables ! Moi j’avais connu l’époque des émissions anticommunistes, des officines anticommunistes spécialisées du type “Paix et Liberté” avec Jean-Paul David etc… J’avais l’impression que c’était un discours imité de Jean-Paul David, carrément ! Et tout d’un coup l’incongruité de la situation m’apparut dans ce qu’elle était : une mise à l’épreuve. Je me suis dis si évidemment j’étais assez bête pour me mettre à dire comme lui, à un moment donné il va me prendre par la peau du dos et me foutre dehors et il aura raison ! Alors ayant conscience qu’il me jouait une grande comédie, je me suis mis sans doute à sourire, ça a duré un moment, et puis tout d’un coup il s’est arrêté, il m’a regardé, il a éclaté de rire, il m’a pris par les épaules et il m’a dit : « Eh bien maintenant je vais te dire quelque chose mon petit : quand on fait le mariole avec le Parti, il réussit à te taper sur le bec et c’est lui qui a raison… » Bon. Voilà cette anecdote. Oh je ne dois pas être le seul à qui il a fait ce coup-là… mais je veux dire… ou plus exactement il a dit, ça a été répété, « je rends ma carte tous les soirs je la reprends tous les matins », il était critique. Il voyait les défauts, les insuffisances ! Dans son univers, il essayait d’y remédier. Il se désolait souvent de la permanence (il en parlait souvent dans sa conversation) des vieilles tendances ouvriéristes dans le Parti communiste français… La Commune, ce n’était pas des marxistes, c’étaient des blan-quistes et des proudhoniens et la vieille tradition ouvriériste, blanquiste, anarcho-syndicaliste finalement qu’il y avait dans la classe ouvrière française, ça l’interrogeait, il disait : « ça n’est pas bon, ça. » C’est caractéristique du mouvement français. C’est le même discours qu’il tenait lorsqu’il disait qu’il y avait un geste pour lequel il avait de la haine, c’est le geste du poing fermé. Le geste du poing fermé, c’est pas un geste français, c’est un geste allemand, c’est le geste spartakiste. Le geste français, c’est la main tendue. En quoi il ren-voyait évidemment à une figure de sa génération, qui était Maurice Thorez pour lequel il avait d’ailleurs une amitié profonde, qui lui était bien rendue. Il tenait, disait-il, énormément, à Thorez. Il devait à deux hommes : il devait à Thorez et à Paul Vaillant-Couturier. Ce sont deux hommes qui lui ont permis de vivre à l’intérieur du Parti. Même s’il disait : « Pourquoi vivre là-dedans, pourquoi je suis resté ? Parce que j’étais fou. » Ça c’était sa réponse. Mais il doit à Thorez et à Vaillant d’être devenu Aragon à l’intérieur du Parti. C’est donc dire qu’il ne permettait à personne d’autre qu’à lui de dire du mal du Parti communiste. Et s’il en disait, c’était pour le bien du Parti, évidemment. Je vous renvoie à une provocation qui avait été faite à son égard au moment des choses de Pologne, à un moment où il était déjà très vieux… quelqu’un que je ne préfère pas nommer est allé le trouver : il dînait solitairement dans une brasserie du côté je crois de la Place de la République, il a essayé de faire un faux, en prêtant à Aragon le texte qu’il avait écrit sur Prague à propos de la Pologne en le tripotant un peu. Quand on l’avait interrogé là-dessus, Aragon avait répondu avec un air de mépris effroyable et croyez moi il était déjà vieux : « Ces gens-là se prennent pour le Parti communiste français…. » Voilà ce que je peux dire d’Aragon communiste. Je sais aussi quel souci il avait des militants, quel respect il avait pour eux, les services qu’il rendait aux hommes, enfin… et la popularité qui était la sienne, qui était immense. Mais il y a aussi des gens qui devaient le haïr au sein du Parti, parce qu’il était aussi l’intellectuel. Luc Vigier. Est-ce qu’il vivait avec le Parti au présent ou est-ce qu’il était tourné vers le passé dans les années 60 ?
Michel Apel-Muller. Oh je crois qu’il était très ouvert à la politique telle qu’elle se faisait, à cause d’Argenteuil et il y avait aussi l’aspect, surtout vers la fin, l’aspect vétéran : son expérience humaine et personnelle se confondait presque avec l’histoire du Parti. Par conséquent il était un des derniers grands témoins des origines et ça il en avait conscience. Luc Vigier. L’incarnation de quelque chose. Donc témoin du PC français certainement, incarnation, représentant… Michel Apel-Muller. D’ailleurs en même temps exigeant à l’égard de ce Parti, n’acceptant pas ou de très mauvais gré les fureurs ou les accès de fièvre et de sectarisme : il n’aimait pas ça du tout. Luc Vigier. On nous demande souvent dans les conférences : « mais tous ces témoignages qui venaient d’URSS, tous ces livres qui tombent, comme le livre de Kravchenko, trafiqué ou pas, il y a aussi plusieurs livres avant-guerre paru dans les années trente, comment est-ce que ces informations assez scandaleuses et graves étaient perçues par Aragon et Elsa Triolet… » Est-ce qu’il en a été question par exemple entre vous des procès Kravchenko et Rousset ?
Michel Apel-Muller. Pas sous cette forme là. Quand on parlait on ne par¬lait pas comme ça en chapitres d’histoire qu’on repassait… Oui, il est arrivé… il faut dire que les années 50 ce n’était pas les meilleures années, ni pour le PC ni pour Aragon, ni pour la société française en face. Parce qu’on a tendance à opposer à Aragon des textes très mauvais autour de Lyssenko, qu’est-ce qu’il est venu faire là-dedans, mais le sectarisme et l’aveuglement n’étaient pas l’apanage des seuls communistes. André Rousseau tenait une chronique célèbre, un feuilleton littéraire dans Le Figaro littéraire et André Rousseau était un résistant, un homme estimable et qui d’ailleurs avait travaillé parallèlement et presque avec Aragon à Lyon pendant la période de la guerre. Quand Éluard a publié sa première anthologie poétique, il (comme tous les surréalistes mais aussi comme certains romantiques en particulier) s’est justifié de ne pas placer La Fontaine dans son anthologie. Les surréalistes n’aiment pas La Fontaine, c’est bien connu ! La morale rationnelle etc… C’est pas ça du tout. Et Éluard a gardé cette attitude à l’égard de La Fontaine jusqu’à la fin de sa vie. Il dit dans sa préface après avoir mentionné le fait que La Fontaine était absent, « Éloignons-le des rives de l’espérance humaine », ce que je trouve d’une injustice monstrueuse à l’égard de La Fontaine… Éluard était comme ça. Di-tes-vous que le compte-rendu donné par Rousseau, s’est intitulé : « Le PC exclut La Fontaine de la littérature française. » Alors quel était le plus aveugle, le plus étroit ? Je crois qu’il y avait un certain concours à la stupidité par moments… On appelait cela la lutte de classe, moi je trouve qu’il y avait surtout beaucoup de stupidité et de fanatisme réciproques. Ce n’est pas la meilleure époque d’Aragon. Ramener l’image modèle d’Aragon autour des années 50, c’est prodigieusement amputer Aragon ! Il ne s’en tire pas facilement ! Ça a fait des dégâts ces quatre ou cinq années ! Par exemple, Les Yeux et la Mémoire, ce n’est pas le livre de poèmes d’Aragon que je préfère même si à l’intérieur, tout à coup, il y a des éclats superbes, mais cette rhétorique pesante, enfin, le côté cheval de labour que je n’aime pas dans l’alexandrin d’Aragon de cette période. Ça a été long… et il s’en tire par Le Roman inachevé plus que par Les Yeux et la Mémoire. C’était une époque féroce.
Maryse Vassevière. C’est vrai que tu dis que ce n’est pas la meilleure période pour Aragon. Sans aucun doute mais en même temps tu mets l’accent sur la férocité de cette période. La guerre froide, c’est une certaine manière une guerre, il y a des affrontements….
Michel Apel-Muller. Il est le premier grand blessé de cette période. On l’a privé de ses droits civiques !
Luc Vigier. En 1949.
Maryse Vassevière. Alors est-ce que tu peux évoquer un peu cela, de manière à dépouiller de certaines idées reçues cette image de l’Aragon de l’après-guerre : on a dit que tout de suite après la guerre Aragon a été le grand procureur des lettres, cette figure de résistant qui finalement exerce une sorte de dictature sur les intellectuels…. il y a peut-être beaucoup de schématisme dans ces images.
Michel Apel-Muller. « Le Fouquier-Tinville de l’épuration ». Non, finalement, ça c’est une énorme légende. Tout cela tourne autour par exemple de la liste noire. La liste noire a été élaborée à Paris par des écrivains dont ne faisait pas partie Aragon parce qu’il n’était pas encore rentré. Première donne. Alors évidemment il va jouer une certain rôle au sein du Comité National des Écrivains, mais si vous regardez les dossiers qui concernent cette époque au Fonds du CNRS, vous vous apercevrez qu’il y a une multitude de lettres dont une bonne part sont surtout des lettres d’insultes à Aragon pour son indulgence. Aragon était l’indulgence ! Critique lucide. Alors que les hommes les plus durs, c’étaient des gens qui n’étaient pas d’abord des communistes, des gens comme Robert Kempf, Mauriac. Voilà des gens qui étaient extrêmement durs avec les collaborateurs qui mettaient tout dans le même sac, alors qu’Aragon pensait qu’il fallait regarder cas par cas. C’est ainsi qu’Aragon a tiré d’affaire un certains nombres d’hommes dont il pensait que, sans avoir été des modèles d’héroïsme, ils n’avaient pas de crime de sang sur les mains ni même de sang intellectuel.
Luc Vigier. Il n’a pas été tendre avec Gide !
Maryse Vassevière. J’allais le dire, pourtant il n’a pas été tendre avec Gide.
Michel Apel-Muller. Oui mais ça c’est une autre question.
Maryse Vassevière. Oui.
Michel Apel-Muller. Ça remonte à avant. Il n’a pas été tendre mais il ne l’a pas traité de collaborateur ! Par contre, ce qu’il a fait c’est qu’il a tiré d’affaire quelqu’un comme Cocteau. Si vous avez lu le journal de Cocteau pendant la guerre, il y a des choses qui font bondir y compris la naïveté avec laquelle Cocteau considère comme tout à fait naturel de jouer les papillons mondains autour des Allemands de Paris avec le fameux sculpteur officiel allemand. Ce qui m’a le plus choqué quelque part c’est que Cocteau depuis son Palais Royal est tout à fait ennuyé, il dort mal et il n’a pas d’appétit parce qu’il voit que sa vieille amie Colette est malade, elle souffre et elle malheureuse. Pourquoi est-elle malheureuse Colette ? Parce qu’on vient de lui arrêter son mari, Maurice Goudeket, qui est juif. Ça dérange Cocteau de savoir Colette malheureuse. Alors il a quelque part cette belle naïveté de dire « Quelle idée quand on s’appelle Colette d’aller épouser un juif ! », quelque chose comme ça, je ne cite pas exactement. J’ai sauté en l’air quand j’ai lu ça. Ça fait partie de ce personnage un peu irresponsable, finalement. Il est passé devant une commission d’épuration qui n’était pas celle de la commission littéraire, mais celle du cinéma et Aragon est intervenu. Bon, Cocteau a dû lui en avoir un peu de reconnaissance. Mais avec la même naïveté il lui demande : « Puisque vous m’avez sorti d’affaire, vous ne pouvez pas en faire autant pour Pierre Benoît ? » Et Aragon le fait pour Pierre Benoît qui lui en a manifesté une reconnaissance éperdue jusqu’à la fin de sa vie. Nous avons ici en particulier des dédicaces de Pierre Benoît, L’Atlantide et Aragon vous voyez un peu ! bon, Le Lac salé ! mais une reconnaissance véritablement éperdue. C’est donc dire qu’Aragon n’est pas dans ce rôle. Éluard était beaucoup plus féroce verbalement que lui.
Luc Vigier. Ce n’est pas non plus le réconciliateur Paulhan…
Michel Apel-Muller. Paulhan est le conciliateur, pas le réconciliateur.
Luc Vigier. Oui mais Aragon n’est pas Paulhan.
Michel Apel-Muller. Bien sûr, même pas Mauriac, à partir du moment où ses affaires sont installées, il trouve que cela a assez duré….
Luc Vigier. Donc Aragon se situe sur une ligne moyenne modérée.
Michel Apel-Muller. Responsable. Là encore on voit l’esprit de responsabilité d’Aragon.
Luc Vigier. Alors justement à propos du champ politique, juste une question sur les hommes politiques, notamment après Thorez, comme ça se passe ?
Michel Apel-Muller. Il avait beaucoup d’amitié et d’estime pour Thorez. Beaucoup, beaucoup… autant que j’aie pu m’en rendre compte, moins pour sa femme, enfin… Il a eu beaucoup et d’excellents rapports avec Waldeck-Rochet, il aimait beaucoup Waldeck-Rochet. D’après ce qu’ils m’ont raconté, il aurait tout fait pour empêcher Waldeck-Rochet de céder à l’idée qu’il serait bien opéré en URSS. Aragon leur montrant que la chirurgie française était très supérieure à la chirurgie soviétique et que, de grâce, il aille se faire opérer à Paris mais pas à Moscou. Il me disait : « Tu vois, tu vois, ils l’ont opéré n’importe comment, regarde dans quel état ils l’ont mis ! » Il voyait ça comme ça. Alors pour Marchais, je ne sais pas trop.
Luc Vigier. Il lui offre LHOOQ, la Joconde de Duchamp. Ça signifie quoi…
Michel Apel-Muller. Je ne sais pas, j’ai ma petite idée… enfin bon, est-ce que c’est la bonne ? Il y a aussi le non dit, le fait sérieux dans l’affaire. Laissons la personne de Georges Marchais là où elle est. Le fait d’offrir la Joconde de Duchamp, LHOOQ, au PCF, ça, ça a une signification formidable. Cela veut dire que le PCF reconnaît Marcel Duchamp, ce que signifie Marcel Duchamp dans l’art !
Maryse Vassevière. La reconnaissance de DADA
Michel Apel-Muller. S’il peut se permettre d’offrir la Joconde [de Duchamp] au secrétaire général du PCF qui va la mettre dans son bureau, c’est quand même que le PCF n’est plus le parti de Lecœur, hein, c’est ça la signification profonde. Il y a un peu de malice parce qu’il devait bien se douter que ça en choquerait tout de même quelques-uns… il y a toujours un vieux dadaïste qui sommeille jamais très loin mais l’important c’est d’abord ce que je dis. Alors bien sûr on peut broder…
Luc Vigier. C’est une autre affaire du portrait, finalement.
Michel Apel-Muller. Oui mais vous savez l’affaire du portrait, elle remonte à avant. D’ailleurs il y a une question si vous voulez qui n’est pas du tout réglé, c’est la situation d’Aragon dans le Parti au lendemain, à l’extrême lendemain de la guerre. On sait qu’Aragon est sorti de la guerre malade, qu’il a dû se reposer. Je ne sais pas si ce n’était pas un début de tuberculose, les symptômes ressemblent évidemment mais enfin après on n’en a plus parlé alors je ne sais pas. Les privations, le stress de la guerre… Je sais qu’à moi il a raconté des quantités de choses sur les difficultés de remettre sur pied la direction du PCF après la guerre. La guerre avait séparé les hommes et créé des tendances et Aragon pensait qu’il y avait toute une tendance, représentée en particulier par d’anciens membres du gouvernement d’Alger qui ne souhaitaient pas voir réapparaître Maurice Thorez à la tête du PCF. Cette tendance-là elle avait été emmenée par une homme comme Billoux, d’après Aragon toujours. Toujours d’après Aragon, se seraient tenues à Paris dès le lendemain de la Libération des réunions comment dire, on aurait dit fractionnelles dans le métalangage de l’époque, pour essayer de dresser ce petit complot contre Thorez. Ça explique aussi que sans doute, averti très tôt de ce qui se tramait là, Aragon depuis Grenoble consacre le premier texte, très étrange ça, le premier texte de son intervention dans une radio libérée, pour réclamer le retour de Maurice Thorez en France. C’est dire que cette lutte à laquelle il a pris sa part pour s’opposer à ces menées contre Thorez, n’a pas dû lui valoir que des amitiés. Moi j’avais dix-huit, dix-neuf ans quand s’est produite l’affaire du portrait, j’étais un jeune communiste, pas plus ouvert qu’un autre à l’époque je n’ai pas été choqué du tout par le dessin de Picasso. Pas du tout ! Je trouvais génial que Picasso nous montre un Staline jeune ! Ce qui m’a stupéfié c’est la réaction du secrétariat, emmené par Lecœur. Elsa a raconté comment elle avait tenté une démarche auprès de François Billoux qui a répondu qu’entre Aragon et le Parti il choisissait le Parti comme si c’était ça le problème. Je pense que là le règlement de comptes se poursuivait, y compris dans la manière dont a été dressé le procès d’Aragon. Il n’y avait pas de quoi fouetter un chat ! Même en 1953. Ça a été un truc à mon avis assez artificiel pour abattre Aragon. Tout cela me paraît le haut d’un iceberg dont il faudrait voir ce qu’il y a sous la surface pour bien comprendre les choses. Il y a des lettres d’Elsa qui vont dans ce sens sans qu’on puisse être très précis là-dessus. Je voudrais dire encore une chose. Il ne faudrait pas croire que les choses sont simples ! En 1940 par exemple… J’ai eu dans les mains, provenant des archives soviétiques, un document qui m’a… d’ailleurs je dirai d’où je le tiens : c’est Lili Marcou, lors des recherches qu’elle avait faites autour de sa biographie d’Elsa… Elle m’en avait donné une copie. Elle a retrouvé un texte de 1940, de la fin 1940, par lequel un secrétaire à l’organisation du PCF adresse, comment dire, au Parti Soviétique une sorte de bulletin annuel sur les activités des membres du Comité Central ou des figures importantes du PCF. Le monsieur qui était secrétaire à l’organisation, c’était Tréand à l’époque, l’un de ceux qui ont commis l’erreur politique de vouloir faire paraître L’Humanité sous l’Occupation et qui en a porté le chapeau et qu’on a fait passer à la trappe. Tréand était un type curieux, il ne pouvait écrire trois mots sans faire dix fautes d’orthographe, c’est invraisemblable, et j’ai en main ce qui sont de véritables dénonciations d’un certain nombre de communistes français aux soviétiques en 1940. Alors les gens dénoncés comme étant ceux sur lesquels on ne peut pas s’appuyer, c’est Marcel Cachin, eh oui… Gabriel Péri, et on sait comment il a mal tourné, Gabriel Péri, n’est-ce pas ? Et Aragon ! Aragon a commis une faute ! Il a publié un poème dans Le Figaro ! « Cela sera réglé avec lui quand il sera en zone Nord. » Alors on proposait de lui faire payer ça.
Luc Vigier. J’allais te poser une question tout à l’heure sur le tribun politique ; est-ce que tu as assisté à des meetings politiques ; parce que, finalement, on a des images, des discours enregistrés… Est-ce que c’était quelqu’un qui appréciait le contact avec le public venu pour écouter un discours politique ? Enfin, on a quelques exemples dans L’Homme communiste, comme cet article intitulé « Écrit pour une réunion de quartier » (1946). Est-ce que les réunions de quartiers, les réunions de cellule, c’était son dada ? Michel Apel-Muller. Non. Ça l’emmerdait prodigieusement. Il l’a fait un moment… Il y a là-dessus des choses amusantes. Elsa raconte une anecdote dans l’article qu’elle consacre à la mort de Jouvet… alors qu’Aragon participait à une réunion électorale dans un préau d’école. Elle raconte, avec un talent fou d’ailleurs, comment au fur et à mesure qu’Aragon lit ses vers elle voyait, je la cite, « le regard de Jouvet devenir glauque » (rires). Alors on imagine la voix et la cadence de la voix de Jouvet (imitant Jouvet) : « Voyez-vous, Elsa, si c’était moi qui lisais ces vers, la moitié de la salle serait déjà en train de chialer ! ». Mais je ne l’ai jamais entendu dans un discours politique.
Luc Vigier. Que sais-tu de ce qui liait Elsa Triolet et Louis Jouvet ?
Michel Apel-Muller. Ce que je sais c’est qu’ils étaient très, très forts. Puisque c’est la mort de Jouvet qui a empêché la réalisation d’un projet qu’il avait demandé à Elsa de transformer le roman Personne ne m’aime en pièce de théâtre. Nous avons d’ailleurs au Fonds un texte d’adaptation dont Elsa dit dans une des ses préfaces aux ORC que cela ne vaut pas cher, que ça n’apporte rien. Maintenant, on ne peut pas en juger puisque ça n’a pas été joué. Parmi leurs grandes amitiés, il y en a qui peuvent surprendre, comme Maurice Chevalier, qui était un très grand ami.
Maryse Vassevière. Sur le dernier volet : Aragon et la littérature, Aragon et l’écriture. Tu nous a dit que tu avais assisté à certaines séances d’écriture de Théâtre/Roman, tu as vu Aragon écrire Théâtre/Roman, peut-être aussi t’en a-t-il lu des fragments, tu l’as dit et que tu n’as pas toujours retrouvés dans le roman. Est-ce que tu peux évoquer cet aspect là, d’abord celui d’Aragon écrivant…
Michel Apel-Muller. Je travaillais sur cette exposition dans la chambre de Rostro[povitch], la porte restant ouverte et celle de son bureau en face étant ouverte aussi, je le voyais en train d’écrire à son bureau. C’est là que j’ai pu me rendre compte. Et, François Nourissier raconte la même chose en voyant Aragon écrire « Le perpétuel printemps », il écrivait comme ça, avec une main qui n’arrivait pas à accompagner dans sa rapidité la formulation mentale qui déroulait son ruban. C’est une des choses les plus impressionnante qu’on puisse imaginer. C’est véritablement impressionnant, c’est aussi impressionnant que de voir Picasso peindre dans le fameux film de Clouzot. Il écrivait comme ça et Elsa me racontait que quand il écrivait, ce qui a été pour lui un terrible pensum, L’Histoire de l’URSS parallèlement à Maurois qui écrivait L’Histoire des États-Unis, il écrivait comme ça quinze heures par jour. On était obligé de l’arracher à son travail, un travail de damné… pour qu’il aille s’aérer, pour qu’il dorme. Il était dans l’activité d’écriture une sorte de marathonien, un formidable athlète, un peu comme Balzac ou Hugo, dans cette aptitude, je ne sais pas si vous l’avez, mais moi je suis incapable d’écrire quinze heures par jour !
Luc Vigier. Pour écrire L’Histoire parallèle, il fallait un certain courage… le respect d’une certaine platitude qu’il croyait devoir être celle de l’historien…
Michel Apel-Muller. Je pense qu’il a dû faire ce choix. Je ne pense pas que cela ait été autre chose pour lui qu’un pensum prodigieux et formidablement douloureux. Cette histoire le faisait formidablement souffrir. Il avait promis, il y avait les obligations économiques… Alors il se détendait en commençant à écrire les premiers vers du Fou d’Elsa. Mais pour en revenir à Théâtre/Roman, oui évidemment je l’ai vu écrire et alors toutes les semaines j’avais droit à ma séance de lecture. C’était ce qu’il avait écrit pendant la semaine. Cela a été tout l’hiver comme ça. Donc deux heures, deux heures et demi de lecture… C’était pour moi un déferlement terrible parce que recevoir Théâtre/Roman dit par Aragon pendant deux heures et demi en lecture à voix haute, l’attention ne résiste plus. C’était pour moi une épreuve et en même temps une épreuve dont je sortais rempli d’admiration pour ce phénomène. Alors de temps en temps évidemment il te balançait de ces éclairs bleus du regard en se disant sans doute « Est-ce que je t’ennuie, est-ce que… » Ça c’est une question qu’il se posait sans cesse.
Maryse Vassevière. Il lisait les textes qu’il avait écrits, mais il ne faisait jamais de commentaires…
Michel Apel-Muller. Non, sauf quand il travaillait mais alors à autre chose qu’un roman… par exemple il travaillait aussi à L’OP. C’est là qu’un jour, toujours dans le fauteuil de cuir de son bureau, j’ai raconté ça pour le colloque de Grenade, il m’a lu le « Chant de la Puerta del Sol », ce qui m’a permis de dire « moi je l’ai vu me lire ça », du bas vers le haut parce qu’il était debout et j’étais enfoncé dans son fauteuil, je voyais que c’était de vieilles feuilles de papier, il s’arrêtait, il les annotait, il les corrigeait. J’ai bien eu l’impression qu’il était en train de rafraîchir un texte ancien. Ou alors il s’amusait un jour à me lire avec le talent d’un comédien : préface à Pierre Roy, texte écrit pour une exposition. Alors il lisait avec un accent anglais, il était assez irrésistible quand il faisait ça.
Maryse Vassevière. Et j’imagine que Vitez l’avait déjà entendu lire ça comme ça.
Michel Apel-Muller. Oui, il a fait des imitations d’Aragon…
Luc Vigier. Et ça donnait quoi ?
Michel Apel-Muller. Tu croyais entendre Aragon ! C’était Aragon. Lors de notre première rencontre (il se trouvait qu’il venait d’entrer au Conseil d’Administration qui venait de se constituer, celui de la Fondation, et comme moi j’ai été nommé par eux directeur et qu’il ne me connaissait pas, je me présentais) il s’est trouvé qu’une de mes filles qui était employée aux relations publiques du théâtre de Chaillot travaillait directement avec Antoine. Et à chaque représentation, Antoine, avant que le rideau ne se lève, l’appelait et lui disait « Mireille, qui est-ce qu’il y a dans la salle ce soir ? » et un soir, pour Hernani, elle a dit : « Oh, il n’y a personne, il n’y a que mon père… « Ah, ton père est là… » Le premier acte il me l’a joué pour moi, dans la conversion de Don Gomès, en Aragon, le vieil Aragon. Il se renversait dans sa chaise en mettant son bras comme ça [Michel Apel-Muller passe le bras par-dessus sa tête en repliant le bras vers le bas de la mâchoire, la main enserrant cette dernière] : c’était Aragon ! Ne pouvaient s’en rendre compte que ceux qui connaissaient Aragon ! La voix un peu nasale, un peu métallique, c’était Louis de façon hallucinante. Puis alors le deuxième acte, il me l’a joué dans l’imitation de… (il savait par ma fille que j’étais un ancien admirateur de Jean Vilar dans ma jeunesse) il m’a joué le même rôle dans l’imitation de Vilar jouant L’Avare… Et je croyais voir Vilar. On est allé ensuite dans sa loge et on s’est mis à discuter et je lui dis « quand même merci pour le… – ah mais tu sais : quand les amis sont là…. faut bien leur faire un petit clin d’œil… ».Voilà, c’était mon premier rapport à Antoine.
Maryse Vassevière. Aragon te lisait parfois son roman…
Michel Apel-Muller. Toujours, toujours.
Maryse Vassevière. Et commentait peu. Est-ce que parfois vous aviez des conversations sur la littérature et est-ce qu’il te parlait des lecteurs ? Ce qu’il attendait des lecteurs, ou la place des lecteurs dans son écriture ?
Michel Apel-Muller. Pas vraiment…
Luc Vigier. Et parlait-il du théâtre… Parce que ce Théâtre/Roman… je ne sais pas comment il te le lisait, est-ce que c’était…
Michel Apel-Muller. Oui ! Il parlait théâtre. Tu sais qu’il adorait le théâtre ! Que plus il vieillissait plus il était heureux au théâtre. Il me disait « parce que comprends-tu mon petit, sourd comme je suis je n’entends plus ce qu’ils disent sur la scène… »
Luc Vigier. Il l’a écrit aussi.
Michel Apel-Muller. « … alors je vois des gens et je me fabrique de merveilleux spectacles… » Oui, il aimait le théâtre.
Luc Vigier. Il n’a pas écrit de théâtre. Il a écrit quelques textes surréalistes avec Breton… Lisait-il Théâtre/Roman comme on lit un roman ou comme du théâtre ?
Michel Apel-Muller. Il lisait toujours très mal son texte. Maintenant… c’était son écriture elle-même qui était théâtralisée, qui théâtralisait tout. Alors qu’il n’ait pas écrit pour le théâtre… Même quand il a donné apparemment une forme théâtrale, ou dialoguée en tout cas.. à ses textes, je n’ai jamais été satisfait de leur réalisation sur le plan du théâtre, jamais. Je crois que la seule chose qui a été réussie, c’était par Vitez et c’était Catherine. Pour le reste, j’ai vu un certain nombre de choses… Jamais été convaincu. Quoique quand il lisait ses vers c’était cette grandiloquence qu’on lui entend aujourd’hui. C’était difficilement supportable !
Maryse Vassevière. Mais qui est aussi datée…
Michel Apel-Muller. Oui, quand on entend Éluard, Apollinaire dire « Le Pont Mirabeau »…
Maryse Vassevière. Est-ce qu’il y avait des périodes de son itinéraire d’écrivain qu’il évoquait parfois avec toi, ou…
Michel Apel-Muller. Oui, oui ça arrivait mais pas comme un sujet si tu veux, mais quand il préparait les textes de L’OP, il revenait évidemment sur la période à laquelle il s’intéressait au moment où nous étions ensemble. C’est ainsi par exemple qu’il lui est arrivé de porter des jugements sur son activité d’écrivain dans la poésie à un moment donné. Un jour il m’a dit, ce qui m’a profondément étonné : « Oh tu sais, petit, après tout en poésie ce que j’ai fait avant Le Crève-Cœur… hein… » Voilà.
Maryse Vassevière. Bon, c’était une manière de parler du surréalisme.
Michel Apel-Muller. Non, de parler de son œuvre. Bon, mais quand tu te dis qu’il met dans L’OP Le Paysan de Paris… « ce que j’ai écrit en poésie »… je crois qu’il voulait dire « en vers »… Je pense qu’il était très fier de ce qu’il avait réussi dans Le Crève-Cœur : cette réinvention de la métrique.
Maryse Vassevière. On va peut-être évoquer à la fois la poésie de la Résistance et aussi le surréalisme. Est-ce qu’il a devant toi évoqué la période surréaliste, par exemple est-ce qu’il t’a parlé de Breton personnellement, en quels termes… Par exemple, est-ce qu’il évoquait leurs origines, leur formation, leur culture différente… ? Est-ce qu’il t’a parlé de la rupture de 1930 ? Michel Apel-Muller. Non, il ne parlait pas en réalité de la rupture, sauf en biaisant un petit peu et en faisant comprendre en hochant la tête que Breton avait plus raison que lui. Oui, il m’a parlé de Breton, il m’a toujours parlé de Breton, toujours, sans une ombre… avec un respect et une affection immenses. Et on en a parlé souvent parce qu’il m’en parlait pour me faire des recommandations pour le Fonds. Il savait qu’il remettait la correspondance, qu’il remettait tous les documents qu’il avait de Breton et il y avait tout de même le manuscrit de Clair de Terre, des choses comme ça. Il m’a dit et répété, de peur que j’oublie sans doute : « Traite-le mieux que tu ne traites mes écrits et ne refuse jamais rien à ce qui peut être demandé concernant André par les siens, traite le mieux que moi. » Quand il me parlait, alors c’était souvent, d’André Breton, c’était toujours “André” avec émotion, il ne faisait jamais de réserve, je ne l’ai jamais entendu dire du mal de Breton. Jamais. Alors oui il a évoqué qu’ils étaient des hommes différents. Il me disait : « André et moi n’avons eu ni la même famille ni la même formation ». C’est vrai que comme Éluard, Breton était passé par ce qu’on appelait “l’école primaire supérieure” à l’époque, ou comme Desnos, tandis qu’Aragon avait fait le collège classique : latin… et Aragon appartenait à une famille certes économiquement mal en point mais qui culturellement était d’un très haut niveau et qui portait avec elle le culte des grands ancêtres, en particulier Jean-Baptiste Massillon. L’enfant, avec les femmes qui l’entouraient, a été élevé dans le culte des grands hommes de la famille… L’oncle Edmond se piquait d’être poète, poète symboliste…Quand on s’envoyait des cartes postales d’un lieu de vacances à l’autre, c’était toujours soigneusement rédigé, on voit l’atmosphère, toutes les références culturelles. Il n’y avait certainement pas d’équivalent pas chez les parents de Breton, certainement, et ça Aragon le savait. Ils n’avaient pas la même formation intellectuelle ni la même famille. Ça rejoint ce que j’avais essayé de montrer, au colloque de Saint-Denis autour de Platon. Alors quand on voit l’activité du premier semestre 1924, entre Breton et Aragon, tu vois la différence de formation culturelle, quelles que soient les intentionnalités. Breton, il est dans les enregistrements de rêves, dont il va faire un manifeste. Le manifeste biaise devant la réflexion philosophique, s’en tire par une formule, alors qu’Aragon est plongé lui dans Platon en se proposant cette ambition presque démesurée de remettre sur ses pieds la philosophie occidentale. Il veut régler son compte à Platon, excusez-moi ! Tu vois qu’à l’époque les passions ne sont pas les mêmes. Et quand tu prends Le Paysan de Paris à cette lumière, c’est un grand dialogue de khâgneux très doué, d’une certaine manière, d’une certaine manière. La féerie du Paris nocturne, ça c’est bien lui, mais il y a tout un substrat de réflexion paraphilosophique qui est d’un homme marqué par les « humanités classiques ».
Luc Vigier. À la fin des années soixante, Aragon réécrit l’histoire du surréalisme et si l’on va vers L’OP, et ses textes préfaciels, on voit qu’Aragon se présente petit à petit comme le dernier survivant. Dans L’OP, c’est flagrant de voir à quel point il réécrit l’histoire du surréalisme… il devait en parler tout le temps, cela devait être une obsession pour lui, surtout en voyant disparaître les derniers surréalistes…
Michel Apel-Muller. Il veut effacer aussi complètement tous les propos négatifs à l’égard de Breton. C’est Madame Breton qui l’a raconté elle-même. Parce que quand même après leur mort, je m’étais dit qu’avec tout ce qu’on avait au Fonds la guerre devait être finie, alors j’ai pris contact avec Élisa Breton, il y avait Jean Schuster qui est venu au Fonds, quelques années avant sa mort. Il avait été le pire des disciples à l’égard d’Aragon. Il n’y avait pas de raison que se prolonge après la mort des écrivains quelque chose, une rancune de Breton (elle n’existait pas chez Aragon)… J’ai rencontré donc de la même façon Élisa Breton qui me racontait comment pour L’OP, Aragon avait eu besoin de publier un texte de Breton. Il fallait donc qu’il lui demande à elle l’autorisation, puisque Breton était mort… alors elle la lui a donnée. Et il a envoyé des fleurs à Élisa… je ne sais pas il devait y en avoir pour plus de dix mille francs ! Et les gens venait me voir, et me disaient « Mon Dieu, qu’est-ce que c’est que ces fleurs ? » et je répondais « Ce sont les fleurs d’Aragon. » – « Comment, les fleurs d’Aragon ? » – « Les fleurs d’Aragon. ». Je suis allé la voir à Saint Cirq Lapopie, la maison de Breton, et en entrant dans la maison de Breton à Saint Cirq Lapopie j’ai été pris de vertige, j’avais l’impression d’entrer chez Aragon : c’étaient à peu près les mêmes objets, les tableaux, les mêmes choses. Aragon ne voulait absolument pas paraître, d’un côté ou de l’autre, projeter une animosité à l’égard de Breton, en quoi il était généreux, quand même parce que, on le sait aujourd’hui, Breton lui a quand même fait quelques “crasses”. Et le travail de John Bennett est en train de prouver que depuis les États-Unis, il inspirait les agressions les pires contre Aragon.
Maryse Vassevière. Bon alors on peut évoquer la transition : on peut évoquer un peu Le Crève-Cœur, et la période de la Résistance, la poésie de circonstance. Il t’a donc fait cette confidence de considérer Le Crève-Cœur comme un des grands moments de son œuvre. Est-ce qu’il évoquait avec toi cette nécessité de la contrebande.
Michel Apel-Muller. Non, il n’aimait pas tellement parler de ce qu’il faisait. Je me souviens que j’avais mis Le Crève-Cœur précisément au programme de licence à Besançon et j’avais été arrêté par un des petits poèmes, tu sais, « Une petite auto navigue », à la manière d’Apollinaire. Il y a Verlaine, la petite auto d’Anvers, c’est très intertextuel. Et puis tout à coup entre deux vers il y a un décrochement typographique. Le vers doit être un hexasyllabe ou un hepta et puis tout à coup ce décrochement, c’est le seul exemple dans le poème. Et j’avais parlé de ce décrochement en explication. Il me dit « Qu’est-ce que tu me racontes ? » Je lui montre le texte, il regarde et il me dit : « Je ne me rappelle plus ! » (rires) .l ne voulait pas donner ses petits secrets. D’ailleurs il disait souvent quand on lui posait la question : « Je ne me souviens jamais de mes poèmes. »
Maryse Vassevière. Et dans le même temps, il y a la volonté de montrer « la trame du chant »… Et du lien finalement entre la poésie de circonstance, enfin la poésie la contrebande et l’utilisation des mythes dans la contrebande et du lien avec le merveilleux surréaliste ?
Michel Apel-Muller. Il se dérobait devant un discours de caractère universitaire…
Luc Vigier. Et ce Claude Rouquier, auteur d’un mémoire de maîtrise sur son œuvre, mentionné dans « Le Mérou », et dont Aragon disait qu’il avait dit des choses très justes sur son œuvre auxquelles il n’avait rien à ajouter, l’as-tu rencontré ?
Michel Apel-Muller. Non, dans la réalité, quand j’arrivais, il me donnait un tas de trucs qu’il avait trouvés pendant la semaine en me disant : « Tiens, tu regarderas ça. » Il arrivait avec un paquet de thèses, de mémoires, qu’on lui envoyait. « Si ça t’intéresse, regarde ça, moi… » C’est-à-dire, on lui envoyait des thèses, il ne lisait pas…
Maryse Vassevière. Une dernière question sur une période de son œuvre dont il a pu parler avec toi. Dans les années 60 et même un peu après le colloque de Cerisy, est-ce qu’il parlait volontiers du structuralisme et des avancées des sciences humaines ?
Michel Apel-Muller. Non, il ne parlait pas du structuralisme en termes théoriques, en tout cas pas à moi, il parlait des hommes, je n’étonnerai personne en disant qu’il était très attentif à ce que disait Roland Barthes, très attentif, il avait beaucoup aimé son Empire des signes par exemple. Ce n’est un mystère pour personne de savoir qu’il connaissait Lacan depuis longtemps, même si Lacan était un cadet pour lui, et qu’on sait aussi l’importance que Lacan accorde à Aragon. Il parlait avec attention de Lacan, beaucoup d’admiration pour Foucault, il m’a dit : « C’est très fort ce que fait cet homme, c’est remarquable. » Derrida également avec lequel il avait des rapports. D’ailleurs à la fin des Lettres françaises il y a eu, je crois me souvenir, des interviews de Derrida. Et puis il y avait aussi que Derrida, et les autres, avaient pour Aragon une immense considération. Enfin il suffit de voir les lettres qu’il y a au Fonds, quelques-unes, de Derrida, de Chomski…
Luc Vigier. On a l’impression d’un commentaire indirect d’un texte d’Aragon de La Mise à mort dans La Vérité en peinture de 1978. C’est une problématique voisine, c’est étonnant. Il y a eu rencontre ?
Michel Apel-Muller. Oui, oui. De la même façon qu’Elsa parlait volontiers de Greimas.
Maryse Vassevière. Est-ce qu’Elsa connaissait Greimas ?
Michel Apel-Muller. Il était comme elle un homme des pays baltes ! Elle disait : (imitant l’accent russe d’Elsa) « Vous savez il a repris le vocabulaire, la traduction de, le mot “actant”, c’est d’une banalité en langue russe ! » Si vous voulez c’étaient des gens qui connaissaient la théorie mais qui jamais ne faisaient un discours théorique. Si vous prenez La Mise à mort, La Mise en mots… Les Incipit…
Maryse Vassevière. Et il y a aussi le rapport avec Jakobson…
Luc Vigier. C’est un rapport d’enfance…
Michel Apel-Muller. C’est un rapport d’enfance… il y a un double rapport, ce que rapporte Elsa est qu’il était amoureux en fin de compte, avec Victor Chklovski aussi, Jakobson… les jeunes copains d’adolescence… qui ont été amoureux d’elle toute sa vie. Elle a bien dû les faire marcher, la coquine ! Oui, même dans leur grand âge, n’est-ce pas ? Les lettres de Chklovski à Elsa sont émouvantes, il parle toujours d’amour…
Luc Vigier. Sur Théâtre/Roman, la jaquette de publication, c’était « mon dernier roman ». Est-ce que la valeur testamentaire était alors évidente ou c’est quelque chose qu’il avait en tête pour achever son œuvre ?
Michel Apel-Muller. Valeur testamentaire, je ne sais pas mais ce dont il était sûr c’est qu’il n’écrirait pas d’autres romans. Il en était en effet persuadé parce qu’il pensait à cette époque qu’il allait mourir tout de suite. Bon, après il n’était plus question qu’il puisse écrire un roman d’une pareille ampleur, c’est le dernier grand flamboiement, parce qu’il faut bien dire qu’après le seul grand texte qu’il ait écrit, après les préfaces de L’OP, c’est le discours du CNRS, après c’est fini. Des petits textes, mais c’est fini. Alors testamentaire, je ne sais pas, oui sans doute. Il y a un côté qu’avait bien vu Vitez, c’est le côté docteur Faust…
Maryse Vassevière. est-ce que tu as l’impression qu’Aragon et Elsa t’ont apporté quelque chose ?
Michel Apel-Muller. Ah !
Maryse Vassevière. Est-ce que tu peux essayer, non pas de résumer mais de… formuler…
Michel Apel-Muller. Écoute, ça représente, le rapport à Aragon et à Elsa, ça représente quarante ans de ma vie. C’est-à-dire l’essentiel. C’est-à-dire que sans eux je serais quelqu’un d’autre. De tout autre. Et qu’en fin de compte ils ont complètement modifié, orienté ma vie. C’est que ma vie était peut-être prête aussi à cette rencontre, ça je ne sais pas mais aujourd’hui, je suis toujours (je commence à être un vieux monsieur) et je suis toujours dans la pro-blématique qui était la mienne il y a trente ans. Ça donne à ma vie une unité absolue, un sens. Et puis je n’ai aucun regret parce que je pense que j’aurai au moins fait ça : servir ces œuvres qui sont pour moi appelées à faire partie pour très très longtemps de la littérature française. Je n’ai pas perdu mon temps. Puis le fait qu’ils aient été l’un et l’autre les plus fantastiques professeurs que j’ai jamais eus, ça aussi c’est sûr et dans tous les domaines.
Luc Vigier. Pas théoriciens mais pédagogues alors…
Michel Apel-Muller. Pédagogues, oui. J’ai appris une manière d’être en les voyant. Ils m’ont enlevé beaucoup d’écailles et d’œillères, que ce soit dans le domaine de la littérature, de la politique, dans le domaine de la vie tout court.
Maryse Vassevière. Bon alors pour conclure, un souvenir, une anecdote qui t’est chère
Michel Apel-Muller. Oui, il y a beaucoup de choses…. le dernier mot, le dernier mot : Aragon était couché, à quelques jours de sa mort, alors il parlait difficilement. Il m’a pris la main (comme il faisait, il prenait la main et il la gardait et si l’on essayait de la reprendre, il serrait) alors il a ouvert les yeux, il m’a reconnu visiblement, et je ne sais pas ce qu’il a voulu me dire, il m’a dit : « Je suppose… » Il n’a pas été plus loin. Je reste sur cette supposition étrange. En m’interrogeant beaucoup sur la supposition. Pour télécharger cet entretien en format pdf