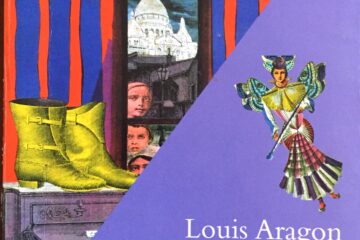Marianne Delranc-Gaudric, « Elsa Triolet dans la Résistance : l’écriture et la vie », 12 décembre 2011
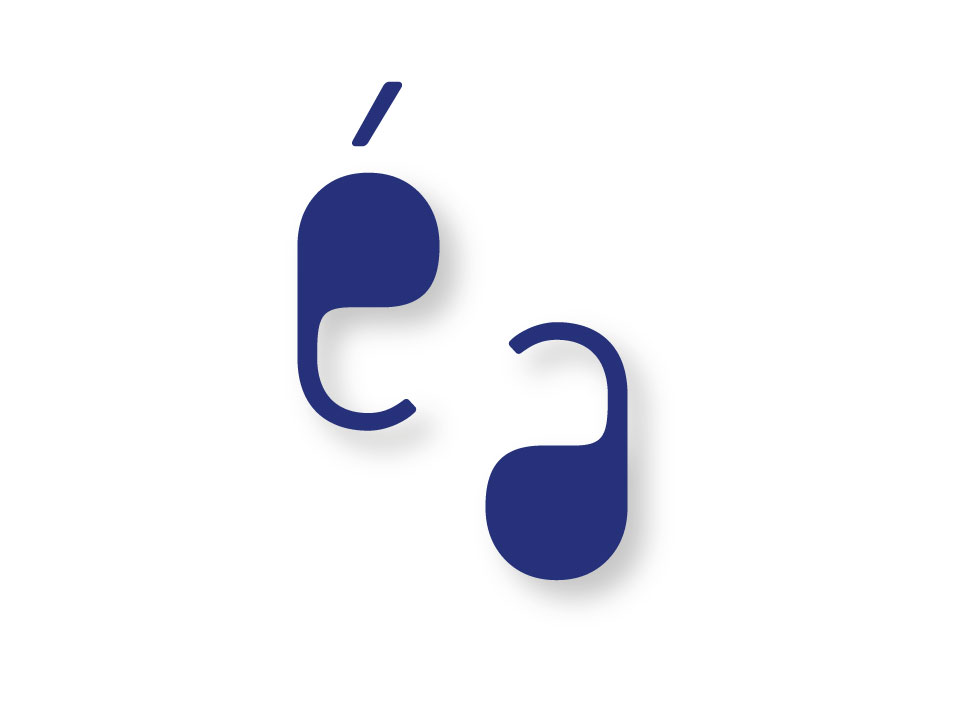
Marianne Delranc-Gaudric, « Elsa Triolet dans la Résistance : l’écriture et la vie », 12 décembre 2011
Ce texte reprend avec quelques modifications la communication réalisée le 15 mars 2008 au séminaire ERITA ; une version plus courte en a été publiée par la revue Europe, n° 979-980, novembre-décembre 2010. Suite au transfert de notre site internet, les notes de bas de page sont intégrées au texte dans un format peu agréable à la lecture, veuillez nous en excuser.
Elsa Triolet fut l’une des rares écrivaines françaises célèbres qui, durant la seconde guerre mondiale, ait participé à la Résistance à la fois par ses actes et par ses écrits. S’il était difficile pour une femme, entre les deux guerres, d’être reconnue comme écrivain – a fortiori lorsqu’elle était d’origine étrangère – il était bien plus périlleux de continuer à écrire pendant la guerre et de résister lorsque l’on était juive et mariée depuis février 1939 à un écrivain communiste surveillé par la police.
Peu avant la fin de la guerre, Elsa Triolet écrit le 1er février 1945 à sa sœur, Lili Brik, restée en Union soviétique, une lettre qui récapitule brièvement ce qu’elle a vécu avec Aragon (il s’agit là de sa première lettre depuis 1940) :
« Notre calvaire a commencé en 39. Le 2 septembre Aragon a été mobilisé, le 3 octobre il y a eu chez moi une grandiose perquisition. Nous étions suivis par des flics. Quand Aragon en a eu assez, il a demandé à quitter son bataillon, en quelque sorte disciplinaire, pour le front. Il s’est retrouvé dans une division de blindés qui ne reculaient que sur ordre, fin mai, ils ont dû fuir par la mer, si tu te souviens de la retraite de Belgique, par Dunkerque, en Angleterre ; de là ils sont allés à Brest et à travers toute la France sans cesser de se battre jusqu’à l’Armistice. Pendant ce temps, j’étais surveillée en permanence et on m’aurait sans doute arrêtée, si n’était intervenue la fuite générale de Paris. » (Lili Brik Elsa Triolet, Correspondance 1921-1970, Gallimard, 2000, p. 159)
Il faut rappeler que le 25 août 1939, le journal Ce Soir, qu’Aragon dirigeait, fut suspendu, ainsi que toute la presse communiste, à la suite de la signature du pacte de non-agression germano-soviétique ; que le 26 septembre, le PCF était dissout et que 11000 perquisitions, 3400 arrestations, 1500 condamnations eurent lieu dans la période qui suivit. Un peu plus tard, Elsa Triolet écrit à sa sœur, le 17 mai 1945 :
« … tu ne peux imaginer ce que cela a été en 39-40-41, surtout en 39, quand les gens passaient sur l’autre trottoir pour ne pas avoir à me serrer la main et la seule personne qui ne m’abandonnait pas était le flic qui me filait partout. » (Op. cit., p. 167)
Son deuxième livre en français, Maïakovski, poète russe, souvenirs (Éditions sociales internationales, Paris, 1939, 139 p.), qui date de juin 1939, est saisi et détruit « au bout de quelques mois à peine » par la police du gouvernement Daladier (Aragon, Elsa Triolet choisie par Aragon, Gallimard, 1960, Introduction, p. 17). Mais ce n’est rien en comparaison de ce qui va se passer vers la fin de la guerre et qui nous est connu par des notes du lieutenant SS Heinz Röthke, l’un des responsables (En charge des affaires juives à Paris, il remplace Dannecker sous les ordres de Bœmelburg) du commandement de la Gestapo et du SD (« Bureau central du service de sécurité », structure de la SS créée en automne 1931 sous le commandement de Heydrich ; cf. J. Littell, Les Bienveillantes, Gallimard, 2006, glossaire, p. 902) en France, conservées au Centre de Documentation Juive Contemporaine (CDJC). L’une d’elles, datée du 21 mars 1944, demande au Commandeur de la Gestapo de Marseille (contrôlant la région d’Avignon) d’arrêter « immédiatement […] la juive Elsa Kagan dite Triolet, maîtresse d’un nommé Aragon également juif » (F. Crémieux, « Arrêtez immédiatement la juive Elsa Kagan dite Triolet… » Faites entrer l’infini, n°21, juin 1996, p. 15). Le 6 avril 1944, le Commandeur Muehler de Marseille répond : « Au sujet d’Elsa Kagan nous n’avons rien pu apprendre. En vue d’une enquête ultérieure l’affaire est transmise à l’antenne de la SIPO [Sicherheitspolizei/Police de sécurité, comprenant la Gestapo et la Kripo] d’Avignon » (F. Crémieux, op. cit. p. 15.). Il ajoute que d’autres juifs ont été arrêtés.
Il faut songer que le premier statut des juifs date du 3 octobre 1940 et que la loi du 18 octobre 1940 prévoit que les « ressortissants étrangers » de race juive pourront être internés dans des camps. Elsa Triolet est française par mariage, mais un décret relatif à la situation et à la police des étrangers, datant du 12 novembre 1938 et signé A. Lebrun, E. Daladier, A. Sarrault et P. Marchandeau, facilite le retrait de la nationalité française (M. R. Marrus & R. O. Paxton, Vichy et les Juifs, Livre de poche Calmann-Lévy, 1981, p. 596-614). Ce premier statut des juifs est repris et aggravé en juin 1941 si bien que l’existence de tous ceux qu’il vise devient très dangereuse, voire impossible. La chasse aux « judéo-bolchéviques » devient de plus en plus cruelle. À cela s’ajoute la propagande vichyste antiféministe, relayée par des revues comme Candide, qui stigmatise les femmes intellectuelles, les rendant même en partie responsables de la défaite de la France :
« Parce qu’enivrée d’elle-même, éprise d’action directe, d’ambition personnelle – avocate, docteur, “homme“ d’affaire – , la femme a peu à peu été détournée de son rôle éternel […]. Parce qu’elle n’a pu transmettre à son mari, à ses fils, la flamme qu’au plus profond d’elle-même elle n’entretenait plus, la femme française porte aujourd’hui dans la défaite de la France sa part, lourde part, de responsabilité » (André Corthis, « Le marxisme est l’ennemi de la femme et du foyer », Candide, 15 octobre 1941, cité par Francine Muel-Dreyfus in Vichy et l’éternel féminin, Seuil, 1996, p. 50-51)
Cette propagande vient conforter les lois d’octobre 1940 qui restreignaient le droit au travail des femmes.
1940
Toutes les conditions étaient donc réunies pour qu’Elsa Triolet se taise ; or, elle ne s’est pas tue. De janvier à mai 1940, alors qu’Aragon est mobilisé, et que se déroule le procès d’une quarantaine de députés communistes qui seront condamnés le 3 avril par un Tribunal militaire, elle publie dans la NRF, dirigée par Jean Paulhan, quatre articles (dans la rubrique « l’Air du mois ») sous le titre « Souvenirs de la guerre de 1939 », qui évoquent un Paris bizarre et inquiétant. L’avant-dernier article, intitulé « Le Petit Brun », qui devait paraître en avril, est refusé par la revue, sous la pression de Drieu la Rochelle. Dans une lettre du 8 mai 1940, Aragon alors médecin auxiliaire à Condé-sur-Escaut, écrit à Jean Paulhan :
« Pour autant que je comprenne ce que m’écrit E. des choses qui se disent d’elle dans nos milieux littéraires, il m’apparaît que quand on ne peut atteindre un homme de front, on le frappe dans le dos, et de préférence en plein cœur. C’est pourquoi il est difficile d’être la femme d’un écrivain détesté. Mon ancien ami, M de La R. [Pierre Drieu La Rochelle, note de Bernard Leuilliot.], n’avait pas encore atteint le fond de la fosse d’aisance : l’y voici. Qu’il y demeure. Mais cela fait que je tiens à ces Airs du Mois, comme dans une chambrée puante à la place qu’on a près de la fenêtre. Je tiens très peu à la vie, et beaucoup à mon amour (excusez cette phrase ridicule, je ne la trouve pas ridicule du tout ». (Aragon, Paulhan, Triolet, « Le Temps traversé », Correspondance 1920-1964, éd. établie et annotée par Bernard Leuilliot, nrf Gallimard, 1994, p. 93.)
Dans cette chronique, contrebalançant la propagande hitlérienne, Elsa Triolet s’attaque au racisme :
« Il avait un long visage triangulaire, ses cheveux noirs étaient frisés comme des jacinthes. Les vêtements n’épousaient pas son corps, comme ils ne sauraient épouser le marbre d’une statue. Mais le marbre de son corps à lui avait la couleur d’un miel foncé. […] Il portait sa beauté avec discrétion et timidité. Les hommes l’admiraient pour la perfection de ses muscles, pour sa virilité. Les femmes l’admiraient pour les mêmes raisons. Il n’était pas très grand, il était très brun, il n’était pas aryen, il était parfaitement beau (Elsa Triolet choisie par Aragon, « Souvenirs de la guerre de 1939, IV», p. 128). »
L’article continue sur ce ton, se poursuit par une réflexion sur l’autosuggestion raciste et se termine par l’expérience inverse. La narratrice s’attable à un café et décide de regarder « un grand type blond » d’un point de vue opposé aux préjugés « aryens » :
« …je lui ai vu des cheveux blêmes […] ses yeux avaient une couleur : celle d’un ciel de pluie morne. Mais comme la bouche n’était guère qu’une fente, il n’était guère possible de parler de la couleur de ses lèvres. Ses grandes mains blanches, avec au doigt une chevalière à couronne, n’avaient pas un poil : des mains chauves (Op. cit.,p. 129-130).»
La description se poursuit, et Elsa Triolet ajoute:
« En somme, on peut être grand et blond et avoir une sale gueule. Telle était ma conclusion. C’était le traître lui-même, l’agent de la Gestapo, le descendant des étudiants allemands aux visages balafrés au cours de duels provoqués dans une Bierstube par des “Mein Herr, Sie fixieren mich !“ (Monsieur, vous me regardez avec insistance !)
Finalement, je considérais ce pauvre homme avec une véritable haine. J’étais complètement hypnotisée par la suspicion que j’avais décidé de porter aux blonds. Quelle incroyable sottise !
Justement. » (Ibid.)
Cet article n’est donc pas publié.
En juin 1940, alors qu’Aragon est pris dans la « poche » de Dunkerque, la police vient interroger Elsa Triolet pour savoir où il est mobilisé (« Préface à la contrebande », ORC, T.3, p. 26). Elle quitte alors Paris pour tenter de le retrouver, séjourne à Arcachon où elle croise Marcel Duchamp, qu’elle avait connu dans sa jeunesse, à l’époque surréaliste, au temps où elle habitait à l’Hôtel Istria, rue Campagne-Première :
« J’ai rencontré Marcel Duchamp pour la dernière fois en juin 1940, dans la rue, à Arcachon. En même temps que je voyais pour la première fois les Allemands en France [C’est le 14 juin que les Allemands entrent à Paris]. Je venais d’arriver à Arcachon, je ne savais pas que les Allemands y étaient. J’aperçus Marcel Duchamp coiffé d’un chapeau de paille à larges bords et, derrière lui un détachement allemand. Marcel avançait sur la chaussée sans se douter qu’il marchait en tête des Allemands. Cela avait quelque chose d’inénarrable et de terrifiant, c’était clownesque, bouffon, implacable… Heureusement que j’ai trouvé derrière moi un mur pour me recevoir. Je n’ai pas couru après Marcel qui ne m’a pas vue… il y avait tout de suite derrière lui les Allemands, et puis, mes complications n’étaient pas les siennes. Et personne n’aurait songé imposer des complications à Duchamp. Parce qu’on avait le tort de croire qu’il était fait autrement que tout le monde ». (Elsa Triolet, « D’un simple mortel », Les Lettres françaises, n°1252, 9 octobre 1968 »
Fin juin elle retrouve enfin Aragon à Javerlhac, en Dordogne [Sur ce point, cf. Pablo Neruda, J’avoue que j’ai vécu, trad. Cl. Couffon, Gallimard, 1975, p. 186-190 et lettre d’Aragon à J. Paulhan du 1er octobre 1940, Correspondance Aragon-Paulhan-Triolet, op.cit., p. 105-106]. Celui-ci écrit à Georges Sadoul le 15 septembre 1940 :
« C’est à Carcassonne que nous sommes tous les deux […] J’ai été démobilisé à côté de Nontron, à Javerlhac, où E. était venue me retrouver, d’Arcachon. De là nous avons été en Corrèze chez Renaud, trois semaines, et nous voici ici depuis le début du mois, avec les mêmes perspectives et soucis que toi [Lettre à G. Sadoul, 15 septembre 1940, Exposition « Georges Sadoul », juin 1993, Cinémathèque de Paris] »
À partir de ce moment, sa vie et ses activités vont tantôt rejoindre celles d’Aragon, tantôt être menées de façon autonome. Réfugiée tout d’abord avec lui aux Angles, chez Pierre Seghers, puis à Nice, de la fin de 1940 au 11 novembre 1942, elle a participé auparavant, à Carcassonne, avec Georges Sadoul, à la création du réseau des « Étoiles » qui s’étendra progressivement sur 41 ou 42 départements de la zone sud et regroupera des intellectuels de différentes branches [Aragon date cette création d’ « août 1940 » (« Les Années Sadoul », Europe n°590-591, juin-juillet 1978, p.186), mais Sadoul est venu à Carcassonne fin septembre]. Elle écrit à sa sœur, dans cette même lettre de 1945 :
« Nous travaillions avec les intellectuels, Aragon avait la responsabilité de toute la zone libre. Nous sortions le journal Les Étoiles et avons monté une maison d’édition : la Bibliothèque française. Dans la clandestinité, bien sûr. Notre réseau a très vite couvert toutes les branches de la science, de l’art, environ 50.000 personnes ont rejoint l’organisation, dans toutes les villes ont commencé à sortir des journaux locaux des médecins, des juristes, des enseignants, etc. Nous avions nos agents de liaison qui diffusaient la littérature, c’étaient comme des commis-voyageurs qui établissaient les contacts. Le principal adjoint d’Aragon était Georges Sadoul [Elsa Triolet, Lili Brik, Correspondance, p. 160].»
Le journal Les Étoiles, auquel elle collabore, paraîtra de février 1943 jusqu’après la Libération (Georges Aillaud, « Les Lettres françaises et Les Étoiles, une lecture comparée » et la reproduction en fac similé de dix-sept numéros des Étoiles, dans Les Lettres françaises et Les Étoiles dans la clandestinité, 1942-1944, présentées par François Eychart et Georges Aillaud, Le Cherche Midi, 2008, p. 181-267). Elsa Triolet agit donc en relation avec un ou des réseaux résistants (on trouvera la MOI un peu plus tard).
Mais le fait de vivre avec Aragon, résistant lui aussi, posait, en même temps qu’un problème de sécurité (évoqué par Aragon lui-même dans ses Entretiens avec Francis Crémieux), celui de son indépendance d’action, à tel point que fin 1942 – début 1943, Elsa Triolet, ne voulant pas céder sur son engagement dans la Résistance, et considérant le danger de rester ainsi en couple, envisage de le quitter. Aragon explique qu’il refuse, « essayant de persuader Elsa que ce qu’elle écrivait était suffisant comme travail social. Elsa ne le pensait pas et elle me disait : « Je ne peux admettre l’idée qu’on arrivera à la fin de cette guerre et que quand on me demandera : Et vous qu’avez-vous fait ? je devrai dire : Rien. » […]. Elsa donc a travaillé, j’ai continué de le faire et nous avons continué d’habiter ensemble. Seulement, nous avons pris les précautions nécessaires pour que ceci ne soit un danger pour personne. […] Cependant, ajoute-t-il, l’essentiel de cette histoire est ailleurs : Elsa m’avait arraché mes lunettes masculines, ces préjugés de l’homme qui, sous le prétexte d’assumer toutes les responsabilités du couple, confine la femme à n’être que sa femme, son reflet [Aragon, Entretiens avec Francis Crémieux, Gallimard, 1964, p. 99-100]. » Aragon évoquera d’ailleurs plus tard cette dignité héroïque des femmes durant la guerre dans son roman Les Communistes, dont il affirme qu’il faut comprendre le titre au féminin.
Pendant toute la guerre, elle va donc agir tantôt avec Aragon, tantôt seule ou avec d’autres résistants, sur ce plan-là aussi en opposition avec l’idéologie vichyssoise, selon laquelle la femme ne peut et ne doit pas être un individu autonome. Aragon la suit dans cette opposition et c’est peut-être le point de départ de sa réflexion féministe, qui va se développer dans ces années-là [Dans Les Yeux d’Elsa par exemple ; sur ce point, cf. Entretiens avec Francis Crémieux, p. 61].
1941
Ainsi, fin juin 1941, après l’arrestation de Gabriel Péri en mai, elle se rend à Paris avec Aragon et Georges Dudach, qui était leur agent de liaison pour la zone nord. Mais après avoir franchi la ligne de démarcation, ils sont arrêtés par les Allemands [« Arrêtés par les Allemands trois jours après l’entrée des troupes hitlériennes en U.R.S.S. (22 juin) nous étions encore à la caserne de Tours plusieurs jours après le 14 juillet où nous avons pris part à une sorte de démonstration des prisonniers à l’occasion de la fête nationale. Cela fait donc un peu plus de trois semaines. Aragon » (note d’Aragon, in Catalogue Elsa Triolet, Bibliothèque Nationale, Paris, 1972, p. 52.] et emprisonnés trois semaines à Tours. Au moment de l’arrestation, Elsa Triolet a l’idée de dire qu’ils arrivaient de Paris et que, pris de peur, au moment de franchir la ligne, ils revenaient sur leurs pas. Le 15 juillet, ils sont relâchés et « refoulés » vers Paris où ils rencontrent Georges Politzer, sa femme Maïe et Danielle Casanova. Ils font admettre à G. Politzer la possibilité de faire paraître légalement une littérature de contrebande [Cf. ŒP 1, T ; 10, « De l’exactitude historique en poésie », p. 67-68.]], préparent le n° 2 de La Pensée libre [Créée en février 1941] et organisent avec Jean Paulhan et Jacques Decour un groupement d’écrivains préfigurant le CNE. Dans sa « Préface au désenchantement », Elsa Triolet raconte les péripéties de cette création:
« Aragon et Paulhan décidèrent de tâter le terrain en premier auprès de Georges Duhamel et s’en furent chez lui, dans sa maison de campagne. Nous devions, ensuite, nous retrouver, toi et moi, pour déjeuner, dans un restaurant du boulevard Montparnasse, avec Maïe, Politzer et Danièle.
Tu étais en retard. Très en retard. Nous avons finalement déjeuné sans toi. Nous avons attendu après le déjeuner, autour de la table. Fait les cent pas sur le trottoir. Nous essayions d’espérer, de plus en plus certains que tu t’étais fait prendre. Enfin, j’ai laissé les autres, je suis descendue dans le métro pour rentrer.
Je t’ai trouvé en sortant de la station Saint-Cloud assis sur les marches, à m’attendre : tu étais bien venu à l’heure du rendez-vous, mais il y avait deux restaurants côte à côte, au même numéro… Tu t’es trompé de restaurant, tu y es entré, tu y as aperçu une tablée de gens que tu connaissais, dont Robert Desnos, et tu es ressorti sans demander ton reste : à cette époque, on craignait trop les bavardages pour saluer même des amis. Et comme c’est moi qui avais la clef de la grille de la maison de Lipchitz, tu ne pouvais pas rentrer et tu m’attendais sur les marches du métro depuis des heures. [ORC, t. 9, p. 4-15. Notons au passage qu’Elsa Triolet joue aussi, par ses écrits postérieurs à la guerre, le rôle de témoin de ce qu’a été la Résistance] »
C’est également au cours de ce séjour qu’ils préparent avec Jacques Decour le projet de publication des Lettres françaises [Cf ; Pierre Seghers, La Résistance et ses poètes, témoignage de Claude Morgan, Seghers, 1974, p. 209]. Puis ils rentrent en zone sud. À l’automne 1941 va paraître dans L’Université libre un « Manifeste des intellectuels de la zone occupée » dont la rédaction, selon Gisèle Sapiro, est probablement due à Aragon, Elsa Triolet, Pierre Seghers et Andrée Viollis [G. Sapiro, La Guerre des écrivains, Fayard, 1999, p. 478. Andrée Viollis (1870-1950) était journaliste ; elle avait collaboré à La Fronde, journal de Marguerite Durand, puis au Petit Parisien, à Vendredi et, à partir de 1938 à Ce Soir.]
Durant cette période, à partir de mai 1941, Elsa Triolet écrit, pour la revue de Pierre Seghers, Poésie 41, une série d’articles intitulés « Fantômes 41 » puis « Fantômes 41 et monstres 42 » dans le n° de décembre 1941-janvier 1942, série qui s’achève en mars 1942. Elle y évoque l’atmosphère trouble et sombre de cette période et y définit à mots couverts, en mars 1941, ce que l’on a appelé la « contrebande » [Cf. Pierre Seghers, La Résistance et ses poètes, Seghers, 1974, p. 114.] Elle y évoque aussi les Juifs pourchassés par les nazis et par Vichy :
« C’est un homme, il est petit, il a une barbe blanche qui descend bas sur sa poitrine, des boucles blanches encadrent son visage et il porte un long vêtement couleur de sable. Quand le vent lui arrache son chapeau noir, il découvre, posée sur ses cheveux blancs, une petite calotte noire, pointue […] Est-ce le Juif errant lui-même ou un juif en chair et en os, devenu errant ? Le vent souffle, il y a un grand soleil, il tourne un coin de rue et l’apparition disparaît [« Fantômes 41 », Poésie 41, n°4,5,6.] »
Elle déclare à sa sœur, dans sa lettre du 1er février 1945 :« S’il n’y avait pas eu l’écriture, je crois bien que je me serais donné la mort, tellement par moments, c’était dur et pénible. [Correspondance, p. 161] ». Pour survivre, donc, elle écrit, et entre autres choses des nouvelles ; « Elsa a écrit de belles histoires » écrit Aragon à Jean Paulhan le 23 mai 1941. Il s’agit de La Belle épicière [Paraît, avec Henri Castellat et Le Destin personnel, chez Denoël, en 1942], rédigée entre Paris et Carcassonne, dans la période troublée qui va de mai à septembre 1940 ; Le Destin personnel, Henri Castellat, Mille Regrets [Paraît tout d’abord dans la revue Fontaine à Alger en décembre 1941, puis est publié chez Denoël en mai 1942], qui datent de 1941. « Vildrac est fou de Mille Regrets. Il n’est pas le seul : on m’en parle beaucoup » écrit Jean Paulhan à Aragon et Elsa Triolet le 4 juin 1942 [Op. cit., p. 138]. Du Destin personnel, daté de « Villeneuve 1941 » (donc de l’été 1941, c’est à dire après l’arrestation de Gabriel Péri en mai), Aragon écrit que son titre sonne « comme un défi, en un temps où il semblait que personne n’eût de destin à soi [Elsa Triolet choisie…, p. 20] » et Elsa Triolet que cette nouvelle « continuait cette sorte d’affirmation de la maxime napoléonienne : Le destin, c’est la politique; les événements qui bouleversaient le monde ne faisaient qu’une bouchée des destins personnels [ , T.3, « Préface à la contrebande », p. 33-34.] » Cette maxime napoléonienne, mêlant vie privée et Histoire, se retrouvera ensuite assez souvent sous sa plume, ainsi que sous celle d’Aragon ; elle est rapportée par Goethe en 1808 dans son Entretien avec Napoléon [Gœthe, Ecrits autobiographiques 1789-1815, éd. établie par Jacques Le Rider, Bartillat, 2001, « Entretien avec Napoléon », 2 octobre 1808, p. 516], entretien évoqué par Aragon dans Commune en février 1939 [ŒP 1, T.IX, « L’Humanisme allemand », in Commune n°66, p. 25] ; on la retrouve dans Le Musée Grévin en 1943 :
« Qu’est-ce que c’est disait à Gœthe
Napoléon que le destin
Le destin c’est la politique » (ŒP 1, T.X, p. 206-20)
Exemple du croisement des réflexions et des œuvres…
Cette nouvelle participe aussi de la littérature de contrebande : « Dans mon esprit, note Elsa Triolet, cela [C’est à dire l’action de la nouvelle.] se passait dans la solitude de la garrigue, et c’était le Palais des Papes que cachait le brouillard. Mais comme rien n’était nommé dans ces pages, j’ai fait courir la ligne de démarcation près du champ où l’héroïne, seule, passe la nuit. Pour lui faire entendre le tintement du vélo de Georges Dudach, l’aboiement des chiens qui nous suivait de village en village, le bruit nocturne d’un avion au-dessus du champ où nous couchâmes. J’écrivais cela à Villeneuve-lès-Avignon, nous venions de rentrer de Paris… J’écrivais cela pour ceux qui savaient et qui reconnaîtraient ainsi en nous des amis ; pour dire à d’autres : « Ne croyez pas que personne n’ose désobéir ! [ORC, T3 « Préface à la contrebande », p. 34] »
Quant à Henri Castellat, c’est un de ces personnages qui, écrit-elle, « ne songeaient qu’à tirer leur épingle du jeu. Comme s’ils pouvaient écarter la mort de leur chemin ! Fuyant le danger, ils écraseront sous leurs pas leur propre vie, ils seront punis d’impuissance…[Ibid., p. 33.] » Henri Castellat est l’image du lâche, qui fuit le danger de la guerre en partant aux Etats-Unis, via Le Havre où l’attend le paquebot Normandie[[Il est à noter que c’est sur le Normandie qu’Elsa Triolet et Aragon s’étaient rendus aux USA en 1939, comme l’indique Aragon dans « Et comme de toute mort renaît la vie… », (ORC T. 15, p.22), et qu’ils avaient refusé, au début de la guerre de s’exiler aux États-Unis. « Nos amis, aux États-Unis et en Amérique du Sud, nous pressaient de venir chez eux. Mais pour nous la question ne se posait pas : ni toi ni moi, nous ne voulions quitter la France. Nous étions certains que le pays ne se laisserait pas faire, et il ne s’agissait pas seulement de Londres, non, cela allait s’organiser sur place. » (« Préface à la contrebande », ORC, T 3, p.28.]].
1942
La nouvelle Clair de lune, quant à elle, écrite à Villeneuve-lès-Avignon en 1942, donc pendant l’été, et publiée dans Poésie 42, est la première qui contienne une évocation des camps de concentration, vus dans un cauchemar par le personnage principal, Madame Léonce :
« Jeanne voit des hommes… Ils défilaient devant elle, nus, tout à fait nus, décharnés… Ils avaient les pommettes saillantes, et le nez retroussé, tous… Les cuisses ne sont pas plus fortes que les bras décharnés, les poitrines sont rentrées, on voit les côtes au-dessus d’énormes ventres ballonnés… […] il y a des vivants parmi eux, roses et bottés. […] de temps en temps, il y en avait un qui tombait […] Puis il y eut des flammes… Les hommes ont mangé toutes les brindilles de paille, ils ont mangé la poussière[[ORC, T.3, p.276.]] » etc…
C’est, en fait, qu’à Nice leur sont parvenues de Suisse, par l’intermédiaire de Bernard Anthonioz, selon Aragon[[Cf. Catalogue Elsa Triolet, Bibliothèque Nationale, 1972, p.54.]], les premières images des camps allemands[[ORC, T.17, « Préface à une ‘Vie de Michel Vigaud’ »p.13..]] et que Joë Nordmann remet à Aragon de la part de Jacques Duclos des documents à partir desquels il écrira Le Témoin des Martyrs[[Cf. ŒP 1, T.IX, note 55 p.405.]]. L’écriture et la publication de cette nouvelle apparaissent d’autant plus importantes et héroïques qu’à la fin juin 1942, Eichmann vient en France transmettre l’ordre de Himmler de déporter tous les Juifs de France sans distinction et sans égard à leur citoyenneté française[[M.R. Marrus et R.O. Paxton, Vichy et les Juifs, trad. M. Delmotte, Calmann-Levy-Livre de Poche, 1981, p.308.]].
Des nouvelles, elle en écrira d’autres l’année suivante. Mais à Nice, elle rédige aussi un roman, Le Cheval blanc, qu’elle terminera en novembre 1942 à Villeneuve-lès-Avignon. On peut suivre les étapes de son écriture dans les lettres qu’Aragon envoie à J. Paulhan : « Elsa s’est jetée à écrire un roman, une sorte de Gil Blas » écrit-il le 16 janvier 1942[[op. cit., p. 124.]] ; « un roman de grande envergure » ajoute-t-il le 4 février[[Ibidem, p. 126.]] et le 17 février : « Le roman d’Elsa est très surprenant, et grandit[[Ibid., p.128.]] » ; le 17 avril : « Le roman d’Elsa approche de sa fin, et je suis enfoncé dans le mien, conjointement avec des poèmes de longue haleine[[Ibid. p. 135.]] » ; enfin, le 4 mai : « Elle a fini son nouveau roman, ou du moins elle l’a écrit pour la première fois de bout en bout, et va se mettre à le taper à la machine, ce qui est pour elle toujours entièrement réécrire[[Ibid. p. 137.]]. » Le Cheval blanc est en effet écrit en dialogue avec ce qu’écrivait Aragon à l’époque. L’on sait que face à l’idéologie nazie d’abaissement de la France d’une part et d’exaltation de la force d’autre part, face aussi à la récupération de mythes comme celui de Tristan par les nazis et les collaborateurs, Aragon avait entrepris de revenir à la culture française du Moyen-Âge, à la littérature de chevalerie qui valorisait l’amour de la France et l’amour de la femme (on trouve cela dans Les Yeux d’Elsa dont beaucoup de poèmes sont écrits en 1941, ou dans Brocéliande par exemple). Pour Elsa Triolet, cela ne suffisait pas, ou en tout cas, ne pouvait toucher la jeunesse de l’époque. Elle crée un personnage, Michel Vigaud, dont elle dit qu’il est « un chevalier du Moyen-Âge qui rêve de délivrer du dragon une ville et la belle aux tresses blondes, et ne reconnaît point les dragons à décapiter et les belles à délivrer de notre XXème siècle, ne sachant que faire de son esprit de sacrifice et de sa soif d’amour[[ORC, T.1, p.17.]]. » C’est « un garçon de la génération à laquelle on avait soudain dit : ‘va, fais la guerre !’ et qui ne savait pas plus que les autres pourquoi il fallait qu’il y aille et quelle était cette guerre[[Ibidem, p.18.]]. » Répondant à Aragon, elle écrit, dans l’un de ses cahiers manuscrits : « Et la jeunesse généreuse s’engage dans ce labyrinthe ayant pour tout bagage les idéaux des siècles passés, ceux de la cape et de l’épée. Comment voulez-vous vivre avec ça[[Cahier 142, f°13.]] ? ». Tout le roman est l’histoire de la prise de conscience de ce personnage qui, abandonnant ses rêves de cheval blanc, dit-elle, « montera dans un char en pleine connaissance du monde et de ses catastrophes[[ORC T. 1, p.21. Concernant le dialogue entre Aragon et Elsa Triolet, cf. L. Follet, Aragon, le fantasme et l’Histoire, Les Belles Lettres, Paris, 1988 et C. Grenouillet, « Celui qui croyait au ciel et celui qui n’y croyait pas », Correspondance Aragon-Béguin, RCAET n°4, 1992, p. 280-282.]]».
Le roman est édité par Robert Denoël, qui était déjà son éditeur avant-guerre et qui avait continué à la soutenir en 1939, lorsque Aragon était mobilisé[[Cf. ORC, T.17, « Préface à Une Vie de Michel Vigaud », p.22-23.]]. En 1942, Denoël passe à Nice, « lors d’un voyage, si je ne me trompe, écrit-elle, avec une amie qu’il avait emmenée au Portugal : elle était Juive, et, peut-être, Anglaise et il voulait la mettre en lieu sûr. Ce voyage était un risque dévoué, passionné.
À cette rencontre, j’ai montré à Robert Denoël la première moitié du Cheval blanc. Il n’eut qu’une peur : est-ce que la suite allait être à l’avenant ?[[Ibidem, p.23.]] » Elle le revoit en septembre 1942 en Avignon, à l’Hôtel de l’Europe, où elle lui lit la fin du roman. Elle lui fait part des « rumeurs sur son compte, entendues pour la première fois rue de France, dans la librairie de Pierre Abraham : l’éditeur Denoël travaille avec les Allemands. Est-ce vrai ? Oui, dit-il, c’est vrai. C’est à peine si je parviens à articuler : « Mais alors, on ne peut plus être amis !… » Et lui qui me console et me prie de ne pas dire de bêtises, ses employés doivent manger tous les jours, n’est-ce pas… Parlons du Cheval blanc !
Dans la nuit, il avait lu le manuscrit en entier. Il allait essayer de le publier sans coupures… Qu’aurait-on pu y couper ? Du point de vue allemand, c’était le tout, la chair même du livre qui aurait dû être exécutée. Mais les Allemands n’y verraient que du feu ! C’était un risque à courir[[Ibid. p.23-24.]]. » Le roman sera publié le 10 juin 1943, sans la phrase finale, qui évoquait le camp de Gurs[[« Stanislas Bielenki ne reçut pas cette lettre, il y avait un an qu’il était dans le camp de concentration de Gurs, où l’on ne fait pas suivre le courrier », ORC, T.18, p.215.]]. Il aura une large diffusion, sera lu y compris dans les prisons et très apprécié par des écrivains comme Roger Martin du Gard, Max Jacob, Robert Desnos, Albert Camus, ainsi que par Henri Matisse, comme en témoignent leurs lettres[[Cf. Elsa Triolet choisie…, Introduction, p.23-25 et Aragon, Henri Matisse, roman I, p. 186.]]. Les Lettres françaises en rendent compte dans le n°11, en novembre 1943 et l’auteur anonyme de l’article[[En fait, Claude Morgan.]] déclare que « Ce héros est de la même espèce que ces centaines de milliers de héros anonymes qui peuplent aujourd’hui la France[[« Le Cheval blanc par Elsa Triolet » Les Lettres françaises n°11, novembre 1943, p.4.]].» La vente du Cheval blanc va lui permettre, ainsi qu’à Aragon, de vivre « deux années entières, et cela tombait fort à propos, les Américains ne nous envoyaient plus rien [[Correspondance, 1er février 1945, p.161.]]» écrit-elle après-coup à sa sœur.
C’est à Nice, en 1942 que leur parvient la nouvelle de l’arrestation de Georges et de Maïe Politzer, ainsi que de Danielle Casanova[[Arrêtés le 15 février 1942.]] et de Georges Dudach[[Arrêté le 19 février.]], qui sera exécuté, avec Politzer le 30 mai 1942. « Nous avons quitté Nice et la vie légale le 11 novembre 42, comme les Italiens entraient dans la ville de Nice. Nos ‘quartiers d’hiver’étaient préparés de longue main.
Nous sommes entrés dans la clandestinité » écrit-elle dans sa « Préface à la contrebande »[[ORC, T.3, p.32.]]. Elle se réfugie avec Aragon, au-dessus de Dieulefit, dans la Drôme, dans une ferme abandonnée proche du village de Combs et où logent deux antifascistes allemands, Ella Rumpf et Hermann Nuding[[Cf. Wolfgang Klein, « Près d’un bourg un peu particulier », trad. R. Lance-Otterbein, Les Annales SALAET, n°3, 2001.]]. Mais en chemin, elle s’est arrêtée, malade, chez Hélène Cingria, à Villeneuve-lès-Avignon, où déjà, en août 1942, des Juifs avaient été raflés. C’est elle qui va en décembre 1942, un peu avant Noël, à Lyon, chercher pour Aragon et elle-même des faux-papiers, que leur fournissent Pascal Pia et Albert Camus[[Cf. ORC, T.3, « Préface à la contrebande », p.38.]], lesquels font partie tous deux du mouvement Combat. Le 31 décembre ils quittent cette ferme très isolée qu’ Elsa Triolet décrit au début des Amants d’Avignon et se réfugient à Lyon, chez René Tavernier, le directeur de Confluences. C’est là qu’elle écrit, en réponse à la philosophie de l’absurde de Camus, avec qui elle est liée d’amitié, un texte atypique : Quel est cet étranger qui n’est pas d’ici ou Le Mythe de la baronne Mélanie[[ORC, T.3, p. 279-304.]], lequel paraît dans Poésie 43 en mai-juin[[N°14.]] et sera illustré par Matisse[[Dans le petit volume des éditions Ides et Calendes, Neufchâtel, 1945.]], qu’elle avait fréquenté à Nice avec Aragon. Le titre forme un écho à la fois au roman de Camus L’Étranger et au Mythe de Sisyphe. Outre des réflexions sur les raisons de vivre, on y trouve l’histoire d’une vieille baronne, qui meurt en 1943, ressuscite et revit toute sa vie à l’envers ; elle retrouve la paix d’avant septembre 1939 et tous ses petits tracas, et remonte sa vie jusqu’à sa conception. Ce texte étonnant est en même temps une réflexion sur le récit lui-même et sur les perspectives qui s’offrent à l’être humain : la vie « à l’endroit » et la vie « à l’envers », les perspectives changeant, ne sont pas du tout les mêmes. Albert Camus lui répond par une lettre philosophique et très élogieuse, où il qualifie son texte de « réussite étourdissante[[ORC, T.3, p.38-39.]] ».
1943
À Lyon également, elle rédige, au début de 1943, la nouvelle Les Amants d’Avignon, qu’elle a conçue au « Ciel », cette ferme abandonnée au-dessus de Dieulefit ; elle achève de l’écrire en février et la nouvelle paraîtra illégalement en octobre 1943 aux Éditions de Minuit à Paris, sous le pseudonyme de Laurent Daniel, choisi en hommage à Laurent et Danielle Casanova. C’est Jean Paulhan qui en remet le manuscrit à Yvonne Paraf (alias Desvignes) au cours d’une réunion clandestine du CNE, comme en témoigne une lettre d’Elsa Triolet à Jean Paulhan du 23 avril[[Correspondance, op. cit ;, p. 154.]]. Sa publication a donné lieu à un échange de lettres assez vif avec Paulhan, Elsa Triolet ayant cru que son texte était refusé[[Ibidem, p.155-162.]]. Cette nouvelle, qui a pour décor Avignon et le Fort Saint-André de Villeneuve, où elle a séjourné, met en scène une jeune femme ordinaire, Juliette Noël, amenée à se comporter héroïquement, de façon naturelle, poussée par les circonstances ; Elsa Triolet souligne le caractère ordinaire de ces résistant(e)s qu’elle côtoie :
« Des circonstances fantastiques avaient révélé les possibilités insoupçonnées des êtres. La vie quotidienne des dactylos, horlogers, apiculteurs, couturières, vendeuses, savants, instituteurs, concierges, le train-train de leur vie, ils le laissaient soudain se muer en danger permanent, prenant des risques insensés jusqu’à l’héroïsme. Les voilà, ces gens ordinaires, devenus chefs de maquis, agents de liaison, les voilà qui abritent des résistants, portent des paquets, cachent des armes, les prennent, se laissent torturer sans flancher, vont à la mort […] dans la nuit et le brouillard, il y avait beaucoup de filles banales comme Juliette[[ORC, T.5, « Préface à la clandestinité », p.14-15.]]. »
Elle est une des premières écrivaines, sinon la première, à mettre en scène le rôle des femmes dans la Résistance, rôle qui sera reconnu officiellement à la Libération et qui leur permettra d’obtenir le droit de vote. En choisissant une héroïne banale, Elsa Triolet s’inscrit aussi dans la discussion qui a lieu au même moment sur ce que Montherlant appelle « la morale de midinette » et Aragon la « morale courtoise ». « Pour ce qui est de la midinette… Il faut dire que bien des gens reprennent cette expression qui fait fureur, morale de midinette par-ci, morale de midinette par-là. Montherlant leur a donné du sucre et ils ont sauté dessus. Ils sont ravis de pouvoir assouvir ainsi leur misogynie, leur nietzschéisme au petit pied, ou simplement leur snobisme. Midinette fait vraiment mal dans le tableau, qui voudrait penser comme une midinette ? [[ŒP1, T.IX, « La Leçon de Ribérac », in Les Yeux d’Elsa, p.297, texte paru d’abord dans la revue Fontaine n°14, juin 1941.]] » écrit Aragon dans « La Leçon de Ribérac ». Il explicite cette position dans ses Entretiens avec Francis Crémieux :
« la morale de midinette était une image volontairement péjorative pour faire place à une autre morale que nous appellerons, aussi pour simplifier, la morale de seigneurs. Cette morale de l’homme au-dessus de la femme, c’est précisément contre elle que je combattais et il est vrai que, ici, le combat de caractère moral contre le fascisme en France allait de pair avec l’exaltation de la femme. Et de la femme que j’aimais. Cela est vrai. Mais les gens ne semblent pas avoir compris ce qu’il y avait là derrière[[Aragon, Entretiens avec Francis Crémieux, nrf Gallimard, 1964, p.61. Aragon fait ici allusion à l’idéologie nazie exaltant la force, le surhomme…]]. » Et Juliette Noël, qui a tout de la midinette, est en même temps héroïque, mais de façon naturelle, par attachement à la liberté et non par culte de la force. De plus, il est ouvertement question, dans cette nouvelle, de la Résistance et d’événements d’actualité, comme la guerre en Lybie, au détour d’une phrase[[Montgomery, après l’épisode de Bir-Hakeim, a remporté la victoire d’El Alamein le 3 novembre 1942.]]; l’on y trouve aussi des propos subversifs, comme ceux de ce voyageur, dans un compartiment:
« je suis cheminot, je viens de Paris, c’est à Paris qu’on voit qu’ils sont fichus… On a déjà supprimé Doriot…
C’est vrai cette histoire ?
Je pense bien ! C’est à dire, je ne sais pas s’il est mort, mais pour l’attentat, c’est sûr ! [[ORC, T.5, p.56. En réalité, Doriot, engagé dans la LVF mourra le 22 février 1945 à Mengen, en Allemagne, sa voiture attaquée en piqué par deux avions inconnus.]]»
Mais l’action continue. En avril 1943, elle se rend à Paris avec Aragon, qui, par l’intermédiaire de Pierre Seghers, vient reprendre contact avec Paul Éluard avec lequel il était en froid depuis une dizaine d’années. « Au début de cette année, raconte Lucien Scheler, afin de renforcer le Comité National, scindé en deux parties, et lui assurer une plus grande audience, Aragon animateur pour la zone sud, décide de rencontrer Éluard à Paris. À la suite de cette réunion, qui se tint dans le plus grand secret boulevard Sully-Morland et à laquelle assistaient pour la zone sud, Aragon, Elsa Triolet et Georges Sadoul, et pour la zone nord Éluard, Nusch et Lucien Scheler, le Comité National des Écrivains était doté d’une direction unique qui allait lui permettre d’agir avec le maximum d’efficacité[[Lucien Scheler, « Chronologie », Europe, Rencontres avec Paul Éluard, colloque de Nice (19-21 mai 1972), n°525, janvier 193,p. 284.]] ».
À Lyon, elle participe également à la création du CNE pour la zone sud (organisation clandestine rattachée au Front National)[[Cf. Pierre Seghers, La Résistance et ses poètes, p. 233.]], dont le « Manifeste » paraît dans le n° 7 des Étoiles, le 7 juin 1943[[Fonds d’archives du MRN, Champigny. Journal de petit format, réduit à une feuille et demie tapée recto-verso au carbone et appelée à être reproduite par ceux qui l’auront lue.]]. Au niveau national, la Résistance s’unifie à ce moment-là aussi, avec la création du CNR le 27 mai 1943. Mais après l’arrestation de Jean Moulin, le 21 juin, Lyon devient une ville trop dangereuse et elle se réfugie avec Aragon à Saint-Donat, petit bourg de la Drôme et siège du commandement FFI de la Drôme-nord. Ils ont tous deux de nouveau « de faux papiers à toute épreuve » écrit-elle[[ORC, T.5, « Préface à la clandestinité », p.19.]] (pour elle au nom d’Elizabeth Andrieux), que leur a procurés Madeleine Braun[[Madeleine Braun (1907-1980) était l’adjointe de Georges Maranne, responsable du Front National pour la zone sud, et directrice du journal Le Patriote. Médaillée de la Résistance, elle fut la première femme vice-présidente de l’Assemblée nationale.]]. « Ils auront été établis à Lyon par l’adjoint d’un commissaire de police, écrit P. Seghers, et inscrits sur le registre du commissariat, cachets authentiques et tout : imparable ! [[P. Seghers, op. cit ; p.233-234.]]»
Parlant de Saint-Donat, Elsa Triolet écrit :
« Il était entendu que nous devions y vivre comme tant d’autres émigrés de la Zone Nord, nous montrant désœuvrés et inoffensifs. Tout prenait la rigueur d’un travail illégal bien organisé […]
Nous y sommes restés jusqu’à la Libération, faisant des voyages assez fréquents à Valence, Lyon, Paris (à Lyon, nous avions même fini par louer une chambre au mois, à Bron). Les villageois nous regardaient aller et venir et faisaient les discrets. Assez vite, nous avions trouvé parmi eux des complicités silencieuses[[ORC, T.5, p.19.]] ».
C’est au cours de l’un de ces voyages à Paris, à l’été 1943, qu’ils manquent tous deux d’être arrêtés dans le train, avec des papiers compromettants, comme l’explique Aragon dans une dédicace d’un exemplaire du Musée Grévin, conservé au Musée de la Résistance nationale et qui en constitue l’édition originale[[sur l’édition du Musée Grévin, voir Guy Krivopissko, « Le Musée Grévin ou François la Colère dans les collections du Musée de la Résistance nationale », Louis Aragon et Elsa Triolet en Résistance novembre 1942-septembre 1944, Rencontres de Romans-sur-Isère, 12,13,14 novembre 2004, Les Annales de la SALAET, p. 100-105.]]. Pour situer cet événement dans le temps, il est nécessaire de citer cette dédicace in extenso :
« Cette édition constitue la véritable originale de ce poème : celle des Editions de Minuit, à Paris, est postérieure de près de deux mois[[L’achevé d’imprimer de cette œuvre aux éditions de Minuit étant datée du 6 octobre 1943, la première édition à la Bibliothèque française daterait donc du début août.]]. C’est, je crois, pour cette première édition imprimée en zone sud, que j’ai inventé le pseudonyme de François la Colère. A.[[r° de la page de garde.]] »
« Ce poème a été écrit presque entièrement à Saint-Donat, sauf la dernière partie écrite à Lyon. Je venais de l’achever quand je rencontrai, dans la montée de Champagne, où nous avions nos rendez-vous réguliers, Ruffe[[« Hubert Ruffe, l’informateur d’Aragon, faisait partie du triangle de direction clandestin de la zone sud et fut membre du comité de Libération de Lyon », note de B. Leuilliot, in « Aragon, autrement dit ‘François la Colère’, Les Annales n°6, SALAET, p.99.]] qui s’appelait alors pour moi Laurent. Il m’apprit la mort de Danielle[[Morte le 9 mai 1943.]] et de Maïe. C’est dans le train de Paris, où devait m’arriver l’aventure que je raconte plus loin, que j’écrivis les deux strophes en octosyllabes de la page 11 (présente édition)
La première partie était inspirée par un discours de Philippe Henriot à la radio. Le poème n’était pas terminé que ce speaker était exécuté par la Résistance[[Philippe Henriot est tué le 28 juin 1944.]] :
Tout le monde peut voir ces condamnés à mort
Et gicler un sang vil d’où la balle les troue…[[v° de la page de garde.]] »
« C’est dans le voyage où Elsa et moi apportions à Paris, en même temps, le manuscrit de ce poème et celui de l’autobiographie de Gabriel Péri, destinés à Vercors pour ses éditions clandestines, — que dans le train, entre Mâcon et Dijon, une fouille des voyageurs faillit empêcher à jamais la parution de ces manuscrits. Le sac qui les contenait venait d’être ouvert par l’officier allemand, quand quelqu’un l’appela dans le couloir : « Je reviens », me dit-il. Je l’attendis près de deux heures et il ne revint pas.
Elsa avait à la dernière seconde mis dans sa poche l’autobiographie de Péri : ce qui n’eût pas été une grande aide, le reste découvert… [[MRN, François la Colère (Aragon), Le Musée Grévin, La Bibliothèque française, 14p., ex. dédicacé à Germaine et Eugène Hénaff et dont la couverture « est faite dans un petit stock de papier mural pour salle de bains, trouvé à Lyon » (Aragon, dédicace, deuxième de couverture)]] »
Cette petite brochure qu’Elsa Triolet met dans sa poche, intitulée La Façon de vivre et de mourir de Gabriel Péri Fragments d’une autobiographie présentés par le témoin des martyrs et suivis d’un poème de François la Colère, publiée à la Bibliothèque française[[Brochure de petit format, sans date, 12p. MRN.]], est en effet un document explosif, car elle contient non seulement des fragments autobiographiques, mais une analyse historique de la guerre : Péri rappelle son opposition à la politique de sanctions menées en 1921 par le gouvernement français à l’égard de l’Allemagne, sa dénonciation du « caractère mercantile » de l’occupation de la Ruhr, son opposition au traité de Munich et donne des précisions sur les négociations qui eurent lieu en 1939 pour la signature d’une alliance politique et militaire entre la France, l’Angleterre et l’Union soviétique :
« Je trouvais les négociateurs réticents, et, en mai 1939, à la tribune de la Chambre, je dénonçai ces réticences. Si j’en crois les mémoires de de Monzie publiées sous le titre « Ci-devant »[[Aragon va se référer à ces Mémoires dans la rédaction des Communistes.]], d’autres partageaient mes appréhensions, mais se turent…
…Quelque temps après, j’accompagnai à Londres une délégation de parlementaires français (MM. Delbos, Bastide et Taittinger) qu’invitaient à un échange de vues des membres de la Chambre de Communes. La plupart de nos interlocuteurs étaient convaincus de l’avortement prochain de la négociation anglo-franco-soviétique. M. Lloyd George nous dit :’Si l’Europe reste dirigée par Chamberlain, Daladier et Beck, il n’y aura pas de pacte avec la Russie, et la guerre passera.’[[La Façon de vivre…, Fragments de l’autobiographie de Gabriel Péri, p.10.]] »
Gabriel Péri participe ensuite à la Commission des Affaires étrangères où il dénonce la « très lourde responsabilité » des gouvernements français et anglais dans l’échec des pourparlers et affirme qu’il est « indispensable de publier sans retard le Livre Blanc de la négociation[[Ibidem .]].»
En transportant cette brochure, publiée par leurs soins, Elsa Triolet effectue donc avec Aragon un travail politique et non seulement littéraire.
Au cours de l’été 1943 selon Aragon[[Elsa Triolet choisie par…, p.30. Concernant la date, il semble qu’Aragon ait raison, le reportage évoquant « d’adorables champs parfumés » et des jeunes gens en espadrilles (« c’est l’été, ils sont hâlés, le soleil arrange tout, mais s’il fallait passer l’hiver… » in « Aux armes, citoyens ! », Les Lettres françaises n° 16, mai 1944, p.5-6).]] ou en décembre selon Georges Sadoul[[Georges Sadoul, L’École du Maquis, coll. « Jeunesse héroïque », éd . France d’abord, avec le concours de l’Assemblée Nationale des anciens FTP, 32p., sans date, p.3. MRN.]], elle se rend dans le Lot, à l’initiative du CNE zone sud, pour un reportage sur les maquis :
« À l’automne de 1943, le Comité national des Écrivains (zone sud) et le Comité National des Journalistes, que venaient de fonder à Lyon Louis Martin-Chauffier[[Rédacteur en chef de Libération de 1942 à avril 1944.]] et André Sauger[[Avant-guerre, rédacteur au Canard enchaîné, et Résistant.]], décidèrent d’envoyer leurs représentants dans le maquis pour en rapporter des récits ou des reportages qui seraient édités en brochures clandestines, programme que la chute de plusieurs imprimeries empêcha la Bibliothèque Française de réaliser.
Elsa Triolet partit en décembre dans le Lot où Jean Marcenac la guida. J’allai en Dordogne au début de février. En mars, la vaillante Andrée Viollis parcourait le sud-ouest. En mai, ce fut le tour d’Édith Thomas, en Ardèche.
Quelques passages du reportage d’Elsa Triolet et du mien furent publiés par le n° clandestin de mai 1944 des Lettres françaises. Les récits d’Andrée Viollis et celui d’Édith Thomas furent perdus lors de la chute d’une imprimerie[[G. Sadoul, op. cit., p.3.]] ».
Jean Marcenac raconte en effet, dans son livre de souvenirs Je n’ai pas perdu mon temps qu’un inconnu vint le voir « un matin », « se recommandant d’Éluard. Il se présenta comme étant Georges Sadoul[[Jean Marcenac, Je n’ai pas perdu mon temps, éd. Temps actuels, Paris, 1982, p.315.]].» Ce dernier lui demande s’il peut prendre en charge « un écrivain qui était en train de rédiger un livre sur la Résistance[[Ibidem.]] ». Marcenac s’étonne « d’un langage aussi ‘ouvert’, dit-il, mais enfin, dans les conditions d’imprudence qui étaient celles où je vivais et agissais, je n’en fus pas stupéfait. Finalement, Sadoul me dit : ‘Oh ! et puis, pour ne rien vous cacher, il s’agit d’Elsa Triolet[[Ibid.]]. » Marcenac demande donc une confirmation « par la voie normale » et la reçoit « par le canal de Fernand Dupuy qui m’annonça que la direction du Front National pour la zone sud me demandait de faciliter l’enquête d’un écrivain sur la Résistance[[Ibid.p.315-316.]] ». Au passage, nous voyons qu’ Elsa Triolet n’agit pas seule, mais dans le cadre de réseaux organisés. Jean Marcenac va donc la chercher « vers sept heures du soir, à la gare de Figeac », avec pour phrase de reconnaissance : « Je suis venu vous chercher de la part de la cousine Madeleine[[Ibid ; p.232. Dans la revue Europe, en 1971, J.Marcenac donne une autre version de cette rencontre : « Georges Sadoul qui avait organisé son voyage m’avait dit : « Vous n’aurez qu’à l’aborder en lui disant : ‘Bonsoir, Thérèse’ et elle vous répondra : ‘Bonsoir, mon cousin’ et les choses marcheront bien. » in Suzanne Labry, « Introduction à la lecture d’Elsa Triolet », Europe n°506, juin 1971, p.181]] ». Ils vont, par la suite, agir ensemble dans cette région du sud, au péril de leur vie :
« Nous sommes si souvent, ensemble, passés au ras de la catastrophe, à Nîmes, à Agen en particulier où je ne sais par quel miracle nous ne fûmes pas arrêtés avec le responsable de la MOI[[La MOI, Main d’Œuvre Immigrée, regroupait au sein des FTP les résistants étrangers ; dans le Sud-ouest, beaucoup d’antifascistes espagnols et italiens en ont fait partie, en particulier au sein de la « 35ème Brigade », issue des Brigades internationales.]], qu’il était assez naturel qu’elle me tienne pour une amulette. […] Et j’allais dans le dédale des traboules, à Lyon, croisant les frères inconnus et les bourreaux possibles, me répétant cette phrase d’elle, une des plus parfaites que je connaisse dans la langue française : ‘Fin, transparent et noir était le portillon donnant sur la montée’[[Ibid. p.316.]] »
« J’ai dit son courage, sa dignité combattante » écrit-il dans son livre de souvenirs[[Ibid. p.316.]] et dans une lettre de 1971 à Suzanne Labry : « Le courage intellectuel d’Elsa Triolet se doublait d’un courage physique, d’une fermeté combattante qui m’a émerveillé dans les années de la Résistance, où je fus un de ses proches camarades[[in Suzanne Labry, « Introduction à la lecture d’Elsa Triolet », Europe n°506, juin 1971, p.181. ]].»
Elsa Triolet va relater cette visite des maquis du Lot d’une part dans Les Lettres françaises en mai 1944[[n°16, p.5-6.]] sous le titre : « Aux armes, citoyens ! » et d’autre part, dans la nouvelle Cahiers enterrés sous un pêcher, où l’on trouve le même texte intégré au récit et complété, le texte des Lettres françaises ayant été coupé, à l’évidence faute de papier[[ORC, T.6, p. 96-118. Un tapuscrit de ce reportage existe au Fonds Aragon/Elsa Triolet. Sur la composition de cette nouvelle et l’intégration du reportage au récit, voir Marianne Gaudric Delranc « Cahiers enterrés sous un pêcher : des racines aux fruits », in Elsa Triolet, un écrivain dans le siècle, colloque ERITA 1996, L’Harmattan, 2000.]]. Elle y raconte comment elle roule dans une de ces voitures noires volées à la Gestapo « sans carte grise, sans papiers, avec, sous les pieds, une mitraillette parachutée…[[ORC, T.6, Cahiers enterrés… p.96.]] » Jean Marcenac précise : « Puis nous partîmes pour le reportage dans une traction avant récupérée sur la Gestapo, avec du sang encore mal nettoyé à la place du conducteur. Nous étions cinq. Le chauffeur, un garde du corps devant, un officier F.T.P. et moi derrière, armés beaucoup plus qu’elle ne le dit dans le Premier accroc — elle a vu la mitraillette, mais pas les grenades — et elle entre nous[[Lettre à Suzanne Labry, ibid.p. 181.]]. »
Elsa Triolet, dans son reportage, décrit le pays traversé, indique la proportion de réfractaires, évoque les activités du maquis, le besoin en armes, les dénonciations, les routes barrées et périlleuses, par exemple :
« La voiture descend toujours tout doucement ; on voit, en bas, comme une large rivière derrière les arbres : la route nationale. Nous en sommes à cinquante pas, quand une violente lumière de projecteur jaillit, blanche et impitoyable… Ce sont les phares d’une grosse voiture arrêtée sur la route, à quelque distance, et c’est à leur lumière qu’apparaît une autre voiture, tous feux éteints, au pied du chemin que nous descendons… Maurice freine. « Qu’est-ce que c’est que ça ? dit Gilbert, ouvrant la portière, qu’est-ce que c’est que ça ?… » Dans la main de l’homme au pantalon de velours surgit un revolver. Je plonge déjà vers la portière ouverte, derrière Gilbert… Mais les deux voitures démarrent et s’éloignent rapidement. Je n’ai pas eu le temps d’avoir peur[[Lettres françaises n°16 p.6 et ORC, T.6, Cahiers enterrés… p.117-118.]]. »
Cette même séquence est racontée par Marcenac de façon légèrement différente :
« Pour rejoindre le maquis que je voulais lui montrer, il fallait traverser deux nationales que nous contrôlions mal, sans cesse parcourues par des patrouilles automobiles, parfois des patrouilles de blindés allemands ; Nous progressions par les chemins de rocade, les départementales où tous les quatre ou cinq kilomètres, un garçon, le fusil ou la mitraillette pointé, nous scrutait, planté au milieu de la route, avec, derrière les murettes de pierres sèches du Causse, deux ou trois gars prêts à dégoupiller leurs grenades.
Puis, tout d’un coup, passé une chicane, c’était le vide, les cent mètres peut-être mortels qu’il fallait faire à toute allure pour traverser la nationale. Nous avions pour tactique, en cas d’accrochage, de tirer, et puis de nous disperser. Je l’expliquais à Elsa à l’endroit même où un peu plus tard, Malraux devait être blessé et fait prisonnier. Alors, elle me regarda tranquillement et me dit : « S’il arrive quelque chose, faites ce que vous avez à faire et ne vous occupez pas de moi ».
Ce que vous avez à faire. Là est toute Elsa Triolet. Car au-delà du courage, il y a ce à quoi sert le courage[[Lettre à Suzanne Labry, ibid. p. 181-182.]]. »
De retour à Figeac où, dit-il « Elsa fut littéralement épouvantée par la façon à peu près officielle dont se passaient les choses », elle lui déclare être autorisée à lui dire « que vous devez travailler sous les ordres de Gérard, c’est-à-dire de Louis. Prenons rendez-vous à Lyon. Ou mieux, partez avec moi demain matin. Parce qu’autrement, il est clair qu’on va vous arrêter ou vous abattre un de ces jours[[J. Marcenac, Je n’ai pas perdu mon temps, p.317.]]. » Après avoir fait une étape à Toulouse, « chez le docteur Mazelier[[Le Dr Mazelier était le médecin du réseau Morhange, une organisation de contre-espionnage combattant l’Abwehr et la Gestapo. Sa femme et lui faisaient aussi partie d’autres réseaux , cachaient et aidaient des résistants, des aviateurs, des commandos parachutés par les Alliés dans la région toulousaine.]], où Elsa donna un coup de téléphone à Saint-Donat, j’imagine, et passé ensuite la nuit chez Pierre Seghers, à Villeneuve-lès-Avignon, nous trouvâmes Aragon, qui nous attendait, dans un café de Valence[[Ibidem.]].»
L’on voit donc que, non seulement elle fait un travail de journaliste, mais aussi d’agent de liaison au péril de sa vie.
Elle va publier un deuxième reportage dans le n°17 des Lettres françaises, « les Voyageurs fantastiques »[[P. 1, 4.]], sur des soldats russes évadés des camps allemands et réfugiés dans les maquis.
Et si elle continue à écrire des nouvelles, c’est, dit-elle, par « le besoin de se gaver, envers et contre tout, entre deux voyages inquiétants, d’une vie différente du présent, mentie et vraie. C’était le stupéfiant du rêve contre l’insomnie de la réalité qui venait trancher le rêve de sa hache[[ORC, T.5, « Préface à la clandestinité », p.23.]]». « Écrire était ma liberté, mon défi, mon luxe. Personne ne pouvait m’empêcher d’inventer une réalité[[Ibidem, p.21-22.]] »
Réel et fiction s’entremêlent. Ses manuscrits, en particulier celui de Cahiers enterrés sous un pêcher, écrit en même temps que La Vie privée ou Alexis Slavsky, artiste peintre, qui en est le reflet inverse[[Récits écrits entre août 1943 et avril 1944.]], elle les enterre réellement, lorsqu’elle doit s’absenter, enfermés dans une boîte en fer, dans une combe, ou une balmette, près de Saint-Donat. La Vie privée ou Alexis Slavsky, artiste peintre comporte, entre autres choses, la reproduction ou le collage d’un tract comportant deux paragraphes, l’un décrivant assez précisément le camp d’Auschwitz, l’autre évoquant l’exécution de Bertie Albrecht[[Bertie Albrecht faisait partie du mouvement Combat et a été tuée en mai 1943 à la prison de Fresnes, dans des circonstances encore mal élucidées ; le tract cité par Elsa triolet parle d’une exécution à la hache ; les historiens actuels évoquent une mort par pendaison.]]. Il est à remarquer que le n°10 des Étoiles, daté d’août 1943, publie un article intitulé « Le camp de l’exécution lente », qui indique que « Le Comité directeur du Front National vient de transmettre aux généraux De Gaulle et Giraud un memorandum écrit par un évadé du camp d’Auschwitz, où il a passé quatre mois[[Les Étoiles, n°10, p.3.]].» Suit la description du camp, qui est celle reprise (sous une forme entrecoupée de points de suspension, le personnage étant censé lire un tract), dans Alexis Slavsky. Il est évident qu’évoquer Auschwitz au moment où les Allemands ont décidé depuis juin de s’occuper eux-mêmes des arrestations et des déportations en zone sud et font partir un ou deux convois par mois jusqu’à la Libération, constitue un acte de résistance plus que courageux. Aragon souligne la difficulté de la chose dans Les Poissons noirs ou la réalité en poésie[[Préface ajoutée en 1946 au Musée Grévin pour sa réédition aux Éditions de Minuit.]] :
«En général, les gens étaient partagés au sujet d’Auschwitz. Fallait-il en parler ou n’était-ce pas dangereux pour ceux qui y étaient ? Cela pourrait fâcher les Allemands. Ceux qui pensaient ainsi étaient fort nombreux. Il y a toujours beaucoup de gens qui s’emparent des raisons de ne rien faire, de ne pas publier de tracts, de ne pas parler des choses, à chaque occasion, sous le prétexte que c’est dangereux, non pour eux-mêmes, mais pour d’autres[[ŒP, T. X, p.180.]]. »
La nouvelle est publiée dans le n°20 de Poésie 44 (juillet-octobre).
Il faut remarquer à ce propos qu’ Elsa Triolet poursuit l’utilisation, dans ses nouvelles, de formes d’écriture variées, pratique amorcée déjà dans ses œuvres en russe, puis dans Bonsoir,Thérèse: collages, montage, insertion de reportages, récits en miroir, expression de contrebande… Elle écrira plus tard que « l’art de la Résistance était un art d’avant-garde. […] Pour créer des œuvres qui porteraient contre l’occupant, il fallait tout inventer : le contenu, la forme que revêtirait l’esprit de la Résistance […] il n’y avait ni règles ni théorie, elles devaient se forger dans le travail de l’artiste[[ORC, T.14, « Entretiens sur l’avant-garde en art et Le Monument d’Elsa Triolet »,p.196-197 ; publié d’abord dans La Nouvelle Critique, mai 1958.]].»
L’œuvre elle-même constitue un danger : Aragon raconte comment ils faillirent se faire arrêter dans le train, au retour d’un voyage à Paris, « près d’Andancette[[Dans la Drôme.]] » par la Feld-Gendarmerie « pour ce fragment des Cahiers qui n’était qu’un rapport sur l’école des Francs-Tireurs et Partisans dans le Lot[[Elsa Triolet choisie par…, p.30 et sq.]]»
1944
Mise à part la nouvelle Yvette, récit de 1943, datée de « Saint-Donat, 1944 » et publiée clandestinement sous le nom de Laurent Daniel à La Bibliothèque française en mai, l’année 1944 est consacrée à l’activité résistante et journalistique. Aragon et elle-même impriment des tracts grâce à une presse « venant, dit Aragon, de la République indépendante qui, en 1943, était arrivée à fonctionner au-delà du Rhône, dans les Cévennes[[Aragon, « Les Années Sadoul », Europe, n°590-591, juin-juillet 1978, p.187]]» et que leur a fait parvenir Georges Sadoul. Deux d’entre eux, rédigés par Elsa Triolet, sont mentionnés dans le catalogue de la Bibliothèque nationale : l’un est intitulé « Vous qui avez souffert, résistez » ; l’autre, un tract du CNE, intitulé « Ce qu’il faut savoir » explique les abréviations usuelles des différents mouvements de la Résistance[[op. cit. p.66 et p.64.]]. D’autre part, Les Étoiles continuent de paraître : jusqu’au n°9[[daté du 15 juillet 1943.]], c’était une feuille dactylographiée recto-verso et reproduite avec un carbone. À partir du n°10[[août 1943, MRN.]] (une feuille pliée en deux) le journal est imprimé. À partir de janvier 1944 (n°15) Les Étoiles paraissent à raison d’un numéro par mois[[Au sujet des Étoiles, cf. Gisèle Sapiro, La Guerre de écrivains 1940-1953, Fayard, 1999, p.518-521. et Georges Aillaud, « Une comparaison entre deux journaux clandestins : Les Étoiles et Les Lettres françaises, Louis Aragon et Elsa Triolet en Résistance, op. cit ;, p.139-153.]]. Elsa Triolet écrit à Jean Paulhan en mars 1945 :
« Nous avons fait venir une presse à bras dans notre village sur laquelle on tirait des tracts ; les choses plus longues étaient imprimées à Romans, à dix kilomètres de chez nous, dans une grande imprimerie qui n’avait rien de clandestin et qui faisait payer très cher « le silence de ses ouvriers ». La presse à bras avait été découverte par les Allemands, mais ils n’ont pas reconnu l’objet. Il en serait de même pour moi. Nous n’allions jamais à l’imprimerie, je me contentais d’apporter les textes à des rendez-vous très clandestins avec l’imprimeur[[Aragon-Paulhan-Triolet, Le Temps traversé, op.cit., p. 179-180.]]. »
En juin 1944, elle fonde avec Aragon un autre journal, La Drôme en armes[[Le n°1 est daté du 10 juin 1944.]] qu’elle écrit d’abord entièrement à la main, et qui est ensuite ronéoté, puis imprimé. Elle écrit en 1971, dans un petit ouvrage à destination des collégiens :
« Peu de temps avant le débarquement, nous avons à nous deux réussi à faire paraître La Drôme en armes, journal imprimé à Romans, que des gens courageux emportaient ensuite à la barbe des Allemands, à travers la Drôme, dans des cageots sous les pêches et les abricots. Le journal a continué à exister pendant la fausse Libération, la Drôme encore bourrée de troupes allemandes, dont les derniers soubresauts étaient d’une violence mortelle[[Elsa Triolet, « Préface », Bibliothèque de Travail, n°728, juin 1971. ]]. » Ce journal, qui aura quatre autres numéros, va accompagner la libération de la Drôme, donnant des nouvelles de la région, publiant les communiqués militaires des FFI, informant sur l’évolution de la guerre. Dans le dernier numéro, du 5 septembre 1944, elle publie un long reportage, « Les Routes de la Drôme »[[La Drôme en armes,p.1-2. Article reproduit dans Louis Aragon et Elsa Triolet en Résistance, op. cit., p.327-333.]], routes qu’elle sillonne avec Aragon, à partir du 26 août, et dans lequel elle relate en détail les péripéties de la Libération, les combats des FFI et l’arrivée de l’armée américaine. Elle évoque ce moment dans la « Préface à la clandestinité » :
« Partis tous deux sur les routes, pour distribuer le journal La Drôme en armes, imprimé par nos soins à Romans, rencontrant partout la joie délirante, les drapeaux tricolores, un pays qui se croit libéré, c’est miracle si, au retour, nous nous sommes arrêtés juste avant le feu des mitrailleuses, à l’entrée de Romans. En ville, les typos qui tiraient tranquillement le numéro suivant de La Drôme en armes, virent soudain, sous les fenêtres de l’imprimerie, des Allemands en armes…[[ORC, T.5, p.24-25]] »
Auparavant, le 14 juin, elle avait participé avec Aragon, à la réception d’un parachutage d’armes près de Saint-Donat, épisode qu’elle raconte dans la nouvelle intitulée Le premier accroc coûte deux cents francs, (phrase codée qui annonçait en Provence le débarquement du 6 juin). De cette nouvelle, proche du reportage, elle dit qu’ « elle n’est point mentie, à peine travestie[[Ibidem, p.25.]].» L’on connaît les représailles sanglantes qui suivirent, le 15 juin, ce parachutage. Elle raconte à J. Paulhan dans une lettre du 16 juillet 1944 comment Aragon et elle-même ont échappé aux Allemands et évoque leur vie quotidienne[[op. cit. p.174.]].
En septembre, après une étape à Lyon, où ils rencontrent le Général de Gaulle, ils rentrent à Paris :
« Nous sommes revenus à Paris le 25 septembre 1944, après la libération, écrit-elle à sa sœur. La gestapo était venue plusieurs fois perquisitionner de même que la police française, ils avaient tout mis sens dessus dessous mais rien emporté. Malgré tout, nous avons perdu la plupart de nos affaires, mais tant pis […][[Correspondance op. cit., lettre du 1er février 1945, p.161.]] »
Son livre de nouvelles Le premier accroc coûte deux cents francs, dont elle dit à sa sœur qu’ « il sortira dès qu’il y aura du papier[[Ibidem ;]] », reçoit le 2 juillet 1945 le Prix Goncourt au titre de l’année 1944[[Sur ce point, cf. « Préface à la clandestinité », ORC T.5, p. 25-27 ; elle précise que l’une des conséquences du prix est qu’ « au bout de quelque temps, j’ai eu assez d’argent pour acheter une maison de campagne », ce qui contredit la thèse d’un Aragon « offrant » le Moulin de Saint-Arnoult à Elsa Triolet…]] ; Et elle-même est décorée de la médaille de la Résistance par décret du 11 mars 1947[[Publication au Journal Officiel le 13 juillet 1947.]].
Que conclure ?
Tout d’abord, qu’Elsa Triolet a fait preuve d’un immense courage, accompagné d’une forte lucidité, dans « cette activité sur laquelle elle fait modestement silence », écrit Louis Parrot en 1945[[Louis Parrot, L’Intelligence en guerre, Le Castor astral, 1990, p.128.]]. À l’instar de beaucoup de Résistantes, elle a transporté des tracts, des brochures et par moments joué le rôle d’agent de liaison.
Ensuite que, si elle a agi en couple avec Aragon, elle a cependant maintenu sa part personnelle, qu’elle a dû imposer, comme on l’a vu. Mais elle a « travaillé » aussi avec bon nombre d’autres résistants de différents réseaux : FTP, FTP-MOI, Combat, groupe Morhange…
En troisième lieu, que son action a consisté pour une grande part à informer, par des reportages, des articles, des textes écrits à la main, tapés à la machine, imprimés sous toutes les formes et transportés au risque de sa vie, sans compter le travail oral de conviction dont il nous reste quelques traces, par exemple dans son Discours du 3 juin 1949 à Saint-Donat, où elle rappelle aux habitants comment elle a essayé de les persuader de la possibilité et des dangers d’une descente allemande : « Il y en avait même qui me répondaient par cette jolie formule : ‘Quand on n’a rien à se reprocher, on n’a rien à craindre !…’[[Discours reproduit dans Louis Aragon et Elsa Triolet en Résistance, op. cit., p.370.]] ».
Que de tout ceci est née une œuvre personnelle très diverse, qui lui servait d’exutoire, de « seconde vie », de lieu de réflexion et, qui, pour les lecteurs, était une incitation à l’action. Cette œuvre, elle l’a écrite parfois en dialogue, avec Camus, avec Aragon, et en inventant des formes d’expression correspondant à l’époque qu’elle traversait. « La littérature de la Résistance, écrit-elle en 1964, aura été une littérature dictée par l’obsession et non par une décision froide. Elle était le contraire de ce qu’on décrit d’habitude par le terme d’engagement, elle était la libre et difficile expression d’un seul et unique souci : se libérer d’un intolérable état de choses[[ORC T.5, « Préface à la clandestinité », p.14.]]. »
Enfin, que son action résistante aussi bien que ses écrits ont contribué à la reconnaissance du rôle des femmes dans la Résistance, dans la Libération et dans la société en général. Je voudrais terminer sur un article qu’elle écrivit à l’occasion de la journée internationale des femmes du 8 mars 1948 dans Les Lettres françaises sur la « dignité de la femme »[[Les Lettres françaises, 4 mars 1948, p.1.]]. Elle y reprend une réflexion commencée dans les années vingt sur le sexisme du langage et fait remarquer que « le même mot accolé au mot femme ou au mot homme prend une signification différente. Un homme honnête est celui qui ne vole pas, une femme honnête est celle qui n’a pas d’amant ». Or, la « dignité de l’homme, écrit-elle, n’est pas autre chose que la dignité de l’être humain, être-femme ou être-homme. Les femmes se sont battues dans cette guerre pour la dignité de l’homme, pour ne pas vivre à genoux, pour que l’homme n’ait pas à essuyer de crachats sur son visage, dans ce combat elles ont subi la prison, le martyre, la mort… » Et elle poursuit, avançant des idées et des revendications progressistes et féministes: « La ‘dignité de l’homme’ chez la femme, la dignité de l’être humain est, comme pour l’homme, dans sa liberté, son indépendance, son droit au travail, ses droits et devoirs de citoyen, de citoyenne.
Croyez-vous que j’enfonce des portes ouvertes ? Que je prêche devant des convaincus ? À l’usage, ces convictions ne sont chez les hommes que des faux-semblants. La dignité de la femme en tant qu’être humain demande en premier lieu que la poussière des siècles soit enlevée de la tête des hommes[[Ibidem.]].»