Hervé Bismuth: Aragon et le XXème Congrès
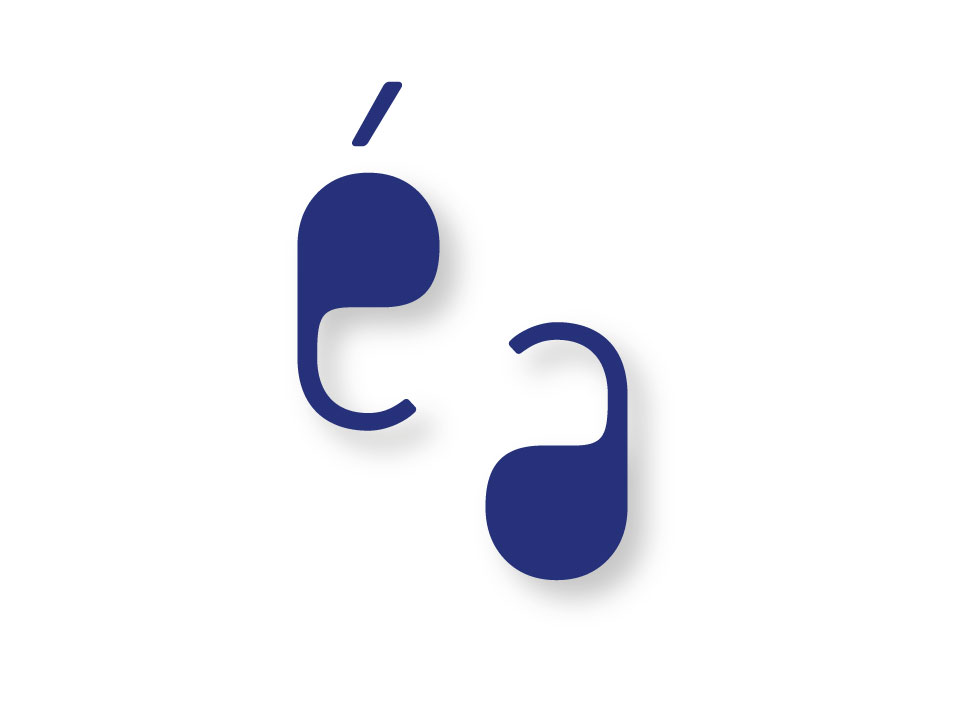
ARAGON ET LE XXe CONGRÈS
Réagissez à cette conférence sur notre blog
Le XXe congrès – sa séance officieuse – a eu une importance énorme dans l’œuvre d’Aragon, et ses conséquences s’en sont prolongées bien au-delà de l’année 1956. Reste qu’Aragon est, dans la période des dix années qui suivront l’annonce de ce congrès, un personnage public qui se fait entendre de deux, et même de trois façons différentes, et que ses réactions ne sont pas du même ordre selon qu’il parle à partir de l’une ou de l’autre instance.
Au moment où se tient ce congrès, Aragon est à la fois un écrivain notoire, romancier et poète, surtout reconnu alors comme poète, un poète officialisé par la période de la Guerre et de la Résistance, officialisé en particulier par le poids de la diffusion culturelle des réseaux communistes ;
Il est également un personnage politique public : il est membre suppléant (depuis 1950) puis titulaire (depuis 1954) du Comité central du PCF ;
En plus de ces deux visages, Aragon est également à ce moment-là le directeur des Lettres françaises, hebdomadaire qu’il avait contribué à créer sous la Résistance, dans un large contexte de collaboration qui regroupait au départ des noms aussi différents que Jean Paulhan, Jacques Decour, Raymond Queneau, Georges Limbour, François Mauriac, hebdomadaire qui était devenu la Libération la propriété exclusive du PCF avant que le PCF s’en décharge sur Aragon en 1953. Cet hebdomadaire est depuis le début l’organe du Comité National des Écrivains, né sous la Résistance.
Aragon militant
De réaction à ce congrès de la part du militant et responsable communiste, il n’y en aura pas : Aragon reste dans la ligne du PCF, une ligne qui se tient bien en deçà des discussions lancées en Union Soviétique, pour des raisons de contexte politique (mais pas seulement), et observe sur ce Congrès et ses implications un silence « qui déçoit tous ceux qui attendaient de lui une autre attitude[[Pierre Daix, Aragon, Taillandier, 2004.]] », si l’on en croit Pierre Daix. De toute façon, aucune voix discordante ne se fait entendre en juillet 1956 au XIVe Congrès du PCF, un congrès raide sur des positions consistant à défendre l’héritage idéologique soviétique, et en particulier le jdanovisme[[Jdanov est le principal artisan de l’étouffement des formes artistiques autres que le réalisme socialiste en URSS.]], un congrès qui adoptera des positions visant à condamner par avance toute velléité d’ouverture à la suite du congrès du PCUS.
Et c’est bien l’homme politique qui s’exprimera, six ans plus tard, dans Histoire de l’URSS (Presses de la Cité, 1962). Les Presses de la Cité avaient demandé à la fois à André Maurois et à Aragon d’écrire parallèlement une Histoire parallèle de l’URSS et des USA, ouvrage auquel Aragon s’attelle dès 1958. En raison de la célébrité du romancier-poète, l’appel à Aragon, à une date où l’Occident sort à peine de la Guerre froide, conjuguait à la fois les intérêts éditorialistes et ceux du camp communiste : mais cette Histoire de l’URSS est bien un travail d’historien, et non un travail de poète, un travail d’historien mené patiemment avec l’aide de deux secrétaires, et également un travail écrit par un responsable officiel du PCF. Dans cet ouvrage, on ne trouvera aucune critique explicite des crimes de Staline : l’historien se contente de relever de façon neutre les critiques officielles émises par le Congrès portant sur les erreurs théoriques de Staline, et mentionne la séance à huis clos du 24 février et la critique du « culte de la personnalité », en rappelant :
Suivant une tradition qui remonte à Lénine, les matériaux des débats à huis clos n’étant pas rendus publics, il en a été ainsi du second rapport Khrouchtchev. Le texte qu’on en a donné à l’étranger n’ayant aucun caractère officiel, on ne saurait s’y référer[[Histoire de l’URSS, page 262.]].
Rien de novateur, rien de critique dans cette Histoire de l’URSS. À travers cet ouvrage, Aragon engage sa responsabilité de militant officiel du Parti communiste. C’est ainsi par exemple qu’à propos de l’année 1946, sous la plume d’Aragon, l’amélioration de la productivité « caractérise bien la démocratie soviétique, à cette époque même où pourtant elle est battue en brèche dans l’appareil gouvernemental »[[Ibidem, page 158.]]. Les italiques sont d’Aragon, et la limitation des attaques contre la démocratie soviétique au seul « appareil gouvernemental » reproduit la seule critique du régime stalinien concédée, du bout des lèvres, par un PCF bien en deçà, dans cette critique, des attaques khrouchtchéviennes. Lorsque il fait paraître chez Gallimard à la fin juin 1956 son Introduction aux littératures soviétiques, Aragon présentera des écrivains que le régime précédent n’aurait pas forcément goûtés mais sans mentionner ce fait. Au contraire, il y justifiera les interventions du pouvoir soviétique dans la littérature, allant même jusqu’à dire :
Les faits sont là, le réalisme socialiste n’a pas restreint les genres littéraires : il leur a donné au contraire un essor nouveau[[Introduction aux littératures soviétiques, NRF Gallimard, 1956, p. 26.]].
Aragon avait-il écrit ce texte après le 20e congrès, ainsi que le suppose Pierre Daix[[« Aragon entre le dégel et le parti », in Aragon 1956, Actes du colloque d’Aix-en-Provence (septembre 1991), Publications de l’Université de Provence, 1992, pp. 219-227.]] ? Toujours est-il qu’il l’a laissé publier plus de trois mois après les échos de ce Congrès.
Les Lettres françaises
La position des Lettres françaises sera différente : le journal est un journal d’équipe, qui n’appartient plus officiellement au PCF, qui n’a pas officiellement de comptes à lui rendre, même s’il lui est arrivé d’en rendre à propos de ce qu’on a appelé « l’affaire du portrait de Staline ».
Au lendemain du congrès
La vocation littéraire et artistique des Lettres françaises permet à l’hebdomadaire de ne pas entrer dans le débat ni même de le mentionner directement. Le grand débat des Lettres françaises dans cette période est un débat orchestré par Aragon sur la compatibilité de Racine et du théâtre populaire : Jean Vilar venait de déclarer que sa vocation d’animateur de théâtre populaire était incompatible avec le fait de monter Racine. Ce débat se mène pendant que le reste de l’actualité journalistique s’étend, à l’extérieur des Lettres françaises, sur le récent congrès soviétique, comme si rien dans ce Congrès ne pouvait concerner l’art ou la littérature.
C’est par écho seulement que la tenue de ce congrès et ses conséquences parviennent dans les colonnes de la revue. Le changement notable est, pour qui connaît la littérature russe, la mise en avant d’auteurs soviétiques écrivant en marge des canons traditionnels du réalisme socialiste ou appartenant à la nouvelle génération d’auteurs protégée par Khrouchtchev : la revue ne fait en cela que reproduire l’éclairage éditorial de la Littratournaïa Gazetta, la revue littéraire soviétique, à qui elle sert de relais. C’est ainsi qu’une place de plus en plus importante va être consacrée, dans les mois et les années qui viennent, à Ilia Ehrenbourg, l’auteur du roman intitulé Le Dégel (1954), décrivant l’effervescence soviétique au lendemain de la mort de Staline et dont le nom (en russe : « Glasnost ») servira longtemps à qualifier la période khrouchtchévienne puis dans les années 1980 la politique de Gorbatchev.
Novembre 1956 : la Hongrie
C’est encore un souci de prendre une position consensuelle, à la fois avec l’URSS, le PCF et les intellectuels français, qui motivera la position des Lettres françaises en novembre 1956, après l’invasion soviétique et la prise de pouvoir de Kadar, installé par les Soviétiques à la tête du pays. La revue reproduit un message du Comité National des Écrivains :
« Le comité national des. écrivains s’adresse tel au président Kadar. Les soussignés, membres du Comité Directeur du Comité National des Écrivains, bien que profondément divisés sur l’interprétation des récents événements de Hongrie, s’unissent, comme ils l’ont fait en d’autres occasions, puisqu’il s’agit de la défense de la culture, pour demander à Monsieur le Président KADAR de réserver l’avenir et de garantir. quelles qu’aient pu être, dans ces événements, leur attitude et leur conception du devoir patriotique, la vie, la liberté physique et les intérêts moraux des écrivains et intellectuels hongrois porteurs d’une part de la culture humaine. Ils souhaitent que tous les intellectuels et leurs organisations, à l’Est comme à l’Ouest interviennent pour leur part dans le même sens. »
Suivent les signatures, d’Aragon, d’Elsa Triolet, de Jean-Paul Sartre, de Maurice Druon, etc.
Ce message est prolongé par la déclaration suivante :
« La rédaction des Lettres françaises, qui comprend des écrivains et des journalistes d’opinions politiques et religieuses différentes, tient, en ces heures difficiles, à protester contre la campagne de haine et de calomnies qui voudrait imposer aux intellectuels français une seule opinion sur les événements récents en Hongrie.
Si nous pouvons nous opposer sur les causes et les conséquences des événements qui viennent d’ensanglanter la nation hongroise, nous tenons à affirmer que les problèmes qui se trouvent ainsi posés à nos propres consciences comme à la réflexion de tous, ne sauraient être résolus par des méthodes de disqualification, des injures et des menaces […] ».
Effectivement, Les Lettres françaises campent sur les mêmes positions consensuelles du Comité National des Écrivains, qui permettent de rassembler tous les intellectuels, staliniens et anti-staliniens compris : aucune mention supplémentaire ne sera faite de l’événement.
1962-1963 : la publication de Soljenitsyne
C’est seulement à partir de la saison 1962-1963 qu’Aragon prendra, avec Les Lettres françaises, une initiative personnelle visant à promouvoir le récent dégel soviétique, à l’occasion de la parution du premier roman de Soljenitsyne, Une journée d’Ivan Denissovitch. La publication de ce roman en URSS avait été orchestrée par Khrouchtchev à l’automne 1962. Le roman arrivera en France en mars 1963 dans des conditions de publication et de traduction officiellement orchestrées par Pierre Daix, rédacteur en chef des Lettres françaises et préfacier de l’édition française du roman, et par un groupe de plusieurs traducteurs successifs piloté par Elsa Triolet, la romancière épouse d’Aragon.
On sait, à présent que les archives de la correspondance d’Elsa Triolet sont publiées, la part personnelle jouée par Aragon dans la publication en France de cet événement littéraire, une fiction relatant la vie dans les camps d’internement en URSS. Mais officiellement, Aragon n’intervient pas et se tait : le PCF, ici aussi, reste sur ce sujet, y compris en 1963, bien tiède et discret.
C’est bien Elsa Triolet qui fait le relais de la propagande khrouchtchévienne et de la publicité faite en URSS autour de cet ouvrage : elle est bien plus libre que son mari, n’étant pas membre du PCF. Elle sait aussi le nombre de communistes français qui se seraient passés de la publicité des révélations du XXe congrès et du premier roman de Soljenitsyne. Dans son article « Pour l’amour de l’avenir » accueillant la parution de ce roman en URSS[[Numéro 955 du 7 décembre 1962 des Lettres françaises.]], elle évoque plusieurs cas de figure des récepteurs de ce roman, en particulier les « individus dangereux » qui ont défendu et défendent encore ce passé de l’Union soviétique, et surtout :
« D’autres encore, probablement les plus nombreux, considèreront que plus vite ces temps maudits seront oubliés, mieux il vaudra ; le souvenir de cette aberration collective leur est intolérable […] ; ils préfèreraient que l’on continuât à se taire, que deux cents millions d’hommes et de femmes gardent leur secret, comme, d’un accord tacite, ils l’avaient fait toutes ces interminables années. […] ils disent, ouvrir les dossiers, avouer, fait le jeu de l’ennemi et risque de démobiliser les amis ; […] ils disent, à force de penser aux crimes passés, on oublie ce qui a été en même temps construit, le chemin parcouru… »
« les plus nombreux » : il ne peut s’agir que de la plupart des militants communistes français de l’époque.
Aragon poète
Si l’homme politique se tait, et si le directeur des Lettres françaises laisse parler d’autres que lui et agit en sous-main, le poète Aragon se livre, en revanche, et donne à lire la stupeur et l’accablement qui ont suivi ce congrès, un congrès dont les conséquences vont marquer durablement son œuvre. Pour en apprécier la portée, je propose de remonter douze années en arrière, à l’époque d’un petit poème de résistance écrit en 1944, qui sera inséré à la fin du recueil La Diane française.
Du poète à son parti (1944)
Le poème s’appelle « Du poète à son parti ». Il est assez petit pour que je le cite entièrement :
Mon parti m’a rendu mes yeux et ma mémoire
Je ne savais plus rien de ce qu’un enfant sait
Que mon sang fût si rouge et mon coeur fût français
Je savais seulement que la nuit était noire
Mon parti m’a rendu mes yeux et ma mémoire
Mon parti m’a rendu le sens de l’épopée
Je vois Jeanne filer Roland sonne le cor
C’est le temps des héros qui renaît au Vercors
Les plus simples des mots font le bruit des épées
Mon parti m’a rendu le sens de l’épopée
Mon parti m’a rendu les couleurs de la France
Mon parti mon parti merci de tes leçons
Et depuis ce temps-là tout me vient en chansons
La colère et l’amour la joie et la souffrance
Mon parti m’a rendu les couleurs de la France
Je glisse ici une rapide explication de texte sur ces « yeux » et cette « mémoire » que le « parti » a rendu au poète :
La mémoire :
La « mémoire » est celle de l’héritage historique. Depuis les années 1930 s’est construite dans l’idéologie ouvrière l’idée suivant laquelle les combats de la France communiste sont le prolongement des combats de la Révolution française, ceux des Jacobins et à leur suite ceux des babouvistes, initiateurs des idées communistes en France. Il existe ainsi une filiation entre les combats d’alors et les combats actuels, qui passe par les moments forts qu’ont été la création du PCF et le Front populaire.
Mais la mémoire, c’est aussi celle de l’Histoire littéraire qui, de la même façon, rattache la poésie de la Résistance à celle qui a précédé, celle des textes médiévaux, celle de la Renaissance, celle de l’épopée hugolienne dont Aragon s’affirme être l’héritier. Et c’est cette mémoire littéraire qu’Aragon veut faire revivre dans sa poésie de guerre et de résistance.
Les yeux :
Quant aux « yeux », ils sont la métaphore évidente de la lucidité : lucidité du présent, et du choix qu’a fait le poète d’épouser le combat de la classe ouvrière en rejoignant le Parti communiste. Mais également : lucidité de l’avenir. Pour Aragon, l’horizon de l’Histoire existe : il s’agira d’une société fraternelle dans laquelle les classes seront abolies et où règnera la paix.
Cette double image, yeux et mémoire, va être développée sur plus de150 pages dix ans plus tard.
Les Yeux et la mémoire (1954)
En octobre 1954, Aragon publie un ouvrage qui se présente, ainsi qu’il le dit lui-même, comme un poème unique « d’une taille inhabituelle dans la poésie contemporaine » : un poème de plus de 150 pages, un poème au sens où le sont certains poèmes épiques de Victor Hugo, La Légende des siècles ou Les Châtiments. Un poème non pas au sens où un « poème » est une pièce de vers, mais au sens où une « épopée » est un poème, tissé de plusieurs pièces poétiques. Car c’est bien une épopée en quelque sorte, une épopée moderne que ce poème : un long discours dominé par un souffle épique, et le rapprochement que je fais avec Victor Hugo n’est pas de hasard.
De quoi s’agit-il ? Le propos d’Aragon est ici de montrer, pour reprendre une formule connue, les « lendemains qui chantent » en réponse au dernier roman d’Elsa Triolet. En pleine guerre froide, à l’époque des menaces nucléaires suggérées par les tensions internationales, Triolet avait publié Le Cheval roux (1953), du nom de l’un des chevaux dans l’Apocalypse de Jean. Ce roman décrit un monde apocalyptique dans lequel se croisent quelques survivants après une catastrophe nucléaire qui a ravagé la terre. À la fiction proposée par son épouse, Aragon répond par un long poème optimiste, le poème le plus clair, le plus enthousiaste, le plus vibrant, le plus empreint de certitudes qu’il ait jamais écrit, un poème où dès son titre il affiche sa fierté d’être un poète militant au PCF, dans des vers tels :
Salut à toi Parti ma famille nouvelle
Salut à toi Parti mon père désormais
Dans Les Yeux et la mémoire, Aragon répond à son épouse en mettant en avant sa lucidité dans des titres comme : « Comment l’eau devint claire », « Sacre de l’avenir », « Chant de la paix » par quoi s’achève le poème. Poème bien clair, trop clair ? trop clairement écrit en tout cas, dans un style de trompettes, de cymbales, un style que d’aucuns jugent « pompier » comme on le dit de certains poèmes de Victor Hugo à qui il s’identifie ici plus que jamais, donnant à ses poèmes des titres comme : « Je plaide pour les rues et les bois d’aujourd’hui » (Hugo : Les Chansons des rues et des bois), un poème boudé même actuellement par la critique universitaire, en dépit des trouvailles poétiques qu’il recèle.
Ce poème reçoit deux ans plus tard un cinglant démenti, qui fera tomber Aragon de son socle, et transformera durablement même son écriture poétique : ce démenti est ce qu’on appelle depuis bientôt un demi-siècle le « rapport Khrouchtchev ».
Le Roman inachevé (1956)
La vraie blessure du 20e congrès se lit dans un ouvrage qui paraît en novembre 1956, un ouvrage entièrement marqué du sceau de l’effondrement qui a été celui d’Aragon à ce moment-là. En témoigne le poème intitulé : « La Nuit de Moscou ».
Les huit premières strophes de ce poème avaient déjà été publiées dans Les lettres françaises en janvier 1955, avec le sous-titre : « Introduction à un petit essai sur le 2e Congrès des Écrivains soviétiques ». Le poème était alors un chant de l’écrivain, empli de nostalgie, à la gloire d’une ville qu’il aime, une ville dans laquelle il se promène – qu’on en juge :
Ah dans ses propres pas que marcher est étrange
Comme tout a changé et comme rien ne change
Cette ville n’est plus la même après vingt ans
Et c’est toujours la même et c’est la même neige
Les étoiles des tours les longs murs le Manège
Mais la nuit n’est plus noire et j’ai les cheveux blancs
Je ne reconnais plus les endroits où je passe
Pouchkine a traversé depuis longtemps la place
Et maladroitement comme des mots écrits
Les grilles des jardins sur la candeur d’hiver
Semblent recopier pour les couples ses vers
Le long des boulevards faits pour la flânerie
Dans la version définitive du poème dans Le Roman inachevé, le texte finit alors par les strophes suivantes :
On sourira de nous pour le meilleur de l’âme
On sourira de nous d’avoir aimé la flamme
Au point d’en devenir nous-mêmes l’aliment
Et comme il est facile après coup de conclure
Contre la main brûlée en voyant sa brûlure
On sourira de nous pour notre dévouement
Quoi je me suis trompé cent mille fois de route
Vous chantez les vertus négatives du doute
Vous vantez les chemins que la prudence suit
Eh bien j’ai donc perdu ma vie et mes chaussures
Je suis dans le fossé je compte mes blessures
Je n’arriverai pas jusqu’au bout de la nuit
Qu’importe si la nuit à la fin se déchire
Et si l’aube en surgit qui la verra blanchir
Au plus noir du malheur j’entends le coq chanter
Je porte la victoire au coeur de mon désastre
Auriez-vous crevé les yeux de tous les astres
Je porte le soleil dans mon obscurité
Quel est ce « vous » dont parle le poète ? Un « vous » multiple : l’interlocuteur n’est pas le même dans chacune de ces deux dernières strophes. Ce vous désigne successivement, en les identifiant l’un à l’autre, les dénigreurs de l’horizon socialiste (avant-dernière strophe) et les assassins de la réalité socialiste, ceux qui l’ont défigurée. Ce qui s’est passé alors pour Aragon en ces lendemains de 20e Congrès est rapporté un peu plus loin dans le poème en un raccourci fulgurant, celui d’un vers de seize syllabes :
Vint mil neuf cent cinquante-six comme un poignard sur mes paupières
Quelques commentaires sur ce vers :
1° On appréciera la force et le paradoxe de l’image qui est proposée : elle est le détournement d’une image connue, celle du « poignard dans l’œil » : un événement prodigieux, une vision stupéfiante peuvent être assimilés à un coup de « poignard dans l’œil », causant un éblouissement équivalant à une cécité. Mais ici, dans ce détournement d’image, le « poignard » réveille une cécité (« poignard sur des paupières »).
2° On appréciera également le fait que cette image retourne totalement les images des chants optimistes des années précédentes. Les yeux, la lucidité, qui faisaient l’objet du poème de 1944 et du grand poème de 1954, ces images qui étaient depuis douze années l’affirmation de l’optimisme et de la lucidité d’Aragon, ne sont plus, après le 20e congrès, que des paupières, ne sont plus qu’une cécité.
3° On appréciera de toute façon la manière particulière dont Aragon réagit au traumatisme de 1956, une manière culpabilisée, et il est vrai qu’Aragon est un écrivain souvent culpabilisé, mais cette culpabilité, il la porte et la retourne sur lui en se focalisant sur sa propre faute, à la différence de tant d’autres qui ont retourné, longtemps après lui, la faute sur les autres, ont accusé les autres en déniant leur propre responsabilité, sur le mode de « ils nous ont trompés » (voir, jusque dans les années 80-90, Yves Montand, Georges Marchais…)…
Et il est vrai qu’Aragon s’est aveuglé volontairement, car il avait comme bien d’autres les moyens de savoir, il avait les preuves – presque sous les yeux – du moins d’une partie de la réalité stalinienne : il était l’époux d’Aragon Triolet, sœur de Lili Brik, ancienne compagne du poète Vladimir Maïakovski, qui était bien au fait de certains traits de la réalité du pouvoir policier en URSS, et bien plus sceptique que lui sur le paradis socialiste. Dès 1952, à en croire Pierre Daix, qui en a été le témoin direct[[Relaté dans ce que je sais de Soljenytsine, Seuil, 1973.]], Elsa Triolet faisait part à Aragon de sa méfiance à l’égard de la politique policière du gouvernement soviétique.
Après 1956…
La façon dont s’achève ce Roman inachevé annonce la posture que prendra le poète Aragon dans les années qui suivent immédiatement 1956 : la dernière section de ce poème s’appelle : « Prose du bonheur et d’Elsa », et il est vrai que dans les poèmes suivants, Elsa (1959) et Les Poètes (1960), Aragon ne parle plus de politique, mais d’Elsa, d’amour, de poésie… et de ses souvenirs personnels. Lorsqu’il reviendra à la politique, ce sera avec Le Fou d’Elsa, en 1963, dans un poème encore plus monstrueux que les précédents.
Dans cet énorme poème, de plus de 450 pages, le poète Aragon fait de nouveau « de la politique ». Mais il le fait, cette fois, de deux façons :
par le retour au mode de la contrebande[[La « contrebande » (l’expression est d’Elsa Triolet) est définie par Aragon comme « l’art de faire naître les sentiments interdits avec les paroles autorisées » : cette pratique a guidé l’écriture des poèmes des Yeux d’Elsa, parus en toute légalité sous les presses de l’Occupation.]] ;
par l’énoncé d’une thèse originale, une thèse qui révise la théorie marxiste.
La « politique » de contrebande
Si le sujet historique du Fou d’Elsa est la chute de la Grenade arabo-andalouse en 1492, Aragon parle, entre les lignes de cette histoire revisitée, de l’URSS stalinienne. Car la Grenade du Fou d’Elsa ressemble à plus d’un titre à la Moscou du XXe siècle, citadelle assiégée de l’extérieur, mais aussi citadelle corrompue de l’intérieur, où déferlent les déchaînements antisémites qui assurent le succès des « dénonciateurs de médecins juifs[[Le Fou d’Elsa, NRF Gallimard, p. 300. La dénonciation des « médecins juifs » renvoie au procès fait aux « médecins juifs » accusés de tentative d’assassinat sur la personne de Staline (complot dit « des blouses blanches ») ; ils furent relaxés après la mort de Staline.]] ». Le Fou d’Elsa affiche en épigraphe une citation extraite de la préface de Pierre Daix au roman de Soljenitsyne, Une journée d’Ivan Denissovitch :
L’enfer d’Ivan Denissovitch, c’est que le futur n’existe plus…
Une telle citation est, dans une période où l’accueil de la traduction de ce roman par le PCF a été plutôt tiède, un signal au lecteur.
La « thèse »
La thèse qu’Aragon énonce dans ce poème est une réponse à la fois à l’optimisme des temps qui ont précédé le 20e Congrès et au silence désespéré qui a suivi.
Il est vrai que c’est dans Le Fou d’Elsa qu’on trouve les célèbres vers :
Un jour pourtant un jour viendra couleur d’orange
Un jour de palme un jour de feuillages au front
Un jour d’épaule nue où les gens s’aimeront
Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche
Mais il est vrai qu’on oublie toujours, à la suite de Jean Ferrat, lorsqu’on cite ces quatre vers, de citer ce qui suit immédiatement ces vers : une ligne de pointillés, marquant l’arrêt du chant, suivie de l’alexandrin orphelin :
Où t’en vas-tu mon cœur à cette heure des larmes
Si Aragon fait parfois preuve d’optimisme dans Le Fou d’Elsa, cet optimisme porte en lui son ombre, sa propre tristesse. Les « lendemains qui chantent » n’approchent point dans Le Fou d’Elsa et ne sont pas prêts d’approcher pour son personnage principal, descendant le temps vers le XXe siècle à l’aide de son miroir magique. Pour qu’ils approchent, il manque aux théories, aux pensées révolutionnaires, une condition jusque-là ignorée : et cette condition est le couple, stable et heureux. Pour l’auteur du Fou d’Elsa, la paix, le bonheur social, doivent d’abord passer par la reconnaissance du couple et de la dignité de la femme, à laquelle l’homme doit se consacrer. Tel est le sens de la formule affichée sur la bande de l’édition originale du poème : La femme est l’avenir de l’homme.
À cette date, Aragon reste un communiste convaincu – il le restera jusqu’à sa mort -, mais sa conviction sera sans cesse – jusqu’à sa mort, également – accompagnée des réserves critiques sur ce qui s’est passé et qui se passe toujours en URSS.
Un double visage ?
On aura parlé souvent des « mensonges » d’Aragon, en particulier durant cette période qui s’étend de 1953 à 1963, « mensonges » tout au moins par omission. Il serait plus exact de dire qu’Aragon parle à la fois, mais dans deux lieux distincts, deux vérités : sa vérité de militant et sa vérité de poète. Est-ce une autre façon de mentir ?
Elle est en tout cas symptomatique d’une brisure qui s’effectue pendant ces années cinquante, après ces longues années de Guerre, de résistance puis de Guerre froide où lorsqu’il parlait en son nom, Aragon pouvait affirmer qu’il parlait au nom d’un groupe, son parti, la classe ouvrière, voire le peuple français. À partir de la mort de Staline et des révélations qui s’en sont suivies, la nécessité poétique et la nécessité militante ne marchent plus, chez Aragon, d’un même pas, comme elles pouvaient le faire avant. Dès lors que le parler vrai ne croise plus les intérêts d’une classe ouvrière qu’il s’agit de ne pas désespérer – pour paraphraser la célèbre formule de Jean-Paul Sartre -, le militant Aragon fait le choix de la fidélité, même si le poète Aragon continue à s’exprimer avec son « Je », en mettant en œuvre toute l’authenticité que cela suppose : un « Je » qui ne dit plus « nous » et qui est désormais seul, un « je » qui livre de plus en plus sa part intime – et en dépit des marques de fidélité renouvelées de la part du personnage public à son Parti.

