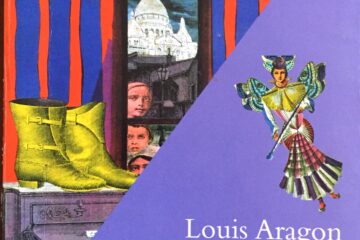Corinne Grenouillet, « Les Incipit : L’écriture et ses mythes chez Aragon », 1998
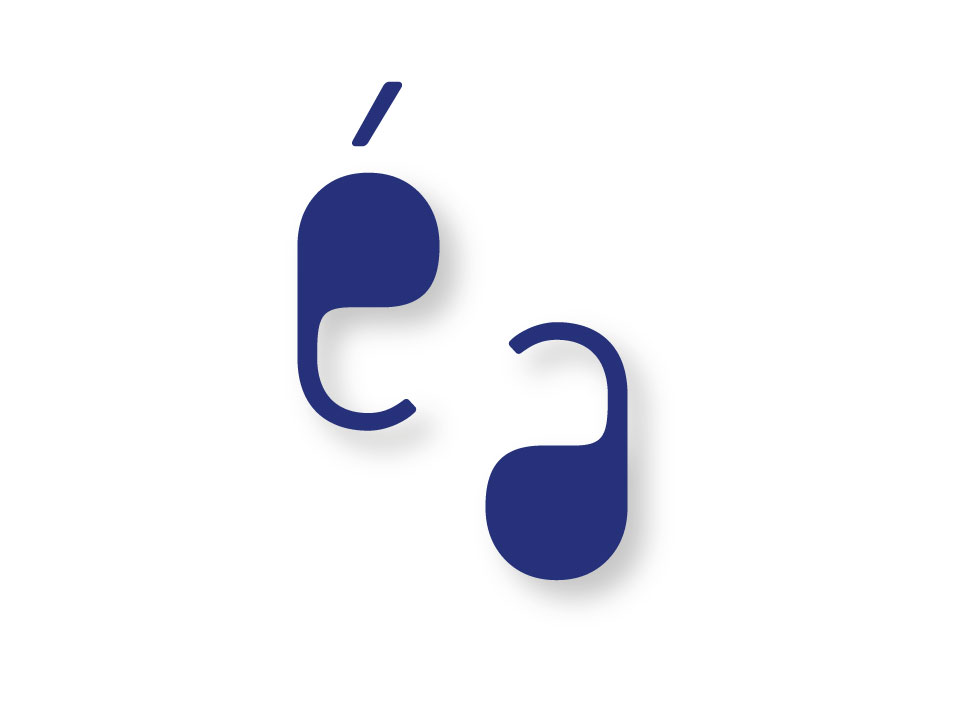
Corinne Grenouillet « Les Incipit : l’écriture et ses mythes chez Aragon »
Communication présentée au séminaire XIXe-XXe siècle “Art et Littérature”
(coordination : G. Séginger), Université Marc Bloch, Strasbourg, 5 mars 1998.
L’essai d’Aragon Je n’ai jamais appris à écrire ou Les Incipit fut publié en 1969 dans la collection d’art « Sentier de la création » chez Skira à Genève et repris dans les ORC en 1974, donnant ainsi au corpus de fictions romanesques qui le précède une conclusion, un intéressant effet de post-scriptum analysé par Édouard Béguin (1989[[ Voir à la fin de cet article les références bibliographiques et les abréviations utilisées.]]). Cet ouvrage à l’esthétique admirable est illustré de nombreuses reproductions picturales et de fac-similés de l’écriture d’Aragon. Publié dans une période d’intense réflexion théorique, il propose des analyses fascinantes sur l’écriture, sur son origine et sur sa fin. Le « sentier » qu’Aragon déclare suivre le conduit à analyser et réinterpréter la majeure partie de son œuvre romanesque du premier roman écrit en 1903-1904 (Quelle âme divine !) au dernier né : La Mise à Mort (1965), non sans que certaines recatégorisations ne manifestent le brouillage des genres opérés par l’auteur à partir des années 60.
La similarité du processus décrit pour chacun des romans souligne que la théorie des Incipit est susceptible de rassembler et de rendre compte de l’ensemble d’une production romanesque, qui de l’extérieur peut apparaître comme singulièrement diverse, voire contradictoire.
Si l’on reprend la définition que Mircea Éliade juge « la moins imparfaite » du mythe, on conviendra que ce qu’Aragon invente pour son propre compte relève davantage de la fiction que du mythe. Rien de directement « sacré » dans cette mythologie personnelle, ni de « temps fabuleux des commencements », pas plus que d’interventions d’« être surnaturels » (Éliade, p 15). Mais les Incipit interroge la survenue de l’écriture (romanesque essentiellement) et à ce titre, constitue bien le récit d’une création (quoique sans transcendance) qui s’inscrit dans la catégorie des discours critiques d’écrivains.
1. Une écriture-lecture
Le mythe fameux qu’Aragon constitue à ses propres fins est celui d’une écriture qui serait d’abord une lecture : l’auteur se mettrait à écrire sous la poussée d’une phrase lue, entendue, ou d’une phrase de réveil qui constituerait la matrice de son livre. Face à toutes les phrases ensuite engendrées par ce mécanisme de création, il serait comme un lecteur découvrant un texte d’où serait absente toute préméditation, toute direction volontairement initiée.
De nombreux exemples donnés par Aragon, comme celui des Communistes, montrent que l’incipit est désigné comme tel en fonction de sa capacité à servir de matrice pour l’écriture ; ainsi n’y a-t-il nulle contradiction pour Aragon à écrire « en arrière » de l’incipit (p. 95), l’essentiel étant que la création se fasse « à partir de lui » (idem). On se gardera donc de considérer de façon mécaniste l’incipit comme la première phrase du livre publié.
Ce caractère génératif de la première phrase, Aragon en trouve une illustration dans les théories de Kavérine et les exemples de Tolstoï et Tchékov. Mais ces références savantes lui servent surtout à préciser une nouvelle fois l’importance qu’il accorde à l’écriture comme découverte. Ainsi, si les premières phrases donnent le la stylistique du livre selon Kavérine, elles ne peuvent en aucun cas remplir consciemment ce rôle pour Aragon : « j’ai lu tout le reste » proclame-t-il, « mais je dénie être pour quelque chose dans le choix. C’est moi qui ai été choisi par mes livres : me comprendra-t-on ? ».
L’aspect le plus déroutant du mythe des incipit réside dans le paradoxe qui fait de l’auteur avant tout (et seulement) un lecteur de son œuvre.
« Mes romans, à partir de la première phrase, du geste d’échangeur qu’elle a comme par hasard, j’ai toujours été devant eux dans l’état d’innocence d’un lecteur. Tout s’est toujours passé comme si j’ouvrais sans en rien savoir le livre d’un autre, le parcourant comme tout lecteur, et n’ayant à ma disposition pour le connaître autre méthode que sa lecture. Comprenez-moi bien, ce n’est pas manière de dire, métaphore ou comparaison, je n’ai jamais écrit mes romans, je les ai lus. Tout ce qu’on en dit, en a dit, en dirait, sans cette connaissance préalable du fait, ne peut être que vue a priori, jugement mécanique, ignorance de l’essentiel. Comprenez-moi bien : je n’ai jamais su qui était l’assassin. C’est au mieux cet inconnu qui m’a pris par la main pour être le témoin de son acte. Et le plus souvent, le Petit Poucet n’a point semé derrière lui à mon intention les cailloux blancs ou les miettes de pain qui m’auraient permis de suivre sa trace. J’ai été mené chez l’Ogre non par un raisonnement, mais par une rencontre de mots, ou de sons, la nécessité d’une allitération, une logique de l’illogisme, la légitimation après coup d’un heurt des mots. L’accident expliqué » (p. 43).
Ces déclarations péremptoires d’Aragon sont de l’anti-Sartre, mot à mot, puisque l’écrivain est donné comme sujet extérieur à sa propre écriture, dans un processus de dédoublement total, qu’indique le choix de la troisième personne ou de la détermination indéfinie (« l’état d’innocence d’un lecteur », « le livre d’un autre », « le parcourant comme tout lecteur »). Non seulement l’auteur se dédouble, mais il cesse d’être lui-même pour devenir un autre, un lecteur ordinaire, banal, sans compétences particulières. Cette transformation, affirme-t-il, ne doit pas être mis au crédit d’une quelconque recherche stylistique (métaphore ou comparaison), mais renvoie à la réalité même de sa création.
Selon Sartre, le dédoublement propre à la communication écrite prend un caractère particulier chez l’écrivain : en effet, celui-ci ne peut pas voir sa propre création objectivement, car il sait que tout y est « trouvaille subjective » ; quand il cherche à “percevoir” son ouvrage, il ne fait que répéter mentalement les opérations de sa création :
« L’écrivain ne peut pas lire ce qu’il écrit, au lieu que le cordonnier peut chausser les souliers qu’il vient de faire […] l’opération d’écrire comporte une quasi -lecture implicite qui rend la vraie lecture impossible. Quand les mots se forment sous sa plume, l’auteur les voit, sans doute, mais il ne les voit pas comme le lecteur puisqu’il les connaît avant de les écrire ; son regard n’a pas pour fonction de réveiller en les frôlant des mots endormis qui attendent d’être lus, mais de contrôler le tracé des signes. […] L’écrivain ne prévoit ni ne conjecture : il projette. » (Qu’est-ce que la littérature ? Gallimard, 1948, pp 48-49).
Une des explications possibles à cette fiction doit sans doute être cherchée dans la souveraine aisance d’écriture d’Aragon, attestés par tous ceux qui le fréquentèrent[[Durant l’été 1927, tandis que Breton écrit avec beaucoup plus de difficultés son récit Nadja, Aragon produit dix pages quotidiennes (Le Traité du Style), « en moins d’une heure, comme en se jouant, dira Breton » (cité par Lionel Follet, p. XXX).
]], et qui a pu lui donner le sentiment illusoire d’être lecteur de ses livres plus qu’auteur.
On remarquera aussi la place très moderne accordée au langage, puisque la création romanesque, traditionnellement attachée à des personnages et un cadre spatio-temporel, découle dans Les Incipit d’« une rencontre de mots, ou de sons, la nécessité d’une allitération ». Dès lors que le langage est premier, la frontière entre création poétique et romanesque s’évanouit. Et surtout, l’affirmation mine l’idée d’une solution de continuité dans les écrits d’Aragon : tous procèdent d’un travail sur les mots, d’une surprise venant d’eux, des écrits surréalistes au dernier roman, en passant par la grande fresque du Monde Réel.
Le mythe d’une lecture-écriture traduit enfin une curieuse crise d’identité : l’auteur cesse d’assumer son propre rôle pour endosser celui d’un lecteur ordinaire. Il laisse donc une place momentanément vide : celle de l’auteur, tandis qu’il usurpe celle de son propre lecteur. Ce renversement des positions semble s’appuyer sur l’absence d’un auteur à son propre texte, voire à lui-même, et manifeste l’irresponsabilité d’un créateur qui a été agi, choisi, ou guidé par l’écriture, forme moderne d’enthousiasme poétique. Par ailleurs, la valeur conclusive et synthétique de l’essai dédoublant l’auteur en écrivain et en analyste de sa propre écriture, brandit la toute puissance d’un créateur, maître de la production comme de la réception de son œuvre.
Mais la prise en compte de ce mythe de l’écriture-lecture ne doit pas empêcher le lecteur d’apercevoir à ses côtés une véritable galerie mythographique de la question de l’origine de l’écriture.
2. Petite galerie mythographique des mythes d’origine
Je n’ai jamais appris à écrire
Les Incipit proposent dans le même temps qu’une réflexion sur l’origine du roman, un roman des origines lié à une démarche autobiographique sensible depuis la théorisation du mentir-vrai dans la nouvelle éponyme. Le sous-titre de l’essai : Je n’ai jamais appris à écrire ne développe pas l’idée de commencement contenu dans le mot latin choisi comme titre principal. La négation singularise d’emblée l’itinéraire d’un écrivain, qui à l’inverse de ses semblables, a su écrire sans avoir jamais connu l’étape de l’apprentissage. On pourrait songer ici à un mythe de notre antiquité gréco-latine : celui de Minerve sortant toute armée du crâne de Jupiter, mais il ne trouve pas de relais dans le texte.
Plus exactement, l’enfant a très rapidement su écrire, dès lors qu’il a compris à quoi l’écriture pouvait personnellement lui être utile. Cette figure de nourrisson savant a été analysée par Carine Trévisan (colloque du centenaire) : étudiée par Ferenczi, elle caractérise l’enfant possédant la science infuse, qu’il oppose à “l’enfant étranglé”, en d’autres termes, l’enfant dont les adultes empêchent le développement harmonieux (cf. M. Zamacoïs). Ces deux modèles permettent de comprendre le soubassement psychanalytique de la figure de l’enfant représenté dans les Incipit, mais aussi dans les textes autobiographiques.
La Défense de l’Infini : le « commencement sans fin » du livre-phénix
Une place singulière est occupée par La Défense de l’infini, cet immense roman dont Aragon dit qu’il a détruit un millier de pages et les centaines de personnages le composant. A partir des préfaces données en 1964 aux ORC, Aragon s’est en effet mis à témoigner de l’écriture et de la destruction de son manuscrit. En 1969, Les Incipit enrichissent le roman de ce « roman-comble », en le plaçant au centre de la réflexion et au cœur de l’essai. Une vingtaine de pages sont en effet consacrée à ce roman mythique, qu’Aragon détruisit en 1927 dans une chambre d’hôtel madrilène (pp 40-68).
L’histoire de La Défense catalyse dans ces années les deux tentatives majeures de théorisation de l’écriture littéraire d’Aragon, l’incipit et la parenthèse. Dans « L’homme fait parenthèse » (HMR II, 1971), ce roman est l’exemple d’une écriture de la parenthèse (autrement dit de la digression) poussé à son paroxysme, puisque que chacun des personnages du roman détruit “habitait” une parenthèse. Dans Les Incipit, il est donné comme le modèle d’un roman qui ne ferait que commencer et qui par conséquent aurait exploré de la façon la plus expérimentale la puissance de génération de l’incipit.
« la multiplicité des personnages étaient née de l’intrication de récits différents chacun ayant pour le commander son commencement, je veux dire une phrase tournant sur l’univers propre à ce personnage, de quoi, par quoi se déterminait un autre roman. » (p. 42).
Ainsi se profile un autre mythe important dans l’essai d’Aragon, celui d’un « commencement sans fin » qu’il voit mis en œuvre chez Beckett. Selon qu’on lui demande d’éclairer le début ou la fin d’un roman, on peut comprendre cette expression de deux manières : elle peut qualifier un livre qui n’en finit pas de commencer, qui n’a qu’un commencement, en somme un livre qui serait “pur commencement”, tout entier dans le moment de son invention. Elle peut aussi désigner un livre qui ne finit pas, qui est “sans fin” ou se poursuit indéfiniment. La Défense à ce double égard est bien le livre d’un commencement sans fin : il n’a fait que commencer à travers les multiples incipits-parenthèses qui s’ouvraient à la vie des personnages, et il n’a jamais connu de fin, puisque le projet n’a jamais pu aboutir.
Expérience de la démultiplication des commencements, La Défense est également présentée comme un roman-seuil, l’aboutissement d’une quête de “volonté de roman” atteignant une impasse (« pour six années environ se consuma la possibilité même en moi de toute création romanesque », p. 41), mais aussi exigeant le nouveau départ décisif de l’écriture réaliste.
Réitérant le geste enfantin de destruction d’un roman au titre brûlant (La Sorcière du Vésuve) l’histoire de ces « quinze cents pages » incendiées sur « le parquet d’une chambre d’hôtel » semble même déclencher la théorie des incipit qui donne son titre à l’essai, laquelle intervient immédiatement après la narration de l’« autodafé ». C’est ce qui nous invite à voir dans ce roman une sorte de “commencement” du roman chez Aragon, même s’il n’est pas le premier roman écrit par lui : non seulement c’est le roman où convergent et se consument les tentatives surréalistes, mais c’est aussi le roman susceptible de renaître par la fiction du roman du roman dans les préfaces et paratextes, où sous la forme d’un autre roman.
La parenté soulignée avec force par Aragon entre La Défense et Les Communistes, joignant les deux fils surréaliste et réaliste d’un parcours dénoués trop hâtivement par les critiques, révèle en effet que le roman détruit a su renaître sous la forme d’une ample fresque sociale (réaliste socialiste). Mais cette résurrection, pour indirecte qu’elle fût, s’est aussi effectuée dans d’autres romans du Monde Réel : la description de Sérianne au début des Beaux Quartiers nous dit Aragon, doit beaucoup à Vernont… ville où il avait précisément commencé à écrire La Défense. Curieusement, c’est aussi par sa fin programmée que La Défense renaît dans Les Communistes :
« cette foule de personnages allait se retrouver, chacun par sa logique ou l’illogisme de son destin, finalement dans une sorte d’immense bordel, où s’opéreraient entre eux la critique et la confusion, je veux dire la défaite de toutes les morales, dans une sorte d’immense orgie […] La Défense de l’infini allait me faire passer (verser, plutôt) du roman traditionnel qui est l’histoire d’un homme, au roman de société où le nombre même des personnages retire à chacun le rôle de héros, pour créer le héros collectif. J’étais bien loin, en ce temps-là, d’apercevoir que cela devait me mener vingt-deux ans plus tard à écrire Les Communistes. » (p. 45)
Cette « immense orgie » où devaient se retrouver tous les personnages du roman, nul doute qu’elle peut se comprendre dans le roman des années 50 comme une métaphore de la guerre, où convergent justement les destins des Jean de Moncey, Raoul Blanchard ou Fred Wisner. Ainsi, la renaissance du roman brûlé s’accomplit dans l’ambition et l’ampleur des Communistes, dans la création du héros collectif, comme dans l’orgie finale de la défaite.
A travers cette destruction et cette résurrection indirecte dans d’autres romans, c’est la figure du phénix qui s’impose, bien qu’Aragon, contrairement à Cendrars ou Apollinaire, ne l’ait jamais directement invoquée : La Défense commencement sans fin, toujours prêt à resurgir d’une manière ou d’une autre, présente bien les mythèmes propre à la figure du phénix : l’auto-engendrement, la mort et la renaissance de l’oiseau selon deux variantes à quoi on fera correspondre deux processus d’engendrement du texte, soit à partir de ses cendres (nouveau texte qui s’érige contre le livre précédemment détruit : Le Monde réel faisant suite à La Défense de l’Infini), soit à partir de restes décomposés (nouveau texte qui poursuit le précédent ou en développe les potentialités, selon la filiation entre Les Communistes et La Semaine sainte par exemple). Mais on sera aussi sensible au mythème de perpétuité véhiculé par le mythe « qui enchante l’homme parce qu’il ne comporte pas le mot fin » (Marie Miguet) et nous indique une autre dimension essentielle de l’écriture chez Aragon (cf infra).
Le démon de la contradiction [[Expression employée par Aragon dans « Le Discours de Prague », OP 1, t. XIII.]]
La genèse de La Défense permet l’élaboration d’un principe qu’Aragon voit à la source de toute création romanesque et qui s’appuie sur le mot d’ordre dada du droit à la contradiction. La contradiction s’érige autant contre les autres que contre soi-même. La Défense de l’infini a été écrit contre le groupe surréaliste où pesait dans toute sa violence la condamnation valéryenne d’un genre arbitraire : Aragon parle alors de « négation du groupe » mais explique aussi qu’il « n’écri[t] jamais que pour [se] contredire » (p. 36)[[Il donne de cette démarche de nombreux exemples : dans La Femme Française, l’extrême lenteur de l’écriture, matérialisé par les blancs séparant de courts paragraphes s’élevait contre le principe de la vitesse surréaliste.
]].
Fort de cette affirmation, A. n’hésite pas à donner un exemple allant contre sa théorie des incipit : celui de la genèse des Beaux Quartiers. Pour la première fois, l’écrivain aurait écrit à partir d’une “préconception” du roman (p. 80), puisque précisément il s’agissait de “contredire” l’absence de construction qu’on reprocha aux Cloches de Bâle ; l’ensemble du roman n’est donc pas directement issu de la première phrase. Ce sont les limites de la compatibilité des deux théories, celle de l’incipit et celle de la contradiction, qui sont ainsi mises au jour : peut-on en effet affirmer dans le même temps qu’on écrit à partir d’une première phrase présentant un haut degré d’arbitraire et susceptible d’engendrer un texte inédit et qu’on écrit pour contredire ce qu’on avait publié précédemment ?
La référence à Ducasse ne permet pas vraiment de sortir de l’aporie en reformulant le principe de contradiction dans les termes de la réécriture, mais elle a aussi pour fonction d’instituer la lecture des Chants et des Poésies de Ducasse comme origine. La valeur matricielle de cette lecture pour le jeune Aragon est très sensible dans les deux grands articles de 1967 consacrés à Ducasse dans LLF : « Lautréamont et nous ».
« cette négation de moi-même était en même temps une constante pour moi depuis la lecture des Poésies d’Isidore Ducasse, et la négation de Maldoror par celui qui avait voulu être le comte de Lautréamont » (p. 96)
La théorie de la “réécriture au bien” apparue dès les années 30, a permis d’expliquer le passage du surréalisme au réalisme, en insistant sur l’œuvre comme devenir (Édouard Béguin, 1992). Ainsi est interprétée la rupture entre la fin du Paysan de Paris (« Le Songe du paysan ») et son début dans Les Incipit. Mais au-delà, c’est la totalité du Monde Réel qu’il faut comprendre comme réécriture au bien du grand roman détruit. Plus encore, comme on a pu le voir dans la citation, le principe de contradiction au fondement de la création romanesque chez A. est aussi ce qui assure la continuité de toute son œuvre.
« Chacun de mes livres contredisant le précédant, le parti-pris du précédent, mais rétablissant ainsi la continuité de tous. J’écris cette note pour tenter d’introduire dans l’esprit du lecteur une méthode qu’il appliquerait par la suite sans que je l’y sollicite du Paysan de Paris au Fou d’Elsa, et au-delà. Jusqu’à ce roman-ci » (note de la p. 50)
Dans cette idée que chaque livre achevé renaît, annonce, prépare, contredit le livre précédent (« cette perpétuelle dialectique tournée contre moi-même » p. 96), il s’agit pour Aragon de trouver une cohérence rétrospective à son parcours de créateur. De fil en aiguille (pour reprendre une de ses expressions fétiches), il parvient ainsi à relier l’ensemble de sa production romanesque. Mais ce fil, feint-il d’affirmer, il est le seul à en connaître les deux bouts, car autant que sa vie, son œuvre est bâtie sur le secret.
3. Le secret au cœur de la création romanesque : Œdipe et le Sphinx
Le secret comme thème manifeste
Dès les premières pages de l’essai, le lecteur est frappé par la récurrence de cette thématique du secret. L’enfant-écrivain passe de l’idée de fixer des secrets à celle d’en provoquer : il cache ses premiers romans dans le tronc d’un arbre afin de les soustraire au regard “étrangleur” de l’adulte. Plus tard, il écrit dans la plus grande dissimulation ses premiers romans d’adulte : Télémaque est désigné comme « ce livre de secrets » (p. 17), résumant « ce que fut Dada », tandis que l’écriture de La Défense de l’infini procédait « d’une décision secrète » (p. 49).
De nombreux ouvrages cités pour l’influence qu’ils eurent sur l’œuvre ou leur parenté avec elle, sont animés du même secret, lequel est “la clef de tout art” (p. 31) ; c’est le cas d’Ulysses de Joyce, dont le “secret” est d’être un calque des épisodes homériques (p. 21). Non seulement les secrets d’une œuvre peuvent être révélés, mais d’une certaine façon ils le doivent : méconnu, le secret perd sa vocation, qui est d’être la vérité de l’œuvre.
Et puisque l’écriture chez Aragon ne va jamais sans la lecture, les livres lus par lui ou par d’autres, sont invariablement associés au secret : ainsi Raymond Roussel présent tout au long de l’essai (cf. même sur la couverture qui représente le décor pour « Poussières de soleil » édité chez Lemerre) est finalement “avoué” comme influence déterminante lors de l’analyse de l’incipit des Cloches de Bâle avant d’être abondamment cité p. 130 à 132. Sa théorie de la production littéraire à partir d’une phrase déclenchant toute une machinerie créative rejoint bien la conception aragonienne du roman comme machine ou machination de ces années 68-69 (Cf. Henri Matisse, roman II, « L’homme fait parenthèse », p. 149). Par ailleurs, Roussel apparaît comme un double de l’auteur, puisque lui aussi avait un secret : Jules Verne, que sa mère lisait tous les soirs à haute voix devant l’assemblée des domestiques. Par le biais de ces lectures se met en place une chaîne qui partant d’Aragon et de son secret (Roussel), passe par le “secret” de celui-ci, Jules Verne… que lisait Aragon également. La boucle bouclée révèle que parlant des autres, Aragon ne cesse de parler de lui, que le détour par les autres ramène forcément à soi, ce qu’il formule explicitement lorsqu’il déclare s’« écarter de [lui]-même pour mieux [se] voir » (p. 125).
Une rhétorique du secret
L’écriture se construit alors autour de la figure de la confession (terme employé p. 139 : « confesser l’obsession ») ou de l’aveu (« je l’avoue donc », p. 140) d’un mystère qui se dérobe. L’essai se présente comme dévoilement de certains secrets de fabrication, « l’envers du jeu » (p. 14) : ainsi se comprend la référence à Roussel, modèle de l’écrivain qui a livré les clefs de la confection de ses livres, et donc – une partie de – ses secrets. Mais il est aussi révélation des secrets de la signification cachée des œuvres, à travers les motifs de l’étonnement d’auteur devant le peu de perspicacité de son lecteur-critique et les conseils donnés aux chasseurs de secrets[[Par exemple : « Il suffirait de rapprocher ces deux commencements d’histoire (Anicet et La Demoiselle aux principes) pour saisir un de mes secrets d’alors » (p. 33), à savoir la réflexion sur les débuts de récit.]].
Mais au-delà du thème, sensible également dans la référence au trobar clus ou dans l’indication d’un thème “caché” dans l’iconographie : la jalousie, « mon visible ravage » (p. 22 ou p. 38), c’est l’ensemble du propos qui file la métaphore de la révélation : l’essai finit par se présenter comme une immense digression, une parenthèse, qui permet d’arriver après plusieurs méandres, au cœur d’un secret enfin exhibé, et qui prend tout d’abord le nom d’un auteur : Samuel Beckett.
« Parce que tout le temps que j’écrivais ce petit livre, je pensais à lui, et de la première ligne à ce point où me voici, mon secret était que je me dirigeais vers lui » (p. 138).
Comme l’avait noté Édouard Béguin (1989), la levée du mobile secret du discours nous oblige à relire l’ensemble de la thèse des incipit comme un thème secondaire, dérivé du thème central enfin atteint. L’écriture permet la levée du secret, mais celle-ci ne peut se faire qu’au terme d’un détour : l’aveu ne peut être immédiat et l’écriture a précisément pour charge de le rendre possible. Mais à la lecture de la page 138, le lecteur ne peut se défendre de supposer à l’auteur une manière de perversité à l’avoir mené ainsi selon les capricieux méandres d’un thème, somme toute inessentiel : les incipit.
Pourtant, si Aragon a écrit Les Incipit comme il prétend le faire pour ses romans, à partir d’une première phrase génératrice dont tout découlerait, on est en droit d’imaginer que la découverte du secret s’est fait pour lui dans les pages mêmes où il est révélé au lecteur… mais rien ne nous autorise à utiliser de la sorte sa théorie de la production romanesque.
L’importance que revêt pour l’auteur la confession du secret, et donc les dernières pages de son essai nous est confirmée par un article des Lettres françaises (n° 1306, 29 octobre 1969, p. 3 et 4), où non content d’annoncer la parution imminente des Incipit sous la forme d’un brillant pastiche de l’écrivain irlandais, l’auteur reformule ensuite, dans des termes très proches de ceux que nous avons cités, l’idée du secret qui aimantait le propos vers Beckett, au point qu’il a le sentiment « d’avoir SECRÈTEMENT voté pour lui » dans l’attribution du prix Nobel. La longue citation de la fin des Incipit (p. 139-146) donnée comme « preuve » de ce qu’Aragon « avance » s’inscrit certes comme écho à l’actualité d’octobre 1969, mais au-delà augmente la portée et la valeur du final des Incipit.
Le Mystère de finir
Au bout du compte (et du livre), par le biais de Beckett, nouveau relais du discours et dernier double de l’auteur, Aragon opère la substitution de la question du « mystère de finir » à la problématique de l’incipit. Il remplace, comme le note Édouard Béguin, la question du pourquoi de l’écriture romanesque par une question laissée en suspens : “comment finir ?”. En effet, coïncidant avec la fin du livre (qui se clôt sur la p. 147), le « mystère de finir » ne reçoit pas d’éclaircissement. Le livre s’achève sur l’impossibilité de révéler ce qui reste l’ultime énigme de l’écrivain, qui par une manière de pirouette, renvoie le lecteur au début du livre : la dernière phrase de l’essai est aussi celle par quoi il débute. La fin du texte et la question de la fin sont ainsi placée sous le signe de la répétition. L’écrivain substitue à la vectorisation vers la phrase de desinit « une logique circulaire qui assurerait à l’incipit une apparence d’infinité » (Limat, 1989, p. 94).
C’est donc l’image du retour, de la boucle ou du cercle qui s’impose comme « la musique de Beckett » qui « tourne désespérément sur elle-même à la façon d’un disque quand l’aiguille n’arrive plus à sortir de son sillon », les Incipit se referme sur leur secret, murant le lecteur dans le vertige de la répétition.
Les questions du Sphinx
On ne s’étonnera pas de trouver au terme de notre parcours le double figure mythique, du Sphinx et d’Œdipe. Œdipe est en effet un mythe privilégié pour un écrivain qui ne pouvait pas ignorer sa revivification par Freud et la mise au jour du roman familial à quoi il a donné son nom. La MM intitule d’ailleurs un de ses trois contes parenthétiques : « Œdipe », qui reprend le mythe antique sur le mode de la dérision et de l’humour burlesque. Dans Les Incipit, Œdipe est associé explicitement à la figure de l’écrivain ; il est celui qui veut savoir, et pour cela, « prend sa plume » :
« Jamais peut-être ne s’était posée avec une telle violence la question de commencer et de finir, qui est une et mille, et qu’à l’Œdipe qui prend sa plume va toujours mortellement poser le Sphinx » (p. 144).
Le Sphinx, conformément à un de ses mythèmes les plus connus, est l’image de la question : question que l’écriture pose à l’écrivain, et que, par voie de conséquence il se pose à lui-même, à l’image des personnages de Beckett « ces sphinx d’eux-mêmes qui ont la langue empâtée de la multiplicité des réponses possibles » (p. 142). On voit ici que l’écriture ne saurait donner de réponse claire, unique, ou définitive : elle ne peut que témoigner de l’incohérence du moi, de sa fragmentation, de ses multiples contradictions.
En soi, la question – soit l’écriture – n’est pas anodine : elle représente un danger existentiel (mortellement) ; interroger le mystère de finir ou de commencer, revient à mettre le doigt sur des problèmes insolubles pour l’écrivain. Le livre aboutit donc, avec cette image de Sphinx à inscrire dans le propos quelque chose d’impensable : la mort, autre expression du tarissement créateur. Or le mystère de finir ou de se taire n’est pas plus susceptible d’être éclairé que l’ultime horizon de la vie humaine. Un commentaire hors-texte de dessins de Titus-Carmel qui associe la disparition d’un personnage à une inquiétante tête de mort, prend du fait même de sa place une valeur conclusive :
« Mais à la fin, l’ailleurs où disparaît le personnage, et la cime à l’horizon des arbres prend des airs de courbe des températures, l’ailleurs, pour tous, pour tous les sphinx et tous les Œdipe nous montre une tête de mort » (p. 142)
La théorie du roman comme miroir permettant l’accès à un arrière-texte, développé dans La Mise à mort et reprise dans les Incipit, permet une nouvelle variation sur le thème du secret. Là également, Aragon passe par la référence à un écrivain, Lewis Caroll, et au thème du passage de l’autre côté du miroir. Il s’agit de découvrir sur l’envers du décor, un secret fondamental, manifestement lié à l’autobiographie :
« l’incipit m’ouvre l’arrière-texte, ou peut-être n’est-il que le trou de la serrure par où je regarde ce monde interdit » (p. 129).
Le secret a partie liée avec l’interdiction, et on songe de nouveau à l’Œdipe de Sophocle, qui n’a de cesse de connaître le mystère de sa naissance, ou encore à la scène primitive observée par l’enfant : lire, mais écrire aussi (puisque ce sont les deux faces du même acte), c’est transgresser une interdiction fondamentale, c’est se comporter comme Œdipe.
Qui veut percer le double secret de commencer et de finir -écrivain ou lecteur, c’est tout un- s’expose peut-être à finir aveugle, à force de se faire « voyeur ». Le risque est donc grand à vouloir percer le secret d’une œuvre (l’écrire ou le lire) : on comprend peut-être mieux l’image des yeux crevés du centaure Polyphème, cet épisode d’Homère illustré par Matisse qui a mis l’accent sur la souffrance du monstre (p. 26). Dans un autre contexte, il a subi le châtiment que s’infligea Œdipe ne supportant pas la révélation du secret. C’est ainsi que la lecture de tout texte est soumise à cette menace. Tout lecteur est « voyeur » : Miguel Zamacoïs subtilisant les livres de l’enfant, mais aussi Aragon adulte lisant Beckett avec un sentiment de « profanation » qui a des connotations sacrées.
L’autre danger est indirectement suggéré par l’image du carrefour. Fugacement présent à travers la figure d’Hercule au carrefour du bien et du mal, elle possède une triple signification : tout d’abord, elle symbolise la situation du créateur, sommé de choisir une voie, puisqu’il se trouve sur un “sentier”, pour reprendre, à la suite d’Aragon, le titre de la collection. L’incipit est d’autre part associé à un échangeur routier, qui conduit l’écrivain vers le dire, la vie, la création. Sans quoi, le taire, la mort ou la stérilité seraient son inéluctable destination. L’image révèle donc un choix existentiel, fondamental, réalisé au prix de la vie. Enfin, cette métaphore de la route et de l’échangeur que constitue la première phrase (p. 41) insiste sur le caractère de détermination hors de toute volonté consciente de l’auteur[[La fécondité de cette figure mythique mériterait d’être exploitée puisqu’elle comporte également le mythème du croisement, au symbolisme multiforme chez Aragon, à commencer par l’intertextualité généralisée de l’œuvre, conjugale (Œuvres romanesques croisées) ou non ou encore la représentation de la complexité la vérité humaine : « Il nous faut des transfigurateurs. Ceux de la Vierge ou ceux de Napoléon. Ah, vienne le temps où l’on nous baisera les mains pour avoir vu dans un marché, une foule, un bouge, une vérité humaine, une vérité de carrefour… » (La Semaine sainte).]].
Plus loin, la figure héroïque d’Hercule est plus spécifiquement utilisée pour désigner un créateur qui, au moment de la rupture avec les surréalistes « fut de ceux qui me suivirent » (p. 62) : le réalisateur Buñuel « toujours au carrefour du bien et du mal » (p. 63), nouvel avatar de la figure de l’écrivain. Dans le fameux apologue de Prodicos de Créos, Hercule jeune est sollicité par deux femmes, « le Vice, qui lui fait miroiter les douceurs d’une vie molle et voluptueuse, tandis que la Vertu lui montre le chemin escarpé qui conduit à l’honneur et à la gloire » (Encyclopedia Universalis). Les deux mythèmes contenus dans la fable insistent à la fois sur la puissance de création de l’écrivain, nouvel Héraclès, et sur son héroïsme moral qui lui a fait choisir, non le chemin de la facilité, mais la voie de la séparation d’avec le groupe surréaliste, de l’engagement communiste, et surtout d’une écriture romanesque et réaliste. On notera qu’Hercule arrive après une référence à Ducasse ; or, celui-ci a « joué le renversement des valeurs » (p. 63) en retournant l’écriture des Chants de Maldoror dans ses Poésies. Ainsi le carrefour d’Hercule devient-il aussi le lieu de la contradiction et la bifurcation est réinterprétée comme renversement et non plus comme alternative[[Dans « Lautréamont et nous » (OP 7), la figure d’Hercule est également utilisée à propos du renversement Ducassien : à la différence près que l’épisode retenu de l’abondante légende d’Hercule est celui de l’affrontement avec le monstre Antée, qu’Hercule tua en le décollant du sol, où il trouvait son énergie vitale, puis en l’étranglant.]].
Dans les Incipit, Hercule est donc deux fois figure de l’écrivain : par le biais de l’image de la route (de l’échangeur) et par la négation du mal qu’il assume en choisissant la voie du bien – tel l’écrivain surréaliste adoptant la voie réaliste.
Pourtant, on est vivement tenté de superposer à cette image d’Hercule, l’autre figure mythologique privilégiée par Aragon, celle d’Œdipe, tuant son père Laïos, précisément à un carrefour, comme ne se fait pas faute de le rappeler le « Conte de la Chemise rouge » de La Mise à Mort intitulé Œdipe :
« le secret est que, ignorant le grec, je n’ai jamais lu Sophocle et je tiens de Sénèque seul l’histoire de Laïus, le salaud de père qui m’a abandonné…gagnant les forêts feuillues de cette sacrée Castalie…calcavit artis abitum dunnis iter…il talonnait une piste encombrée de toute sorte de saloperies…trigemina qua se spargit in campos via…là où trifurque la route dans les champs. Mais je vous dis que je n’ai pas tué mon père, moi, ce n’est pas moi qui l’ai tué, en tout cas, je veux dire si on l’a tué sur le troisième rameau du carrefour, celui qui fait serpent dans un val profond et touche les errantes eaux de l’Ilissus dont il coupe d’un gué le lit glacé… Drôle d’histoire ! » et plus loin, lors de la transposition de la scène mythique en décor parisien : « c’était où la route se détriple ». « Troisième conte de la chemise rouge : Œdipe » in LMM, Folio, p. 418.
Ainsi, si l’écriture se présente comme carrefour, elle l’est également au prix d’un meurtre symbolique : celui du père, dont on refuse la paternité pour choisir de devenir le fils de ses œuvres[[Cet aspect a été abondamment développé par Roselyne Collinet-Waller dans sa thèse reprise en volume : Aragon et le père, romans, Presses universitaires de Strasbourg, 2001.]].
Mais ce n’est sans doute là qu’un des aspects du secret d’Aragon… l’écrivain préfère en effet céder au vertige de fermer le secret sur soi, se préservant d’une inquisition dont il ne livre d’ailleurs que de fausses clefs : nous n’aurons pas le fin mot de l’énigme ; au contraire, les Incipit, feignant de résoudre les mystères de la création, ne font qu’ajouter à la perplexité du lecteur, promu nouveau Sphinx (ou nouvel Œdipe ) affamé de questions.
Aragon se révèle donc un véritable mythographe de l’écriture, théorisant de façon fascinante les problèmes liés à la création. La théorie des incipit se présente comme une fiction, dont la valeur essentielle est de donner une cohérence unificatrice et rétrospective à l’œuvre. Mais elle reste incapable de révéler comment (et d’où) la phrase de genèse s’impose.. Contrairement à Roussel qui, lui, explicite le processus, Aragon montre surtout comment se développe le roman à partir de cette phrase inaugurale, si bien que le lecteur bute sur ce qui restera pour toujours une énigme : l’origine même de l’inspiration, irréductiblement mystérieuse.
Des mythes constitués par la tradition gréco-latine servent de relais pour exprimer une esthétique ou métaphoriser le visage de l’écrivain, explicitement (le Sphinx, Œdipe ou Hercule) ou implicitement (le Phénix).
La figure du secret est emblématique de ces mythes plus ou moins exhibés dans le corps de l’essai et qui sont tous des “mythes d’origine” : du livre qui n’a pas de fin car il s’autogénère (Phénix) au Sphinx qui symbolise les questions que l’homme ne cesse de se poser à lui-même ou Œdipe qui représente l’écrivain avide de réponses.
La rhétorique du secret consiste à livrer celui-ci au lecteur… par le biais de dévoilements successifs mais incomplets. On aboutit ainsi au problème crucial du mystère de finir. L’impossibilité d’élucider davantage ce noyau aveugle de la réflexion révèle que le discours sur l’écriture ne peut pas être un discours objectif sur la création, sur la difficulté pour l’homme à trouver sa cohérence comme à envisager sa propre fin : le recours aux mythes qui permet d’élaborer littérairement des explications assigne aux Incipit non un statut à part d’“essai”, mais une place au sein même de la production fictionnelle d’Aragon (roman ou poésie).
Aragon affirme dans son titre (Je n’ai jamais appris à écrire) qu’il n’a pas eu de commencement, puis refuse de se prononcer sur la question de la fin, laissée en suspens. La dernière phrase – qui n’assume pas sa fonction de desinit – renvoie à l’incipit du livre, et par conséquent à l’idée d’une absence de commencement. Le mythe ultime ainsi constitué est alors celui, sans commencement ni fin, d’une éternité de la parole .
Corinne Grenouillet, Université Marc Bloch, Strasbourg II
Références bibliographiques :
Édouard Béguin, « Les Incipit ou les mots de la fin » in Europe Janvier Février 1989, pp 81-89.
Édouard Béguin, « La notion de réécriture chez Aragon : la filière d’Isidore Ducasse » in Recherches Croisées Aragon/Elsa Triolet n° 4, Annales Littéraires de l’Université de Besançon, 1992, pp 119-146.
Mircea Éliade, Aspects du mythe, Gallimard, 1963, “Idées”, 247 p.
Lionel Follet, préface à La Défense de l’infini, Gallimard, 1997, “NRF”.
Nathalie Limat-Letellier, « Le “Mystère de finir” dans les derniers romans d’Aragon » in Europe Janvier Février 1989, pp 91-103.
Marie Miguet, article « Phénix », Dictionnaire des mythes littéraires, sous la direction de P. Brunel, Éditions du Rocher.
Les ouvrages d’Aragon sont abrégés ainsi :
La Mise à Mort (Folio, 1965) = LMM.
Henri-Matisse Roman (Gallimard, 1971) = HMR
Les Lettres françaises = LLF
Œuvre poétique= OP (édition en 7 volumes)