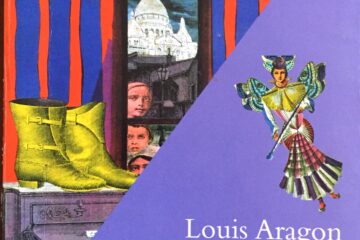Maryse Vassevière, « Aragon / Racine: les mots palpitants », 2006
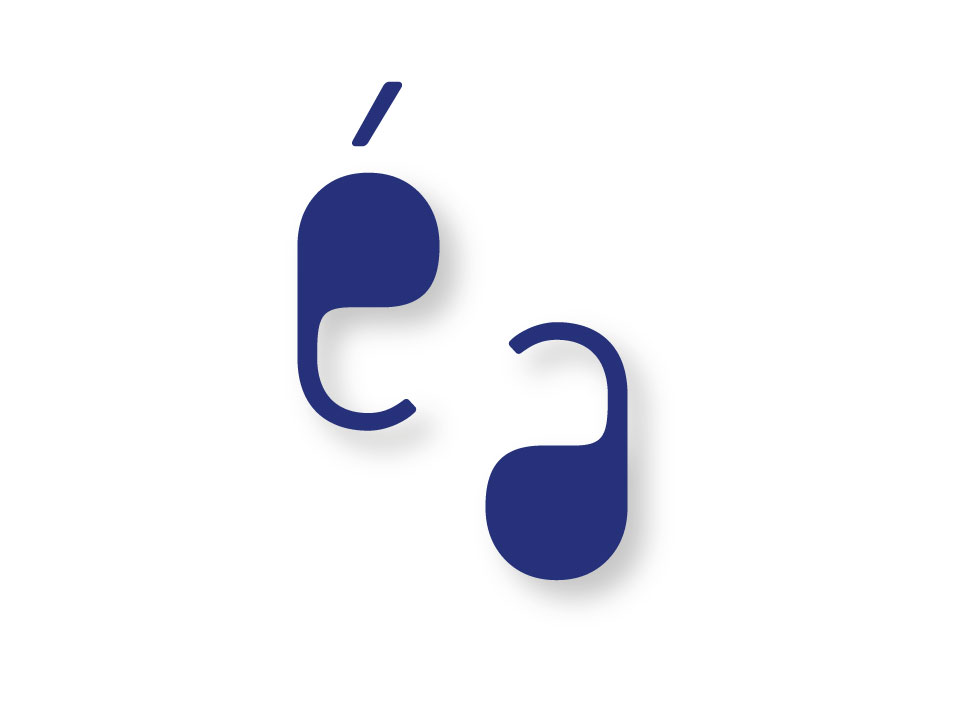
ARAGON / RACINE
OU LES MOTS PALPITANTS
Travaillant sur l’intertextualité dans l’œuvre d’Aragon, j’ai très vite été confrontée à la trace des « mots palpitants de Racine » dans le texte aragonien. Les relevés que j’en ai fait constituent une liste impressionnant et intéressante au plus haut point pour comprendre les mécanismes de la pensée et de l’écriture chez Aragon, mais aussi peut-être pour éclairer l’œuvre de Racine elle-même par ce coup de projecteur magistral que donne la lecture d’un grand écrivain du XXe siècle.
Je voudrais essayer d’utiliser les ressources de la recherche intertextuelle pour cette conférence en évitant les termes savants et en faisant servir cette recherche à une entreprise de lecture à grande échelle et à ciel ouvert, avec vous, avec vos propres remarques qui ne manqueront pas de jaillir au moment du débat, et aussi avec le concours d’un comédien qui lira pour nous les grands fragments de ce discours croisé entre Aragon et Racine sur lesquels repose cette conférence.
1. LE CORPUS
Il me faut d’abord dresser la cartographie de ce croisement des textes. Il y a deux entrées possibles dans ce continent :
– soit par l’auteur cité c’est-à-dire l’auteur ancien dont les textes se trouvent convoqués dans le texte d’un autre, séparé de cet autre qui le cite par le temps, quelques années ou plusieurs siècles. C’est le cas de Racine que trois siècles séparent de ce pair prestigieux par-delà le temps qui a d’abord été surréaliste, puis poète de la Résistance pour finir par être l’un des grands romanciers réalistes, peut-être le plus grand, de notre temps.
– soit par l’auteur citant, c’est-à-dire l’auteur moderne qui cite un auteur ancien alors qu’il est éloigné de sa source non seulement par le temps, mais aussi par les changements de société, la transformation des mœurs et l’évolution des manières de penser comme d’aimer et qui se trouve pourtant assez proche de lui, pour une attitude face au monde et un langage communs qui lui permettent d’engager le dialogue.
Et c’est ce dialogisme-là qui est fascinant dans toute écriture intertextuelle parce qu’il permet de faire entendre des paroles là où l’on croyait qu’il n’y avait que le silence des siècles et parce qu’il permet de bousculer toutes les catégories que l’institution littéraire, universitaire, scolaire mais aussi l’idéologie avaient établies de manière étanche. Quand on interroge les textes avant tout, et eux seuls, on découvre alors que la parole circule et qu’il n’y a pas de patrimoine accaparé ou confisqué. C’est au-delà des modes et des interdits qu’Aragon, sans contradiction avec ses engagements et sa conception de l’écriture, va converser magistralement, aimablement et fraternellement, avec le grand Racine. Et il est émouvant que ce dialogue-là se fasse entendre par-delà le temps en ces deux lieux « des champs », Port-Royal et le Moulin de Villeneuve, si proches dans l’espace des Yvelines, où nos deux auteurs ont vécu et qui sont devenus à leur tour des objets de notre patrimoine comme les textes auxquels ils sont apparentés.
Si je choisis l’entrée par l’auteur citant (Aragon/Racine), je constate la permanence de la référence à l’œuvre de Racine dans toute la carrière littéraire d’Aragon. Il faudra bien sûr entrer dans le détail, mais constatons d’abord que même pour le jeune poète surréaliste, irrévérencieux et même iconoclaste face à la tradition littéraire, Racine est une référence, et ce sera Phèdre. Si l’on comprend mieux la référence au Racine du patrimoine national sous l’Occupation, on se sera pas étonnés de retrouver Racine dans Les Communistes. Mais c’est peut-être les œuvres de la dernière période, et notamment Théâtre/Roman, précisément parce qu’elles sont des œuvres critiques en même temps que des romans, des entreprises de lecture somme toute, qui s’approchent au plus près du secret des tragédies de Racine. Je reviendrai donc plus loin sur ces trois périodes et sur ces trois approches où pour chacune d’elles Racine a sa part spécifique.
Si je choisis maintenant l’entrée par l’auteur cité (le Racine d’Aragon), je constate que les pièces les plus citées, avec des constantes d’un bout à l’autre de l’œuvre à la fois dans les romans et la poésie, sont au nombre de cinq : Phèdre (dans Les Aventures de Télémaque (1922) et dans Les Communistes (1949-1951 et 1966)), Bérénice (dans Aurélien), Andromaque (dans Les Yeux d’Elsa (1942) et dans Les Poètes (1960) avec un croisement supplémentaire avec Baudelaire), Mithridate (dans En français dans le texte (1944) et dans Les Communistes) et Britannicus dans Théâtre/Roman (1974).
Autrement dit on a l’impression qu’on trouve tout Racine dans tout Aragon… et que ce dialogue n’est pas qu’occasionnel mais qu’il représente un long compagnonnage, la rencontre de toute une vie.
Si maintenant on prend ces références et qu’on les situe dans le contexte des deux œuvres, c’est-à-dire en rétablissant la chronologie propre à la fois à l’œuvre de Racine et à celle d’Aragon, on fait quelques découvertes que l’on pourrait schématiser ainsi : (voir tableau annexe que je donnerai au moment de la conférence)
RACINE DANS L’ŒUVRE D’ARAGON
TEXTES DE RACINE TEXTES D’ARAGON
Andromaque (1667) Phèdre : dans Les Aventures de Télémaque (1922) et dans Les Communistes(1949-1966)
Les trois «tragédies du refus» selon Lucien Goldmann Britannicus (1669) Mithridate : dans En français dans le texte (1944) et dans Les Communistes.
Bérénice (1670) Bérénice dans Aurélien (1944).
Le «drame intramondain» Mithridate (1673) Andromaque dans Les Poètes (1960).
La «tragédie» : retour à la tragédie Phèdre (1677) Britannicus dans Théâtre/Roman (1974).
À observer ce tableau, on constate une sorte de chiasme matérialisé par le croisement des flèches : ceci visualise la pratique de l’écriture à-rebours dont Aragon est coutumier dans un grand nombre de ses démarches intertextuelles qui consistent souvent à invertir et convertir. On voit ici que le texte aragonien reprend le texte racinien dans son ordre inverse : Phèdre d’abord alors que c’est la dernière des tragédies après la conversion et Andromaque et Britannicus dans la dernière période d’Aragon alors que ce sont les premières tragédies de Racine. Comme si pour Aragon l’écriture de la vieillesse remettait ses pas dans ceux de la jeunesse de Racine, dans une sorte de jeunesse éternelle recherchée par l’écriture. Comme si, à la manière de toute lecture , Aragon suivait le chemin inverse du chemin de Racine vers le retour à l’ordre janséniste. Comme si toute lecture-écriture était une remontée vers les origines.
C’est ainsi que Phèdre, la pièce la plus chrétienne qui marque le retour de Racine vers Port-Royal, est prise dans Les Aventures de Télémaque dans son sens le plus iconoclaste, par une opération de détournement caractéristique de l’époque contestataire d’Aragon dada. Par contre avec Andromaque , pièce de l’exil des troyennes captives des grecs vainqueurs, Aragon marque le retour aux tragédies de jeunesse de Racine pour dire le drame de tous les exils et de toutes les tragédies du XXe siècle, y compris celle de l’utopie communiste, au moment où avec la vieillesse s’opèrent les bilans critiques et les réévaluations. De même dans Théâtre/Roman le vieil Aragon par le biais d’un acteur qui va jouer Britannicus, médite sur Néron le monstre et utilise cette tragédie d’avant la pacification janséniste pour dire le doute sur soi.
On remarquera avec intérêt et sans étonnement la position d’équilibre de Bérénice qui confirme son statut de prédilection dans l’œuvre d’Aragon. Comme si la flèche du milieu qui matérialise cette position d’équilibre sur notre schéma représentait le fléau de la balance en équilibre entre les deux parts égales des deux œuvres et comme si elle donnait à voir cette « double perfection » un peu énigmatique qu’Aragon décèle au cœur de « l’ombre de Racine à la Ferté-Milon » dans « Plus belle que les larmes », ce très beau poème en réponse aux accusations de Drieu la Rochelle dans L’Émancipation nationale, le journal de Doriot, et qui est construit comme un survol de la France et une litanie du patrimoine culturel national.
Une fois ce corpus d’ensemble dressé et envisagé selon la double chronologie de l’œuvre racinienne et de l’œuvre aragonienne, je voudrais revenir sur le détail de ces croisements, comme je l’ai annoncé. Et pour cela les envisager du point de vue d’Aragon et en fonction du contexte historique qui éclaire chaque pan de son œuvre et donne aussi un sens particulier aux différentes modalités de son dialogue avec Racine.
2. LE RACINE D’ARAGON OU LES TERMES D’UN ECHANGE
On a coutume, notamment depuis l’ouvrage biographique de Pierre Daix sur Aragon qui donne à le fois le parcours de l’homme et de l’œuvre, de distinguer trois périodes dans l’itinéraire littéraire et intellectuel d’Aragon : la période dada et surréaliste, celle de la poésie de la Résistance et de l’immédiat après-guerre marqué par les formes les plus véhémentes de l’engagement et la « dernière carrière », pour reprendre un terme de Pierre Daix, qui s’ouvre avec le bilan critique du Roman inachevé (1956) et qu’on peut caractériser comme le temps des réévaluations. Pour la commodité de l’exposé, je conserverai cette tripartition que l’œuvre elle-même impose, mais je voudrais montrer les continuités et notamment la manière dont l’écriture est toujours en prise avec le monde, toujours tendue vers une vérité à démasquer et toujours l’instrument d’une parole adressée au lecteur. Et le dialogue avec Racine n’échappe pas à cet objectif majeur d’un dialogue majeur avec le lecteur, comme si Aragon en demandant au lecteur de se situer dans cet échange à deux voix le mettait à même de dialoguer avec Racine lui-même. Où l’on voit que cette communication d’un genre particulier qu’Aragon entretient avec son lecteur par le biais des intertextes ressemble fort à la communication théâtrale que Racine poète a privilégiée pour son œuvre et dont Aragon a compris l’importance en en faisant dans Théâtre/Roman la métaphore de l’écriture romanesque elle-même.
2. 1. Le poète dada et le Racine du patrimoine
Au moment où le jeune Aragon qui vient de connaître l’horreur de la guerre de 14 entre en littérature, Racine fait partie de son héritage scolaire. Contrairement à Breton qui a suivi un cursus scientifique au lycée, Aragon a suivi un double parcours littéraire et scientifique, et si à la suite de son bac sciences il fait des études de médecine comme son ami – c’est d’ailleurs sur les bancs de la faculté qu’ils se rencontreront – Aragon a aussi passé un bac lettres et sa culture littéraire est immense, puisque, comme il le raconte dans Je n’ai jamais appris à écrire ou Les incipit, il a appris à lire dans le Télémaque de Fénelon.
Et c’est essentiellement cette littérature classique du Grand Siècle que va mettre en pièces le jeune poète dada contestataire : Aragon en ce début des années 20 est en effet soucieux de rompre avec la littérature constituée et ses compromissions depuis que Tzara est arrivé de Zurich pour répandre à Paris le mouvement Dada, qui est aussi une révolte de ces jeunes gens contre la guerre de 14 et la société bourgeoise qui l’a engendrée. C’est ainsi que sur le mode humoristique et désacralisant Aragon se livre avec ses Aventures de Télémaque à rien de moins qu’une réécriture de Fénelon qui lui-même avait réécrit Homère comme Racine et tous les autres écrivains classiques.
Je n’entrerai pas dans le détail de cette réécriture dada qui est d’abord une entreprise de jeunesse et qui nous frappe encore par l’extraordinaire vivacité et la liberté de cette écriture qui se moule dans un récit canonique pour parler d’amour et de philosophie d’une manière neuve. Car c’est bien de philosophie qu’il s’agit d’abord entre Télémaque et Mentor qui d’une certaine manière réécrivent sur le mode tout autant humoristique un autre couple célèbre du philosophe et son élève, le couple Candide et Pangloss de Voltaire. Télémaque et Mentor discutent de la liberté et du destin et c’est alors que se trouve cité un vers de Phèdre, une phrase de la scène 3 de l’Acte I où Œnone qui représente « le monde » et la tentation de pactiser avec lui, évoque pour Phèdre la possibilité d’un avenir alors qu’elle-même se pense comme déjà potentiellement suicidée. Et la seule trace de la référence à Racine est donnée de manière bouffonne par le narrateur qui cite ses sources mais abrège comme le font les étudiants dans leurs notes : « Rac. » Et cette abréviation iconoclaste qui introduit le doute sur la prononciation de ce vocable incongru – faut-il prononcer [RAS] ou [RAK] ? – pervertit le modèle et le désacralise. Dans « Rac. » si on le prononce [RAK] n’y a-t-il pas le début de « racaille » ? En tout cas sans aller jusque là, on peut voir dans ce saccage du nom du grand auteur une rage iconoclaste dont les poètes surréalistes ont donné d’autres exemples : n’ont-ils pas procédé à l’enterrement d’Anatole France et au procès de Maurice Barrès ?
Pourtant l’ombre de Racine est plutôt tutélaire dans Les Aventures de Télémaque, même si elle est discrète. On découvre en effet l’écho indirect et plutôt sympathique de la figure d’Hippolyte dans la séquence où Télémaque , malheureux d’être poursuivi des assiduités de Calypso, erre dans un bois pour y devenir le voyeur d’une scène d’amour entre Mentor et Calypso elle-même qui a plusieurs cordes à son arc.
2. 2. Le Racine national du poète de la Résistance
Dès qu’Aragon pendant l’Occupation va se trouver confronté aux accusations de ceux – Drieu la Rochelle par exemple et la presse vichyste – qui lui reprochent son faux patriotisme qui ne serait en réalité qu’allégeance à Moscou depuis le pacte germano-soviétique, c’est à Racine, entre autres, qu’il va faire appel pour répondre. C’est ainsi que Racine apparaît dès les premières strophes qui évoquent la France dans le poème « Plus belle que les larmes », publié à Tunis sous la caution de l’Amiral Esteva et en réponse à Drieu. Celui-ci en effet avait répliqué à « La leçon de Ribérac », article paru dans la revue Fontaine de juin 1941 et repris dans Les Yeux d’Elsa (1942) où Aragon expliquait le sens national de sa référence aux chevaliers de Chrétien de Troyes dans le contexte de la guerre, par un article violent de dénonciation, l’article de L’Émancipation nationale déjà évoqué. Drieu écrivait notamment ceci qui a dû blesser Aragon au plus profond de lui-même : « Dans certaines revues littéraires où se sont réfugiés l’opposition politique au maréchal Pétain, et l’esprit de guerre à tout prix et n’importe comment, on voit quelques-uns de nos nouveaux patriotes des dernières années s’occuper à fourbir ces armes étrangères qui ont plus servi à découvrir la patrie qu’à la défendre. Par exemple les armes qui étincellent sur la petite enclume délicate d’Aragon. » Et après lui avoir reproché de prôner un étrange Moyen Âge dans la ligne de l’analyse marxiste et un Chrétien de Troyes « un tantinet communisant », après avoir bassement ironisé sur Gustave Cohen, Drieu attaque : « Aragon est resté le grand pasticheur qu’il a toujours été, le pervers pasticheur qui altère toutes les valeurs sur lesquelles il fait main basse et qui les transforme dans sa monnaie de singe, dans sa monnaie de russomane et de russophile, d’internationaliste impénitent pour qui les trémolos sur « mon pays » ne sont qu’un truc à l’usage des badauds littéraires. »
On comprend mieux le sens de « Plus belle que les larmes » qui s’ouvre sur une allusion presque explicite à l’ami d’autrefois :
J’empêche en respirant certaines gens de vivre
Je trouble leur sommeil d’on ne sait quel remords
Il paraît qu’en rimant je débouche les cuivres
Et que ça fait un bruit à réveiller les morts
[…]
Vous pouvez condamner un poète au silence
Et faire d’un oiseau du ciel un galérien
Mais pour lui refuser le droit d’aimer la France
Il vous faudrait savoir que vous n’y pouvez rien
Après cette apostrophe, le poème sera une longue litanie de la France dans ses artistes et ses régions à travers une comparaison traditionnelle, officielle, éculée même mais où le stéréotype – celui-là même de tous les monuments de la République – se trouve perverti et retourné du fait de la hardiesse presque surréaliste ou même baroque et toujours signifiante des diverses comparaisons. C’est ainsi que cette femme-France aussi exquise qu’un cadavre exquis a des cheveux de Champagne, un « gorgerin » de Bretagne, une épaule d’Ingres de Montauban et aux lèvres le sourire de l’ange de Reims. Racine, lui, apporte à cette étrange sculpture de femme les beaux bras blancs des statues ou mieux encore des comédiennes du Grand Siècle classique :
N’a-t-elle pas les bras que l’on voit aux statues
Au pays de la pierre où l’on fait le pain blond
Douce perfection par quoi se perpétue
L’ombre de Jean Racine à la Ferté-Milon
Au-delà de cet hommage à la douceur de l’Ile-de-France berceau de la nation et à la perfection classique de Racine, Aragon exaltera surtout l’art poétique du grand dramaturge de Louis XIV.
Mais avant de m’attacher aux leçons de versification qu’Aragon ira chercher chez Racine, grand artisan de la langue, je voudrais dissiper un malentendu et ouvrir une parenthèse. À voir Aragon exalter ainsi le terroir et le génie français, on pourrait le soupçonner de nationalisme et certains, notamment parmi ses anciens amis surréalistes comme Benjamin Péret, ne se sont pas gênés. Or Aragon lui-même répond par avance à cette accusation dans « La conjonction ET », article paru dans Les Cahiers du Rhône n° 5 de novembre 1942 (Éditions de La Baconnière, Neuchâtel). Dans le cadre d’un débat sur le génie français suscité par les Réflexions de Marcel Raymond, Albert Béguin, qui dirige la revue suisse et sera aussi l’éditeur clandestin parce qu’étranger des Yeux d’Elsa, demande à Aragon un article sur un des aspects de la tradition française qu’Aragon est en train d’explorer depuis Le Crève-cœur et avec Les Yeux d’Elsa, c’est-à-dire sur « l’esprit de courtoisie, tel qu’il nous vient du moyen âge ». Ce n’est pas exactement ce qu’il écrira mais plutôt une réflexion sur ce qui unit dans le « génie français » (d’où le titre significatif dans son anodine apparence grammaticale) et notamment sur l’unité des deux grandes traditions françaises (« Où prend-on qu’elles soient inconciliables ? ») : la chrétienne et la matérialiste. Et il se livre à une critique de ce qui divise, comme « ces joutes professorales récentes qui nous somment d’avoir à choisir, disons de Corneille ou de Racine… de Pascal ou de Montaigne (un Juif ! me fait observer quelqu’un, eh bien donc de Pascal ou du Juif Montaigne)… Non, la France, c’est Jeanne d’Arc et Diderot, c’est Corneille et Racine, Pascal et Montaigne : on pousserait très loin ce petit jeu, où seule est caractéristique la conjonction et, le plus français des mots du dictionnaire, parce qu’il est le mot qui exprime l’union. Comme impossible n’est pas français, et est français, m’entendra-t-on ? » Et cette conclusion est dans le droit fil de la réflexion critique sur la notion de « génie français » par quoi l’article débute :
Si définir le génie de la France, c’est diviser les Français, et ceci en 1942 précisément, c’est certainement que les dés sont pipés. On s’en doutait un peu. (Peut-être serait-il du génie de la France de montrer comment ils le sont.) Mais enfin trop de chemins glissants s’offrent à nous, et je m’assure que tout le monde conviendra qu’il ne saurait y avoir du génie de la France d’autre définition valable que celle qui, loin de désunir, unirait vraiment les Français, et précisément les Français de 1942. Mais je vous prie, quel pas cela fera-t-il faire à la question de dire que le France c’est Racine, ou que c’est Baudelaire, ou que c’est Péguy, ou que c’est… peu importe ? ou même l’esprit de finesse, ou le bon sens, ou la mesure, ou la démesure, l’imagination, la révolte ? Le débat sur le génie de la France n’est pas une guerre de religions, ou ne doit pas l’être. Et il ne manquera pas de tenants de cette idée que la France c’est avant tout le Christ, ni de cette autre que c’est la terre de l’incrédulité. Je crains que les plus séduisants systèmes soient ceux qui permettent de dresser les uns contre les autres les frères ennemis, et que l’énoncé de quelques vérités grossières détourne de celui qui s’y risquerait les esprits distingués, systématiques et subtils qui ont toujours fait grand tort à notre pays. […] La première des vérités très grossières dont je parlais est qu’il n’y a pas de France sans les Français. C’est une constatation qui manque d’originalité sans doute. Mais, en 1942, on ne le dirait pas. […] Pas un instant je ne voudrais voir limiter la France, oublier qu’elle est un corps vivant , un être en devenir. […] Qu’elle tire sans doute d’elle-même, d’un sol nécessairement limité, sa substance spirituelle, mais aussi qu’elle puise dans le monde entier des aliments qu’elle transforme. […] De telle sorte que si je voulais participer à ce travail qui tend à définir son génie, je dirais d’abord qu’il ne faut jamais oublier ce double aspect de ce génie : français et humain, au sens le plus haut de l’un et l’autre de ces mots. […] On voit bien quelles sont, en 1942 précisément, les difficultés de cette définition, qui demanderait qu’on se mît nombreux à l’œuvre pour rendre à la France son visage véritable, nullement idéalisé : merveilleux. Il ne suffirait pas pour cela de s’asseoir à sa table de travail avec une plume, de l’encre et du papier : les instruments de l’abstraction. Il y a des mauvaises herbes à arracher du jardin, et cela demande qu’on se mette, et tous, et tout de suite, à la tâche. Le génie français, cela se définit pratiquement : en le continuant, en le prolongeant. Non pas à coup d’étiquettes. Ah, je vous entends, dira-t-on : voilà que vous méprisez la tradition ! Moi ? quand je parle pour la découverte, cette grande tradition française ? Dès le premier pas, si on écoutait les gens, on s’arrêterait. Ou on serait arrêté. »
(Œuvre poétique, tome X, Livre Club Diderot, p. 38.)
Je ferme ici la parenthèse et reviens aux leçons de poésie qu’Aragon trouvera chez Racine qui sera une référence de prédilection dans tous ces textes théoriques de la période de l’Occupation où notre poète, revenu aux formes traditionnelles de la versification, s’interroge sur l’art des vers et sur son rapport aux règles. Se situant lui-même dans la lignée d’Apollinaire qui renouvela la règle classique de l’alternance des rimes féminines et masculines en donnant une autre définition plus phonétique de ces deux sortes de rimes devenues rimes consonantiques et rimes vocaliques, Aragon réfléchit sur le rapport de la poésie à la langue orale et aux chansons populaires et n’hésite pas à voir dans la liberté par rapport aux règles et même dans les «fautes de français» l’essence même de la poésie. Et c’est encore un vers de la Phèdre de Racine qui lui sert d’exemple dans sa démonstration, même si plus loin, comme on s’y attendait davantage, c’est à Hugo qu’il renvoie :
Mais de cette origine lointaine [la poésie latine], il n’est resté que des habitudes métriques, des règles mécaniquement appliquées. Pour leur redonner sens et vie, si j’ai cherché, m’appuyant sur l’expérience et le double précédent de la poésie populaire et d’Apollinaire particulièrement, à redéfinir les rimes masculines et féminines, ce n’était qu’un premier pas.
Il m’était apparu que non seulement l’art des vers est l’alchimie qui transforme en beautés les faiblesses dans le langage, mais aussi dans la métrique. Presque tous les poètes ont fait des vers admirables en transgressant les règles, parce qu’ils les transgressaient. Les règles ou la mode, cette autre forme des règles.
La fille de Minos et de Pasiphaé
est un vers qui fut fait au rebours de ce qu’on appelait alors un beau vers.
« Arma virumque cano », préface aux Yeux d’Elsa
La règle principale qu’Aragon va transgresser c’est celle de l’interdiction de la rime intérieure considérée à l’époque classique comme une faute et pourtant pratiquée par les poètes au mépris des règles. Et c’est encore l’exemple de Racine que donne Aragon : « Le frère de Junie abandonna la vie » ou « Il perd le sentiment, amis, le temps nous presse ; / Ménageons les moments que ce transport nous laisse » en ajoutant en note : « Ces exemples, et bien d’autres, sont condamnés par P.-M. Quitard (Traité de versification française) qui écrit : « L’oreille est trompée par l’intrusion de ces rimes illicites, qui lui font prendre deux grands vers pour quatre petits, et en rompent ainsi l’harmonie. » Et c’est précisément à prendre le chemin de l’illicite qu’Aragon s’attache au moment même où il renoue avec la versification traditionnelle, geste que les anciens surréalistes, et notamment Benjamin Péret dans le détestable Déshonneur des poètes, ne lui pardonneront pas. Car n’est-ce pas le goût de l’illicite que le pousse dans « La Nuit de Mai » à faire prendre au lecteur « deux grands vers pour quatre petits » et un quatrain d’alexandrins pour un faux quatrain où se cache un vrai huitain d’octosyllabes :
Ô revenants bleus de Vimy vingt ans après
Morts à demi Je suis le chemin d’aube hélice
Qui tourne autour de l’obélisque et je me risque
Où vous errez Malendormis Malenterrés
Benjamin Péret aurait dû y regarder de plus près. Il aurait vu alors que derrière le patriotisme d’Aragon sous l’Occupation, l’antipatriotisme du jeune poète dada qu’il était en 1918 n’était pas mort et que ce jeu avec l’illicite de la rime intérieure permettait de mettre à la rime « les revenants bleus de Vimy […] Malendormis Malenterrés » et de poursuivre la critique de la guerre dans ce qu’elle a d’impérialiste. Où l’on voit que l’illicite de la versification c’est déjà une pratique de la contrebande.
Car la pratique de la contrebande c’est peut-être l’innovation formelle la plus importante de la poésie d’Aragon pendant la Résistance. Et encore une fois on va voir quel discours subversif permet le détour par la poésie de Racine. Le premier exemple est celui d’Andromaque, le second celui de Mithridate.
Dans un poème à très forte densité intertextuelle (réécriture d’une romance espagnole et d’un poème de Valéry) des Yeux d’Elsa intitulé « Contre la poésie pure », Aragon va convoquer Racine, ici uni à Corneille, pour dire la France qui refuse l’asservissement et le poète qui est la voix de cette liberté. Reprenant une romance espagnole qui conte les amours malheureuses d’un rossignol, Aragon transforme le rossignol en aigle allemand amoureux d’une hirondelle rétive symbolisant la France. Et cet oiseau de France est à la fois comparé à Andromaque, parce que comme elle veuve et en exil, l’hirondelle ne veut pas accepter la soumission au vainqueur, et à Chimène parce que l’hirondelle qui se refuse à l’aigle, nouveau Cid guerrier est considérée par lui comme une « inhumaine inhumaine ». C’est ainsi que dans cet étrange poème presque merveilleux Aragon fait parler l’aigle allemand à la fontaine d’eau froide (la « fontfreda » de la romance espagnole) :
On n’y voit jamais la veuve rétive
L’aronde toute noire et son gorgerin clair
Andromaque du vent de soi-même captive
Ce doux refus ailé qui se déprend et prive
L’eau de son reflet d’air
D’un Cid oiseau chère et folle Chimène
Crains-tu de l’oublier dans l’eau froide à plaisir
Ce deuil aérien que partout tu promènes
Aronde que j’adore inhumaine inhumaine
Qui n’as pas voulu me choisir
Dans ce récit métaphorique, il est étonnant de voir ainsi l’aigle allemand, par le croisement des métaphores, comparé à Pyrrhus. L’hirondelle française a pour lui la même haine que l’Andromaque patriote de Racine, cette Troyenne qui se souvient de la nuit d’Apocalypse du sac de Troie : « Songe, songe, Céphise à cette nuit cruelle / Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle ». L’hirondelle de France « pleure tout un ciel de morts », et pas seulement un Hector – comme d’ailleurs l’Andromaque de Racine qui se lamentait aussi pour tout son peuple. Et ce sentiment national la pousse à refuser les avances de l’aigle à la fontaine aux oiseaux et à n’avoir pour tout désir que celui de la révolte et de l’insoumission. Elle lui répond :
Où qu’elle soit je troublerai l’eau pure
Si tu me tends le feu je souffle et je l’éteins
Si tu me tends ton cœur je le jette aux ordures
Ah que le jour me blesse ah que la nuit me dure
Jusqu’aux fantômes du matin
Car ce que propose l’aigle, ce sont les plaisirs de la collaboration (« Je ne crois pas à tes métamorphoses / Je ne veux de plaisir que ceux de mon malheur »), et la fontaine d’eau froide devient ainsi métaphore de la poésie, où le titre se trouve expliqué, en même temps que l’hirondelle se fait aussi métaphore du poète lui-même qui explique ainsi la fable à la fin « Doux mentir de tes eaux poésie ô miroir / Fable entre les roseaux les oiseaux y vont boire / Excepté l’oiseau noir et blanc ») :
Si l’oiseau blessé la source méprise
Cette aronde est mon cœur et qui la va chassant
Qu’il assure sa fronde et sache qu’il me vise
Pour avoir préférant la vie à la feintise
Préféré le sang à l’encens
Ce que le poète rejette ainsi face aux avances allemandes appelant les écrivains à la collaboration, c’est comme l’hirondelle Andromaque, la soumission de son chant aux pièges de l’occupant (on songe aux tentatives de séduction d’un Von Abetz vis-à-vis des écrivains français), au miroir aux alouettes de la poésie pure dont aurait pu s’accommoder un Valéry. « Préférant la vie à la feintise », l’oiseau poète, ivre de liberté, choisit « le sang » des combats de la Résistance contre « l’encens » des célébrations littéraires et des compromissions. On voit ainsi comment la référence à Racine permet l’affirmation d’un programme de résistance pour les poètes.
Le deuxième exemple est celui de Mithridate dans le poème « Nymphée » publié en juillet 1942 dans Confluences (et repris dans En français dans le texte en 1943, Neuchâtel, Ides et Calendes), tellement de contrebande que la censure a eu la puce à l’oreille et a fait interdire la revue lyonnaise de René Tavernier qui contenait le poème. J’ai là la lettre du censeur conservée dans les archives du Fonds Aragon-Elsa Triolet.
Aragon d’ailleurs explique ces faits dans « De l’exactitude historique en poésie », longue réflexion sur la poésie de contrebande en guise de préface à En étrange pays dans mon pays lui-même (Monaco, Édns du Rocher) qui réunit en 1945, deux recueils de la guerre, En français dans le texte de 1943 et Brocéliande de 1942 :
De même le poème Nymphée qui fit suspendre à Lyon, en août 1942 la revue Confluences, ne supporteraient pas l’examen de l’historien qui connaîtrait à fond le règne de Mithridate. Mais cette fois MM. Paul Marion et René Vincent, chargés pour l’Allemagne de maintenir la poésie dans les justes limites de la fantaisie, ne s’y trompèrent pas. C’est qu’ils avaient sous la main un dictionnaire mieux renseigné que le Petit Larousse illustré, où ils avaient dû découvrir que l’ancienne capitale du Royaume de Pont avait dans les temps modernes abandonné le nom de Nymphée qu’elle tenait de son fondateur, Ariobarzane, pour l’appellation, plus connue en 1942, de Kertch. […] Il existe une jolie lettre à ce sujet que, sous le numéro d’ordre 15.934, M. Marion adressa, le 24 août 1942, aux directeurs de revues de la zone dite libre et de l’Afrique du Nord, où il se plaint des « allusions aux événements politiques actuels », dans les poèmes, notamment :
« … Ces allusions, pour habiles qu’elles soient, si elles échappent aux censeurs locaux, n’en sont pas moins notées à Vichy.
« J’ai toujours eu le souci d’éviter en ce domaine des sanctions administratives analogues à celles prises quelquefois à l’égard des journaux quotidiens ou des grands hebdomadaires.
« Toutefois ces clins d’œil complices au lecteur averti tendant à se multiplier, je me vois dans l’obligation d’en limiter l’abus.
« C’est pourquoi je viens de suspendre pour deux mois la revue mensuelle Confluences qui, dans le numéro 12, a publié un poème de M. Aragon dont quelques vers relèvent de la tendance que je viens d’évoquer… »
Il m’a paru nécessaire de recopier ici ce texte qui est assurément l’un des plus curieux qu’ait produit la critique littéraire de ces dernières années. Et qui montre l’utilité de l’exactitude historique, d’une certaine exactitude historique, en poésie. Et qui touche à ce fameux mystère poétique dont un autre critique contemporain, M. Jean Paulhan, qui est de mes amis, dit en d’autres termes mais en substance qu’il est essentiellement mystérieux.
OP, tome X, p. 62.
Aragon ironise sur ces censeurs : « Et si l’on conviendra que Nymphée est plus pompeux, plus poétique au sens des familles que Kertch, on devra aussi avouer que MM. Marion et Vincent ayant l’oreille très sensible ont dû moins s’arrêter aux inexactitudes du poème concernant Mithridate et sa capitale, aux anachronismes […] qu’à des résonances contemporaines. » Et il est évident, si l’on sait que Kertch est cette ville de Crimée où l’armée rouge résiste à l’offensive allemande décidée par Hitler contre l’Asie soviétique par le Caucase en été 1942, que cette ville, autrefois appelée Nymphée jusque dans les didascalies de Racine, devient l’objet d’un investissement mythique, poétique et politique où se croisent de manière étonnante, Mithridate, la pièce la plus politique peut-être de Racine, et l’URSS. Que Racine soit ainsi la voie d’accès à l’Union soviétique, n’est-ce pas le meilleur exemple de ce qu’Aragon explique dans « La conjonction ET » ? Ce qui donne sens à cette conjonction de la « tradition chrétienne » et de la « tradition matérialiste » qui font toutes deux « le génie de la France ». Ainsi le poète commence à rêver à partir de Racine :
C’est par désœuvrement que j’ai pris Mithridate
J’y lisais sans trop suivre un vers de temps en temps
À quoi pensais-je donc quand vous vous accordâtes
Longs rêves de mon cœur à ces mots palpitants
Et sa rêverie le conduit du côté de la Crimée et de l’Oural (les monts Riphée de l’Antiquité évoqués à la strophe 25) par un rapprochement spatial au-delà du temps que seule permet la poésie : la ville où se déroule le drame historique de Mithridate raconté par Plutarque est aussi celle où se battent les soldats soviétiques explicitement évoqués dans les huit dernières strophes (strophes 22 à 29) avec la justification suivante du poète :
Le crime de rêver je consens qu’on l’instaure
Si je rêve c’est bien de ce qu’on m’interdit
Je plaiderai coupable Il me plaît d’avoir tort
Aux yeux de la raison le rêve est un bandit
La rêverie d’Aragon sur Racine est d’une rare richesse, parce qu’elle est multiforme, à la fois historique et humaine, mêlant tragédie et quotidien, et renvoyant aussi bien à la jeunesse surréaliste par son apologie du rêve comme instrument de connaissance du réel qu’à la vieillesse du poète à travers l’image du vieux roi amoureux, encore capable de souffrir pour une jeune femme que lui disputent ses deux fils. Cette polysémie de la rêverie sur Mithridate se manifeste sur trois points :
– la méditation politique sur la guerre qui débouche sur l’image d’un Racine national
– la réflexion sur le rôle des mythes et des tragédies dans l’écriture de contrebande
– la rêverie sur le vieillard amoureux.
Sans entrer dans le détail de ces trois points, je ferai seulement quelques remarques.
Tout d’abord qu’Aragon, occultant le caractère ambigu de la pièce avec sa happy end de pardon si bien relevée à la fois par Roland Barthes qui parle de « mauvaise foi » dans son Sur Racine que par Lucien Goldmann qui dans Le Dieu caché va jusqu’à parler de « l’oblation postiche » du vieux roi, insiste davantage, en ces temps difficiles de la Résistance, sur la magnanimité toute cornélienne de Racine. Le geste du vieux roi qui à la fin pardonne à ses fils pourtant coupables de tentative de parricide pour l’un (Pharnace) et presque d’inceste pour l’autre (Xipharès) et donne Monime à Xipharès, fait de lui un héros qui témoigne de la grandeur nationale, c’est-à-dire humaine de Racine, pour reprendre l’équation d’Aragon dans « La conjonction ET » :
Cet univers mal fait quel dieu le redessine
Mithridate Eupator ici trouve sa fin
Mais Plutarque cruel auprès de Jean Racine
Nous ne le lisons plus pour apaiser nos faims
Et le poète donne aux amours de Monime
Le dénouement qu’exige une France exaltée
Quand il dément l’Histoire et la fait magnanime
Sa morale triomphe avec l’humanité
Et si Aragon préfère au récit « cruel » de Plutarque (celui de l’histoire réelle) la fable de Racine qui réécrit l’historien, c’est parce qu’il trouve en 1942 dans ce haut idéal de la « France exaltée » du Grand Siècle un aliment pour « apaiser ses faims », c’est-à-dire un espoir pour la présent. Ce Racine national qui dément l’histoire met la magnanimité et la justice à la place de la barbarie. De même la Kertch soviétique de la dernière strophe du poème devient l’écho de la Nymphée française du siècle de Louis XIV, comme un autre moment de l’humanité :
Nymphée où je respire un air de la justice
Nymphée une statue au ciel levant le doigt
Nymphée où Dieu s’effrite au fronton des bâtisses
Nymphée où l’homme sait enfin ce qu’il se doit
Ce que la censure refuse donc bien c’est de laisser Aragon annexer le Mithridate de Racine pour dire l’espoir qui vient de la Crimée où règne la justice. De même que Drieu refusait de voir Aragon annexer Chrétien de Troyes pour dire les modernes chevaliers rouges qui regardent du côté de Moscou. En somme ce que cherche Aragon c’est arracher le patrimoine national à Vichy, arracher Racine à Drieu. Et on verra avec Aurélien combien sa Bérénice avec son nom de princesse juive revendiqué par le narrateur s’oppose à l’antisémitisme de Barrès dans Le Jardin de Bérénice.
« Qu’est-ce qui me retient sur les quais de Nymphée » s’interroge le poète en imaginant « le port où le monarque meurt » sous l’effet du poison donné par son fils. C’est donc bien une rêverie sur l’histoire et sur la guerre sensible aussi dans la réécriture du drame de Mithridate à la lumière de la réalité de l’Occupation. Ainsi le triomphe des Romains appelés par le traître Pharnace dans la pièce de Racine est lu comme la victoire des Allemands occupant la France et violant l’intimité de chacun avec la complicité des collaborateurs. Il imagine Pharnace au bord de la mer regardant les Romains aborder et déchiffrant sur le sable de la crique la « piste des trahisons rides ineffaçables » :
Lui qui désespérait déjà de leurs galères
Enfin les voici donc ces vainqueurs qu’il aida
Ils ont mis à venir la lenteur de l’éclair
Leur triomphe est le sien sur ses propres soldats
Et sa rêverie se prolonge sur le malheur de la ville occupée et l’humiliation devant le rire des vainqueurs qui sont à la fois ceux de l’Antiquité et du présent :
Affreuse nudité de l’homme dans l’orage
La catastrophe arrive alors qu’il somnolait
Ou que sans se presser il rentrait le fourrage
Et sur le feu la femme oublie alors le lait
Lorsqu’un peuple s’enfuit devant l’envahisseur
Il laisse sur ses pas les ruines de sa vie
Une salle de bal à l’aube sans danseurs
La table du repas qu’on n’a pas desservie
[…]
Ils riront en voyant les portraits de famille
Les bibelots sans charme aux yeux indifférents […]
Ils riront sans comprendre Ils sont les conquérants
Celui qui s’assiéra dans le fauteuil-bascule
Avec ses yeux d’ailleurs en juge à sa façon
Les souvenirs d’autrui sont toujours ridicules
Mais ce qui retient Aragon sur les quais de Nymphée et au cœur du texte de Racine (« Et je ferme Racine et je rêve à mon gré ») c’est une réflexion sur l’écriture en temps de guerre et de censure et le rôle des fables anciennes, mythes et tragédies, comme le rôle du merveilleux et du rêve pour dire ce « temps misanthrope ». C’est ainsi que dans cette méditation sur la poésie se croisent à la fois l’exactitude historique et le merveilleux ou le rêve, ou mieux encore le rêve et l’inexactitude historique pour dire le vrai. On aura remarqué les nombreux anachronismes de ce « Mithridate-1942 » avec la ciguë bue par le monarque « qui a le goût du café », la femme du peuple qui laisse fuir le lait sur le gaz ou encore ce rocking-chair dans une maison qui suscite l’étonnement d’un occupant romain… Mais outre qu’ils permettent de désacraliser la référence classique (les colonnes du décor ou « Ce portique de pierre à toute tragédie ») en unissant la tragédie et le quotidien, ils permettent aussi d’actualiser ce drame ancien et d’unir la tragédie et le monde.
Par la magie des lieux, Nymphée devient le symbole de la poésie elle-même, et d’une poésie qui n’hésite pas quand elle est bâillonnée de recourir au chant d’un autre continué comme un long écho prolongé :
Rien ne peut altérer la chanson que je chante
Même si quelqu’un d’autre avait à la chanter
Une plainte étranglée en renaît plus touchante
Quand l’écho la reprend avec fidélité
[…]
Je parle avec les mots des jours patibulaires
Où la maître bâtit le temple qu’il lui plaît
Et baptise raison dans son vocabulaire
Le loisir d’à nos poings passer cabriolet
Il faudrait rendre sens aux mots blasphématoires
Refaire un cœur saignant à ceux qui n’en ont plus
Ceux qui ne pleurent pas pour une belle histoire
Méritent-ils le ciel qui leur est dévolu
Il faudrait avoir le temps de s’attarder sur la troisième leçon de cette relecture de Racine par Aragon et notamment la manière dont il fait de Mithridate, vieil homme amoureux, un personnage positif qui l’attendrit (« Ô vieux roi malheureux contre qui tout conspire », « Plus que de son poignard il meurt d’aimer encore »), mais je ne l’ai pas et vous renvoie seulement à la lecture de ce poème par le comédien.
3. « RACINE MON FRERE » : DIALOGUE ENTRE PAIRS
Il me reste à évoquer le Racine du dialogue intertextuel qu’Aragon entretient avec lui dans les romans, et notamment ceux de la dernière période qui s’inaugure paradoxalement, comme Aragon le dit lui-même dans les Entretiens avec Dominique Arban, par Aurélien (1944), ce roman écrit pendant la guerre et contemporain de « Nymphée » avec qui il présente des échos évidents.
C’est ainsi que le roman de Bérénice et Aurélien s’ouvre sur ce vers d’Antiochus dans la Bérénice de Racine : « Je demeurai longtemps errant dans Césarée » où la ville défaite de cet Orient désert n’est pas sans évoquer Kertch dans la Crimée occupée de 1941 et toutes les images de la défaite et de la guerre.
Ce que raconte le roman d’Aragon comme la pièce de Racine que d’une certaine façon il réécrit, c’est l’histoire d’un couple qui n’arrive pas à se constituer : de même que Titus laissera repartir Bérénice dans l’Orient désert, de même la petite provinciale mariée à un pharmacien repartira dans sa province et son amour pour Aurélien sera comme pour lui la romance de toute sa vie. Cette femme, à la fois si banale, si simple dans sa banalité et si compliquée par son goût de l’absolu qui lui fait avoir peur de l’amour, est comme la Bérénice de Racine une femme aimée de deux hommes (Aurélien et le poète Paul Denis) et sera comme la Bérénice de Racine l’emblème même de la femme présente-absente (« Il vient de sentir son absence »), de la femme interdite, inaccessible.
Ce n’est donc pas un hasard si à la fin du roman, un jeune écrivain américain, Archie Murphy, alias Malcom Cowley ami d’Aragon à l’époque surréaliste qui est celle du roman, explique à Bérénice dont il devient l’ami à Giverny : « Vous êtes un drôle de peuple, vous autres Français… C’est pour cela que nous avons tant de peine à comprendre Jean Racine. Ses femmes… Elles nous attirent, et elles nous font peur… comme vous. » Et ce n’est pas non plus un hasard si Aurélien à l’incipit du roman, par une rêverie sur Racine semblable à celle du poète dans « Nymphée » ou à celle d’Anatole de Monzie dans Les Communistes, est assimilé à Antiochus plutôt qu’à Titus :
En général, les vers, lui… Mais celui-ci revenait et revenait. Pourquoi ? c’est ce qu’il ne s’expliquait pas. Tout à fait indépendamment de l’histoire de Bérénice… l’autre, la vraie… D’ailleurs il ne se rappelait que dans ses grandes lignes cette romance, cette scie. Brune alors, la Bérénice de la tragédie. Césarée, c’est du côté d’Antioche, de Beyrouth. Territoire sous mandat. Assez moricaude même, des bracelets en veux-tu en voilà, et des tas de chichis, de voiles. Césarée… un beau nom pour une ville. Ou pour une femme. Un beau nom en tout cas. Césarée… Je demeurai longtemps… je deviens gâteux. Impossible de se souvenir : comment s’appelait-il, le type qui disait ça, une espèce de grand bougre ravagé, mélancolique, flemmard, avec des yeux de charbon, la malaria… qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fût sur le point de se mettre en ménage, à Rome, avec un bellâtre potelé, ayant l’air d’un marchand de tissus qui fait l’article, à la manière dont il portait la toge. Tite. Sans rire. Tite.
Je demeurai longtemps errant dans Césarée…
ça devait être une ville aux voies larges, très vide et silencieuse. Une ville frappée d’un malheur. Quelque chose comme une défaite. Désertée. Une ville pour les hommes de trente ans qui n’ont plus de cœur à rien. Une ville de pierre à parcourir la nuit sans croire à l’aube. Aurélien voyait des chiens s’enfuir derrière des colonnes, surpris à dépecer une charogne. Des épées abandonnées, des armures. Les restes d’un combat sans honneur.
Aurélien (Folio, p. 28.)
Et lorsque Aurélien médite douloureusement après son rendez-vous manqué avec Bérénice, le gâchis de la Saint-Sylvestre et l’échec annoncé de son amour, c’est encore ce vers d’Antiochus qui revient comme une scie, mais aussi comme l’emblème même d’une vie gâchée :
… Je demeurai longtemps…
Le temps à certains jours de notre vie cesse d’être une trame, d’être le mode inconscient de notre vie. D’abord il commence d’apparaître, de transparaître dans nous comme un filigrane, une marque profonde, une obsession bientôt. Il cesse de fuir quand il devient sensible. L’homme qui cherche à détourner sa pensée d’une douleur la retrouve dans la hantise du temps, détachée de son objet primitif, et c’est le temps qui est douloureux, le temps même. Il ne passe plus. On ne songerait même pas à l’occuper, toute occupation paraît dérisoire. Un désespoir vous prend à l’idée de cette étendue devant vous : non pas la vie, inimaginable, mais le temps, le temps immédiat, les deux heures à venir par exemple. Cette douleur ressemble plus à celle des rages dentaires, qu’on ne peut croire qui cesse, qu’à n’importe quoi. On est là, à se retourner, à ne plus savoir que faire, comment disposer d’un corps, d’un délire, d’une mémoire implacable, desquels on éprouve vainement être la proie.
Aurélien (Folio, p. 380.)
Et c’est encore sur une douleur de cet ordre-là que revient Aragon dans Théâtre/Roman en recourant cette fois-ci à l’intertexte de Britannicus. En choisissant un personnage d’acteur qui s’apprête à jouer le rôle de Néron dans Britannicus (« Cet homme de l’enfer qu’enfin je le devienne / Comment lire dans lui sa profonde fureur / Cette couleur en moi qui monte Ce fumet / De sacrilège ») Aragon retrouve la douleur du temps, du temps historique et de l’engagement : la douleur de se penser comme monstre. En se référant à cette tragédie d’avant la pacification janséniste pour dire le doute sur soi, le vieil Aragon fait retour au tragique de l’histoire et de l’individu dans l’histoire. En se pensant comme monstre et comme noyé l’auteur, par le biais de la métaphore de l’acteur, reconnaît son néant et sa faute, dans un moment de bilan extrême, de sincérité absolue, qui est aussi le moment où l’on peut inventer du neuf : « Seul l’homme à ce moment de sa perdition peut exprimer aux dépens de tout ce qu’il aurait pu dire d’autre, l’essentiel de ce qu’il fut, qu’il est, qu’il ne sera jamais, mais pourrait être… au bout du compte CE QU’IL NE SAIT PAS. » (OP, tome 41, p. 198.)
C’est grâce au personnage de Racine donc qu’Aragon passe aux aveux. Avec un aveu de cette taille (la reconnaissance de la part du mal en soi et dans le réel), on voit comment Aragon fait retour sur le tragique de l’histoire et comment cette réécriture de Racine donne un sens neuf au tragique racinien : ce n’est plus la tragédie d’une conscience janséniste face au dieu caché de Port-Royal, mais la tragédie de l’engagement où le communisme a pris la place du dieu caché. On comprend alors que l’Andromaque des Poètes ait pu signifier, dans cette époque des réévaluations qu’est la dernière carrière d’Aragon, non seulement l’exil mais aussi toutes les tragédies du XXe siècle, y compris et surtout peut-être celle de l’engagement.
Comme le premier Racine, Aragon engagé trouve dans l’histoire un dépassement du tragique et à la tragédie préfère le monde, qu’il faut pouvoir dire avec sa vérité dans la poésie. Et il est significatif que la citation de Mithridate, « la pièce de l’espoir historique » selon Lucien Goldmann, déjà analysée dans « Nymphée » se trouve presque à l’identique dans Les Communistes même, ou plutôt surtout, parce qu’elle émane d’un autre que l’auteur, d’un personnage historique réel, l’homme politique de la bourgeoisie, Anatole de Monzie qui a beaucoup œuvré pour le rapprochement de la France et de l’URSS en mai-juin 1940 en facilitant l’intervention à Moscou de Pierre Cot comme représentant officiel de la France. Ceci nous renvoie à la scène de la fin des Communistes après la capitulation des Belges où de Monzie médite comme le poète de « Nymphée » :
Difficile de s’endormir des soirs comme celui-là. Il a pris dans sa bibliothèque un petit Racine pour se changer les idées. Un très joli petit Racine en maroquin sombre. […] Et voilà qu’il lit, au hasard tombé sur cette page : (suit une citation de la même scène de la trahison de Pharnace appelant les Romains, Mithridate, Acte IV, scène 6) … Comme dans le songe tout est folie, tout dans l’insomnie prend sens, s’organise, se prolonge sur un monde inconnu du grand jour. […] Ô nuit, nuit innombrable ! Dérision des choses humaines. Tout n’est que moquerie, feinte, miroir, illusion…
(ORC, tome 26, p. 164.)
Mais à la fin de sa vie Aragon va douter de cet optimisme révolutionnaire – doute déjà présent dans cette citation des Communistes même – et c’est encore par la parole de Racine qu’il pourra faire cet aveu.
Pour finir je voudrais rêver, à la suite de Lionel Follet dans sa remarquable étude sur Aurélien à laquelle je renvoie , sur les villes de Racine dans l’œuvre d’Aragon et leur lien avec la guerre et le tragique. Et j’aurais pu partir de là pour structurer plus poétiquement cette conférence – mais toujours la pédagogie indécrottable impose sa loi – et j’aurais alors trouvé sur le chemin, Césarée, la ville-défaite, Nymphée la ville de l’espoir, Andromaque-les-Bains, la ville symbole de l’exil et de toutes les tragédies… Dans ces villes comme dans les pièces de Racine il y a des colonnes antiques, des portiques de pierre ou de carton, des statues et des mendiants aux pieds de ces statues comme chez Hugo où les statues se mettent à marcher et parlent ainsi que le montrent Les Quatre Vents de l’esprit. Rêvons un peu sur ces mendiants : figures tragiques de ce pays endormi, méhaigné qu’est la Césarée d’Antiochus ou la France, ils disent « le réel déréalisé de l’Occupation » (Lionel Follet) à quoi s’oppose le chant de Bérénice (« trouver ce qui chante en elle »,« trouver le cœur du chant ») comme celui de Racine ; mais figures burlesques que Les Poètes et Théâtre/Roman multiplient à l’envi, ils désignent aussi le poète face à ses poètes de prédilection , ceux qu’il sollicite sans cesse comme Racine. Je vous laisse rêver sur cette image, Aragon en mendiant aux pieds de la statue de Racine.