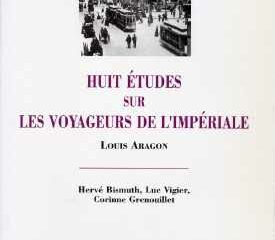Individu et communauté dans Les Voyageurs de l’impériale: le cas Mercadier

Reynald Lahanque (Université de Nancy II) [décembre 2001]
INDIVIDU ET COMMUNAUTE dans Les Voyageurs de l’impériale (Le cas Mercadier)
On sait qu’Aragon a, dans la préface de 1965, placé son roman sous le signe de la « liquidation de l’individualisme », de « la condamnation de l’individualisme par l’exemple », Pierre Mercadier étant désigné comme « le dernier individualiste ». Cette clé de lecture, qui n’a pas manqué d’être très utilisée ces temps-ci, est à la fois éclairante et réductrice ; elle renvoie à un enjeu très important du roman, mais moins simple qu’il n’y paraît.
Qu’en est-il de l’usage du terme dans le roman lui-même? Il apparaît trois fois, non pas isolément, mais à chaque fois dans l’expression « individualisme forcené »:
l’expression est d’abord prêtée par le narrateur à Blanche Pailleron à propos de Pierre: elle se met à aimer « ce qu’elle croyait voir en lui de destructeur, de négateur […] L’individualisme forcené. Jusqu’à ce refus de la politique, un principe chez Mercadier, un avantage sur Pailleron »(I-XXVII).
elle est ensuite utilisée par Pierre lui-même à propos de Blaise, dans une conversation où il lui dit sa « secrète estime » pour son courage: « cette décision de rupture, jadis[…] une liberté…enfin un individualisme forcené… »(I-LV).
elle est proférée, à la conclusion du roman, comme la pire des accusations, à travers Pascal, qui se trouve « jeté dans la guerre, comme tout un peuple », par la faute de cet « individualisme forcené »qui « résume à ses yeux » son père, et toute la génération des pères, « avec leur aveuglement, leur superbe dédain de la politique » (II-L).
La question est pour nous de savoir si le personnage de Mercadier peut être efficacement résumé par la notion d’individualisme, et plus exactement par ce syntagme : individualisme forcené, « forcené », c’est-à-dire excessif, acharné, sinon délirant. Que serait d’ailleurs, a contrario, un individualisme raisonnable? La réponse pourrait se situer précisément du côté de l’articulation suggérée par ce triple emploi de l’expression. Articulation entre le plan amoureux (avec Blanche admirative du négateur qu’elle voit en Pierre), le plan social (avec Pierre admiratif du bohème Blaise), le plan familial (avec la rancœur du fils victime d’un père irresponsable), plan familial lui-même articulé avec le plan national (puisque la grande victime, c’est la France elle-même). Ce dispositif, qui semble autoriser la dénonciation finale de « tous les Pierre Mercadier », renverrait donc à la façon dont le romancier a construit son personnage, en superposant des plans par eux-mêmes distincts, en amalgamant des attributs hétérogènes, mais dont la conjonction aboutit à cette monstruosité, cette « horreur », comme dirait Paulette : l’individualisme forcené.
En d’autres termes, le caractère forcené de cet individualisme viendrait de ce que ses composantes sont multiples et qu’elles font système : leur articulation formerait la logique profonde du personnage. »Individualisme » serait à prendre en ce sens radical : l’individu considéré comme valeur absolue, comme source et objet uniques de valeur, et donc comme négation de toute forme de dépendance envers un autre individu ou envers une entité sociale ; l’individu comme antithèse de tout ce qui fait lien, de ce qui constitue ou réclame une solidarité, de ce qui engage et oblige ; l’individu comme refus de toute responsabilité, comme contestation des valeurs, par essence collectives, qui permettent de vivre ensemble, qui régissent une communauté en instituant des liens, que cette communauté et ces liens soient d’ordre amical, amoureux, familial, social, ou national. Pierre Mercadier incarnerait la négation systématique de toutes ces formes de liens, d’attaches et d’attachements, la négation de toute communauté, et, par voie de conséquence, le risque encouru de la séparation, de l’émiettement, de la débâcle. Pour le vérifier, nous traiterons successivement de la construction du personnage, du « vertige de désagrégation » qu’il incarne et qu’il théorise, et enfin des cruelles défaites du voyageur. Nous verrons ainsi que Mercadier ne fait pas que s’abstenir de la politique, que son mal vient de plus loin, et qu’il est sans remède.
I- La construction du personnage
Faisons d’abord le tour des données initiales qui composent son portrait, dont beaucoup sont fournies dans le deuxième chapitre. Ses ascendants ? « A vrai dire, ce n’est déjà plus une famille. Ils se sont démembrés et disputés pour des lopins de terre » : ainsi, pas de communauté originaire où prendre place, pas de filiation assurée, mais une première dislocation, des querelles, un démembrement. Son métier ? « Une erreur d’aiguillage », erreur en partie imputable à une mère trop aimante qui l’a poussé vers le refuge du professorat, du fonctionnarisme : la sécurité au cas où les rentes fondraient. Mais lui-même a cru « à sa calme destinée », par peur d’affronter le monde réel : « Il redoutait les aléas de l’avenir du monde. Il avait traversé des bouleversements, il savait au fond la fragilité de l’édifice social »(il a quinze ans au moment de la défaite de 1871, de l’annexion de l’Alsace-Lorraine par le vainqueur allemand, et de la Commune de Paris). La dislocation menace donc aussi la société et la communauté nationale, aux yeux d’un jeune homme qui a, en outre, perdu son père (dans un accident de chemin de fer, funeste symbole du progrès), puis son beau-père, tué par un obus allemand (funeste instrument du démembrement national). L’insécurité fait rechercher des refuges, celui du professorat, mais aussi celui de la musique ou de la peinture.
Et celui du mariage ? Pour les deux mères, toutes les deux veuves, assurément, le mariage est une valeur-refuge et il est une bonne affaire (une particule contre de l’argent), ce dont Paulette elle-même s’avise, d’autant que Pierre vient compenser la « disparition du seul mâle de sa famille », c’est-à-dire de Blaise, ce frère aîné qui a abandonné les siens et qui incarnera à jamais « toute la lâcheté masculine, le lâchage des siens, la fuite devant les responsabilités du chef de famille » : en épousant Pierre, Paulette a eu le nez creux, c’est le moins qu’on puisse dire ! Quant à Pierre, la chose se présentait différemment car il avait accueilli le mariage comme « une libération, un changement total dans sa vie », étant « par tempérament tout enclin à ce genre de rupture avec son propre passé ». Affaire de tempérament, écrit Aragon, et aussi d' »esprit critique » (envers le milieu de sa jeunesse et le monde des artistes qu’il a un temps fréquenté), à quoi s’ajoutait un rêve d’idylle (en se mariant, « il prenait un billet pour un pays lointain »). Ces trois qualifications du personnage ont présidé à son mariage, vécu comme une première rupture : comment pourraient-elles ne pas présider à la seconde rupture, celle des liens mêmes du mariage et de la famille?
Et le lien amoureux, qu’en est-il ? Il est d’emblée fort ténu, l' »absurde orgueil du mâle » répondant à la sottise et au conformisme de l’épouse, si bien que « mariés sous le régime de la communauté », ils forment très vite le contraire d’une communauté élective. Pour Paulette s’établit même « une absolue discrimination du mien et du tien entre elle et Pierre » : on ne saurait mieux dire qu’ils n’ont bientôt plus rien en commun, ce qui fait que s’installe entre eux « l’horreur banale de toutes les familles de leur monde », « l’enfer quotidien ». Oui, Pierre vit en enfer, le mécompte est pour lui total, la « maldonne » avérée, dès le seuil du roman, si bien que la question se pose de savoir quelles solutions le romancier peut offrir à un personnage ainsi conçu. Il semble en avoir envisagé deux, et deux seulement : ou bien la rupture, le salut dans la fuite, »le lâchage des siens »; ou bien la tricherie avec les rôles sociaux, le désengagement larvé, l’abstention. On sait que Pierre va d’abord épuiser toutes les ressources de cette comédie des apparences, de cette tricherie quotidienne, avant de se décider à rompre tous ses liens. Il va jouer au « mari modèle », en se réfugiant dans le fonctionnarisme « aussi bien devant la vie, que devant sa femme »; il joue d’abord la sécurité, alors qu’il était « bâti comme pas mal des siens pour une aventureuse destinée »; il refuse le combat et croit trouver la tranquillité dans une « existence en veilleuse ». En d’autres termes, il semble n’avoir de choix qu’entre deux formes de lâcheté : la lâcheté ordinaire de qui joue le jeu social sans s’y impliquer, comme à distance, sans y croire, c’est-à-dire en faisant en sorte que ses liens soient les plus lâches possibles ; ou la lâcheté du lâcheur, de celui qui a ce courage paradoxal de rompre un jour brutalement d’avec les siens, le courage de la trahison. Qui plus est, le romancier le condamne à passer de la première forme de lâcheté à la seconde, en posant dès le chapitre II qu’avec celle-là Pierre a fait un « mauvais calcul », qui libère une « insatisfaction grandissante ». Il aura cru pouvoir « biaiser », en pratiquant « une sorte de restriction mentale », et ceci sur tous les plans : ce mauvais calcul, en effet, « il le pratiquait dans son ménage. Il le pratiquait en politique ». Ayant très mal spéculé, et beaucoup perdu, il lui restera à miser sur un individualisme plus radical. Mais retenons que Pierre est désigné ici comme porteur d’une unique attitude, sur le plan privé et sur le plan public : voici qui déjà le « résume », et qui décidément l’enferme dans une alternative bloquée.
Une dernière donnée achève de placer le personnage dans cette situation sans issue : Pierre perd coup sur coup sa mère et sa fille, « l’avenir comme le passé », écrit Aragon(I-V). De ce passé (du monde de la mère), »il s’était mal et difficilement détaché », tandis qu’à cet avenir il avait eu à peine le temps de s’attacher, alors même que la naissance de la petite avait été « le premier miracle de sa vie, le premier étonnement » : « il avait un peu cru à une sorte de devoir accompli, donner la vie… » Il avait donc joué le jeu, en perpétuant le lien des générations, en contribuant à cette permanence essentielle, même si sa foi était modérée. Et comme le lui dit Meyer, avec plus de conviction, « c’est un but dans la vie…des enfants » (I-X). Le fait est qu’avec la mort de la petite, le père demeure « désemparé, ayant perdu le sens même de sa vie, de la vie ». Le mal est fait, la conséquence est extrême, et de cette mort ne va pas renaître la vie, en dépit de la naissance de Jeanne, le troisième enfant, puisque celle-ci consacre la « séparation définitive » des parents, la dissolution du couple sous les apparences sauvegardées. Aragon prive donc son personnage de ce double lien fondamental, celui sur lequel repose, comme il l’explique lui-même dans un discours de 1937, « la continuité du passé vers l’avenir », et dont la prise de conscience est le préalable à l’intérêt que peuvent porter les individus aux affaires de la cité. Que peut être le destin de Pierre Mercadier dans ces conditions ?
II- Le vertige de désagrégation
Pierre et Paulette deviennent rapidement des étrangers l’un pour l’autre, et pareillement Pascal pour son père, qui laisse peu à peu ses liens se défaire, ou qui s’abstient d’en nouer de nouveaux avec ses semblables ; son indifférence à la politique est régulièrement rappelée. Ne partageant rien, échappant à toute communauté, il s’écarte du domaine des valeurs et des raisons d’exister : « j’ai toujours été en dehors, à côté de ce que les autres appellent la vie », confiera-t-il plus tard à Meyer (II-XVIII). Il cède à une « disposition mélancolique » qui va s’aggravant, et doute d’avoir jamais espéré quelque chose de l’existence ; dans son étude sur John Law, il professe un pessimisme radical : il n’y a pas de but à l’activité terrestre de l’homme, « le seul sens de la vie est le désordre »(I-XIV) ; ce qu’on appelle « l’ordre », naturel ou humain, est ou une illusion ou une absurdité en regard du « vertige de désagrégation qu’il y a dans le monde »(I-XXV) : ce que Pierre a en vue, c’est l’entropie universelle, ou, pour parler comme Werther, « la force dévorante cachée au sein de la nature »,ou encore, dans le langage que Flaubert prête à Frédéric Moreau, « l’éternelle misère de tout ». Il convient donc de ne nourrir aucune foi, aucune croyance, aucune espérance, ce qui ne peut manquer de dresser contre vous, si vous prétendez être un biographe ou un historien rigoureux, et non un « charlatan de la destinée humaine », non seulement vos confrères, mais aussi : « les hommes politiques, les prêtres des diverses religions en usage, les écrivains, les âmes sensibles, et en général les hommes de devoir » (I-XIV). L’énumération n’est pas de hasard, elle désigne des catégories d’hommes qui, à divers titres, concourent à l’institution de la société, qui introduisent ou maintiennent de l’ordre et du lien, en rassemblant les individus autour de croyances ou de valeurs communes, en les rappelant à leurs responsabilités. Si l’on ajoute que Mercadier salue en John Law un « génial introducteur de désordre », on mesure la portée négatrice de son propos.
Mais plus encore, on commence à vérifier que son indifférence à la politique n’est que l’un des symptômes de son hostilité déclarée envers ce que l’on peut appeler le politique, c’est-à-dire la façon dont les hommes organisent leur existence collective, dont ils donnent corps à ce principe majeur de l’institution des sociétés (j’emprunte la formule à Régis Debray) : « l’échange d’une sécurité contre une dépendance ». Résister aux puissances de dissolution, endiguer l’entropie sociale, contenir les risques de désagrégation, voici qui suppose d’entrer dans des réseaux, de nouer des liens, de compromettre son indépendance. Pour s’intéresser à la politique, il faut commencer par ne pas dénier son appartenance à la communauté humaine et ce qu’elle implique d’adhésion minimale à des valeurs, à des rites, à des symboles ; il faut accepter de parler le langage de la tribu. Or, avant même sa fuite vers Venise, Pierre aura vécu seul, « seul comme personne au milieu du monde. Sans amis, sans but. A la façon d’un explorateur tombé chez des sauvages dont il ne parle pas la langue, bien qu’il en copiât fidèlement les rites observés » (Venise-I).
Il y a donc bien un ferment puissant de dissolution et de négation dans l’attitude de Pierre Mercadier, et dans le discours qu’il élabore. C’est ce qui donne une signification toute particulière à son « esprit critique », dont on souligne souvent l’intérêt qu’il revêt sur le plan du réalisme romanesque (voir, par exemple les études de D.Bougnoux, de S.Ravis, ou de H.Bismuth). Une lucidité certaine est prêtée au personnage, qui lui permet de dénoncer les mensonges étouffants de la vie sociale, de l’amitié ou de l’amour. On relève aussi la coloration marxisante de son analyse : « Il n’y a pas de sentiments, il n’y a que l’argent […] Cela se présente sous les dehors idéaux du devoir, de la responsabilité, de l’affection, des liens du sang, de l’amour »(I-LI), alors qu’il n’y a rien d’autre ici qu’un « voile de sentimentalité », écrivait Marx, dissimulant de plus en plus mal de « simples rapports d’argent ». Toutefois, la lucidité critique est chez Mercadier aveuglée par l’exaspération, elle est emportée dans ce « vertige de désagrégation » qui ne laisse rien subsister, qui n’autorise aucun effort de compréhension, aucune sympathie envers autrui, aucun partage, serait-il amoureux, et, évidemment, aucun espoir d’une société mieux faite (dont Marx, quant à lui, et Aragon de même, envisageaient la réalisation future), une société où les sentiments ne seraient plus « les billets de banque des rapports humains ». Tout attachement est une imposture et la société un piège définitif : « Tu as donné la vie, tu es prisonnier de ceux que tu as engendrés, c’est-à-dire de leur mère. La société s’est ainsi créée. Elle te juge. Elle te condamne. Prison à vie. Tu es fait, mon pauvre vieux, fait comme dans un bois » (I-LI).
Ces propos révèlent que Mercadier n’ignore pas la fonction de liaison, d’organisation, qui incombe aux liens familiaux, aux valeurs sociales, aux idées et aux croyances, qui sont, en somme, de précieux « introducteurs d’ordre » ; mais en les réduisant à cette fonction, il les récuse en bloc et les dénonce comme mensonge généralisé. Il est ainsi fait (par son créateur) qu’il ne peut admettre que cette fonction d’agrégation est à la fois vitale et compatible avec des valeurs et des significations tout aussi précieuses, parce que consubstantielles à l’ordre du symbolique, à l’essence inter-humaine de l’humain. Comme le Michel de La défense de l’infini, S.Ravis l’a rappelé, Pierre pourrait dire: « J’étais condamné à savoir que rien ne pouvait me lier ». Pendant les années qui précèdent sa fuite vers Venise, il fait l’expérience de qu’a d’intenable à la longue une vie familiale et sociale vidée de tout contenu, à quoi s’ajoutent des échecs cuisants dans les domaines auxquels il consacre encore un peu de sa faible énergie : les jeux de l’amour, la spéculation boursière, l’écriture du John Law. Nous ne pourrons développer ici ces trois points : son art de la déliaison amoureuse, sa pratique du jeu et de la démonétisation des valeurs, son renoncement au pouvoir de liaison de l’écriture. Nous y ferons simplement allusion à la faveur de notre dernier point consacré au second pôle de l’alternative que nous avons définie, la rupture franche, la longue disparition, et la lente catastrophe du retour.
L’aventure négative et la fin du voyage
Une fois épuisées les ressources du compromis, la solitude « au milieu du monde », s’offrent à Pierre les joies plus pures de « la vraie solitude » ; mais, on le sait, « la lune de miel » est de courte durée : en faisant « l’épreuve de la solitude », écrit Aragon dès le début de l’épisode de Venise, « notre homme s’aperçoit du vide absolu de la vie », un vide que ne peut combler longtemps l’exaltation « d’encore entendre la pulsation de son sang après ce que l’on a traversé » et avant la catastrophe menaçante. Ce pressentiment de la catastrophe, en effet prêté au personnage, permet bien sûr d’inscrire son destin dans l’Histoire (dans l’horizon de la guerre), mais il trahit plus encore la logique profonde de son aventure : rompre tous ses liens expose nécessairement à la déliaison, à la dérive, à l’émiettement du moi, à la débâcle intérieure ; privé du miroir de l’autre, le moi se délite ; délesté de sa substance sociale, l’individu se liquéfie. C’est pourquoi Mercadier, pour se sentir encore exister, s’accroche un temps au sillage de la jeune Francesca : « nous cherchons en autrui l’aveu de notre force pour cesser d’être un déchet emporté par l’ouragan, pour devenir le centre de ce monde qui s’effacera quand nous ne serons plus… moi, moi, rien que moi… » (Venise-III). Mais quand autrui ne compte que pour aider un moi défaillant à se recomposer, les cartes sont truquées et les valeurs bafouées. Pierre ne tarde pas à le comprendre, à l’admettre, et même à le revendiquer, en perdant ses dernières illusions amoureuses et en s’en remettant au « principe de fuite de soi-même et d’autrui [qu’] il y a dans le jeu » (Venise-VI).
Sa brève mésaventure avec Francesca et son étrange partie de cartes avec Angelo lui font franchir un pas décisif en direction d’un individualisme radical : il aspire désormais à se rendre « propre d’autrui », à renoncer, donc, à la promiscuité amoureuse (le dernier extrait du John Law parle de l’intimité de la fosse commune à laquelle sont promis les voyageurs de l’impériale comme d’une « intimité pire que celle de l’amour », ce qui se passe de commentaire) ; il rêve d’atteindre à « l’égoïsme parfait », et professe que tricher est la « véritable morale de l’individu », si bien que le héros moderne n’est autre que « l’escroc parfait », qui seul sait s’affranchir de « la morale des hommes associés ». Mais il lui faut admettre aussi qu’une morale et une communauté d’hommes séparés sont de pures chimères : les joueurs ne constituent pas « une famille humaine » où l’on pourrait prendre place, et encore moins une « confrérie enchantée » ; la solitude est le « lien de ces êtres sans lien », un lien éminemment paradoxal, impropre même à fonder une petite société séparée, qui prospèrerait dans les marges du monde social. Mercadier est donc libre de dériver solitairement, loin des siens, loin des hommes, loin du monde réel, et loin du monde fictif, puisqu’il disparaît du roman pendant quelques douze ans.
Cette remarquable ellipse a pour effet de priver de substance l’entreprise d’affranchissement de Mercadier, de n’accorder aucun crédit à cette fugue, ni héroïque, ni rimbaldienne : ainsi, la tentative d’idéalisation qui en est faite par l’écrivain Bellemine est tournée en dérision, Pierre refuse de coller à sa propre légende (fabriquée par Meyer) et à son avatar romanesque (le personnage de Mirador) ; il le dit lui-même, « Parti, revenu… Tout cela est très relatif », avant d’ajouter : « J’ai eu dix ans de vie à moi tout seul. C’est beaucoup. Dix ans de liberté. C’est-à-dire dix ans d’argent » (II-IV). Insistons, l’ellipse narrative permet de ne pas donner de contenu à ce « c’est beaucoup », ces dix ans de liberté, de vie à soi (on n’en saura rien, pas de quoi nous faire rêver) ; en outre, cette indépendance est ramenée à sa condition prosaïque de possibilité, l’argent possédé, les rentes peu à peu dépensées, jusqu’à épuisement complet ; enfin, c’est le protagoniste qui est chargé de le dire lui-même, de relativiser la portée de sa fugue, de ne pas l’idéaliser, de même qu’en donnant tort à Bellemine à propos du mythe du départ, il donne lui-même raison, après coup, à Blaise, qui en avait fait tout autant avec lui autrefois : « Partir pour partir, entre nous, c’est parler pour ne rien dire […] Est-ce qu’on part ? On se déplace, voilà tout » (I-LV). Pierre n’aurait fait, au fond, que se déplacer ; le voici revenu, et bientôt revenu de tout : selon nous, c’est un aspect majeur de la stratégie narrative de la dernière partie du roman qui se lit ici en clair : faire collaborer le personnage à la proclamation de sa défaite, l’amener à se donner tort, lui faire boire ainsi le calice jusqu’à la lie ; en d’autres termes, liquider lentement, et non sans cruauté, cet individu, en même temps que son individualisme.
Pour ce faire, l’auteur le place à son retour dans une situation accablante : fatigué, vieillissant, physiquement diminué, obligé de travailler et de subir la promiscuité des collègues et du foyer Meyer, il doit payer le prix fort, lui qui « avait cru comme personne à l’indépendance de l’homme, à son droit de rejeter toute responsabilité, de rompre tout lien » (II-V). Le monde réel, quitté, oublié, méprisé, fait retour et se venge. « Prison à vie », disait-il de la société : il ne mesurait pas à quel degré de dépendance peut conduire l’absence d’argent, la nécessité de gagner son pain. Humilié, il réagit d’abord par un mépris aggravé envers toute forme de solidarité : son indifférence au sort des Juifs dégénère en antisémitisme, « un sentiment bizarre mais fort » (idem), les menaces de guerre ne lui inspirent que des propos cyniques sur le patriotisme. Ce comportement indigne et ce rejet de tout sentiment national achèvent de le peindre en héros négatif : il est le type même de l’individu comme être négativement défini (comme négation de tout lien, de toute solidarité, objective ou subjective). C’est pourquoi son individualisme nous semble bien éloigné du « culte du moi » cher au premier Barrès, où l’accent porte sur la quête et l’affirmation de soi), et même assez étranger à la notion de « religion de l’individu » avancée par le roman. Cette notion est d’ailleurs associée à des gens comme Bellemine, dont on sait que Mercadier refuse les élucubrations ; pourtant, elle lui est également, et tardivement, attribuée, quand il confie à Dora Tavernier : « A toutes les religions mortes se substituait la religion de l’individu. Et voilà, même pour cette religion, je n’ai plus la foi, j’ai perdu la foi… » (II-XLI) Deux explications à cela : d’une part, pour s’affranchir des liens sociaux, il faut au moins croire en une possible liberté, définie comme une non-dépendance (de même que le sceptique doit au moins ne pas douter du doute, défini comme une non-certitude) ; d’autre part, on l’a entrevu, il s’agit que le personnage dénonce lui-même sa défaite et sa faute, ce qui nourrit dans les derniers chapitres du roman une généralisation aux accents de réquisitoire.
Rappelons d’abord qu’un moment décisif dans la prise de conscience critique de Mercadier est celui où, à propos de son indifférence aux siens, il en vient à se demander : « Et si j’étais un monstre ? » (II-XVIII)- ce qui le conduit à nouer un contact avec son petit-fils, à ne plus dénier le lien des générations, à contredire son attitude et sa conviction passées, et finalement à renoncer à son indifférence de longue date à la politique. Mais à peine cette révision déchirante est-elle amorcée qu’il s’effondre, condamné à balbutier dérisoirement le mot trop longtemps méprisé. Sur ce plan comme sur le plan familial, il est beaucoup trop tard pour réparer les dommages causés. Lui en accorder le temps et la volonté affaiblirait d’ailleurs la démonstration : Pascal a été la victime de la démission paternelle, et il le demeure, de façon plus dramatique encore en étant « jeté dans la guerre ». C’est que le roman entend montrer les conséquences désastreuses, à l’échelle collective, de « l’individualisme forcené ». La guerre est imputable à toute une génération : « Ce sont eux qui nous ont menés là, nos pères, avec leur aveuglement, leur superbe dédain de la politique » ; avec la catastrophe imminente prend fin « le temps de tous les Pierre Mercadier ». Cette généralisation n’est pas sans poser problème. Certes, elle a été préparée par l’inscription de la destinée du personnage dans un monde en crise, par une dénonciation, elle aussi formulée par Mercadier, du « parasitisme » de la classe sociale intermédiaire à laquelle il appartient, par la peinture d’une société en proie dans toutes ses sphères à de délétères conflits d’intérêts, et aussi par le parallèle établi entre ce détraquement de la machine sociale et la débâcle, physique et mentale, du personnage. Il demeure qu’une telle généralisation privilégie in extremis l’aspect politique du comportement individualiste en en faisant une explication de la crise et de la guerre très réductrice par rapport à celle que le roman lui-même invite à construire.
Disons, pour conclure, qu' »individualisme forcené » devient une expression polémique, à rapporter aux circonstances de l’écriture, alors qu’elle désigne précédemment l’attitude existentielle incarnée par Mercadier, où l’idéologie compte peu au regard du « vertige de désagrégation » qui est sa marque propre : vertige venu de la conscience aiguë de l’universelle entropie, l’impuissance à y résister se mêlant de façon trouble à la tentation d’y céder, que ce principe de dégradation se manifeste par les stigmates odieux du vieillissement et de la maladie, par la déliaison familiale et le délire amoureux, ou par la débâcle des couples et la crise des sociétés. Par conséquent, si l’expression « individualisme forcené » permet bien de stigmatiser une attitude d’irresponsabilité radicale, elle n’est pas sans rapport avec ce qu’écrit le biographe de John Law à propos des voyageurs de l’impériale, autant dire du commun des mortels : « Est-ce qu’il y a dans la vie un seul roman heureux ? Est-ce que chaque vie humaine, la plus humble, ne se termine pas de façon tragique ? […] C’est vers cette issue horrible de la vie que nous sommes tous portés, inconscients du mouvement qui l’anime, du mécanisme de la locomotion, par un immense omnibus lui-même destiné aux catastrophes » (II-XXXVII).
Telle est la leçon de dés-agrégation de Pierre Mercadier. Une leçon en tous points opposée à celle alors prônée par Aragon, et dont le roman ne fait pas état, une leçon d’agrégation maximale : le communisme, comme antithèse exacte de l’individualisme.