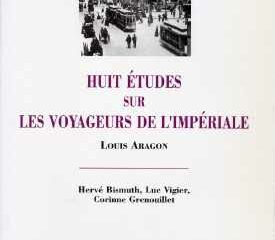Roselyne Waller: Boniface, des rives et des rêves

Roselyne Waller. 2002.
Aragon, Les Voyageurs de l’impériale (éd. Folio)
Boniface, des rives et des rêves
Boniface est un personnage singulier des Voyageurs de l’impériale, qui surgit de l’arrière fond sur le devant de la scène dans le chapitre XLII qu’il occupe tout entier, pour retourner apparemment à l’obscurité dont il avait été un instant tiré. Personnage épisodique, personnage-épisode pourrait-on dire puisqu’il n’en sera plus question qu’à travers de minces allusions et dans la seule 1ère partie du roman, il est le protagoniste quasi exclusif de l’une des péripéties fondamentales de cette 1ère partie, péripétie qui participe de la montée dramatique, de la précipitation des événements qui caractérise l’été 1897 à Sainteville.
Suzanne a eu la preuve de l’intimité entre sa mère et Pierre (la conversation surprise entre l’oncle Pascal et Mme D’Ambérieux confirme ce que suggérait la petite voiture attelée près de la chapelle), sa fugue est découverte au matin, la tension monte à l’idée des marais et la battue organisée durant la journée par le père de Suzanne, Ernest Pailleron ne donne aucun résultat.
Boniface part alors seul à la recherche de Suzanne, et la retrouve au terme d’un parcours qui a toutes les allures d’une épreuve initiatique. On se demandera si ce personnage aux contours stylisés acquiert, par l’accomplissement de cette épreuve, le statut héroïque. Il semble bien qu’il accomplisse en tout cas une traversée symbolique, un cheminement qui fait accéder une personnalité marquée par l’indistinction et le défaut à une identité assurée. Enfin, on verra que, par un effet analogue, ces quelques pages du roman qui semblent aller à la dérive à l’instar de Boniface et constituer une faille dans le récit y trouvent un passage et un ancrage à travers de profondes ramifications, s’inscrivant par là même dans une problématique fondamentale d’intégration indirecte masquée par une apparente étrangeté, suivant un procédé d’écriture particulièrement aragonien.
A la première question que l’on examinera : la réussite de la mission que s’est donnée Boniface par sa victoire inespérée sur le marais entraîne-t-elle son héroïsation ? la réponse est équivoque.
Le personnage au départ apparaît comme proche du type, voire du stéréotype, celui du colosse au cœur d’or, celui de l’innocent aux divers sens du terme : pur et sans malice, naïf et simple, enfin incapable de nuire.
Le portrait qui ouvre le chapitre met immédiatement en relief les contrastes qui caractérisent Boniface et qui trouveront des correspondances dans son comportement à l’inverse des celui des autres. Sa taille, sa puissance physique, ses forces inépuisables (il travaille depuis toujours, il n’est jamais fatigué) s’opposent à sa soumission et à son humilité. Dans la société, il appartient à une frange : c’est un bâtard, de basse extraction, l’homme de peine des travaux déconsidérés ; mais la marginalisation sociale dont il est victime fonctionne étonnamment avec l’absence totale de rancœur à l’égard de ceux qui le méprisent ou profitent de lui, et même avec un altruisme et une bonté absolus. Non seulement il tend à idéaliser les autres (la demoiselle du château), mais il croit « à tout ce qui est bon, à tout ce qui est beau dans ce monde » (259). Boniface, comme le suggère son nom, ne rêve que de faire le bien (il rêve « de belles actions, de travaux à émerveiller le monde, de dangers courus, de services rendus », 258), il rêve sans doute d’entrer dans la légende ; car son goût du chevaleresque le situent du côté de l’enfance (tout comme sa candeur) et du merveilleux.
La figure du géant est d’ailleurs relié à l’imaginaire des enfants du pays et de Pascal. La 1ère description de Sainteville (chap. VIII) fait valoir que le marais recèle pour eux « toutes les puissances du mystère » (88) et qu’escalader les montagnes fait parvenir au « monde des fées et des géants sur lesquels il n’est pas de contes » (89) ; et sans doute peut-on lire le chapitre XLII comme le conte de l’un de ces géants. Dans l’entonnoir que Pascal découvre du haut de la montagne, il croit voir « des traces sanglantes d’un géant tombé jadis du ciel dans ce puits de mirages » (90). Tout y est marqué, en effet, sinon par le gigantisme, du moins par le grandissement : « les rêves de Pascal prenaient corps et recréaient une vie où toute chose était amplifiée… Tout y était à la taille héroïque, et la bande de garnements dépenaillés, ses compagnons, y devenait une chevalerie épique. Pascal imaginait la geste de Rambert » (92-93). C’est cette montagne favorable aux visions d’épopée qui se fait le théâtre d’une geste en quelque sorte annoncée, la geste de Boniface, qu’Aragon imagine.
Elle comporte essentiellement une épreuve terrifiante, un véritable voyage au bout de la nuit qui confronte Boniface à un ennemi implacable, le marais, soutenu par toutes les forces naturelles. L’accumulation des difficultés fait figure de motif appuyé, se constituant en insurmontable et angoissante montée des périls. Tout nuit à Boniface, et conspire à lui nuire, y compris lui-même. Car si Boniface est aveugle dans le marais, c’est que la nuit est sans lune mais aussi qu’il a oublié sa torche ; c’est lui qui décide de se risquer à un endroit du marais où l’on ne connaît pas de passe, et précisément parce que personne n’a jamais osé y aller (même pour sauver le frère de Michel qui y est sans doute mort). Et Boniface s’abîme victime de sa stature qui se transforme en handicap, il va succomber au sommeil, il perd son couteau, et le vent se lève, la pluie, autre forme d’eau léthale, se met à tomber en rafale et redouble : les éléments – la terre, l’air et l’eau – se liguent traîtreusement contre lui.
La mort est sûre de sa victoire et déploie des signes innombrables à travers des souvenirs, des images, des sensations qui renforcent sa proximité. Boniface revoit un jeune homme écrasé, pense au frère de Michel, songe aux morts qui mangent la terre. Il sent des « odeurs de mort » (261), feuilles en décomposition ou exhalaison de « tombeau fraîchement remué », et l’odeur de la pluie qui dans les marais se confond avec celle de la mort. Il perçoit une « fraîcheur de tombe » (262), et « le goût de son sang mêlé à de la terre » (262). La nuit dans laquelle il s’enfonce est aussi métaphorique, elle est sur lui un linceul, un « un drap noir » ; le sommeil qui fond sur lui est Hypnos, frère jumeau de Thanatos, image du néant, tout comme le silence absolu qui succède aux derniers appels dans la nuit (259-260).
Boniface avance sur le « terrain de la mort » (l’expression figure deux fois page 261), dans une mise en scène du combat entre les extrêmes, entre l’aspiration vers le bas et l’aspiration vers le haut.
Cette tension s’inscrit dans la dramatisation du récit qui fait alterner l’accélération du rythme avec l’expression de la durée (« près d’une heure », 262 ; « combien de temps est ainsi passé », 263) et même le ralenti, qui conjugue le surgissement de l’inattendu, l’aspect ponctuel (« soudain ») et l’imminence (« Boniface va mourir », 263) avec la répétition du même (« La pluie. La pluie. La pluie. »). Cette dramatisation use de l’hyperbole et de l’oxymore (« il se sauve avec cette lenteur épouvantable », 263) ; et elle est servie par une écriture qui suit au plus près la marche de Boniface : « impossible de s’arrêter », lit-on page 262 ; impossible également pendant tout un temps de mettre un terme à l’écriture du ressassement et de la reprise.
La montée de la terreur produit les claquements de dents et le hurlement d’épouvante de Boniface, qui troue la nuit et déchire un silence de mort (celui de Boniface et celui de « l’ennemi muet », 262) ; et elle se communique au lecteur, si l’on en croit le témoignage de la traductrice américaine du roman, Hanna Josephson,, qui « confesse avoir frissonné pendant trois jours, après avoir traduit le chapitre dans lequel Boniface sauve Suzanne des marais » (Bougnoux, La Pléiade, II, 1407).
Mais cette lutte titanesque n’aura pas été vaine, et la victoire de Boniface semble bien en faire un héros, un héros positif dans un roman qui n’en présente guère.
Sa réussite est multiple en effet : il a accompli ce que personne n’avait fait, trouver une passe à cet endroit du marais, il a vaincu la mort, et il a retrouvé Suzanne, lui « Et non eux autres », comme il en priait Dieu (259).
Sa puissance et son exploit surhumains le situent sur un plan non humain, mythique, quasi surnaturel, comme le souligne la thématique religieuse qui informe le texte.
Boniface ce « cœur simple » s’inscrit dans une imagerie catholique, dont le personnage lui-même est nourri (et l’on songe à ce qu’écrit Flaubert de Félicité : « pour de pareilles âmes le surnaturel est tout simple »). Non seulement il est en étroite proximité avec son Dieu à qui il demande une faveur qu’on pourrait dire égoïstement altruiste, puisqu’elle doit le racheter de « ces fautes mystérieuses qui étaient en lui » (261), mais il a « la tête pleine des saints voyageurs » (260), saint Roch et Saint Christophe. Sa plongée dans les ténèbres lui est descente aux enfers : prisonnier des herbes qui « bruissaient comme si des diables y avaient collé leur bouche », et battu par une pluie « sans pardon » qui tient du déluge, « Boniface commençait à comprendre ce que c’est que l’enfer » (262).
Sa propension sacrificielle et oblative l’apparente à une figure de saint : il se fait saint Christophe, cet autre géant qui passait pèlerins et voyageurs à gué sur ses épaules, devenu dans l’hagiographie tout à la fois le patron des voyageurs et celui qui protège de la mort subite. Boniface même trouvant un passage dans les marais n’est sans doute qu’un voyageur de l’impériale, mais c’est un saint voyageur. Au-delà il est le Sauveur, et son itinéraire dans la nuit des marais ne peut que faire resurgir une autre figure christique littéraire, celle de Jean Valjean sauvant Marius dans les égouts de Paris dans un livre des Misérables dont le titre « La boue, mais l’âme » pourrait convenir au chapitre de Boniface.
Par ailleurs la victoire de Boniface contre le marais tient du miracle, comme la découverte de Suzanne au moment précis où il touche terre : il est alors véritablement exaucé, comme le souligne la coïncidence « romanesque » devant laquelle Aragon ne recule pas. Sa foi a vaincu les montagnes marécageuses, tâtant le sol, il rencontre Suzanne : « Aux innocent les mains pleines ». Enfin le motif du rachat et de la résurrection participe de la dimension religieuse du personnage, nous y reviendrons.
Mais le grandissement du « jeune géant », dont le haut fait marque l’adéquation de l’âme et du corps, son caractère héroïque sont-ils perçus par les autres ?
Le mot de héros est prononcé par la seule Denise, dont la théâtralité coutumière dégrade certainement le terme, tout comme son association immédiate à la notion purement pécuniaire de prime. De plus, le héros, qui pourtant était fatigué, est reparti travailler aussitôt après avoir porté Suzanne au château, il n’a attendu aucune parole flatteuse reconnaissant son exploit. Le texte du chap. XLIII évoque l’arrivée de « ce brave garçon » et non d’un garçon brave, et d’une manière générale les termes le désignant ne changeront pas dans le roman : « grand flandrin gauche », « jeune paysan », « jeune géant », il sera le « petit paysan » pour Pierre, qui dégrade dans ses pensées le sauveur en « sauveteur » (Aragon lui-même parlera à J. Sur, dans Le réalisme de l’amour, paru en 1966, de « grand gosse » touchant).
Quant à la réaction de Blanche à l’égard de Boniface, elle est bien terne : la mère de Suzanne, qui avait fait une crise de nerfs et s’était évanoui d’angoisse, ne le rencontre que parce qu’il vient aux nouvelles, et « lui fit donner 50 francs » (285 ; et elle demande s’il a été content !), ce qui maintient Boniface dans son statut de domestique, ou du moins d’inférieur (il sera toujours reçu à la cuisine), et ce qui, par ailleurs, est peu payé, comme le souligne seule Yvonne, qui calcule qu’il lui faudrait sauver trois enfants pour pouvoir s’acheter un gramophone. Plus tard, Blanche est touchée par le côté fleur bleue de Boniface, par les fleurs bleues qu’il va cueillir à l’aube dans la montagne (cf. Quasimodo ?), et on apprendra qu’elle l’a emmené avec elle à Lyon, sans autre précision (et l’on ne peut qu’imaginer le déracinement de Boniface ; et douter – à moins d’y lire un signe de l’autonomie acquise).
En tout état de cause, Boniface n’est pas fêté comme un héros, ni au château, ni à Buloz, où Pascal suppose simplement que les langues vont « bon train » (266), c’est-à-dire qu’il est devenu un (simple) sujet de conversation. Son sort ne semble pas changé, tout se passe comme s’il retournait à son ancienne vie obscure, comme s’il ne s’était rien passé. Pourtant un signe au moins se trouve inversé : dans les chamailleries des enfants, le nez plat de Boniface devient un critère de beauté (304) pour Yvonne, selon laquelle de surcroît Boniface est « un homme » (266) (ce que confirmera sur un mode plus sérieux la représentation que s’en fera Pierre comme d’un rival).
Si la reconnaissance sociale de l’héroïsme de ce personnage fait défaut, c’est sans doute que l’essentiel est ailleurs, et que la traversée du marais est fondamentalement un parcours psychique qui fait accéder Boniface à une identité maîtrisée.
En effet, au départ, l’identité de Boniface n’est pas assurée, ce qui la caractérise est l’indétermination de la filiation. Il est à sa manière une incarnation de « l’homme à l’identité fuyante » (408), celle du bâtard abandonné. Le texte du chapitre débute par les deux malheurs de Boniface : sa naissance (il n’a pas de père et sa mère au statut de prostituée l’a laissé choir) et son nez. Sa filiation déficiente est comme signifiée en même temps que rédupliquée par le manque de nez : elle est visible comme le nez au milieu de la figure ; inscrite sur sa face elle le défigure.
Sa force joue comme une sorte de contrepoint au défaut originel, mais aussi comme révélateur qu’elle ne peut le compenser : le « colosse courbe l’échine » (257) devant la moindre allusion. Si les autres ne sont pas incriminés par Boniface, leur bassesse est signifiée par la métaphore que peut constituer « la quantité de fumier qu’il a pu brasser depuis qu’il est au monde ! » (257).
L’indistinction qui le distingue se manifeste dans le texte par divers biais significatifs de l’absence de frontières, du flottement des contours de Boniface : sa perméabilité avec l’ordre animal et avec l’ordre naturel.
Boniface est comparé à un « animal affolé » (263), et les termes d’« échine », de « pattes », de « paturons », sa conviction que Suzanne pourrait dans le noir « croire au voisinage de quelque bête » (258) et qu’il serait pour le marais « une bonne pièce de boucherie » (261), de même que son flair (il sait qu’il sauvera Suzanne) et son hurlement à la mort relèvent de l’animalisation. Son mutisme renforce cette impression : il n’adresse de paroles à nul être humain, si ce n’est à lui-même celle qui le réduit à un animal, au capon.
S’il est mal dégagé de l’espèce animale, sa proximité avec la terre suggère une continuité avec l’ordre de la nature. Il connaît la terre en profondeur, il la creuse comme terrassier ; il vit dans son intimité féminine, au fait de « ses secrets » et de ses failles, il lui a donné des noms connus de lui seul, la reconnaît entre ses mains, et « point gêné avec elle » (260), il se couche sur elle, le cœur palpitant, pour un « baiser du sol » fusionnel (il a de la terre dans la bouche) qui lui redonne de la vigueur. Il rejoint par là les mythes d’origine qui accordent un rôle aux géants dans la genèse du monde ; et la dernière image ne peut d’ailleurs manquer de suggérer précisément le géant fils de Poséidon et de Gaia, de l’eau (l’océan) et de la terre, Antée, qui, s’il n’est pas nommé, trouve au moins un équivalent sonore dans le « corps hanté » de Boniface (263).
Mais le rapport charnel de Boniface à la terre est ambivalent, elle n’est pas pour lui qu’une amante vivifiante, elle est aussi, du côté de la mort et de l’enterrement, « le sol perfide » (261), la terre-mère dévoratrice qui « mangea les hommes imprudents » (261) comme le frère de Michel et veut faire de Boniface un « bon repas » (261). La forêt bénéfique s’oppose au marais maléfique, lequel, magma de terre et d’eau, réitère et renforce le thème de l’indistinction mortifère. Boniface, aspiré par le marais, battu par la pluie et le vent, semble participer de l’élémentaire, appartenir à ces éléments confondus, terre, eau et air, dont on observe qu’il leur manque, le feu, l’élément mâle, que Boniface a significativement écarté sous les espèces de sa torche oubliée.
L’enlisement attire comme un vertige, Boniface a envie « de se laisser aller à l’ombre, à l’humidité, à la terre » (261) ; se muer en « noyé de la terre » (263) relève du trouble désir de fusion-confusion avec la mère. Le marais vaut alors comme paysage mental, configuration psychique, tourbe cachée des fantasmes humains, emblème de l’inconscient.
Pourtant Boniface résiste au désir de régression dans le sein maternel, à la dérive, il aborde la rive, il trouve la terre ferme, se hisse hors du marais, il « se sauve » pour reprendre une expression (263) à la grande densité de sens.
Son activité inlassable a été d’emblée associée à la culpabilité du Sans-père qui fonde son humilité et sa volonté de rachat, de manière si voyante qu’Aragon l’atténue en 1965 par une suppression (la fin du 3ème paragraphe du chap. XLII, « il avait tant à se faire pardonner, sans compter le paradis à gagner », était suivie de : « où il n’arrivait pas à croire qu’il y eût grand’chose pour un enfant du péché »). Le problème filiatif est très nettement accentué du côté du père à travers la nomination, marquée par l’absence de patronyme et par le surnom de Sans-père. La lutte de Boniface contre la mort est intimement tissé à la question de sa naissance : il redoute ultimement de devenir le Sans-tombeau après avoir été le Sans-père, d’être sans fin comme sans origine. La victoire sur la fin se transformera en victoire sur l’origine, en réparation de la faille généalogique.
Celui qui est de père inconnu se jette dans une partie inconnue du marais pour la reconnaître et se faire reconnaître ; et le caractère quasi impossible de toute son entreprise semble relever d’un pacte non dit avec le Créateur : s’il réussit contre toute espérance, alors Dieu exaucera sa prière.
Et l’enjeu est de taille : il est non seulement de sauver Suzanne, non seulement d’échapper à la mort mais d’accéder, par une recréation de soi, au statut d’homme (et se traitant de capon, de jeune coq châtré, le Sans-père démontre assez qu’il n’en est pas un à ses propres yeux).
La naissance à partir de la terre-mère dont il s’extrait est suffisamment suggérée par son propre cri qui vient couronner une sorte de remontée de l’existence en sens inverse, vers l’origine : le texte assimile la traversée de Boniface à « Une longue vie, une courte vie, une vie… », et le peint comme « un tout petit enfant qui ne tient pas encore sur ses pieds » (263) ; et cette naissance est comme confirmée, répétée, par le surgissement de Suzanne du cœur des marais, à l’endroit même où il retrouve la vie : il touche de sa main « un être, là, qui soudain s’éveille et crie » (264).
Il s’est arraché de la terre à l’issue d’une manière de renversement des signes : « la terre tout entière pend à chacun de ses pieds » (263), qui annonce sa domination, sa résurrection au sens propre du terme. Il s’extirpe de la matrice terrestre avec la puissance du taureau de Diderot que cet auteur imagine dans Le Rêve de D’Alembert « faire effort pour […] dégager son corps pesant » de la matière. Le terrain de la mort s’est transmué en terre fertile, vitale.
La deuxième naissance du ressuscité des marais a pour vertu essentielle d’effacer le péché d’origine : accentuant la référence à Jésus, ce sauveur rachète la faute originelle ; et l’innocent relève désormais d’une autre forme d’innocence : il est innocenté, non-coupable. Se substituant à la première naissance, c’est le père que la seconde annule : c’est ce qu’indique la prière à Dieu de Boniface, qui nomme Jésus à la problématique paternité « fils de Marie » (263), et c’est ce que corrobore le fait qu’il remplace dans le rôle du sauveur un père déficient, Pailleron.
Le motif d’une deuxième naissance qui abolit la première, et singulièrement la part qu’y a prise le père est récurrent dans l’œuvre d’Aragon, même s’il est secondaire, et il est déjà présent dans le roman précédent du Monde réel, Les Beaux Quartiers, autour d’Armand que sa mère sauve d’une maladie grave par ses soins constants (alors que c’est le père qui est médecin) : « Elle l’avait donc enfanté deux fois, et la seconde fois sans le secours de l’homme » (103, éd. Folio).
Boniface s’est créé lui-même (il s’est engendré, fécondé lui-même comme le suggère une relecture du baiser du sol qui en fait le fils incestueux de la terre), il s’est substitué à son père défaillant, il est devenu à lui-même son propre père.
L’émergence d’un père symbolique, même non séparé, fondamentale pour l’avènement d’un sujet structuré, délivre Boniface de son enchaînement au seul ordre naturel ; selon Lacan, le père symbolique est le support de la figure de la Loi qui « superpose le règne de la culture au règne de la nature livrée à la loi de l’accouplement » (Lacan, Ecrits I, Seuil, Points, 156).
Le fondement qui se dérobait s’est solidifié, et l’on peut songer à ces marbres de Rodin, où des visages naissent d’un bloc de matériau laissé à l’état brut (exposition de 1997 au musée Rodin à Paris).
Par ce qu’ailleurs le texte appelle un « refus désespéré du malheur » (198, ajout d’Aragon en 1965), Boniface, ce personnage du dehors a accédé à une intériorité, il a trouvé un ancrage, le passage vers lui-même, la passe capable de contrer le destin mauvais, la bonne aventure (comment s’appelait-il donc, se demande Pierre plus tard : Bonaventure ?) qui restitue son plein sens à son nom – et désormais sans tonalité ironique – Boniface, l’homme à l’heureux destin.
Ce statut en fait d’ailleurs un personnage à part dans le roman, et de son histoire un passage étrange, qui ramènent à la question de leur inscription dans le texte. L’épisode peut en effet apparaître comme une faille dans l’économie du roman, pourtant cette manière de « tempête » fait sentir ses « contrecoups » « par des voies profondes et cachées » (deuxième partie, II, 463).
On peut considérer que la geste de Boniface constitue l’un des « romans réprimés » des Voyageurs de l’impériale dont parle D. Bougnoux (La Pléiade, II, 1364). Le roman de Boniface pourrait être développé, mais il demeure inachevé, et son fonctionnement quasi autonome (Boniface reparaît aux chap. XLIII, XLVIII, LI, LVII, LIX et LXI de la première partie, plus ou moins fugitivement, mais toujours à travers le regard des autres) semble ressortir d’un certain point de vue à la technique du collage.
Car si l’épisode part de l’histoire, c’est pour en partir, s’en départir (comme Aragon affirmera qu’il le fait du modèle réel, à l’instar de Matisse) ; il dérive de l’histoire, mais il excède ses rives, il constitue une sorte de digression, d’enclave, (qui pourrait être publiée à part), de fuite hors du roman, de « parenthèse. Distincte et séparée », pour reprendre les termes appliqués par Aragon aux « Deux mesures pour rien » des Voyageurs de l’impériale dans Henri Matisse, roman (Gallimard, NRF, II, 155).
Cette parenthèse a les allures d’une pause dans l’écriture du roman au sens musical du terme, d’une suspension, d’une respiration, d’un soupir – et c’est aussi ce qui fait son charme – : pause poétique, pause onirique, suspens dramatique qui s’achemine en crescendo vers l’accord majeur de la fin heureuse, vers le chant d’exultation, l’hosanna de Boniface (« Il la tient, il la tient.. », 264).
(Et par extension, peut-être réveille-t-il l’enfant qui sommeille dans le lecteur par le bonheur enfantin de la fin heureuse.)
A ce titre, le passage qui met en scène un enlisement évité à grand’peine peut valoir comme mise en abyme et jouer comme métaphore de soi-même ; car il semble enfoui, englouti dans le roman comme un corps étranger, mais il trouve obscurément vers lui et vers l’œuvre de son auteur des passes sûres – ne serait-ce que celle qui le relie au motif de l’inachèvement (et au manuscrit abandonné sur John Law), à la prolifération des histoires, à ce que Suzanne Ravis appelle dans son ouvrage sur Les Voyageurs de l’impériale dans la collection foliothèque « la mobilité narrative » (48) et Bougnoux la « focalisation tournante » (La Pléiade, II, 1375) ; il s’inscrit de surcroît dans une pratique romanesque qui fait de la parenthèse une nécessité esthétique (Suzanne Ravis rappelle (35) que pour Aragon la parenthèse est ce qui allège le roman, lui permet de n’être pas qu’une « pierre lourde », qu’elle « en est ce qu’on appelle aussi bien la poésie. Le merveilleux inutile » (Henri Matisse, roman, II, 151). Ce passage est le point nodal sous-jacent de divers fils du roman et de thèmes aragoniens, et son apparente hétérogénéité dissimule des convergences.
Ainsi pour ce qui est de la portée dramatique de l’épisode, outre son rôle immédiat qui est de mettre un terme à la fugue de Suzanne, cette fugue vaut comme prélude de celle de Pierre, car elle mènera à la rupture entre Pierre et Blanche, annulant le dernier lien qui le rattachait à un mode d’existence que rien ne l’empêchera plus d’abandonner ; et les ragots sur les rapports de Boniface et Blanche seront utilisés par Pierre pour rabaisser définitivement leur aventure et rejeter Blanche qui revenait à lui.
En amont, ce passage est préparé, comme on l’a vu, par un certain nombre d’amorces, inscrites dans le paysage de Sainteville et le monde de l’enfance qui y trouve sa place. La géographie des lieux, décrite dans le chapitre VIII, établit ainsi la nécessité d’un franchissement du marais pour atteindre le sommet. Boniface est venu se couler dans les légendes du marais, les justifier, les enrichir, les actualiser, substituant au « géant tombé » un géant relevé. A ce titre il participe de la représentation de l’univers de l’enfance dans le roman.
Le personnage de Boniface présente d’ailleurs de subtils points de contact avec certains enfants du roman, Pascal notamment, qui sera victime lui aussi, mais autrement, d’un abandon paternel. Ainsi Pascal, dans ses rêves, fasciné par le vide attirant de l’abîme « sentait s’effondrer sous lui l’écorce légère des apparences, il s’agrippait à des touffes de plantes rêches et soyeuses pour ne pas se laisser aller au vertige » (90) ; et lui aussi s’est couché sur une terre féminisée (avec ses « épingles à cheveu » et son « quelque chose de rose », 134), et il a bu à la fontaine une « eau de mort » (Pléiade, 596, « une eau morte », Folio,135) ; enfin on ne peut s’empêcher de songer que le titre donné à ses poèmes « Les Forces et les Rêves » pourrait convenir au chapitre de Boniface Et peut-être Pascal rejouera-t-il dans la guerre – même si c’est sur un tout autre plan – le voyage au bout de la nuit de Boniface, dans « Le sang, la sueur, et la boue », « morceau d’un énorme corps, d’un immense animal blessé et rugissant » (745). Quant à Yvonne, socialement plus proche de Boniface, sans père elle aussi, elle invente « un monde féerique » (187), des jeux avec des ogres ; elle joue la simple d’esprit, ce qui la relie à Boniface, tout comme son parler animal Ouah-Ouah quand il remplace sa volubilité ; de plus lors de l’escapade des trois enfants dans la montagne, elle s’est enfoncée jusqu’au mollet dans le marais, a jeté un cri qui leur a fait ressentir l’épouvante (229). Les enfants ont alors perçu la conjonction maléfique des marais et de la pluie, tandis qu’à Sainteville au même moment la vieille Marthe évoquait un « jeune marié » enlisé, qui préfigurait les étranges noces de Boniface avec la terre.
En aval, la figure de Boniface sécrète quelques discrets épigones, pâles décalques qui ont avec lui de curieuses similitudes de bon géant et témoignent de la fécondité imaginaire de cette figure, ainsi que de l’aptitude de Boniface à s’autoreproduire. Ainsi en va-t-il du gondolier de Venise, (les gondoliers en général sont comparée à des « damnés », p. 374), « personnage […] herculéen, […], les yeux rieurs et doux, un géant qui s’incline » (381) « athlète » brusquement surgi dans cette ville de terre et d’eau pour sauver Pierre et Francesca d’une horde de gamins ; il en va de même, dans la 2ème partie, du personnage du taxi, « un type blond au nez écrasé » (622), « un grand bonhomme, rouquin » (684), « une espèce de colosse roux » (625) avec lequel Méré d’abord se bat : « Ils cherchaient à s’arracher de la terre et n’y parvenaient pas » (625) et dont il finit, doté lui aussi d’une « force inépuisable » par réussir « l’arrachement » (avant de lui confier son sauvetage politique).
Boniface, contre-exemple de la théorie de Pierre suivant laquelle les rapports humains sont fondés sur l’argent, être moral à l’encontre de la démoralisation à laquelle Pierre croit, sorte de rival qui revient dans les rêves de Pierre et qu’il s’acharne à dévaloriser, est pourtant en secrète connivence avec lui par divers biais : Pierre est comme lui un être de contradictions, il est comme lui recréé par une seconde naissance (« Il avait tué le professeur Mercadier » (369), il se rattache enfin au motif de l’enlisement emblématisé par Boniface, au motif d’un marais métaphorique, tout comme d’autres personnages du roman qui s’y laissent aller.
Parmi ces personnages prend place l’étrange Mme Seltsam dont « On aurait dit par moments que toutes sortes de petits animaux dans sa poitrine sortaient comme d’un marais couvert de feuilles. » (570) ; Elvire s’enfonce dans les débordements de son embonpoint et dans son passé, dans la « glissade lente de ces années-là […]. Le roman d’une noyée » (701). Dora, qui présente d’autres ressemblances avec Boniface (origine sociale, capacité d’aimer, rapprochement avec un stéréotype romanesque, la prostituée au cœur pur) s’enlise dans sa folie, « dans une nuit sans fin », se refaisant une vie « après coup », elle remonte le cours de l’existence, ses lèvres redeviennent « virginales » (723), elle retrouve « l’enfance du cœur » (724), et, dans une inversion des signes, c’est pour elle la réalité qui se dérobe et son « roman, sa terre ferme » où elle « reprenait pied » (695).
Mais c’est avec Pierre que l’analogie se déploie avec la précision la plus méticuleuse dans la reprise des termes même, d’abord à Venise, « cercueil flottant » (369) où Pierre demeure « comme un animal pris au piège » (373), Venise « en proie aux éléments » (id.) le vent, la pluie en rafales, Venise où Pierre éprouve la solitude absolue, traverse une « période de mue » (375), ville des « hommes enlisés » (377) où tout évoque le marais : « la terre qui se décide difficilement à la cohérence » (375), les « immondes bêtes de vase » (384), comme « la facilité qu’on a de s’y perdre, de croire s’y reconnaître et de se déconcerter en dix pas » (377). Mais c’est aussi la vieillesse et sa déchéance finale que Pierre ressent comme un enfouissement, une aspiration irrésistible et « Il avait peur de ce marais en lui, énorme, de cet enlisement » (692) ; d’ailleurs, lors de son attaque, il est tombé, « la bouche sur la terre » (697), et quand il revient à lui pour un temps, il « déplonge » (703).
Contre ces victimes à peu près consentantes, Boniface se dresse alors comme l’affirmation à contre-courant qu’il est possible de lutter contre l’immersion mortelle.
Enfin, l’indéniable sympathie qu’Aragon éprouve pour son personnage est fondée sur des liens profonds, « des liens mystérieux […] entre son héros et lui-même » (317) à l’instar de ceux qui existent entre Pierre et John Law, liens qui déterminent les échos que l’épisode de Boniface trouve, au-delà des Voyageurs de l’impériale, dans l’œuvre d’Aragon.
Les plus évidents touchent à l’origine, à la naissance illégitime, au père inconnu, à la question paternelle et à l’imaginaire de la paternité qui se déploient dans les textes d’Aragon, et particulièrement dans Les Voyageurs de l’impériale, dont ils constituent une des problématiques essentielles. Il n’est pas indifférent à cet égard que le passage se situe en 1897, année de naissance d’Aragon. La culpabilité qui en émane entraîne chez Boniface la même « passion de servir » qu’évoque Suzanne Ravis (53) comme caractéristique d’Aragon. Le thème de la recréation de soi par soi-même, de l’auto-engendrement, qui se lit ici en filigrane et qui vaut à la fois comme élimination du père et intégration d’une paternité symbolique, est déjà esquissé dans Anicet (« plus fort que cet autre qui reconstruisit le monde, je me suis rebâti moi-même ») ; et il trouvera des développements dans l’œuvre d’Aragon, à travers des personnages et jusque dans la représentation du romancier, conçu de dans Théâtre/Roman comme fondateur d’une institution fantasmatique de soi à travers « cette existence, qu’au lieu de tenir d’un père, je me donne » (Gallimard, NRF, 1974, 21).
La présence du marais est récurrente dans les textes d’Aragon, associée à la question de la mort, de la renaissance et à celle de la création. Le marais est toujours davantage qu’un décor, une image qui hante l’imaginaire d’Aragon, liée sans doute à l’expérience de la guerre et de la boue des tranchées, et il appartient à sa « palette d’images » propre (Aragon emploie cette expression à propos de Matisse).
L’imaginaire aragonien du marais se caractérise par l’ambivalence. La dimension létale du marais est soulignée par le nom du tourbier dans La Semaine sainte : Eloy Caron a pour homonyme Charon et les méandres des tourbières en deviennent Styx. Certains se sont abîmés dans les marécages, Michel Sandor dans La Défense de l’infini, et le frère de Michel dans Les Voyageurs de l’impériale, tous deux « noyés de la terre ». Les similitudes d’écriture entre les séquences de Boniface et de Michel Sandor dans les marais (hormis leur issue car Boniface résiste à « l’invincible précipice » du sommeil, 261) ont déjà été soulignées, notamment dans l’édition de la Pléiade et dans un article de M. Vassevière, « Réalisme/Surréalisme des Voyageurs de l’impériale (Lectures d’Aragon, PUR, 132-133) et je ne citerai que le passage suivant, pour son dernier terme : « Mais les pas de Michel faisaient, disais-je un bruit de baisers sonores, vulgaires, paternels » Messidor, 1986, p. 98). Dans La Mise à mort, dans le deuxième Conte de la chemise rouge, « Le Carnaval », le magnétisme fatal de l’eau bourbeuse affecte également les faisans qui tombent comme des pierres, ivres de vertige, dans le Rhin débordé qui transforme le paysage alsacien en marécage, à la fin de la première guerre mondiale (Folio, 314-315).
Le marais est aussi l’image d’une profondeur cachée. Il est relié dans Les Voyageurs de l’impériale au thème de l’autre côté des choses, de l’autre versant de la réalité, du secret que toujours la réalité cache à montrer autre chose (comme Aragon l’affirme aussi de son écriture : « l’essentiel n’est pas ce qu’on dit, mais ce qu’on cache à dire autre chose », La Mise à mort, 335) et cette conception doit sans doute à sa situation familiale truquée. Suzanne Ravis observe que « L’envers des choses est un thème constant d’Aragon à partir de La Mise à mort », et qu’il « désigne […] l’arrière-texte de ce qui est dit, le vertige de l’indéchiffrable ou de l’indicible » (152).
Le marais métaphorise également l’être, ou du moins son passé et ses souvenirs enfouis, dans des vers d’Elsa qui font rimer « mes marais » avec « secrets » : et si une part de soi est en proie à l’enlisement, ce n’est peut-être pas la simple conséquence du temps et l’oubli mais l’effet d’une volonté d’obscurité. Le secret est lié à l’enfance, si l’on en croit le poème « Le Téméraire » du Roman inachevé, où s’entrelacent les motifs de la mort, du marais, du secret et de l’enfance.
Mais le marais maléfique est aussi le lieu de la renaissance de certains personnages (ainsi Marc-Antoine d’Aubigny dans La Semaine sainte laissé pour mort dans les tourbières va revivre, comme Suzanne et Boniface), et dans cette perspective revalorisée, il se fait également emblématique de la création littéraire. De Traité du style à Blanche ou l’oubli, le texte établit que le terreau est mouvant où s’enracine l’œuvre :
Mon style est comme la nature ou plutôt réciproquement (168-169)
Les fougères ! ici c’est chez toi. Partout, quand surgissent ces verdures inquiétantes, qui révèlent par leur plénitude un sous-sol infidèle et de dormantes eaux, ton royaume s’étend, où le lecteur se perd. Phrases sphaignes sphinges. [… ] La métallepse (sic) est de règle où la sauge fleuri. (Traité du style, Gallimard, L’imaginaire, 173-174)
Dans Blanche ou l’oubli les romanciers, ceux qui rêvent par écrit, sont des êtres enlisés :
Ceux qui se livrent à ce sport ont les yeux des gens pris en traîtres, les pieds, les jambes, le ventre, par un marais. Ils sont encore en ce monde, et déjà voient les profondeurs mortelles [[Blanche ou l’oubli, op. cit., p. 254. Dans L’Écriture de la terre dans l’œuvre romanesque d’Aragon, Amy Smiley analyse le lien profond entre le rapport à la terre et l’écriture.]]. (254, Folio)
Le marais représente les difficultés inhérentes à l’écriture, les menaces qui pèsent sur elle, obscurité et enlisement, mais aussi le triomphe sur ces difficultés.
Dans le personnage de Boniface se love une représentation, ou du moins une esquisse, du romancier victorieux : l’écrivain, par l’écriture, parvient à ne pas sombrer totalement ; la création est, tout autant qu’immersion funeste, émergence salvatrice.
C’est dire que Boniface est proche de son auteur, et la solitude est encore entre eux un point précis de conjonction. Aragon, seul de son nom, dans sa famille sera toujours hanté par le sentiment de son étrangeté ; il fait dire dans La Défense de l’infini, à Michel, ce personnage qui sombrera dans les marécages : « J’ai été frappé de solitude » (Messidor, 134), et il brodera des rêveries sur le fait que Soledad soit en espagnol un nom portée par des femmes, comme la marque affichée d’une irréductibilité aux autres et comme si Aragon en était l’équivalent masculin, l’autre nom espagnol de la solitude.
Boniface est lui aussi frappé au sceau de la solitude ; seul depuis son enfance, il part seul à la recherche de Suzanne (à l’inverse des autres, quand ils reviennent), il est seul pour affronter la nuit, les éléments et le marais, et il saura seul ce qui s’est passé, puisqu’il ne raconte rien : seul acteur et seul témoin de sa lutte et de sa victoire – ce qui confirme son statut de victoire intérieure). Par ailleurs, dans le roman, il est seul à faire une apparition aussi ponctuelle, les autres personnages de sous-romans « ébauchés » ( Dora, Méré, Georges Meyer) faisant l’objet de développement beaucoup plus longs.
A vrai dire, s’il n’est pas de « clangorante épopée », d’épopée déclamée, pour Boniface, il a tout de même deux autres témoins, son auteur Aragon bien évidemment, mais aussi le lecteur solitaire de Boniface qui atteint à une proximité hallucinée avec le combat et le corps de ce personnage dont nulle distance critique de l’écriture ne le sépare ; et ce lecteur n’est pas prêt d’oublier le gros plan qui fixe Boniface dans une posture sculpturale puissante, ni le ralenti opéré par et sur Boniface, l’arrêt sur image qui réduplique un mouvement à la limite de l’immobilité – et fait songer à la posture du lecteur, menacé peut-être d’enlisement dans le royaume au sous-sol infidèle où il se perd ?
Boniface est donc le lieu où fusionnent et peut-être s’annulent, dans le temps de la lecture, la solitude de l’écrivain et celle du lecteur ; et il est de ce fait aussi intriqué à la question de l’écriture.
Boniface apparaît donc comme un héros d’un type singulier, point de convergence de traits contrastés à l’image de la contradiction qu’il incarne d’emblée comme type. En deçà du portrait à l’emporte-pièce et de la classique épreuve héroïque, la simplicité du personnage enferme des questionnements complexes sur la constitution de la personnalité, sur les fondements de l’être et de la création. La geste secrète de Boniface est relié par des ramifications souterraines au roman, aux Voyageurs de l’impériale, dont il semblait diverger dans un fonctionnement pour soi. Boniface est profondément en harmonie avec l’imaginaire de l’auteur et quelques-unes de ses thématiques dominantes, et discrètement rattaché à sa conception du roman. Il incarne le refus du malheur vaincu par l’invention de soi que produit et signifie le geste d’écriture.
Il en va de Boniface un peu comme des mots, dont Aragon évoque la dimension cachée :
jamais un mot pour moi ne fait tableau à lui tout seul, mais lié à une multitude de pensées, de sons informes, de calembours, de cris, d’images […], tout un capharnaüm sensible, duquel je refuse de faire une seule fois abstraction. (« Préface à l’édition de 1924 » du Libertinage, La Pléiade, I, p. 283)
Personnage à part sous bien des aspects, il est donc aussi un personnage prismatique, une image constituée de couleurs et d’éléments qui se combinent en une configuration originale et poétique, mais appartiennent à un fond d’où en surgiront d’autres, au gré de l’incessante inventivité de l’auteur et de ce qu’il nommera « d’étranges gisements ayant entre eux des communications que j’ignorais » (Le Mauvais plaisant (suite), 1975, p. 382 de l’éd. renouvelée et augmentée par L. Follet de La Défense de l’infini (Gallimard, 1997).
Boniface, fragment d’un discours aragonien.