Corinne Grenouillet, « Les Cloches de Bâle d’Aragon… » (2001)
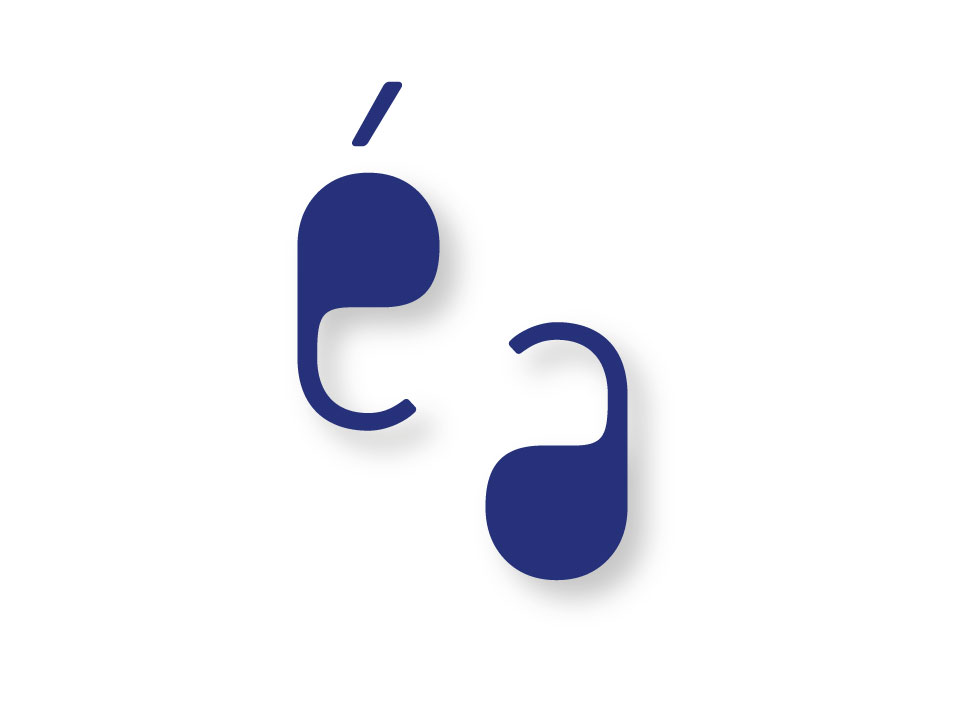
Les Cloches de Bâle d’Aragon : le roman à thèse,
interprète de l’histoire et la question de la « polyphonie »
Communication de Corinne Grenouillet au séminaire « L’écrivain et l’Histoire »
(animé par Gisèle Séginger et Éléonore Roy-Reverzy),
Université Marc Bloch, Strasbourg, 6 décembre 2001.
Cet article a été publié sous une version papier :
« Les Cloches de Bâle d’Aragon : le roman à thèse et la question de la polyphonie » dans Écriture(s) de l’histoire, textes réunis par Gisèle Séginger, Presses Universitaires de Strasbourg, 2005, p. 199-212.
Aragon disait à propos de Victor Hugo que ce qu’il appréciait par dessus tout chez l’écrivain des Misérables, c’était sa façon de mettre les pieds dans le plat. Nul doute qu’Aragon, à travers l’écriture de ses romans de la série du Monde réel, n’ait pas hésité, comme l’écrit Claude Roy[[[1] Claude Roy, « Aragon romancier » in Descriptions critiques, I, Gallimard 1949. Première publication : Europe n° 27, 1948.]][1], à mettre les pieds dans les plats pas toujours délicats de la réalité, de la politique, de l’argent, du roman. On peut ajouter que tout cela est une manière pour lui de mettre les pieds dans le plat de l’Histoire.
À la parution de La Semaine sainte en 1958 (qui retraçait la fuite du roi Louis XVIII au moment du retour de Napoléon en France lors des cent jours), Aragon s’était offusqué de l’éloge unanime fait autour de cette œuvre (à droite comme à gauche), qui le félicitait d’avoir écrit un roman historique enfin dégagé de toute propagande communiste ; il avait alors affirmé : « Tous mes romans sont historiques, même s’ils ne sont pas en costume ». Il s’agissait pour lui de restituer à son œuvre romanesque une cohérence que la critique lui déniait partiellement, en la tronçonnant en période ; « il n’y a pas de solution de continuité dans mon œuvre »[[[2] « Il n’y a pas de solution de continuité dans mon œuvre », entretien d’Aragon avec Jacqueline Piatier, Le Monde 13 septembre 1967.]][2], martèle-t-il dans les années 50 et 60 contre cette implicite doxa. Ainsi, il fut longtemps de bon ton de considérer qu’entre 1926 (Le Paysan de Paris) et 1958 (La Semaine sainte), Aragon n’avait rien écrit d’intéressant sur le plan romanesque. Les 4000 pages (3500) du Monde réel (3 tomes et demi de La Pléiade) était alors vu comme une sorte de trou noir dans l’œuvre, produit des errements politiques d’un écrivain qui avait fait le mauvais choix : celui du communisme.
Les Cloches de Bâle, premier roman de la série (qui va faire l’objet de ma communication[[[3] L’édition de référence sera le tome II des Œuvres romanesques complètes, Gallimard, Pléiade, 1997. Texte établi, présenté et annoté par Philipp Forest.]][3]) fut sans doute le plus mal aimé des romans d’Aragon (avec Les Communistes), sinon le moins étudié. Mal construit, du propre aveu d’Aragon[[[4] Par exemple dans « Il faut appeler les choses par leur nom » [1959] dans J’abats mon jeu, Mercure de France/Lettres françaises, 1992, p. 146.]][4], il portait aussi sans doute comme un fardeau, la bannière du « réalisme socialiste » qui lui fut accolée. Les éditions Denoël et Steele l’annoncèrent comme : « le premier exemple dans le roman français de ce réalisme socialiste que l’on a défini au premier congrès des écrivains soviétiques ».
Écrire un roman réaliste socialiste en 1934, c’est considérer que l’écrivain a un rôle militant à jouer et que ses écrits peuvent avoir une influence sur le lecteur, le conduire à une prise de conscience salutaire, et à avoir une action politique. Les rapports d’Aragon à l’histoire en cette période sont donc déterminés par son engagement politique : si l’histoire, c’est de la politique refroidie, la politique, c’est tout naturellement l’Histoire en train de se faire…
Dans ce cadre, écrire un roman historique, car Les Cloches de Bâle en sont un, même si le recul historique n’est que d’une vingtaine d’année (la diégèse du roman, paru en 1934, couvre les années 1911-1912), ne peut s’envisager en dehors d’un regard sur cette histoire, et par conséquent ne peut échapper à une thèse. Et cette thèse concerne aussi le temps présent des lecteurs, car il y a toujours superposition dans les roman d’Aragon entre la période de la diégèse et la période de l’écriture (au moment de la genèse de l’œuvre, mais aussi au moment de la réception).
La suspicion porté sur le genre du roman à thèse doit évidemment beaucoup au courant du nouveau roman et à la nouvelle critique, insistant sur la polysémie et l’autoréférentialité des textes littéraires : le message politique devient un crime lèse-littérature, puisqu’il transcende le « texte » en prétendant que celui-ci parle du monde et au monde. On citera la boutade de Claude Roy en 1947 (dans un bel article sur « Aragon romancier ») : « ce n’est pas tout à fait son genre à lui d’écrire des livres dont on dit qu’ils sont à thèse comme les corsets sont à baleines, c’est pour mieux t’étouffer mon enfant »[[[5] Claude Roy, op. cit., p. 110.]][5].
Pour aborder cette problématique du roman à thèse, j’ai choisi une perspective stylistique : il s’agit d’examiner ses liens avec la question de la polyphonie linguistique, notion centrale dans les travaux de Bakhtine, puis largement reprise (Ducrot etc.). Bakhtine oppose en effet deux types de romans, le roman polyphonique et le roman monologique ; ce sont chez lui, à la fois des notions littéraires et stylistiques.
Le roman polyphonique tel qu’il est défini dans La Poétique de Dostoïevski[[[6] Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski, traduit du russe par Isabelle Kolitcheff, présentation de Julia Kristeva, Seuil, 1970, 347 p. collection « Pierres Vives ».]][6] (désormais PD) se caractérise par l’individualisation des voix de chacun des personnages, indépendantes de celle de l’auteur. Le roman procède donc d’une « pluralité de mondes » et de « centres » liés à la conscience de chaque personnage (PD, p. 46). Toutes sont engagées dans une interaction, un dialogue avec autrui, et le discours de l’auteur lui-même n’a aucune supériorité sur celui du personnage. Au contraire, « le mot de l’auteur trouve en face de soi un mot à part entière, authentique et sans mélange, du personnage » (PD, p. 94)[[[7] Comme l’a indiqué Peytard, il faut entendre le terme russe slovo plutôt par discours ou énoncé que par notre terme mot comme unité linguistique intuitivement et spontanément identifiée par tout locuteur (Jean Peytard, Mikhaïl Bakhtine, dialogisme et analyse du discours, Bertrand Lacoste, 1995).]][7].
L’ensemble du roman est alors « structuré de façon à laisser l’opposition dialogique sans solution » (PD, p. 48) ; pas plus que l’auteur, le personnage n’a pas le dernier mot sur lui-même, il reste dans un état d’inachèvement… par ailleurs, si Dostoïevski s’avère être un grand peintre de l’idée, si chacun de ses héros est un idéologue, un homme de l’idée, nulle idée ne triomphe comme étant la “bonne” idée, celle qui représenterait une position de l’auteur. On assiste au contraire à un dialogue d’idées, qui témoignent de la grande attention d’un auteur aux discours idéologiques de son époque ou du passé récent.
Le roman polyphonique appelle en creux son contraire, le roman monologique, qu’incarne le roman russe “traditionnel”, Gogol et surtout Tolstoï. Là, l’auteur possède un « champ de vision excédentaire » par rapport au personnage, qu’il juge « par contumace » (PD, p. 111) et dont il n’admet pas de réponse. Ainsi repère-t-on aisément dans ce type de roman la position idéologique de l’auteur, à travers des idées qui sont explicitement affirmées. C’est clairement l’accent de l’auteur qui triomphe, son seul et unique point de vue. Les idées non partagées par l’auteur ne sont développés que comme caractérisation des personnages ou supports d’une réfutation ; la vision monologique suppose en effet qu’on détienne une vérité sur le monde.
Le roman monologique peut apparaître sous deux versions : la version “noble” du roman réaliste (russe) “traditionnel” et son avatar, régulièrement brocardé, le roman à thèse. On considère souvent le premier roman de la série du Monde Réel, à l’instar du dernier (Les Communistes) comme un roman à thèse de la pire espèce : celle où l’auteur prend littéralement le lecteur par la main pour lui expliquer sa façon de concevoir le monde et lui faire admettre une vision politique particulière. Roman du “passage” comme l’indique Philippe Forest dans l’édition de la Pléiade, c’est-à-dire du passage du surréalisme au communisme, il se distingue des livres antérieurs de l’écrivain, Anicet ou Le Paysan de Paris -avec lesquels on ne peut que constater une véritable rupture- par le choix de cette esthétique du réalisme socialiste, littérairement réactionnaire penseront certains, signalant le « reniement » d’un écrivain pour ce qu’il était jusqu’alors : un véritable maître pour toute une génération (Joë Bousquet comme Claude Roy disent qu’ils ont appris à lire dans Le Paysan de Paris).
Ce qu’il s’agira de montrer aujourd’hui, c’est comment la maîtrise et l’insertion du discours rapporté, en somme le travail du style d’Aragon qu’un critique a un jour qualifié de “pensé parlé”, fait des Cloches de Bâle un cas exemplaire de “roman à thèse” réussi (c’est-à-dire lisible aussi par ceux qui ne partagent pas les convictions politiques de l’auteur) et finalement un roman … lui aussi polyphonique… En somme, un véritable roman suscitant un réel bonheur de lecture, et non pas un simple manifeste révolutionnaire au service d’une cause.
Finalement, en étudiant la variété des procédés stylistiques d’insertion du discours d’autrui, on se trouvera confronté au paradoxe d’un roman monologique présentant des caractéristiques de la polyphonie. C’est là mon hypothèse principale.
La thèse développée dans le roman s’inscrit dans le cadre général d’une composition claire : Les Cloches de Bâle sont composées de trois parties et d’un épilogue. Chaque partie est dominée par un type de discours particulier, plus exactement par un rapport spécifique entre le mot de l’auteur et le mot des personnages. Ainsi, on passe du discours ironique de la condamnation (« Diane »), à un discours “empathique” et partiellement distancié d’avec le “mot” du personnage (« Catherine »), puis à un discours d’auteur s’appuyant sur la stylisation (« Victor »), avant de devenir monovocalement emphatique et lyrique dans la dernière partie (« Clara »).
Nous analyserons les différents types de relation au discours de l’autre, en commençant par ceux qui témoignent le plus nettement d’une vision monologique, avant d’aller vers ce qui la brouille partiellement.
1. Le mot d’auteur excédentaire et l’ironie
Le personnage de Catherine, jeune bourgeoise révoltée en rupture de ban, assume la mise en place de la thèse du roman. Personnage principal du roman, elle est une héroïne engagée dans une structure d’apprentissage : sa fréquentation du monde ouvrier va en effet lui permettre de s’ouvrir à la conscience socialiste et donc de délaisser l’anarchisme, le féminisme et l’individualisme de sa classe d’origine. Pour elle, l’épreuve décisive sera la grève des horlogers de Cluses de juillet 1904, qui déclenche une brutale prise de conscience et l’amène à rompre avec son amant, lequel incarne un ordre bourgeois détestable. Celui-ci a en effet choisi le camp des patrons armés qui tirent sur leurs ouvriers (p. 824).
La perception de Catherine, qui oriente une partie du texte, est parfois désolidarisée du discours du narrateur, lequel commente le cheminement idéologique du personnage, ses erreurs et errements. Dans ces moments, le monologisme de la thèse apparaît dans tout son éclat, comme dans ce passage où le narrateur commente la difficulté de son personnage à communiquer avec les ouvriers[[[8] On ne peut s’empêcher de lire derrière l’affirmation soulignée les difficultés d’Aragon lui-même dans ces années 30 où intellectuel et écrivain, il aspirait à devenir un parfait militant communiste en se fondant dans le moule d’un milieu social profondément étranger, voire hostile (les tendances ouvriéristes dominaient le Parti où l’on se méfiait des intellectuels), et cherchant à se convaincre de la supériorité du monde ouvrier. La probable dimension autobiographique du personnage de Catherine le rend d’ailleurs d’autant plus attachant et sympathique.]][8] :
« Cela, se masquant derrière les difficultés de langage, de vocabulaire, en imposait à Catherine pour une infériorité de leur part. Elle ne voyait pas que, bien souvent, tout était à l’inverse : c’était elle qui avait encore à discuter ce qui n’était en réalité que vestiges d’un autre siècle, et c’est peu dire, d’un autre monde. Et ils n’avaient pas des heures non plus à donner aux arguties, ils avaient leurs problèmes à eux, autrement pressants et immédiats » (p. 902).
On peut observer ici l’excédent discursif du “mot” de l’auteur, lequel est nettement en position de supériorité idéologique active par rapport à son personnage. En effet, il “voit” ce que Catherine “ne voit pas”, soit la supériorité des ouvriers et il atteint une “réalité” insoupçonné par elle, à savoir que son monde et ses préoccupations relèvent d’un « autre siècle » dépassés par la montée du prolétariat et la prise en main de leur histoire par les militants socialistes.
Particulièrement visible dans la première partie du roman « Diane » (mais présente ailleurs aussi), l’ironie est un procédé qu’Aragon utilise en virtuose pour dénoncer la classe qu’il condamne. Il l’exerce plus spécifiquement aux dépens d’un langage auquel sa sensibilité d’écrivain l’a rendu plus qu’un autre attentif. Dans les volumes du Monde réel, il y a une véritable jubilation de l’écriture ironique.
Si l’ironie est généralement considérée comme un phénomène relevant de la “polyphonie” linguistique parce qu’elle fait s’affronter au sein d’un mot deux accents opposés, elle n’en est pas moins un procédé fondamental de la monologie ; qu’on songe aux Contes de Voltaire, mais aussi à Flaubert où l’ironie est souvent clairement dirigée contre les représentations romantiques.
En fait, on se trouve confronté à deux acceptions contradictoires du terme polyphonie : chez Bakhtine (PD), la polyphonie a un caractère général, relève de et traduit une “vision”, liée au fait que l’auteur n’impose pas sa conception du monde, mais qu’il propose – dialogiquement, car il dialogue avec eux – les points de vue contradictoires, parcellaires, inachevés, des personnages.
L’ironie ou la mimèse ironique (Hamon[[[9] Philippe Hamon, L’Ironie Littéraire, Essai sur les formes de l’écriture oblique, Hachette supérieur, 1996, 158 p.]][9]) révèle certes d’une discordance énonciative (et donc d’une certaine forme de polyphonie), mais mise au service d’un point de vue souvent clair ; dans ce cas, il n’y a pas d’ambiguïté sur le “message” que l’auteur souhaite faire passer : pour Bakhtine, les romans de Flaubert (même et surtout Bouvard et Pécuchet) sont des exemples de romans monologiques.
L’exemple que nous voudrions analyser se situe dans la troisième partie du roman. La scène se déroule lors d’une de ces retraites militaires dans Paris dont Aragon fait ressortir toute la dimension propagandiste : il s’agissait de galvaniser consensuellement le patriotisme des foules tout en faisant pièce à la contestation sociale.
La narration de cette première retraite (début février 1912) utilise le procédé de la focalisation interne avec un personnage secondaire, Mme Lopez, maîtresse du Comte d’Évreux :
« Mme Lopez avait toujours aimé les militaires. La musique lui parut bien enivrante. Elle emboîta le pas des petits soldats. Ils l’entraînèrent avec d’autres comme le joueur de flûte qui se fait suivre par les souris. Du parc Monceau, on remontait vers Montmartre, et Mme Lopez fut toute surprise de se trouver boulevard Barbès, quand un olibrius, un ouvrier, probablement un étranger, excita la fureur des manifestants en ne se découvrant pas devant le drapeau. Il restait là comme un abruti, sur le bord du trottoir, avec sa casquette carrée sur sa tête. On la lui arracha, et la foule lyncha l’impudent. Un anarchiste peut-être. Ou un socialiste » (950, « Victor », XIII)
et p. 951 (début du chapitre XIV) :
« Le samedi 17 février, Paris vit encore une retraite militaire, plus éclatante que la première, mieux organisée. Il y avait, Dieu merci !, pas seulement des antimilitaristes à Paris. » (951)
Deux modèles littéraires ironiques me semblent apparaître en surimpression à ce passage, le célèbre début du chapitre III de Candide, où les qualifications élogieuses tendent à présenter la guerre comme un spectacle (« Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en enfer ») et le chapitre inaugural du Voyage au bout de la nuit (paru deux ans auparavant, très apprécié par Aragon et qu’Elsa Triolet traduisait en russe), où Bardamu se met à suivre un régiment qui passait en grande fanfare sous les encouragements de la foule des civils et se retrouve engagé : « on était fait, comme des rats » lit-on à la fin du chapitre.
Comme chez Céline (chez qui elle était toutefois implicite), le choix de l’image très railleuse du joueur de flûte insiste sur l’embrigadement d’une collectivité, sur l’anesthésie de la pensée, sur l’hypnose suscitée par la pompe militaire. Chez Aragon, elle se double de celle, tout aussi dépréciative des « petits soldats » qu’on suppose être de plomb… et comme les figurines d’un jeu d’enfant, facilement manipulables.
Le point de vue d’Aragon est clair (et redondant dans le roman) : dénoncer la montée du militarisme et du patriotisme, tout en mettant en évidence les rouages économiques qui allaient déclencher la première guerre mondiale. Le roman ne cesse de mettre en évidence l’intérêt qu’avaient les financiers et les industriels (la classe bourgeoise) au déclenchement de la guerre (notamment au moment de la crise du Maroc de septembre 1911 donnée comme le prélude à la grande guerre[[[10] Comme dans Les Voyageurs de l’Impériale, « Vingtième siècle », chapitre V et suivants.]][10]. Cf. le personnage de Wisner et ses liens avec l’aéronautique et l’armement).
C’est ce point de vue global, défendu dans l’ensemble du roman, qui permet en réalité une juste interprétation du passage et l’identification des termes (ci-dessus) soulignés comme mention du discours d’une sotte représentante de la bourgeoisie : on y repérera un lexique dévalorisant (olibrius, comme un abruti), des associations idéologiques d’extrême droite (l’équivalence est faite entre un ouvrier = un étranger = un anarchiste : trois représentants de l’anti-France), des jugements qui ne peuvent qu’être ceux d’une foule justifiant sa propre violence ou d’un témoin partial le faisant après-coup (l’impudent, excita), des modalisateurs (peut-être)… La narration est de toute évidence investie par le mot du personnage, dont se désolidarise un narrateur qui ne peut pas y adhérer, et qui, par la mimèse (c’est-à-dire la reprise des mots de l’autre) accomplit un acte d’évaluation négative[[[11]. « L’évaluation constitue donc le cœur même de l’acte d’énonciation ironique » (Hamon, op. cit., p. 30).]][11].
Le style ridiculise le personnage et surtout son discours, grâce à cette bivocalité au service d’une démonstration… on reste pourtant dans le monologisme car une voix condamne, l’autre est condamnée (tandis que chez Dostoïevski il y a “équipollence” des voix).
2. Stylisation de la narration par insertion du discours de l’autre
Lorsque le texte se consacre au personnage de Victor, il est en grande partie dépourvue de cette énonciation ironique perceptible ailleurs, ce qui s’explique par l’adhésion partielle, mais fréquente du “mot” de l’auteur et de celui du personnage. Pourtant linguistiquement, les procédés d’écriture ne sont pas fondamentalement différents de l’ironie et on peut là aussi utiliser le terme de mimèse.
Gréviste actif dans la grève des chauffeurs de taxi de 1911-1912, Victor est une figure de militant exemplaire à bien des égards[[[12] Même s’il ne l’était pas suffisamment aux yeux des lecteurs communistes du temps, le montre l’article de René Garmy dans L’Humanité du 30 décembre 1934, cité et analysé par Suzanne Ravis, « A comme anarchie : d’Anicet aux Cloches de Bâle », Recherches croisées Aragon/Elsa Triolet, Presses universitaires franc-comtoises, 2001.]][12] assez proche du Raoul Blanchard des Communistes, entré au parti socialiste en 1909, « un véritable militant de sa classe » (898). Il est un personnage positif, un lutteur, dont la première action, hautement significative, est de sauver Catherine du suicide, épisode tout romanesque qui permet la rencontre entre la jeune géorgienne et l’enfant de Levallois (fin de la partie « Catherine »).
Dès le chapitre IV de la partie « Victor », un changement de ton marque une rupture narrative : le récit principal suspendu, le roman propose un retour en arrière éclairant l’état civil et la biographie du nouveau venu. Ce changement affecte principalement le discours du narrateur, qui va abondamment se teinter du discours du personnage, qu’il s’agisse du lexique ou des appréciations modales. Aucun verbe introducteur n’indique qu’il s’agit de discours rapporté, le texte se contentant d’un sobre : « Et c’est ainsi que Catherine connut Victor » (p. 896). Ainsi, si l’on reprend la classification que Bakhtine donne dans Le Marxisme et la philosophie du langage, on doit parler de discours direct (dit parfois « libre ») dans une variante particulière : le « discours rapporté anticipé et dispersé, caché dans le contexte narratif [MB soul.]» (p. 186)[[[13] Difficulté d’analyse quand solidarité totale entre auteur et héros : « leurs voix, alors, se fondent et il se crée de longues périodes qui relèvent en même temps du récit de l’auteur et du discours intérieur (parfois même extérieur) du héros. Il en résulte un phénomène qu’on ne peut plus distinguer du discours indirect libre. Il n’y manque que l’interférence » (Mikhaïl Bakhtine, Le Marxisme et la philosophie du langage, essai d’application de la méthode sociologique en linguistique, traduit du russe par Marina Yaguello, Les Éditions de Minuit, 1977, p. 191).]][13].
Des expressions et une syntaxe empruntées au registre familier donnent le ton du “mot” représenté du personnage, qui, dans son enfance, se trouva parisien « par raccroc », « poussa » dans le bas de la rue de la Roquette, élevé par son beau-père : « Joseph l’aimait bien, Victor ». La narration de l’itinéraire du jeune chauffeur permet d’observer la contamination du discours du narrateur par celui du personnage. Léo Spitzer, cité par Dorrit Cohn[[[14] Dorrit Cohn, La Transparence intérieure, modes de représentation de la vie psychique dans le roman, traduit de l’anglais par Alain Bony, Seuil, 1981, p. 50.]][14], parle dans ce cas de « contagion stylistique », phénomène absolument caractéristique du style d’Aragon dans ses romans du Monde réel (qui mêle constamment le direct libre, l’indirect libre à la narration) :
« En 1901, on lui confia une bagnole. Il allait dans la nuit chercher des légumes dans les épandages d’Argenteuil ou dans la banlieue sud, et il revenait, au petit pas exténué des deux bêtes, ramenant son butin aux Halles, où il le déchargeait sur le carreau. Il dormait ensuite jusqu’à midi, mais l’après-midi il devait être à la boutique ; il travaillait quinze à seize heures. À son âge, ça ne lui faisait pas de mal, pas vrai ? N’empêche qu’à dix-huit ans on le flanqua sur le pavé, parce qu’il s’était battu avec le fils du patron, un baveux, qui voulait le faire trimer des heures de supplément à l’œil » (p. 898).
La présence dialogique de Catherine, interlocutrice avec laquelle Victor est « attablé » (p. 899), est sensible dans la recherche d’approbation que manifeste l’interrogative. Cette interrogative laisse entendre l’opinion de la mère ou de l’entourage du jeune Victor, justifiant l’exploitation intensive de la force de travail. On ne commentera pas les autres manifestations du “mot” du personnage, assez évidentes dans ce passage, mais on soulignera une nouvelle fois que l’art d’Aragon dans Le Monde Réel se fonde sur une représentation sociolinguistique à la fois précise et juste des discours de son temps.
Contrairement à ce que nous avons pu observer dans les passages mettant en scène Diane ou d’autres personnages liés à la bourgeoisie, le mot du personnage n’a aucun caractère de “bivocalité divergente” ; on n’y entend pas la voix critique ou l’ironie de l’auteur. La “stylisation” à l’œuvre ici relève bien d’une “bivocalité”, mais celle-ci, “convergente” (PD, ch. V).
Cette absence d’ironie, cet accord entre la voix du personnage et celle de l’auteur, ne peut être déduite, là encore, que du contexte général, de la représentation et du statut du personnage dans l’ensemble du roman. Par bien des traits, Victor se rapproche du héros positif que le réalisme socialiste appelait de ses vœux, notamment par sa connaissance immédiate et comme infuse du monde, en somme par ce que les communistes nommaient le “sens de classe”… Le point de vue de Catherine exprime ce mythe de l’ouvrier clairvoyant :
« Un regard peut-être, l’espèce de robustesse de Victor, plus que tout sans doute les brèves réflexions qui coupaient le récit de Catherine, et lui faisaient sentir à quel point cet homme, cet inconnu si totalement étranger à tout ce qu’elle avait voulu fuir, comprenait d’une façon directe, immédiate tout ce dont elle n’aurait jamais pu souffler mot à Martha par exemple » (899).
La positivité du personnage, « habitué à regarder la vie en face » (899), s’inscrit par ailleurs de manière redondante dans l’ensemble de son portrait physique et dans les traits qui l’opposent au financier Blaise Jonghens, flamand comme lui : « Il y avait dans le fond du teint ce coup de feu du grand air qui vient du travail et qui ne se confond pas avec le halage raisonné des sports » (899).
« Victor était pour elle un type humain absolument nouveau. Sa façon de parler, si choquantes que fussent ses idées, elle y voyait quelque chose d’exceptionnel, n’ayant jamais rencontré ces militants qui sont l’avant-garde de la classe ouvrière, rompus dès la jeunesse à la parole et à l’action » (903) : la voix idéologique du narrateur est particulièrement audible dans l’acte de présupposition affirmant l’existence bien réelle de l’« avant-garde ouvrière », postulat central du communisme et cliché du discours militant (et de ses dérives, ouvriéristes justement).
Ainsi les passages où s’entend le “mot” du personnage reçoivent-ils leur sens du contexte large où Victor apparaît comme ouvrier exemplaire et sectateur du travail (face à l’anarchiste Catherine qui le considère comme pure aliénation). S’il y a bien mimèse du discours de l’autre, celle-ci est dégagée de toute appréciation négative, toute contestation de la part de l’auteur, qui au contraire « s’install[e] dans le mot d’autrui » (PD, p. 252) en le phagocytant.
3. « Clara », les ambiguïtés du discours de l’auteur et les failles du roman à thèse
Les interventions directes de « l’auteur de ce livre » adressées à son lecteur se font de plus en plus fréquentes au chap III de « Clara » (L’épilogue). Il se présente tout d’abord comme témoin de la grande militante Clara Zetkin rencontrée « vingt ans plus tard […] presque mourante » (990)et substitue à l’illusion réaliste romanesque le gage de la véracité biographique. Première rupture.
L’inscription du discours d’auteur prend ensuite la forme suivante, évoquant Catherine :
« Entre toutes les images du monde et ses yeux s’interposent de récentes images, celles que sa mémoire a gardées de la prison. Toute la déchéance et toute la grandeur humaines. Elle a vu à Saint-Lazare des prostituées et des ouvrières. Tout est un peu plus affreux qu’on ne l’imagine : mais il en est resté dans son cœur une certitude. Elle sait maintenant ce qu’est le sort des femmes. Elle sait qu’à tout prendre, il y a deux sortes de femme. Elle est sortie du parasitisme et de la prostitution. Le monde du travail s’ouvre à elle. Il avait raison, Victor.
Il avait raison, Victor, mais je ne puis plus parler de Catherine. Hésitante, vacillante Catherine, comme elle s’approche lentement de la lumière.
[…] Je prends Clara Zetkin comme un exemple, mais tout me ramènerait invinciblement à elle » (992).
Au mépris des conventions romanesques tacites qu’il a adoptées précédemment, l’auteur a donc pris la parole en son nom propre pour dégager le sens de son roman, et, selon le mot d’Henri Mitterand, il ne va plus lâcher la main de son lecteur. Le passage souligné fonctionne bien comme épilogue idéologique, marquant le terme de l’apprentissage politique de l’héroïne principale. Le choix du verbe savoir permet d’entendre le présupposé d’auteur derrière la prise de conscience du personnage. Le jugement de valeur est clair qui donne raison à l’ouvrier militant contre le féminisme anarchiste de Catherine.
Dans un premier temps, l’épilogue fonctionne donc comme affirmation ostentatoire, voire naïve de la “thèse” idéologique du roman. Mais, comme toujours avec Aragon, les choses ne sont pas aussi simples.
Les commentaires qui vont suivre, iront en effet bien au-delà du sens idéologique du roman en prenant la forme d’une auto-critique assez ambiguë, du moins très inattendue dans ce contexte :
« On dira que l’auteur s’égare, et qu’il est grand temps qu’il achève par un roulement de tambour un livre où c’est à désespérer de voir surgir, si tardivement cette image de femme qui aurait pu en être le centre, mais qui ne saurait venir y jouer un rôle de comparse. On dira que l’auteur s’égare, et l’auteur ne le contredira pas. Le monde, lecteur, est mal construit à mon gré, comme à ton gré mon livre. Oui, il faut refaire l’un et l’autre, avec pour héroïne une Clara, et non point Diane, et non point Catherine. Si je t’en donne un peu le goût, la simple velléité, tu peux déchirer ce bouquin avec mépris, que m’importe ! » (992)
Prévenant de manière solennelle et quasi-prophétique toute contestation critique (notamment à sa “gauche”, c’est-à-dire du côté des camarades du Parti), Aragon manifeste ici la conscience de l’inaboutissement formel de son roman, de son incapacité à faire d’une héroïne entièrement positive un personnage véritablement incarné, aporie d’ailleurs propre au genre réaliste socialiste[[[15] « Le héros positif ne peut être qu’un horizon, une limite à atteindre dans l’indétermination, une visée. Dans l’écriture de la représentation, il n’est pas figurable en tant que tel, son sociogramme peut alors travailler, demeure actif, jouer sur une frontière, une bordure, un horizon. Le sociogramme du héros positif devient la trace même de cette visée » (Régine Robin, Le Réalisme socialiste, une esthétique impossible, préface de Léon Robel, Payot, 1986, p. 316).]][15].
Le livre est donné comme dépourvu de valeur propre, plus exactement cette valeur est mesurée à l’aune de l’action militante et par conséquent se résout toute entière dans le projet politique. Or, à l’endroit de la plus grande “monologie”, Aragon ne réinstaure-t-il pas un dialogue ouvert avec le lecteur, adouci (ou irrité !) par la rhétorique d’une tardive captatio benevolentiae, en anticipant sur ses réactions et en lui laissant finalement la liberté de ses choix ?
Ce « véritable dialogisme » qui intervient dans les parties 3 et 4, « celles de la fraternité » avait été analysé par Henri Mitterand : « Tout se passe comme si le romancier venait de découvrir un nouveau rapport aux autres et prenait en compte, dans l’exercice même de la parole romanesque, l’exigence d’une réflexion à plusieurs voix, au moins duelle, sinon plurielle, sur la vie sociale et les conflits politiques »[[[16] Henri Miterrand, « Les trois lecteurs des Cloches de Bâle », Europe n ° 717-718, janvier-février 1989, p. 119.]][16]. C’est peut-être aller un peu loin et tirer trop violemment le roman du côté d’un dialogue et d’une pluralité… Toutefois, l’intérêt du roman réside aussi (et surtout) dans tout ce qui affecte la représentation monologique et que S. Suleiman nomme la « revanche de l’écriture »[[[17] Susan Rubin Suleiman, Le Roman à thèse ou l’autorité fictive, PUF, 1983, 314 p.]][17]…
Les failles du roman à thèse sont de plusieurs ordres, même si nous ne pourrons pas toutes les analyser ici (et ne peuvent bien sûr se résumer à des questions de style).
a. Le lyrisme du discours de l’auteur dans la dernière partie a une fonction ambiguë : explicitement, il sert la thèse, mais les moyens utilisés ont un tel caractère d’excès qu’il y a là comme un débordement du message idéologique. On citera la représentation du dernier discours de Jaurès fondée sur l’incantation : « J’appelle les vivants, je pleure les morts et je brise les foudres », ou le lyrisme du dernier chap. « La femme des temps moderne est née, et c’est elle que je chante./ Et c’est elle que je chanterai » (p. 1001).
b. L’invention de certains personnages, comme Mme de Lérins, perceptrice farfelue de l’enfant Guy dans la première partie, ne peut être rattachée à l’énonciation d’une thèse quelconque : elle relève au contraire d’une sorte de gratuité jubilatoire (et par moment réellement comique dans le cas de Mme de Lérins), eu égard à la “thèse” du roman. Aragon comme souvent dans les pages du Monde Réel, écrit une page oblique de son autobiographie, et rend hommage à travers ce personnage à la femme qui lui a appris à lire.
c. L’analyse de la question politique concrète posée par la question du légalisme ou de l’illégalisme dans le mouvement de grève (faut-il suivre ou non des méthodes “dures”, saboter ou non l’outil de travail, c’est-à-dire les taxis…) montre qu’Aragon n’a pas choisi, contrairement à ce que le Parti communiste pouvait attendre, de discréditer totalement les positions anarcho-syndicalistes défendues par le personnage de Bachereau. Nous reprenons ici les analyses de Suzanne Ravis[[[18]. Suzanne Ravis, « A comme Anarchie, d’Anicet aux Cloches de Bâle », Recherches croisées Aragon/Elsa Triolet n° 7, Presses universitaires franc-comtoises, 2001, collection « Les Annales littéraires » n° 719, p. 249-294. ]][18].
Pratiquement dans le chapitre IX (« Victor »), ce sont de long passages en discours direct qui donnent voix à ses positions : « C’est pourri, disait-il, leur politique. N’en faut pas ! », déclare Bachereau. Ce personnage aspire à « La grève générale ! », est partisan des manières fortes : « qu’on leur brûle leurs voitures, qu’on leur casse la gueule ! » (922). En revanche, les répliques de Victor, soutien de Fiancette, le patron des syndicats, et plutôt légaliste, est en discours indirect. Ces deux procédés ne s’opposent pas dans le sens où l’auteur favoriserait par l’utilisation de tel type de discours telle opinion politique. Au terme de ce chapitre, il est en effet difficile d’identifier à coup sûr la “bonne” attitude que les grévistes auraient dû adopter face aux « renards » ou au sabotage, même si l’emploi d’un verbe comme « hurlait » tend à souligner le caractère excessif (et donc politiquement peu efficace) de la révolte de Bachereau.
La condamnation des méthodes de l’illégalisme se réalise de manière plus subtile (comme l’a montré Suzanne Ravis), par la présentation objective (omnisciente et dépourvue d’appréciations) des amalgames que la presse d’alors faisait entre les illégalistes et les tueurs de la Bande à Bonnot, presse qui discréditait ainsi les justes revendications des chauffeurs de taxi.
Ainsi Aragon s’adosse-t-il à la condamnation communiste “officielle” des actions illégales, sans transformer son roman en bannière politique… et tout en refusant de prendre explicitement position entre les deux voies possibles de la révolte ouvrière.
d. L’ambiguïté du texte par rapport à l’histoire de la Bande à Bonnot qui a défrayé la chronique et les passions en 1912 est tout a fait notable (elle aussi été étudiée par Suzanne Ravis). Outre une fonction évidente d’illusion référentielle, de recréation réaliste du contexte historique des années 1911-1912 (au même titre par exemple que la référence ironique au naufrage du Titanic, p. 975), la présence de l’« Odyssée sanglante » des « bandits tragiques » dans le roman revêt une signification symbolique et complexe. Le texte contribue en effet à faire de la mort de Bonnot une apothéose lyrique et dénonciatrice en dressant « en figure sacrificielle le personnage de Bonnot, comme un héros accusateur face à un “ordre” social criminel »[[[19] Suzanne Ravis, op. cit., p. 287.]][19] : « un seul homme, écrit Aragon suffit à éclabousser, de son sang et de sa cervelle, les défenseurs d’un ordre, qui deux ans plus tard allait s’auréoler de millions de cadavres » (p. 979). Cette “héroïsation” du « révolté abattu »[[[20] Ibid.]][20] pose la question de la clarté du message politique et constitue une des failles les plus visibles dans l’édifice du roman à thèse.
On a bien là cette « revanche de l’écriture » que Susan Rubin Suleiman identifiait dans le personnage de Carlotta des Beaux Quartiers : « La manifestation la plus claire du débordement, c’est lorsqu’un personnage dont la valeur dans le super système idéologique de l’œuvre est fortement négative réussit à devenir charmant, c’est-à-dire à exercer une certaine séduction sur le lecteur »[[[21] Susan Rubin Suleiman, op. cit., p. 247.]][21].
La séduction exercée par la Bande à Bonnot s’appuie sur la concordance entre deux appréciations, celle du personnage de Catherine qui les « trouvait admirables. Seuls contre tous ! Le browning en main, ils défiaient la société. » (926), auquel répond le propos de l’auteur, lorsqu’il s’élève contre « l’hallali » de la mise à mort de Bonnot : « Plus de mille hommes suffisent à en abattre un seul » (978) ou lorsqu’il qualifie l’aventure de la Bande à Bonnot de « terrible et grande » (978)
Les deux « mots » se renforcent l’un et l’autre par leur co-présence ; l’effet produit par cette redondance est de brouiller la clarté de la démonstration idéologique. La page de l’anarchie a beau être brusquement tournée dans le paragraphe suivant (« Mais avec Bonnot, en France, agonise l’anarchie » etc.) et le roman galoper vers sa fin, subsiste pour le lecteur une “impression de lecture” (Ravis) favorable à l’anarchie et à la violence de sa révolte.
Conclusion
Le roman à thèse interprète l’Histoire puisqu’il évalue la démarche, les pensées et les discours de personnages impliqués dans des événements historiques précis : montée de la guerre dans les années 1911-1912 ou grève des taxis parisiens.
Mais il apparaît aussi nourri de tensions : même si le “message” du roman apparaît clairement dans les commentaires sur l’évolution de Catherine, dans la stylisation de la narration, dans le lyrisme de l’épilogue ou dans les appels au lecteur, le monologisme de la thèse présente des failles, soit que des positions contradictoires soient par moment défendues de manière égalitaire (illégalisme et légalisme au moment de la grève des taxis), soit qu’une position contestée soit en fait nimbée d’attrait (la révolte anarchiste de Bonnot), soit que l’écriture déborde l’étroitesse du cadre idéologique (par la création de personnages fantaisiste, par le lyrisme ou la démesure).
Sur le plan de l’écriture, la qualité “littéraire” des Cloches de Bâle, provient d’une polyphonie (linguistique) constitutive du roman moderne, fondée sur le tressage des discours d’auteur et d’autrui (grâce à l’ironie, la stylisation etc.). Certes, nous ne pouvons identifier ce que Bakhtine apprécie au plus haut point dans les romans de D., à savoir cette incertitude sur le “sens” définitif du roman, ni la façon dont elle se manifeste à travers les phénomènes propres à une poétique particulière (celle de Dostoïevski), de « polémique interne cachée », de « confession à coloration polémique » ou de ces « mots » qui ont toujours un « coup d’œil de côté sur le mot d’autrui » (PD, chap. V, p. 253 et suivantes).
Nous espérons avoir montré ici la complexité de l’écriture d’un roman souvent tenu pour manqué, sans prétendre toutefois nous hausser à la hauteur des exigences de l’Aragon surréaliste ! : « Je demande à ce que mes livres soient critiqués avec la dernière rigueur, par des gens qui s’y connaissent, et qui sachant la grammaire et la logique, chercheront sous le pas de mes virgules les poux de ma pensée dans la tête de mon style »[[[22] Aragon, Le Traité du style, Gallimard, L’Imaginaire, p. 47.]][22].


