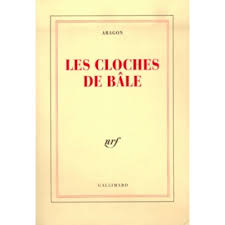Emmanuel Rubio, « Hegel, l’amour et « Le Paysan de Paris » », (2003)

Cet article d’Emmanuel Rubio est publié en ligne avec l’aimable autorisation de l’auteur et des Presses Universitaires de Provence
Emmanuel Rubio, « Hegel, l’amour et Le Paysan de Paris » dans L’Atelier d’un écrivain. Le XIXe siècle d’Aragon, textes réunis par Edouard Béguin et Suzanne Ravis, Publications de l’Université de Provence, « Textuelles », 2003, p. 55-69.
Aragon, de ses premiers écrits aux nombreux témoignages et souvenirs de la fin de sa vie, a souvent souligné l’importance d’Hegel pour sa formation, comme pour toute sa période surréaliste. Il était assez naturel, de ce fait, que la critique aborde couramment à propos du Paysan de Paris le rapport à Hegel, et nous ne saurions prétendre innover sur ce point. Il faut pourtant le reconnaître : la complexité de l’écriture aragonienne, sa recherche de l’image, la manière dont les références y apparaissent le plus souvent comme cryptées, voilées, transposées, ne sont pas pour faciliter le travail d’interprétation. Et ceci d’autant plus que la réception du philosophe, en ce début de vingt-et-unième siècle, diffère profondément de celle que pouvait offrir le début de siècle précédent. Il importe ainsi de revenir à cette présence, et ce avec une attention toujours plus grande au texte : au texte d’Aragon bien sûr, mais aussi au texte du philosophe tel que pouvait alors le lire le poète. Et de tenter de situer véritablement le rapport entre ces deux textes, qui tisse aussi un rapport tout à fait particulier entre la poésie et la philosophie. Notre travail, dans ce cadre, ne pourra nullement prétendre proposer une synthèse définitive. Mais il pourra peut-être tenter d’explorer un versant méconnu de cette confrontation : le discours de l’amour.
La philosophie hégélienne apparaît à deux moments déterminants du Paysan de Paris, puisqu’elle semble avoir inspiré à la fois son commencement et sa fin, et encadrer ainsi tout le développement poétique. La quête d’une mythologie moderne, à laquelle convie la « Préface à une mythologie moderne », peut apparaître, au premier abord, peu hégélienne. On ne peut s’empêcher pourtant, à lire la critique de la certitude qui fait le fond de cette même préface, de la rapprocher de certains développements du philosophe. La certitude cartésienne a subi il est vrai d’autres assauts philosophiques, et la vindicte d’Aragon contre le pouvoir démesuré de la raison et de l’esprit d’analyse semble d’abord s’appuyer sur l’éloge des sens. Immédiatement pourtant il dénonce la « fausse dualité de l’homme »[[[1] Louis Aragon, Le Paysan de Paris, Gallimard, coll. Folio, 1987, p. 13. Les chiffres entre parenthèses, dans le texte, renverront désormais aux pages de cette édition.]][1] et prend conscience « que ni les sens ni la raison ne peuvent, que par un tour d’escamoteur, se concevoir séparés les uns de l’autre, que sans doute ils n’existent que fonctionnellement » (14). Le rejet du matérialisme, explicite dans ces pages, défend quant à lui de les interpréter dans le sens du sensualisme ou de l’empirisme positiviste. Faut-il supposer, dans l’allusion tacite à un principe qui unirait les sens et la raison, une référence à l’« esprit » si prisé des surréalistes en ces années ? C’est l’imagination, en fait, qui apparaît explicitement comme le principe premier : « imagination de la raison », « imagination des sens », « c’est toujours l’imagination seule qui agit », et elle seule qui nous offre le sentiment du réel (14). Il n’en est pas moins vrai que l’opposition initiale est rapidement abordée selon des termes qui rappellent de toute évidence la dialectique hégélienne, et lui empruntent ses exemples les plus pédagogiques :
« La lumière ne se comprend que par l’ombre, et la vérité suppose l’erreur. Ce sont ces contraires mêlés qui peuplent notre vie, qui lui donnent la saveur et l’enivrement. Nous n’existons qu’en fonction de ce conflit, dans la zone où se heurtent le blanc et le noir. » (15)
Il n’en est pas moins vrai, enfin, que ce jeu d’oppositions, loin de se figer, mène à un véritable processus qui se substitue à l’idée d’une vérité métaphysique et immuable :
« Je ne veux plus me retenir des erreurs de mes doigts, des erreurs de mes yeux. Je sais maintenant qu’elles ne sont pas que des pièges grossiers, mais de curieux chemins vers un but que rien ne peut me révéler, qu’elles. » (15)
De telles réflexions nous rappellent ainsi fortement celles de Benedetto Croce, dans Ce qui est vivant et ce qui est mort dans la philosophie de Hegel, sur ce même rapport entre l’erreur et la vérité – même si le philosophe s’opposait finalement à la transformation hégélienne de la « phénoménologie de l’erreur » en « histoire idéale de la vérité »[[[2] Benedetto Croce, Ce qui est vivant et ce qui est mort dans la philosophie de Hegel, Giard et Brière, 1910, p. 84-87. Ce livre fut très pratiqué par les surréalistes, et Aragon y renvoie clairement dans la suite du texte : « Ainsi j’éprouve la force de mes pensées, ainsi je me demande ce qui est mort en moi, ce qui est encore efficace » (185, nous soulignons).]][2]. Ruse des sens, ruse de la raison, le parcours mythologique amorcé ici par Aragon, et sans cesse soumis au devenir, cette « science vivante qui s’engendre et se fait suicide » (16) n’est pas sans point commun avec le processus historique de production de la vérité par le mouvement dialectique cher à Hegel. Celui-ci, dans sa Philosophie de la religion, dont il rappelle les principes dans la préface de la Logique[[[3] « Comme c’est un besoin irrésistible de la pensée qui se révèle dans ces manifestations extérieures et passagères dont je viens de parler [les religions, mythologies, philosophies gnostiques et mystiques des temps anciens et modernes], c’est aussi le besoin de toute pensée qui s’est élevée jusqu’à l’esprit ainsi que le besoin de son temps, et par conséquent le seul objet digne de notre connaissance que de manifester, dans, et par la pensée, ce qui jadis ne s’était manifesté que comme un mystère », G. W. F. Hegel, Logique, Ladrange, 1859, t. I, p. 194 – référence abrégée dans la suite du texte en L. Il existe une seconde édition de la traduction Véra, augmentée et publiée en 1874. La citation que nous examinerons plus haut sur la « différence des sexes » ne s’y retrouve pourtant pas telle quelle. Il convient donc de se reporter à cette première édition.]][3], n’a-t-il pas lui-même intégré les productions mythologiques et religieuses dans un développement intellectuel propre à l’histoire de l’humanité ? De l’imagination aragonienne à l’Idée hégélienne, le passage n’est pas évident. Un lien, dans la pensée du poète n’est pourtant pas impossible.
Il importe, afin de s’en rendre compte, et avant de se reporter au « Songe du paysan » qui clôt l’ensemble du livre, d’éclairer une autre allusion au philosophe, moins explicite que les deux autres, et pourtant significative. Aragon, on le sait, aime à faire paraître, parmi les personnages de ses œuvres, les figures majeures qui ont pu marquer son parcours intellectuel et poétique. Anicet ou le panorama en est un bon exemple, mais Le Paysan de Paris n’est pas en reste, qui aux côtés du « petit chien Freud » ou de Nana, caricature Schelling, le compagnon des premiers jours du jeune Hegel, sous la forme d’un vieillard sénile jouant au cerceau. Un personnage, dans cette optique, peut attirer notre attention : l’Imagination. Son entrée en scène intervient en effet dans un climat saturé d’allusions philosophiques. Introduite par le « sophisme » du « petit Emmanuel » Kant, comprenant la citation du Phédon naguère repérée par Michel Apel-Muller, la saynète « L’Homme converse avec ses facultés » (76) met en scène une partition de l’esprit dont on sait qu’elle reste attachée pour ce début de vingtième siècle à la critique qu’en a fait Hegel, reprise et célébrée par tous ses disciples, surréalistes y compris – que l’on pense au chapitre « Le Sac à facultés » du Clavecin de Diderot de Crevel. L’ironie est assez évidente et touche particulièrement la Volonté, « se relevant d’une bouteille de champagne » (76), et décidant de son plein gré de suivre l’homme là où il ira. La nocivité du compartimentage de l’esprit apparaît elle aussi assez nettement : l’homme, prisonnier de ses facultés divisées, est réduit à l’inactivité, et la connaissance abandonnée est quasiment agonisante. Seule l’Imagination est présentée sous un jour bénéfique : défendue par l’homme contre ses méfiantes facultés, elle semble capable de mettre fin à leur cacophonie, dans la mesure où elle produirait et saisirait tout à la fois le réel. De ce point de vue, on remarquera que la structure conceptuelle de la « Préface à une mythologie moderne » est parfaitement reprise. La scission néfaste entre la raison et les sens se poursuit ici dans le dialogue entre la Sensibilité et une Intelligence qui se fait à nouveau le champion de la « certitude » – « Je n’aime pas l’incertitude » (79) -, tandis que l’Imagination apparaît comme le véritable principe originel, maîtresse des illusions, comme dans la préface, et seule garante du réel :
« A la guerre comme à la guerre. Vous tous, avec votre façon de faire contre fortune bon cœur, vous aviez compté sans moi. D’une illusion à l’autre vous retombez sans cesse à la merci de l’illusion Réalité. Je vous ai tout donné pourtant : la couleur bleue du ciel, les Pyramides, les automobiles. » (80)
Un point, à partir de là, est à noter : l’Imagination est présentée comme l’unique médecin au chevet de la connaissance. Cette caractéristique tend ainsi, dans le contexte philosophique que nous avons souligné, à la présenter comme un philosophe. Est-il insignifiant, dans ce contexte, que cette pourfendeuse de facultés, que cette idéaliste déclarée s’associe explicitement à l’enseignement hégélien ?
« Le pouvoir de l’esprit, je l’ai dit en 1819 aux étudiants d’Allemagne, on en peut tout attendre » (80),
déclare l’imagination. Or cette proclamation rappelle un papillon surréaliste, dûment signé celui-ci :
« On ne saurait rien attendre de trop grand de la force et du pouvoir de l’esprit. HEGEL. »[[[4] Tracts surréalistes et déclarations collectives, t. I, Losfeld, 1980, p. 33.]][4]
Le cadre lui-même s’éclaire tout à fait dès lors que l’on rend cette citation à son contexte original : le discours inaugural de Hegel à l’université de Berlin daté, pour être précis, non de 1819, mais d’octobre 1818, et traduit par Véra en ouverture de la Logique (L, t. I, p. 161 et sqtes)[[[5] On remarquera cependant que le texte du papillon ne correspond pas tout à fait à celui de la traduction de Véra : « On ne saurait rien penser de trop grand de la grandeur et de la puissance de l’esprit » (L, t. I, p. 169). Une telle divergence, à moins qu’elle ne soit due à un travail de récriture de la part des surréalistes, témoignerait ainsi de la nécessité de se reporter à un autre intertexte reproduisant le discours hégélien, que nous n’avons pas réussi à identifier.]][5]. La qualité d’étranger, de médecin d’une connaissance abandonnée de tous prend ici un sens nouveau, et entre en résonance avec le même discours aux étudiants berlinois, pour lequel la philosophie, dans les autres pays, n’existe plus « qu’à l’état de souvenir ou de pressentiment » :
« C’est en Allemagne que cette science s’est réfugiée et qu’elle vit. C’est à nous qu’a été confiée la garde de cette lumière divine, et c’est notre devoir de l’entourer de nos soins, de la nourrir, et d’empêcher par là que ce que l’homme possède de plus élevé, la conscience de son essence, ne périsse. » (L, t. I, p. 165)
L’aspect physique, sur lequel Aragon revient à deux reprises, est lui-même intéressant : le « bonnet à poil », la « grande redingote fourrée », si étranges aux yeux de l’Intelligence, peuvent rappeler l’habit du philosophe sur des gravures devenues classiques, et qu’Aragon pouvait voir dans le précis de Paul Archambault paru en 1911 : Hegel, choix de textes, qui offrait une anthologie des traductions Véra et Bénard. Le portrait, il est vrai, ne correspond pas tout à fait. Les « moustaches à la Habsbourg » (79), prêtées par Aragon à son personnage, ne se retrouvent sur aucun portrait de Hegel, et l’on ne saurait réduire à la seule évocation du philosophe une figure dont le caractère hétéroclite témoigne autant du pouvoir unificateur de l’imagination que de l’humour aragonien[[[6] « Ce brave et digne médecin étranger qui habite la maison isolée […] cette maison sur la hauteur, qui est bâtie avec les lettres d’une phrase ancienne », participe aussi de Paracelse, dont Aragon indique implicitement le jeu de traduction qui a décidé de son nom de plume. Rappelons que « Paracelse […] assemble une racine grecque, para (vers), et une racine latine, cels (élevé) […] Paracelse signifie donc : vers les hauteurs, du côté des sommets. C’est la traduction du mot allemand Hohenheim [véritable nom du médecin-philosophe] : une maison élevée, haut située. » (René Allendy, Paracelse, le médecin maudit, Dervy-Livres, 1987, p. 22). Un certain nombre de portraits du médecin correspondent eux aussi avec l’habit décrit par Aragon. Notons seulement que cette association entre Paracelse et Hegel peut confirmer une lecture du philosophe plus orientée vers ses sources romantiques, sinon occultistes, que vers sa postérité marxiste – et favoriser, par l’analogie entre le microcosme et le macrocosme professée par le médecin, l’association entre la femme et la nature que nous étudierons plus loin.]][6]. Il peut pourtant être intéressant de voir associées par le poète l’Imagination – en amont des sens et de la raison – et la philosophie hégélienne. Cela tend en effet à confirmer notre lecture initiale et à situer la recherche aragonienne de la connaissance, par l’erreur, par la quête mythologique, par l’abandon aux forces de l’imagination, dans le prolongement d’un hégélianisme perçu comme une figure possible de cet idéalisme de l’imagination qui semblait plutôt redevable à Schelling et à ses disciples poétiques – Baudelaire par exemple, et sa « reine des facultés »[[[7] « Mystérieuse faculté que cette reine des facultés ! […] Elle est l’analyse, elle est la synthèse […] Elle est la sensibilité, et pourtant il y a des personnes très sensibles, trop sensibles peut-être, qui en sont privées. C’est l’imagination qui a enseigné à l’homme le sens moral de la couleur, du contour, du son et du parfum. […] Comme elle a créé le monde (on peut bien dire cela, je crois, même dans un sens religieux), il est juste qu’elle le gouverne. », Charles Baudelaire, Salon de 1859, in Curiosités esthétiques / L’Art romantique, Garnier, 1990, p. 321.]][7]. Le rapprochement est d’autant plus probant que l’Imagination unit aussi à la figure du philosophe l’ensemble du projet surréaliste. Le vieillard tient à la main Au 125, Boulevard Saint-Germain, de Benjamin Péret ; la citation du discours inaugural berlinois, par le truchement du papillon, mêle l’histoire philosophique et l’histoire du surréalisme. Mieux, le léger décalage, de 1818 à 1819 – imputable peut-être à une source qui reste à repérer – lie la découverte de l’automatisme au centenaire de l’exorde philosophique. Plusieurs temporalités se mêlent ainsi, comme dans l’édifice hégélien lui-même : la quête mythique sur le plan individuel, sa prolongation sur le plan des mouvements intellectuels historiques, où le surréalisme prolonge l’idéalisme allemand, l’ensemble se dirigeant vers la possession toujours approfondie de la « connaissance concrète ».
Cette prolongation d’ailleurs ne signifie pas nécessairement une parfaite identification. Et le surréalisme aragonien, s’il se définit de toute évidence par rapport au processus dialectique hégélien, ne se confond pas avec lui. « Le Songe du paysan », en fin de parcours, tient à préciser la position du poète par rapport au philosophe, et éclaire ainsi nos analyses précédentes. Aragon salue « l’idéalisme transcendantal » – qu’il associe très généralement au mouvement allant de Kant à Hegel – comme l’entreprise « la plus haute que l’homme ait rêvée, comme une étape nécessaire de l’esprit » (237). Mais marquant son « échec », et fidèle au mouvement renouvelé de ce même esprit, il situe le surréalisme comme la relève poétique de l’idéalisme allemand. La discussion se fait en deux temps. Elle passe d’abord par l’affirmation d’un athéisme rigoureux et de l’abandon de toute résolution philosophique par la divinité. Elle entame ensuite, et nous retrouvons ici notre philosophe, une discussion serrée de la structure même de la Logique hégélienne. Cette discussion, nous ne pourrons l’aborder en détail dans ce cadre. Commençons simplement par remarquer qu’elle s’appuie sur une connaissance réelle de l’ouvrage, qui a certainement fait partie des lectures mentionnées à Jacques Doucet lors de l’été 1924[[[8] Lettre à Jacques Doucet du 4 août 1924 : « Je partage mon temps, en costume de bain, entre Schelling et Hegel d’une part, et de l’autre la mer. », Louis Aragon, De Dada au surréalisme, papiers inédits 1917-1931, Gallimard, 2000, p. 72.]][8]. La logique hégélienne, on le sait, diffère des logiques traditionnelles en ceci qu’elle refuse de distinguer une logique subjective entièrement séparée du monde objectif et qu’elle prétend au contraire, selon l’introduction de Véra, à « l’absolue logique, ou […] Logos absolu, suivant lequel les choses sont rationnellement faites et pensées » (L, t. I, p. 69.), apparaissant ainsi comme une structure commune à la pensée et au monde ; qu’en ce sens elle abolit « la distinction assez généralement admise de la vérité logique et de la vérité métaphysique » (L, t. I, p. 67.), puisque « la logique est un élément intégrant et constitutif de la vie et de l’être des choses [et qu’] ainsi considérée la logique devient métaphysique » (L, t. I, p. 70.) La Logique procède du plus abstrait vers le plus concret selon trois mouvements bien définis par Hegel : la science de l’être, la science de l’essence, puis la science de la notion (L, t. II, p. II, 5 et table des matière p. 395-96.), déclinant à la fois, au gré du processus dialectique et sur un plan parallèle, l’engendrement du monde naturel et celui de la connaissance rationnelle la plus haute, celle de la notion. La critique d’Aragon, à partir de là, est assez radicale, puisqu’il juge « inacceptable » « l’acceptation de synonymie » (236) entre logique et métaphysique, et rompt ainsi le point de départ de la Logique, tel que l’explicite Véra. A l’opposé, le poète rétablit un doublet conceptuel simple : d’une part la logique, qui « a pour objet la connaissance abstraite », et correspond donc à la science de l’être – mais ne saurait en aucun cas aborder la notion ; d’autre part la métaphysique, qui a pour objet « la connaissance concrète », et correspond donc à la science de la notion (236). Ce faisant, il exclut la science de l’essence comme « intermédiaire inutile » (236), et scinde totalement l’édifice hégélien. S’il garde l’idée de la sphère de la notion comme seule connaissance concrète, comme seul but de la philosophie comme de la poésie, il limite la logique, soumise à la plus extrême réduction et revenue à peu près aux schémas classiques, à une simple propédeutique. Mieux, il en réduit encore l’importance dès lors qu’il suppose que l’esprit peut parvenir à la métaphysique, la sphère de la notion donc, sans passer par la logique, et en suivant au contraire la voie de l’image.
Cette discussion explicite des principes de la Logique permet ainsi de mieux saisir quel rapport peut entretenir le discours aragonien avec la philosophie de Hegel. L’Imagination en effet n’apparaît plus comme une simple figuration du philosophe. Elle s’y substitue au contraire, comme l’image se substitue à la logique pour aborder la notion. La quête de la connaissance mise en scène par Le Paysan de Paris, de ce point de vue, ne s’inscrit dans la suite de la Logique hégélienne que par son transfert sur un plan second. Le parcours mythologique peut être associé au processus hégélien de recherche de la vérité. Mais il en est aussi déjà le surpassement, c’est-à-dire la transposition sur ce plan de l’imagination. La notion ne s’atteint plus que sur ce plan, à l’aune de l’image et de l’amour.
Car avec « Le Songe du paysan », c’est aussi l’amour qui entre en scène, et qui libère le poète du « cachot logique », dont « aucune démarche logique ne semblait devoir [le] tirer » (239). C’est la révélation amoureuse et elle seule qui lui permet de prendre conscience de la sphère du concret, du pouvoir de l’image et de surpasser ainsi la Logique de Hegel. Or nous retrouvons là, paradoxalement, un élément de la présence hégélienne sur lequel nous ne nous sommes pas encore arrêtés. Il est en effet une citation du philosophe qui intervient dans le premier tiers du livre et qui, pour énigmatique qu’elle apparaisse, caractérise en tout cas la rencontre sexuelle :
« L’individu vivant dit Hegel, se pose dans sa première évolution comme sujet et comme notion, et dans sa seconde il s’assimile l’objet, et par là il se donne une détermination réelle, et il est en soi le genre, l’universalité substantielle. Le rapport d’un sujet avec un autre sujet du même genre constitue la particularisation du genre, et le jugement exprime le rapport du genre aux individus ainsi déterminés. C’est là la différence des sexes. » (45)
La citation mérite un rapide commentaire. Elle propose en fait une analyse des rapports entre l’animal et le monde extérieur. Se constituant comme sujet, l’animal s’oppose au reste du monde objectif. Il réduit ce rapport d’opposition par l’assimilation de ce même monde objectif, c’est à dire, essentiellement, par l’alimentation, qui transforme l’être extérieur en une partie de lui-même. Mais l’union ne se réalise que dans la rencontre d’un être à la fois extérieur et identique à l’animal, qui se reconnaît dans le monde extérieur et se fond avec lui, quittant ainsi l’état de séparation de l’individu pour réaliser la notion absolue, l’union parfaite du sujet et de l’objet. Ceci, apparemment ne nous aide guère dans notre lecture de la citation. Obscure, isolée, menant comme par contre-emploi – par ironie ? – à l’évocation des prostituées, elle semble devoir résister à l’effort interprétatif. Elle a même pu être intégrée, avec la référence au Phédon – qui fait allusion aux amours de Simmias et Cebes (77) -, dans une sorte de dispositif visant à dévaloriser la référence philosophique, les philosophes, selon une tradition aristotélicienne dûment féminisée, retrouvant leurs collègues péripatéticiennes[[[9] Voir Nathalie Piégay-Gros, « Philosophie de l’image », Recherches Croisées Aragon / Elsa triolet, n° 5, Presses Universitaires Franc-Comtoises, Besançon, 1994, p. 165-66.]][9]. Il convient pourtant, avant de mener cette lecture ironique, de revenir à l’origine même de la citation. Celle-ci en effet n’est pas sans rapport avec les développements théoriques du « Songe du Paysan », dont nous avons rappelé ce qu’ils doivent à Hegel. Elle est issue de La Logique (L, t. II, p. 355). Mieux, et plus encore que dans la Philosophie de la nature, où est développée la même analyse, mais sans la même formulation, elle y joue un rôle significatif. Apparaissant dans les dernières pages du second volume, la différence sexuelle et l’union qu’elle suppose viennent en effet clore la sphère animale, et avec elle la sphère naturelle dans son ensemble pour réaliser la notion absolue. L’on pourrait ainsi, à partir de cette situation stratégique dans l’économie de la Logique, établir un lien entre la différence des sexes et l’atteinte par l’esprit de la « sphère de la notion », « pareille au fond des mers », dont Aragon fait le but ultime de l’effort métaphysique et poétique dans « Le Songe du paysan ». Le rapport entre philosophie et érotisme changerait ainsi radicalement de nature : si les philosophes sont constamment rapportés aux figures érotiques, y compris les plus triviales, c’est aussi parce que la philosophie, d’une certaine manière, trouve sa résolution dans la relation amoureuse, et ce conformément aux dires du paysan :
« L’esprit métaphysique pour moi renaissait de l’amour. L’amour était sa source, et je ne veux plus sortir de cette forêt enchantée. » (242)
Revenons, pour tester cette hypothèse de lecture, au contexte de notre citation. L’analyse de Hegel ne semble pas, à première vue, trouver beaucoup d’écho dans la suite du texte. Aragon y voit « la signification véritable de l’histoire de Pâris ». Mais c’est pour lui opposer la diversité féminine du Passage et la presque impossibilité du choix amoureux. Le jugement de Pâris, l’élection ne trouvent pas à s’y réaliser. La thématique de la rencontre générique n’est pas absente de la suite du texte, et on la retrouve à l’œuvre dans l’apostrophe aux « coiffeurs pour les deux sexes » :
« Les lois du monde s’inscrivent en lettres blanches à votre devanture ; les bêtes des forêts vierges, voilà vos clients : elles viennent dans vos fauteuils se préparer au plaisir et à la propagation de l’espèce. Vous aiguisez les cheveux et les joues, vous taillez les griffes, vous affûtez les visages pour la grande sélection naturelle. » (49-50)
Mais on reste ici plus proche de la thématique darwinienne que de la prise de conscience propre à l’animal hégélien. Est-ce à dire que la problématique hégélienne ne soit posée que pour être abandonnée ? De fait, la citation, si elle s’intègre au réseau thématique du genre et de l’espèce, ne semble pouvoir caractériser le passage qu’à contrario, comme une réalisation idéaliste impossible en ces lieux de plaisirs stériles. Cette fonction n’empêche pourtant pas un rapprochement plus lointain. Car Le Paysan de Paris, pris cette fois-ci dans son ensemble, progresse de ces amours inféconds et éphémères vers une rencontre amoureuse plus essentielle, que la citation hégélienne pourrait bien annoncer. Des « vieilles putains » à la femme révélée, le jugement de Pâris, par une étrange ruse de la raison ou du poète, trouverait ainsi à se réaliser.
Il est significatif, de ce point de vue, que les « putains terribles et charmantes » rencontrées en début de parcours soient à nouveau convoquées en conclusion, lors de la révélation amoureuse et semble-t-il, pour en éclairer la nature. Est ainsi proposé un double jeu d’oppositions. Le premier contraste s’établit en effet d’une manière on ne peut plus explicite entre l’unité de la femme aimée et la multiplicité / diversité des vendeuses d’amour d’abord évoquées. C’est cette irréductible multiplicité qui rend impossible l’élection amoureuse et avec elle la « particularisation du genre » :
« Dans le passage tant de promeneuses diverses se soumettent au jugement hégélien, d’âge et de beauté variables […], tant de promeneuses dans ces galeries, leurs complices, se contentent uniquement d’être femmes, que l’homme encore indécis et solitaire avec son idée de l’amour, l’homme qui ne croit pas encore à la pluralité des femmes, l’enfant qui cherche une image de l’absolu pour ses nuits, n’a rien à faire dans ces parages. » (45, nous soulignons.)
Le passage, en proie au mouvement continu de la séduction et du plaisir, semble devoir exhiber la diversité du monde sensible, sans permettre jamais un ressaisissement du sujet ou de l’intellect à l’œuvre. « Multiplicité charmante des aspects et des provocations », « tout ce peuple changeant de femmes » (46) interdit le choix, et le passage à la révélation singulière de l’amour.
Le rappel des prostituées en fin de parcours, dans ce contexte, permet d’affiner le jeu d’opposition, et d’entrevoir deux issues possibles, à partir de la disparité initiale. Le passage de la diversité sensible à la recherche du général semble ainsi proposé :
« Putains terribles et charmantes, que d’autres dans leurs bras se prennent à généraliser. Qu’ils s’enivrent à retrouver sous cet aspect changeant qui, moi, me déconcerte, ce qui les unit toutes […] J’ai entendu des hommes qui se plaignaient, leurs maîtresses n’avaient pas ceci qui est le propre des femmes, et cela que les femmes évitent, elles y tombaient. Ils souffraient de ne point sentir sous la peau caressée ce frisson de la loi générale, qui les pâmerait. » (238, nous soulignons)
Mais c’est aussitôt pour y opposer la véritable rencontre amoureuse. Celle-ci en effet ne se contente pas de confronter l’unité à la multiplicité, elle démarque encore la singularité, la particularité, de toute réduction par le général. Le poète ainsi s’écarte immédiatement de ces amants de la généralité :
« Eh bien, pas moi. Je t’adore, toi, pour ce particulier adorable, pas un pouce du corps, un mouvement de l’air, qui soit pour un autre valable. On ne te bâtirait pas sur ta menotte. Tu confonds la loi, en même temps que tu la manifestes. Une grande liberté qu’elle néglige éclate à tes pas. La merveille c’est que j’ai fui de la femme vers cette femme. » (238-39.)
On aura reconnu, dans la mention de « la menotte », une allusion à Cuvier et aux lois générales de l’anatomie, à partir desquelles ce dernier se vantait de reconstituer quelque animal que ce soit à partir d’un de ses membres. Au frisson de la loi générale répond ainsi la particularité, au « grand désir abstrait » (130), poursuivi dans les maisons closes, au « désir très général qui vous [y] entraîne » (126) la découverte du concret :
« Ce qui dans cette femme au-delà de son image se reformait reprenant cette image, et développant d’elle un monde particulier, le goût, ce goût divin que je connais bien à tout vertige, m’avertissait encore une fois que j’entrais dans cet univers concret, qui est fermé aux passants. » (242, nous soulignons.)
Or on ne peut s’empêcher de retrouver, dans cette interprétation des divers rapports érotiques, les distinctions majeures qui fondent la théorie hégélienne de la connaissance. La recherche du général ne saurait ainsi correspondre qu’au travail de l’entendement, tandis que la raison et la philosophie aspirent à la seule véritable connaissance, celle du concret, réalisée dans la notion. On se l’interdira d’autant moins qu’Aragon, on l’a vu, se réfère explicitement à ce jeu d’opposition dans « Le Songe du paysan ». L’élection amoureuse ouvre ainsi l’univers concret au poète, et se confond donc parfaitement avec l’abord de « la notion, ou connaissance du concret, [qui] est donc l’objet de la métaphysique » (237). On s’en convaincra à nouveau dès lors que le jeu de réalisation / dépassement de la loi, qui caractérise la singularité de la présence féminine, vient qualifier « la sphère de la notion », « pareille au fond de la mer ».
« La notion est aussi le naufrage de la loi, elle est ce qui la déconcerte. Elle m’échappe où je l’atteins. J’ai peine à m’élever au particulier. Je m’avance dans le particulier. Je m’y perds. Le signe de cette perte est toute la véritable connaissance, tout ce qui m’est échu de la véritable connaissance. » (242-243.)
A mieux y regarder, il semble donc que la citation de La Logique, pour voilée qu’elle paraisse au premier abord, joue un rôle programmatique réel. La rencontre de la femme vient parachever le processus de reconnaissance du monde par le sujet, et l’introduit dans la sphère de la notion, unissant l’universalité et la particularité. Le parcours amoureux mime parfaitement le développement dialectique de la connaissance propre à la philosophie hégélienne. Et le dépassement de la Logique, de ce point de vue, se fait à partir d’un élément de cette même Logique, mis en avant au dépens de la systématique de l’ouvrage. Ne pourrait-on aller plus loin ? Il semble en fait qu’Aragon joue, consciemment ou non, du recouvrement clairement signalé par Croce dans le texte hégélien, qui mêle logique et philosophie de la nature, pour surpasser l’une par l’autre – à moins qu’on ne puisse voir encore dans cette récriture de la rencontre animale une annonce de la philosophie de l’esprit. Comme si le dépassement de la philosophie hégélienne était aussi une manière de la suivre un peu plus en aval.
Il convient ainsi, arrivés en ce point, de revenir à l’apparition même de la figure féminine. La « Préface à une mythologie moderne » en effet, qui ouvre le volume, repose sur le rejet de toute certitude, mais ne s’ouvre pas pour autant sur un processus d’élection amoureuse. C’est au contraire le processus mythologique qui est alors annoncé, et cette même recherche des mythes modernes, toujours renouvelée, qui semble régir toute la première partie du Paysan de Paris. Nous ne reviendrons pas ici sur le sujet de la mythologie. On notera tout de même que la découverte du sens mythique correspond assez bien à la phase de reconnaissance, par le sujet, d’une identité entre lui et le monde objectif[[[10] Voir Emmanuel Rubio, « Présences de Schelling dans Le Paysan de Paris », dans Recherches Croisées Louis Aragon / Elsa Triolet, n° 8, Presses Universitaires Franc-Comtoises, Besançon, 2002, p. 189-210.]][10]. Et qu’il pourrait ainsi se substituer, dans la triade hégélienne, au moment de l’assimilation par l’animal du monde extérieur. Or, de ce point de vue, l’apparition de la femme aimée ménage une transition parfaite entre le processus mythologique et son équivalent amoureux. C’est de la réflexion sur les « lieux sacrés » en effet que sourd à deux reprise cette présence plus essentielle. Ainsi les lieux sacrés manifestent-ils « par le monde comme des nœuds de la réflexion humaine tout le concret de quelques grandes idées surnaturelles particularisées » (204) et appellent, pour les caractériser, une réflexion sur « les formes d’une idée ». Mais la rêverie érotique donne à ces formes un caractère nettement féminin – « la bouche d’une idée, ses lèvres, je les vois » (205) – et renvoie tout naturellement à la présence de « cette femme dans chaque idée » (206). Le retour explicite aux lieux sacrés et à leur évocation, dans le paragraphe suivant, mène au même glissement :
« Le divin se recueille au fond d’une caresse : tout l’air du paysage est mêlé à l’idée, tout l’air de l’idée frissonne au moindre vent. C’est une grande boucle brune, et vous joueriez à votre envie, la roulant et la déroulant, tant qu’à la fin vienne la fin du monde, c’est la boucle idéale où l’idée se résume, la notion concrète sortant des eaux pures, et sans roseaux. » (206-207)
La révélation de la femme-Vérité, de la femme-Aphrodite, s’impose à nouveau, et ce non comme une simple figure d’exemple, mais bien comme la résolution de la pluralité des révélations mythologiques.
« Femme tu prends pourtant le place de toute forme. […] Charmante substituée, tu es le résumé d’un monde merveilleux, du monde naturel, et c’est toi qui renais quand je ferme les yeux. Tu es le mur et sa trouée. Tu es l’horizon et la présence. L’échelle et les barreaux de fer. L’éclipse totale. La lumière. » (207)
Réapparaît ici, sous ces paradoxes multiples, la récriture imagée de l’unité contradictoire de la notion, qui unit la loi et la particularité, la nécessité et la liberté, auxquelles fait allusion la double évocation carcérale. La vision qui suit développe quant à elle cette idée d’un résumé du monde réel par le corps de la femme, en passant du monde figuré à l’image, comme si l’écriture traduisait elle-même cette progression vers le concret.
« Ainsi l’univers peu à peu pour moi s’efface, fond, tandis que de ses profondeurs s’élève un fantôme adorable, monte une grande femme enfin profilée, qui apparaît partout sans rien qui m’en sépare […] La grande femme grandit. Maintenant le monde est son portrait […] Montagnes, vous ne serez jamais que le lointain de cette femme, et moi, si je suis là, c’est pour qu’elle est un front où se pose sa main. Elle grandit. Déjà l’apparence du ciel est altérée de cette croissante magicienne. » (207-208)
La scène rappelle évidemment le rêve visionnaire de Nerval, dans Aurélia, qui propose une transfiguration identique[[[11] « Puis elle se mit à grandir sous un clair rayon de lumière, de telle sorte que peu à peu le jardin prenait sa forme, et les parterres et les arbres devenaient les rosaces et les festons de ses vêtements; tandis que sa figure et ses bras imprimaient leurs contours aux nuages pourprés du ciel. Je la perdais de vue à mesure qu’elle se transfigurait, car elle semblait s’évanouir dans sa propre grandeur. « Oh! ne fuis pas! m’écriais-je… car la nature meurt avec toi! » » Gérard de Nerval, Œuvres complètes, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1993, t. III, p. 710.]][11]. Et l’association finale faite par Nerval entre la femme et la totalité de la nature ne fait de ce point de vue que confirmer notre piste de lecture. La révélation toujours particulière, isolée, que proposait chaque fois le sentiment mythique, mène ici à une révélation plus complète, et englobante :
« Tout m’est enfin divin puisque tout te ressemble, et je sais par-delà ma raison et mon cœur ce qu’est un lieu sacré, pour moi ce qui le sacre. […] Pas un lieu désormais qui ne me soit une place de culte, un autel. » (210)
La transition entre les deux phases du Paysan de Paris s’écrit ainsi dans cette image qui, par-delà la chronologie réelle de l’écriture, reconduit l’unité de la quête aragonienne. Faut-il s’arrêter sur un détail de la mise en scène ? La déclinaison des « formes d’une idée » pourrait bien relever d’un jeu sur la formulation de Véra, qui évoque souvent dans son introduction la « forme des idées », et affirme même que « la forme des choses n’est qu’une image et une manifestation imparfaite de la forme éternelle et immuable des idées » (L, t. I, p. 84.) Le passage au pluriel des « formes » est ici générateur d’image. On pourrait d’ailleurs en dire autant à propos d’une locution elle aussi souvent employée par Véra et Hegel lui-même, au sens figuré, et qui veut que l’esprit « descende » de l’abstraction logique vers le monde concret. Chez Aragon, c’est l’homme qui « [descend] dans [son] idée, puisatier pendu à [sa] corde », pour atteindre sa réalité concrète et féminine. Le poète reprend ainsi sur le mode concret l’expression hégélienne, tout en la mêlant à une sorte de négatif du cliché traditionnel : la vérité sortant de son puit. L’écriture, au moment où se joue le passage final vers la notion, réalise elle-même, une fois de plus, la transfiguration de l’abstrait en concret[[[12] Pour un beau passage au concret de la source hégélienne, on se reportera aussi à la récriture d’une note de Véra sur Mœdler, qui situait le centre du monde dans l’étoile Alcyone (L, t. I, p. 222) – permettant de la part d’Aragon le déplacement vers la femme de ce centre mythique (157).]][12].
Mise en scène, discussion, prolongement, surpassement, le rapport à la philosophie hégélienne, on le voit, se décline sous de nombreuses formes complémentaires, qui unissent indissociablement la poésie à son antécédent philosophique. Et peut-être en conclusion faut-il revenir au sujet même de ce colloque : le dix-neuvième siècle d’Aragon. Il n’est pas impossible en effet que par sa lecture de Hegel Aragon en vienne à promouvoir une nouvelle approche du philosophe. Il est assez établi que la réception de Hegel en France devait subir de profonds bouleversements avec l’ouvrage de Jean Wahl sur Le Malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, paru en 1929, et le cours de Kojève à l’Institut des Hautes Etudes, à partir de 1933. Ce cours marque en effet le passage d’un hégélianisme lu à la lumière du panlogisme systématique à une philosophie marquée par la Négativité, la mort et la lutte existentielle, avec un notable déplacement du centre de gravité de la Logique vers la Phénoménologie de l’esprit. Ce recentrement, finalement, sera peu suivi par le surréalisme orthodoxe, à la différence d’un Bataille ou d’un Queneau par exemple. Mais il n’est pas interdit de voir dans la lecture aragonienne un déplacement comparable, même si moins rigoureux, et la naissance de ce qui pourrait caractériser un des axes majeurs de la lecture surréaliste de Hegel. C’est la reconnaissance de l’autre dans la lutte de prestige qui fonde l’interprétation kojèvienne ; c’est un autre type de reconnaissance que met en avant le poète, en isolant l’analyse sur la différence des sexes et la rencontre amoureuse. Cet axe de lecture n’est d’ailleurs pas étranger à Hegel lui-même puisqu’aux dires mêmes de Kojève, la reconnaissance amoureuse avait dans un premier temps paru à Hegel pouvoir constituer la clé de son système, avant qu’il ne lui substitue la lutte à mort entre le maître et l’esclave[[[13] Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, Gallimard, coll. Tel, 1997, p. 513.]][13], et que, selon Jean Wahl cette fois, « de la philosophie hégélienne de l’amour à la philosophie hégélienne de la notion le chemin n’est pas si long qu’on pourrait le croire d’abord »[[[14] Jean Wahl, Le Malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, Rieder, 1929, p.227.]][14]. Aragon, en reconstituant un parcours qui trouverait son aboutissement dans l’union amoureuse, et par-delà la liberté de la récriture, revivifiait ainsi, en quelque sorte, les origines romantiques de la philosophie hégélienne. Fondait-il une lecture proprement surréaliste ? ce qui est certain, c’est que Breton ne devait pas être indifférent à ce parcours qui permettait d’allier l’interprétation marxiste de la dialectique hégélienne, menant à la révolution sociale, à cette valorisation de l’amour comme aboutissement ultime du devenir humain.
Paris III Sorbonne-Nouvelle
/>
On mentionne rarement aussi la prise de position courageuse d’Aragon, face à un Breton déchaîné, prise de position qui n’est pas sans conséquences dans ses textes.
L’homosexualité dans Le Libertinage et La Défense de l’infini d’Aragon
Dans les années vingt, Aragon se plaît à représenter des personnages homosexuels, hommes ou femmes, en particulier dans Le Libertinage et dans La Défense de l’infini. L’enjeu de ces représentations est double. Si on la considère de manière isolée et comme une pratique sexuelle propre à certains personnages, il est frappant de constater que l’homosexualité est présentée de manière neutre du point de vue moral, ni les personnages, ni le narrateur ne jugeant l’homosexualité, et de manière objective du point de vue narratorial, le narrateur préférant souvent décrire les objets qui font naître le désir homosexuel plutôt que d’analyser le désir lui-même.
Lorsque la neutralité et l’objectivité sont poussées à leur comble, il arrive que l’homosexualité apparaisse dans les textes sous forme presque allusive, voire difficile à repérer. Nous nous pencherons ainsi sur un conte du Libertinage, dans lequel l’homosexualité des personnages est diffuse, si diffuse que la critique ne la repère guère. Le caractère allusif de la thématique homosexuelle n’est pas à rattacher, dans le cas des textes d’Aragon, au souci de discrétion, mais bien plutôt, selon nous, à la poétique. Aragon construit en effet dans les années vingt des textes qui ne soient pas pures représentations mimétiques invitant à une lecture passive ; ses textes invitent bien plutôt à chercher les éléments épars d’un sens à élaborer de manière active, la lecture se faisant quête et le lecteur chasseur d’indices.
Pour Aragon, d’autre part, le désir homosexuel est aussi à inclure dans une réflexion globale sur la sexualité ; mais loin de lui accorder une place subordonnée, à la manière des critiques dont nous avons parlé plus haut, il voit en l’homosexualité la pierre de touche de la sexualité libre. Alors que, pour Breton, et quelques autres, la liberté érotique et morale s’arrête où commence l’homosexualité, pour Aragon, en revanche, l’affranchissement sous toutes ses formes – sexuelle, morale, psychologique, sociale, etc. -, a lieu quand les corps se mêlent indistinctement, ce que l’homosexualité atteste par excellence, étant donné l’intolérance qui l’entoure habituellement ; et le modèle achevé de l’affranchissement consiste en l’orgie, qui, par définition, inclut l’homosexualité.
La neutralité axiologique
1. « La pédérastie me paraît, au même titre que les autres habitudes sexuelles, une habitude sexuelle. Ceci ne comporte de ma part aucune condamnation morale », déclare donc Aragon le 31 janvier 1928. Le recueil de contes et nouvelles publié en 1924, Le Libertinage, comprend plusieurs textes qui, déjà au début des années vingt, annoncent la déclaration de 1928. Par exemple, dans « Les Paramètres »[[[34] « Les Paramètres » ont fait l’objet d’une prépublication dans : La Nouvelle Revue Française, t. XVIII, n° 101, février 1922, p. 190-198, avant d’être repris dans le recueil Le Libertinage publié en 1924. Nous donnons les citations tirées du recueil dans l’édition suivante : Aragon, Œuvres romanesques complètes, t. I, édition publiée sous la direction de Daniel Bougnoux avec, pour ce volume, la collaboration de Philippe Forest, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1997 (désormais Pléiade, t. I).]][34], le personnage de Roland, ouvrier agricole, éprouve du désir pour Paul. Le narrateur représente la naissance du désir de Roland de manière indirecte, par la description objective de ce qui a fait naître ce désir, en l’occurrence les signes qui indiquent la qualité de citadin au vert de Paul : « Il était habillé de gris clair, avec un chapeau de paille et des souliers découverts ; et une chaîne de montre. »[[[35] Pléiade, t. I, p. 318.]][35] Plus loin, c’est de la même manière objective que se trouve décrit Paul que Roland regarde se baigner : « De la berge, Roland regarde Paul dans l’eau, son caleçon blanc traversé par l’eau courante, n’oubliez pas qu’il fait la planche. Une flèche rousse remonte au milieu de son ventre. Un brusque mouvement des jarrets ride l’eau. »[[[36] Ibid., p. 320-321.]][36] Les faits sont présentés tels quels, sans aucun jugement de la part du narrateur, qui traite par ailleurs l’homosexualité exactement comme l’hétérosexualité, car de Marceline et de Roland, tous deux tournés vers le même homme, il déclare simplement : « Il n’y a qu’une chose qu’ils ne s’avouent pas, un autre lien plus fort, une communauté de désir : tous deux pensent au même homme roux, et blanc comme une laitue. »[[[37] Ibid., p. 324.]][37] Pour les personnages non plus, l’homosexualité d’autrui ne semble guère de nature à provoquer un jugement ; tout au plus Thomas, qui a reçu un baiser de Roland, trouve-t-il cela « drôle »[[[38] Ibid., p. 322.]][38].
L’héroïne de « La Femme française », dernier texte du Libertinage, fait calmement part à son amant de son attrait pour les femmes aussi bien que pour les hommes. Même si elle note : « Au vrai, je n’aime pas beaucoup les caresses des femmes »[[[39] Ibid., p. 409.]][39], il n’en reste pas moins qu’il lui arrive de goûter celles de son amie Mathilde, et ses lettres sont émaillées de phrases de ce type : « Le fait est que j’aime rudement, homme ou femme, toucher le corps qu’un rêve de l’amour déjà possède. », « il ne me reste qu’à sourire, à manier mon éventail, et à fixer de façon un peu gênante deux ou trois hommes, et quelques femmes, qui me plaisent : décolletés et pantalons »[[[40] Ibid., p. 422 et p. 432.]][40]…
2. Deux « parties » de La Défense de l’infini, à savoir le « Projet de 1926 » et Le Con d’Irène (1928), sont riches en personnages ayant des pratiques homosexuelles, et, comme dans Le Libertinage, les « habitudes sexuelles » sont mentionnées sans être étiquetées, ni évaluées. Tout comme la « femme française », les femmes du Con d’Irène[[[41] Le Con d’Irène a paru de manière clandestine et anonyme en 1928 : Le Con d’Irène, s.l.n.d. [avril 1928] ; nous le citons dans l’édition suivante : Aragon, La Défense de l’infini, édition renouvelée et augmentée par Lionel Follet, [Paris], Gallimard, « Les Cahiers de la NRF », 1997 (désormais Défense).]][41] sont tentées par les amours féminines, et cela est dit de manière à souligner leur force morale. Dans le chapitre [5], l’on apprend ainsi du père de Victoire que celle-ci ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes, et ce, dans un discours tout empreint d’admiration et d’amour : « Elle s’est montrée à moi dans les bras de tous les hommes qu’elle a eus, je crois bien de tous. Je l’ai même vue avec des servantes. Elle est devenue une vraie femme, solide… »[[[42] Défense, p. 281.]][42] Dans le chapitre [11], l’on apprend que la fille de Victoire, Irène, ne partage pas le goût de sa mère pour les femmes. « Bien sûr qu’elle a essayé », précise cependant le narrateur, avant d’ajouter : « C’était tout simple, et puis tentant. »[[[43] Défense, p. 301. ]][43] Le « Projet de 1926 »[[[44] Le « Projet de 1926 » n’a pas été publié du vivant d’Aragon. ]][44] (chapitres [17], [18] et [20]) présente, quant à lui, un trio amoureux : Gérard, éperdu de désir pour Blanche, partage par ailleurs ses jeux érotiques avec Firmin, et c’est avec ce dernier que Blanche finit par se marier. La scène où se rencontrent les deux hommes, où le désir naissant est suggéré par des détails, n’est pas sans rappeler celle des « Paramètres »[[[45] Lionel Follet a déjà rapproché le Roland des « Paramètres » et le Gérard du « Projet de 1926 », dans Défense, p. 81. C’est tout autant pour des raisons stylistiques que nous faisons de même.]][45] :
Au fond de la grange où sur des clayonnages mûrissaient des fruits amers, il rencontra Firmin la bouche ouverte. Firmin regardait venir Gérard. […] Les mains sur le bord d’une claie se crispaient. Les mains de Gérard atteignirent aussi le bord de cette claie. Eh bien, eh bien ? Les yeux, les yeux.[[[46] Défense, p. 80.]][46]
L’homosexualité est donc représentée de manière inaccoutumée, nous semble-t-il : elle n’est pas pas stigmatisée, mais elle n’est pas davantage louée. C’est bien une pratique neutre du point de vue moral.
L’homosexualité, un thème à construire
Dans la plupart des exemples donnés ci-dessus, le narrateur ne dit pas explicitement le désir homosexuel ; il se contente de montrer les objets particuliers sur lesquels il se fixe ou les scènes où il trouve à se réaliser, de sorte que la présence du thème homosexuel est bien souvent comme à construire à partir d’indices. Le lecteur est invité à lire les textes comme s’il se trouvait au « pays du Petit Poucet »[[[47] Défense, p. 175.]][47]. Le conte « Le Grand Tore » [[[48] Ce conte a été l’objet d’une prépublication dans : Littérature, n. s., n° 7, 1er décembre 1922.]][48] du Libertinage est emblématique de ce type de lecture[[[49] Sur la lecture comme recherche de traces, voir : Carlo Ginzburg, Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire [1986], Paris, Flammarion, trad., 1989.]][49] : la critique passe à côté des petits cailloux qu’égrène le narrateur du conte, à l’exception de Daniel Bougnoux, qui, tout en les remarquant, ne comprend pas bien dans quelle direction ils le mènent.
Du « Grand Tore », on a écrit qu’il est « énigmatique »[[[50] Claudine Lacroix-Mesliand, « Collages et adages : armes pour un libertinage. Voyage à travers Asphyxies et Le Grand Tore », in Sur Aragon. Le Libertinage, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1986, p. 223-237 ; l’affirmation relevée se trouve p. 229.]][50], et, de son côté, Daniel Bougnoux note : « Cette histoire […] ne se laisse pas aisément déchiffrer. Que comprendre à la première lecture du Grand Tore ? […] / […] De quoi traite Le Grand Tore ? »[[[51] Pléiade, t. I, p. 1142.]][51] Selon nous, « Le Grand Tore » « traite de » l’homosexualité et de la bisexualité, mais, plus encore que dans « La Femme française » et dans « Les Paramètres », le sujet se manifeste de manière allusive.
1. Tous les personnages masculins du « Grand Tore » – Sullivan, qui épouse Concepcion, Boris, ancien ami de Sullivan, Joseph, ami présent de Sullivan – goûtent ou ont goûté les amours masculines. Joseph apparaît ainsi dans le texte : « Joseph se lève et sort. Les pissotières le reçoivent comme des sœurs. A travers leur tôle étoilée il surveille les ombres glissantes. »[[[52] Ibid., p. 404.]][52] C’est là une allusion aux rencontres homosexuelles furtives qu’abritaient les vespasiennes. Si l’on comprend cela, l’on comprend dès lors que c’est à des rencontres du même type que le narrateur fait allusion un peu plus loin : « Joseph frissonne aussi mais c’est de la fièvre. Il prend trop de goût à certaines pratiques, ce garçon. »[[[53] Ibid., p. 405.]][53] Quant à Boris, on saisit ce qu’il trouve à ce point comique dans la lettre où il apprend le mariage de son ancien ami Sullivan (comme le note le narrateur : « Boris lit le faire-part de son ancien camarade australien. Il est pris d’une hilarité sans mesure. Ne ris pas si fort, jeune homme pâle, des dents luisent au coin des rues. »[[[54] Ibid.]][54]), si l’on devine ce qui se cache sous le terme de « camarade ». L’on y est invité par l’allusion de la fin de la lettre au désir que d’autres hommes pourraient éprouver pour Boris. D’ailleurs, l’on apprend ensuite que Boris finit par rencontrer un de ces hommes, d’où ce dialogue :
Nous sommes quelques-uns, dit Boris à ce compagnon taciturne, qui ne pouvons plus nous passer de cela. Le besoin frénétique des trottoirs et des surprises. Nous n’aimons que les ombres sans visage, les ombres douces du hasard. – Mais, dit le quidam, n’avez-vous jamais songé à prendre femme ?[[[55] Ibid., p. 406.]][55]
De Sullivan aussi, le texte invite à deviner qu’il est bisexuel, en particulier dans le passage suivant, qui prend place lors de son mariage : « […] de l’église au repas sous le platane, ces images défendues dans la tête de Sullivan. Le soir habillé en boxeur apparaît debout sur l’horizon. »[[[56] Ibid., p. 405.]][56] La métaphore du boxeur vient comme préciser le contenu des « images défendues » qui occupent l’esprit du jeune marié, la deuxième phrase pouvant être considérée comme relevant de son point de vue. La façon dont le narrateur décrit ensuite l’attitude de Sullivan après la cérémonie corrobore l’hypothèse[[[57] Ibid., p. 406.]][57] :
Mais [Sullivan] fait un petit tour en ville pendant que sa femme se déshabille. Une idée comme ça.
Pure coïncidence, il pense à Boris. a ne le fait pas rire, lui. […] Des régiments passent l’œil extatique. […] A minuit les cuirassiers sortent de la Pépinière. En attendant le jeune marié m’a l’air de ne plus savoir ce qu’il fait. […]
Qu’il tarde Sullivan. Ce n’est pas tant qu’il tarde, mais il est en tête-à-tête avec son passé […].
L’indication : « Pure coïncidence », relève de l’ironie du narrateur, à moins qu’elle n’exprime le point de vue de Sullivan, la manière dont il se berce d’illusion à propos de Boris, qu’il pensait avoir oublié. Le narrateur suggère que l’errance de Sullivan est due à sa difficulté à faire face à sa nuit de noce et à son désir de la remplacer par des rencontres masculines. La mention des soldats qu’il rencontre sur son chemin suffit à suggérer le désir qui naît en lui à ce moment-là, selon la technique que nous avons déjà relevée dans « Les Paramètres », en particulier. D’ailleurs, au cours de son errance, Sullivan rencontre Joseph et l’emmène chez sa nouvelle épouse, et c’est en sa présence qu’il veut la forcer à quelque chose qu’elle refuse, dont Daniel Bougnoux se demande ce dont il s’agit : « Qu’exige Sullivan de sa jeune épouse, et quelle part prend Joseph à sa dépravation ? »[[[58] Ibid., p. 1142. On notera incidemment le vocabulaire moral qui se glisse sous la plume de Daniel Bougnoux.]][58] Notons simplement, en guise de réponse, que c’est seulement stimulé par la présence de Joseph qu’il peut envisager de consommer sa nuit de noces, et que la jeune épousée s’exclame : « Mais Sullivan, Sullivan, pourquoi m’avoir épousée ? »[[[59] Ibid., p. 406.]][59]
2. L’on peut maintenant tenter de répondre à la question que pose Daniel Bougnoux sur l’identité, ou la nature, des « ombres menaçantes » qui peuplent « Le Grand Tore » : « Quelles sont ces ombres menaçantes, bien proches des hombres dans la langue de Concepcion ? »[[[60] Ibid., p. 1142.]][60] En réalité, Daniel Bougnoux y répond quasiment lui-même par la précision qu’il apporte, à savoir queces ombres sont « bien proches des hombres dans la langue de Concepcion », c’est-à-dire proches phonétiquement du mot qui signifie « hommes » en castillan. Le contexte de diverses occurrences du mot vient étoffer cette piste. Les « ombres » apparaissent pour la première fois dans les vespasiennes où se rend Jules, lieu de rencontres masculines ; elles apparaissent peu après dans ce passage, qui commence par un jeu de mots : « Les ombres n’ont cure des desseins des hommes. Les voilà qui s’échappent et s’infiltrent entre les maisons. D’où viennent-elles ? Ombres, ombres, prenez garde : vous êtes le désordre et la perdition. »[[[61] Ibid., p. 405.]][61] Elles ressurgissent aussi précisément au moment de la rencontre homosexuelle entre Sullivan et Jules : « Le jeune homme [Sullivan] revient en griffant les murs. Une ombre encore une ombre. Mon cher Joseph vous ici. Curieuse rencontre »[[[62] Ibid., p. 406.]][62], et reviennent aussi dans le dialogue entre Boris et un homme de rencontre, que nous avons vu plus haut. Par conséquent, les ombres sont sans doute les hommes qui sortent à la tombée du jour pour errer dans les rues à la recherche de compagnons de jeux érotiques.
La présence à construire du thème homosexuel de ce conte soulève la question suivante : pourquoi Aragon offre-t-il une représentation presque cryptée de l’homosexualité dans certains de ses textes des années vingt, alors que l’homosexualité est clairement dite dans d’autres ? Si le poids de l’homophobie le conduit peut-être parfois à une certaine discrétion, nous voyons là, sans doute davantage que de la discrétion, la manifestation d’enjeux de poétique. Aragon, comme les autres surréalistes, se fait fort d’écrire des textes qui demandent la participation active du lecteur pour recevoir du sens. Le cryptage épisodique de l’homosexualité permet aisément de susciter l’activité herméneutique du lecteur, encore que ce ne soit pas le seul thème qui puisse subir un cryptage : l’on trouve, dans La Défense de l’infini au premier chef, nombre de passages portant sur des sujets divers, dont le sens échappe.
Des « plaisirs partiels » à l’orgie et à la « défense de l’infini »
En réalité, la réflexion sur le désir homosexuel est à inclure dans une réflexion plus large sur le désir tout court. Pour Aragon, en effet, le désir repose par essence sur l’indistinction, si bien qu’il existe un continuum entre homosexualité et hétérosexualité. Toutes les distinctions communément admises, entre désir hétérosexuel et désir homosexuel, entre personne hétérosexuelle et personne homosexuellle, mais aussi entre tel objet féminin du désir et tel autre, entre tel objet masculin du désir et tel autre, toutes ces distinctions reposent sur des présupposés sociaux, pyschologiques, politiques, moraux, à rejeter. Elles cherchent avant tout à assigner à des « personnes » à la psychologie stéréotypée une place bien définie dans une société ainsi figée et conservée.
1. Les écrits d’Aragon le proclament avec force : le désir est transitoire – il peut se porter sur une infinité d’objets différents. La « femme française » le déclare sans ambages : « Aimer que veux-tu, n’est pas une question de personne. Il y a déjà quelque absurde anomalie à te réserver certains privilèges. »[[[63] Ibid., p. 419. ]][63] La déclaration de cette femme concerne donc aussi bien les hommes que les femmes. Mais c’est sans doute encore trop dire : dans l’érotisme, c’est la notion même de « personne » qui se dissout, telle qu’elle est définie par la psychologie traditionnelle, qui repose sur le repérage de « caractères », au sens classique du terme.
Le désir, ensuite, est métonymique – il se porte sur des éléments partiels des corps. Nous avons vu que, dans les scènes de rencontre du Libertinage et du « Projet de 1926 », le regard de l’un se trouve attiré par telle partie du corps ou tel pièce du vêtement de l’autre, et que la naissance du désir est suggérée par la simple mention de cette partie ou de cette pièce vue. Dans « La Femme française », cette caractéristique du désir est explicitée :
Pas une rencontre qui ne soit partielle. Je m’explique, je n’ai encore jamais trouvé quelqu’un qui m’ait semblé le prête-nom d’un mystère un peu général. Un individu ne me donne guère par malchance que la curiosité d’un tic, d’une ride, d’un détail.[[[64] Ibid., p. 431-432.]][64]
Deux critiques ont remarqué l’aspect métonymique du désir de la « femme française », de façon fort juste, Françoise Douay-Soublin, qui parle d’« émiettement […] d’une métonymisation radicale », et Daniel Bougnoux, qui évoque « sa conscience irrémédiablement métonymique »[[[65] Françoise Douay-Soublin, « Figures perverses. De La Femme française à l’Irène d’Aragon », in Sur Aragon. Le Libertinage, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1986, p. 247-255 (citation p. 254) ; Daniel Bougnoux, in Pléiade, t. I, p. 1147.]][65]. On pourra remarquer qu’ils semblent manifester leur réprobation sur ce point par le choix de termes à connotation négative et, pour ce qui concerne la première, par l’emploi du mot « perverses » dans le titre de son étude.
Le désir est métonymique aussi, inversement, parce que chaque partie du corps est douée de sa propre force de désir et de plaisir ; et c’est même une affirmation polémique sous la plume d’Aragon, qui cherche à lutter contre la pauvreté du plaisir. C’est dans Le Paysan de Paris (1926), autre œuvre d’Aragon, qu’on en trouve la formulation la plus claire :
C’est pour moi un sujet d’étonnement toujours renouvelé que de voir avec quel dédain, quelle indifférence de leurs plaisirs les hommes négligent d’en étendre les domaines. Ils me font l’effet de ces gens qui ne se lavent que les mains et le visage, quand ils croient devoir limiter en eux les zones de la volupté. […] Des localisations grossières, voilà tout ce que l’homme a dégagé de l’expérience individuelle.[[[66] Aragon, Le Paysan de Paris [1926], in L’Œuvre poétique, t. III, 1926, Paris, Livre Club Diderot, 1974, p. 127-128.]][66]
Le héros du Cahier noir, autre section de La Défense de l’infini, fait chorus, en des termes voisins :
Et même cette fureur des corps, dont je voyais généralement abandonner l’étude dès les leçons élémentaires, était toujours pour moi la source de découvertes renouvelées. Les détails infinis de la volupté, les chemins sans nombre du plaisir, j’avais à les apprendre le même émerveillement qu’à la première révélation.[[[67] Le Cahier noir a paru d’abord dans La Revue européenne, n° 36, février 1926, p. 1-17 et n° 37, mars 1926, p. 28-38. Il est repris dans l’édition de La Défense de l’infini due à Lionel Follet, où nous le citons : Défense, p. 117.]][67]
2. Le désir ainsi conçu trouve à s’exprimer de façon privilégiée dans l’entremêlement de corps indistincts, ainsi que le montre le conte du Libertinage « Paris la nuit »[[[68] « Paris la nuit » a été publié à Berlin, sans date, en 1923, sous le titre « Paris, la nuit, les plaisirs de la capitale, ses bas-fonds, ses jardins secrets », par la maison Malik Verlag ; il a été repris dans le recueil Le Libertinage en 1924. Nous le citons dans Pléiade, t. I.]][68], où les deux formes de métonymies sont évoquées ensemble au cours d’une scène orgiaque qui se déroule « dans une salle sombre où cent personnes peut-être se devinent »[[[69] Pléiade, t. I, p. 394.]][69] :
Il se formait peu à peu dans chaque esprit une espèce de monstre, assemblage au hasard des morceaux d’hommes et de femmes qui éveillaient tour à tour un désir passager. […]
Je connais des parties de mon corps qui se croient toujours frustrées aux dépens de leurs voisines. Je connais des coins de ma peau qui ont des instincts propres et contradictoires. Ceci aime écraser, et cela… mais qu’importe l’objet de tout ce délire ? […]
Chacun devenait dans ce chaos le lieu géométrique de quelques plaisirs partiels. L’ardeur de chacun se distribuait à plusieurs, toute la salle était une corde embrouillée par un espiègle : je donne ma langue aux chats. Il se trouvait que chacun satisfaisait à plusieurs vices et en satisfaisait plusieurs [[[70] Ibid., p. 394-395.]][70]
De fait, la sexualité telle qu’elle apparaît dans les œuvres qu’Aragon écrit à l’époque, tend à l’orgie. Or, on trouve une définition fort intéressante de l’orgie sous la plume d’Aragon ; elle apparaît dans un texte de 1969 où il rapporte la conversation qu’il a eue avec BuÔuel une quarantaine d’années plus tôt :
Connaissant assez, chez BuÔuel, une certaine frontière du dégoût, j’entrepris de le convaincre que l’orgie commence où se fait un certain bariolage de ses participants
[…] C’est à la multiplicité des hommes que l’orgie mérite son nom, et pour ce qu’elle suppose de désordre, de refus des limites, l’orgie implique le non-choix des partenaires immédiats, la variation sans frein des rapports sexuels, donc (aussi bien des hommes que des femmes) l’homosexualité. […]. Depuis une dizaine d’années on lui avait inventé un nom plus vulgaire, moins redondant : la partouse.[[[71] Aragon, Je n’ai jamais appris à écrire ou les incipit [1969], in Œuvres romanesques croisées d’Elsa Triolet et Aragon, t. XLII, Paris, Robert Laffont, 1974, p. 211 et 213.]][71]
Si Aragon en est alors venu à parler de l’orgie avec BuÔuel, c’est parce que La Défense de l’infini devait, d’une certaine manière, faire revivre « les orgies des dernières heures royales »[[[72] Ibid., p. 211.]][72]. Aragon n’a jamais achevé La Défense de l’infini, mais l’orgie n’en est pas absente pour autant. Dans le « fragment Nancy Cunard » « Il y a une heure où », qui se déroule dans le Montmartre des plaisirs, Anne, qui regarde Gaston lutter avec un lutteur professionnel, échange des gestes érotiques avec Armand tout en observant Prudent à la dérobée, dont l’esprit est tout occupée de pensées érotiques pour Irène. Il y a bien là une orgie au moins imaginée, ainsi soulignée : « Lequel des trois ? Elle [Anne] se sent la femme de ces trois hommes d’un seul coup. »[[[73] Défense, p. 183.]][73] Dans Le Con d’Irène, on trouve la mention désenchantée d’orgies[[[74] Ibid., p. 264.]][74], et les dessins d’André Masson illustrant l’ouvrage viennent encore expliciter le motif en 1928[[[75] L’édition de La Défense de l’infini qu’a offerte Lionel Follet en 1997 comprend Le Con d’Irène, mais non les illustrations de 1928 dues à Masson ; en revance, les dessins ont été repris dans l’édition de La Défense de l’infini qu’Edouard Ruiz a proposée en 1986 : Aragon, La Défense de l’infini suivi de Les Aventures de Jean-Foutre La Bite, présentation et notes d’Edouard Ruiz, Paris, Gallimard, 1986 (dessins p. [97-103]).]][75]. De ces cinq dessins qui représentent figures complexes et enchevêtrements variés, deux paraissent particulièrement intéressants : le troisième et le cinquième[[[76] Respectivement [p. 101] et [p. 103] de l’édition de Ruiz.]][76], celui-ci parce que le fouillis des lignes du dessin est tel que les limites des corps ne sont plus assurées, celui-là parce qu’il montre un homme dont la tête est remplacée par un second phallus en érection. Ces procédés visuels suggèrent que, dans l’orgie, c’est le désir sans individualité propre qui s’exprime.
Mais La Défense de l’infini, déclare Aragon en 1969, n’avait pas seulement pour but de représenter l’orgie. Partant de l’idée que c’est la poétique même de tout roman qui est orgiaque – « l’orgie des mots, le roman, qui existe et mérite son nom par la multiplicité permise de ses participants, la liberté potentielle des rapports entre eux »[[[77] Incipit, p. 218.]][77] -, Aragon aurait voulu avec La Défense de l’infini mettre en œuvre une manière de poétique romanesque orgiaque exacerbée, en juxtaposant dans un ordre presque aléatoire les chapitres, et souvent aussi les paragraphes à l’intérieur des chapitres, chacun d’entre eux faisant entrer un nouveau personnage. Cela apparaît assez nettement dans les deux sections « Projet de 1926 » et « Fragments Nancy Cunard ».
3. L’orgie est un principe de dissolution de l’individualité telle qu’elle est pensée le plus souvent. Mais ce processus qui a lieu dans l’orgie a, plus généralement, lieu à chaque fois que le désir est libre. L’orgie est à la fois le paroxysme et la modélisation du désir. Daniel Bougnoux note ainsi à juste titre à propos du désir de la « femme française », qui ne s’accomplit pas dans des « partouses » stricto sensu : « Ici triomphe le mouvement flou, la grande pulsion ou poussée qui s’étire […] entre les êtres ; ici commence proprement la défense et illustration de l’infini, soit le travail de dé-finition de la personne rendue à l’anonymat des désirs, où l’idée de l’individu se dissout. »[[[78] Pléiade, t. I, p. 1147.]][78] On trouve aussi dans un « fragment Nancy Cunard » ce dialogue entre le narrateur et des personnages anonymes qui errent dans le Montmartre des plaisir : « Que cherchez-vous à ces quinquets, oublieux de vous-mêmes ? Nous cherchons l’oubli, disent-ils, et qu’on nous laisse en paix nous défaire au hasard. »[[[79] Défense, p. 178.]][79]
Dans la mesure même où c’est un principe de dissolution du « caractère », ou de la « personne », et de leurs implications psychologiques et sociales, le désir est le moyen privilégié d’échapper à la finitude. En particulier, avoir des pratiques homosexuelles quand on est hétérosexuel permet d’échapper à des déterminations fausses et à des limites indues. On lit dans la scène de rencontre entre Firmin et Gérard, deux personnages précédemment hétérosexuels, qui a lieu dans le chapitre [17] du « Projet de 1926 » :
Gérard ou Firmin frôle Firmin ou Gérard. Gérard, Gérard, Gérard, Gérard. Etrange absence de Blanche. Blanche, qui c’est ça ? Etrange attrait. Gérard, Gérard. Il faut en finir. Gérard. En finir. Gérard. Finir. Gérard. L’infini. L’infini, Gérard, l’infini.[[[80] Ibid., p. 80.]][80]
La thématique homosexuelle traverse l’ensemble du Libertinage et de La Défense de l’infini, et, au-delà, l’ensemble des textes qu’Aragon a écrits dans les années vingt. Etant donné l’intolérance envers les homosexuels qu’Aragon pouvait alors noter à l’extérieur et à l’intérieur du groupe surréaliste, les représentations du désir homosexuel qu’il donne à lire ne peuvent que frapper le lecteur en raison de leur neutralité axiologique. De façon plus générale, les pratiques érotiques ne font pas l’objet de jugement de valeur dans les deux œuvres ; mais remarquable aussi est le fait que les pratiques homosexuelles occupent une place particulière, parce qu’elles sont comme la preuve et le moyen d’une subversion radicale, dans tous les domaines, et non seulement dans le domaine sexuel.
A la représentation de la sexualité sont attachés des traits formels, qu’ils soient de détail, comme la métonymie, ou d’ensemble, comme l’agencement des paragraphes et des chapitres. Le dévoilement des pratiques érotiques se prête aussi particulièrement bien à la mise en place d’une lecture indicielle. Il semble donc bien qu’une poétique soit à mettre en relation avec la représentation de la sexualité et que cette poétique soit très prégnante lorsqu’il s’agit plus particulièrement de l’homosexualité. Ce ne sont là que quelques jalons d’une étude qui reste encore à mener.
Franck Merger