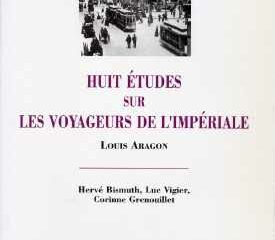Luc Vigier, « Humour et ambiguïté dans Les Voyageurs de l’impériale », 2001

Les Voyageurs de l’impériale : humour et ambiguïtés
Il y a là de quoi sourire, mais de quoi souffrir aussi (338)
Personne, à ma connaissance ne s’est hasardé, en cette rentrée prolifique, à parler des Voyageurs comme d’une œuvre humoristique et encore moins comique. Il y a quelques raisons à cela. On n’est guère enclin à s’engager de ce côté là lorsque pèse sur l’ensemble du roman cette « sombre humeur » (293), cette humeur noire de Pierre Mercadier, qui partage avec les personnages mélancoliques d’Edgard Poe une propension irrésistible aux propos et aux visions fantasmagoriques propres au spleen. Sans doute aussi parce que « les craquements sourds dans la vieille demeure », c’est-à-dire la montée des extrémismes dans les pays voisins, autant que le développement des ligues factieuses de février 34, viennent se mêler à l’approche de la première guerre et à l’antisémitisme, les deux époques étant placées en miroir.
Pourtant, les paroles des personnages, tout autant que la voix auctoriale, déjouent les tensions, les rendant plus grinçantes encore d’être observées avec distance et légèreté de ton. L’humour aragonien pourrait alors s’entendre dans la droite ligne de l’esprit saugrenu et imprévisible d’Yvonne, grâce à laquelle « on sort de toute cette mauvaise humeur par le chemin ouah-ouah.» (189). Or, cette ‘soupape’ intervient, si l’on y est attentif, à plusieurs niveaux de lecture ou, si l’on veut rester dans le champ de l’humour, à plusieurs ‘degrés’ : dans les propos ou visions de certains personnages au sujet de leurs contemporains, dans la voix flottante de la narration qui reflète les discours et pensées communes, dans l’humour direct ou indirect de certaines situations. Le décalage qu’impliquent les variations de ce ton peut déborder vers l’ironie ou le sarcasme, selon les cas et surtout selon le positionnement intellectuel du lecteur. Reste à savoir si l’on parvient à sortir de toute cette « mauvaise humeur » ou si l’on reste les pieds pris dans les marais de la mélancolie.
La valse des ridicules
Paroles écoutées, pensées investies
Dans l’ensemble du roman cette « parole écoutée » donne lieu à une sorte de glissando de la voix générale vers le discours rapporté, sans qu’on sache toujours à qui attribuer et la voix et le rapport du discours. C’est le cas par exemple page 95 :
L’oncle Pascal emmenait son neveu en visite chez les Champdargent où séjournait Jeanne. Il l’avait fait coiffer par la cuisinière. On l’avait forcé à se débarbouiller. Le gosse avait mis son costume propre, un marin, à pantalon long, avec un sifflet pendant à une cordelette blanche. Il était à peu près présentable. Montre–moi ces mains. Enfin ça peut aller.
Les discours directs sont là, terrifiants, image de la bêtise et de la niaiserie à l’image de ce « Quelle horreur », trois fois entendu dans le premier chapitre puis une fois dans le chapitre VI ( le duel) puis encore une fois un peu plus loin, par quoi une bonne partie de la France en prend du reste pour son grade. De même, c’est presque un collage qui est utilisé dans l’évocation critique de l’enseignement du latin dans le lycée de Pierre Mercadier, en décalage complet avec la réalité du monde et des responsabilités qu’il implique. Aragon évoque ainsi « ces jeunes garçons tourmentés par leurs cols durs » qui « abordent tout d’un coup les responsabilités de la vie par le biais étrange des langues mortes. « ….mais comme le dit Monsieur Legros qui enseigne le latin en cinquième, Felix, heuheu, Felix qui potuit, vous m’entendez ? potuit rerum, M. Levet, cessez ces apartés ! rerum cognoscere causas. » (109) La transcription directe des paroles, qui vient s’ajouter à celle des pensées, on le voit, a également son efficacité. Et je n’en prendrait pour exemple que l’altercation qui oppose M. D’Ambérieux à sa sœur :
Le comte accusa sa sœur de tout mêler pour masquer sa responsabilité dans la fuite de Suzanne.
Mme d’Ambérieux hurla que c’était inadmissible. Le mal s’envenimait. On en vint aux insultes. Qui avait commencé ? La vierge de porcelaine au‑dessus du bénitier en sait peut‑être quelque chose, à moins que le buis bénit ne lui ait caché l’essentiel. M. de Sainteville, toujours est–il, cria Vieille taupe ! en claquant la porte et disparut.
Vieille taupe ! C’était un peu trop fort ! Ah, on allait voir. Vieille taupe ! Pas un instant de plus… pas un instant… Son frère, son propre frère ! Sous le toit de leurs parents… La maison où elle était née… mais tant pis !… pas un instant…
Elle jetait pêle‑mêle tout ce qui lui tombait sous la main dans sa malle, elle dégarnissait les porte‑manteaux. Elle tournait sur elle‑même, l’eau dentifrice à la main. Les robes. Les mouchoirs.
Pas un instant ! Alors ça… pas un instant ! Avec une difficulté pour respirer, les jambes gonflées à éclater, et cet affreux battement aux tempes, pan‑pan‑pan, la vue troublée… De bonnes conditions pour faire ses malles, mais tant pis ! Vieille taupe, il avait dit vieille taupe ! On verrait. (p.246-247)
ou, mieux, le dialogue Mercadier-Bellemine :
– Oui… c’est‑à‑dire… par quel bout prendre ? Si vous me demandiez ce qui est ressemblant, ce serait plus simple…
– Je vous en prie…
– Eh bien, rien, à franchement parler. Rien. Les faits peut‑être, un homme de quarante ans qui s’en va un beau jour… Mais la psychologie ! Cette psychologie profonde… et légère à la fois… Je me suis bien diverti. Vous êtes très subtil. Si, si… Sans le montrer, je vous le concède, mais… subtil. Il est vrai que votre héros, lui, est un écrivain… alors. (481)
Il en va de même pour la transcription du discours intérieur, aux effets dévastateurs. Ce réalisme de l’humour, de nombreux personnages en ont font les frais et il impossible de les citer tous. Evoquons simplement l’Amiral, mais aussi Paulette, pauvre Paulette. Les exemples foisonnent dans la première partie et j’ai une petite préférence pour le chapitre VII, p. 73 « Bonjour, je ne te dérange pas ( …) Denise était assise à son bonheur du jour, avec de la dentelle, de la dentelle et encore de la dentelle :une fortune, c’est sûr. » Le point de vue descriptif extérieur bascule en une soudaine focalisation interne, dont le statut reste ambigu. D’autant qu’Aragon joue de cette ambiguïté : « Denise pense aux siens, elle virevolte sur sa chaise, les dentelles volent un peu, le déshabillé s’ouvre, on voit les jambes de Madame Lassy de Lasalle, et on pense que le baron de Lassy pouvait plus mal faire son lit. » (74) Puis « c’est le bouledogue qui n’a aucune bienséance, alors il faut purifier l’air… » (74) La bourgeoise ridicule, qui reprendra du service (et des jambes) dans Aurélien, devient un exutoire du roman. Paulette est également capable d’humour, quoique pour des motifs on ne peut plus triviaux et puérils : « Mais cette fois, l’histoire était que l’Amiral, de passage, serait leur hôte, et ( il faut bien le dire) Paulette était assez ravie de leur flanquer l’Amiral, à toutes ces pimbêches, avec toutes ses décorations, du Moulin-à-Vent et du Veuve Clicquot. Elle en riait d’avance. » (69). Les pensées de Paulette à l’égard de Blanche Pailleron créent un effet similaire : « madame Pailleron aurait pu passer pour une femme du monde. Telle quelle, elle lui plaisait beaucoup. Pas mal habillée pour une Lyonnaise. » (179). Autres exemples : pensées de Dora p. 545 ou 517 (hernie)
Conclusion sur l’utilisation de l’humour déclenché par l’imitation du langage oral, art ancien chez Aragon et qu’il retrouva avec enthousiasme chez Céline, dans Le Voyage.
Le point de vue de l’auteur
Jugements secs
Aragon rate rarement ses cibles et ne se contente pas des transposition de paroles ou de pensées. A côté des paroles écoutées et des pensées rapportées, sont clairement identifiables les sarcasmes qui émanent directement de la voix romanesque, systématiquement dirigés contre les bourgeoises mais aussi spécifiquement contre Pierre Mercadier. Le « Quelle horreur » de Paulette, c’est la vanne ouverte à la caricature dont les personnages initiaux se chargent jusqu’à l’explosion : « l’amiral qui devenait d’un technique à éclater » (37) « Paulette n’écoutait plus du tout (…) Tout à coup, quelque chose sembla particulièrement s’adresser à elle (…) Pour la première fois, il sembla que Paulette fût habité par une idée à elle » (38). C’est bien de l’absence de pensée ou de goût qu’il s’agit et ce thème sera abondamment développé dans l’ensemble du roman. Chez Pierre Mercadier, lui-même doté d’humour, sont plutôt fustigés l’égoïsme, l’aventurisme individuel, le contentement, mais aussi la misère morale. 166-167 : « heureusement que les dents sont bonnes ». De même face à Blanche
Elle lui passait la main sur sa nuque, Pierre remua la tête comme un chat, et gonfla cette nuque aux cheveux ras sous les doigts électriques. Extraordinaire sentiment de jeunesse, il avait vingt ans, ce soir, malgré la fatigue, malgré ce vieillissement de son corps, le poil touffu, ces secrètes déchéances qui ne lui échappaient point à lui, graisse aux reins, et une inquiétude, qu’il ne connaissait pas jadis devant une femme, des comparaisons possibles. (209)
Irruptions
La voix auctoriale ne manque pas de faire de nombreuses intrusions, plus ou moins marquées, qui font en sorte qu’on se détache de Mercadier et que se brise l’identification toujours mécaniquement possible du lecteur à l’indivualiste en rupture de ban : « En dehors de toute politique, comprenez-moi bien, Pierre Mercadier n’eût pas placé un liard dans une affaire contraire aux intérêts de la France… » (61) De même, et de manière plus massive, à la manière de Gide ou plutôt à la manière de Diderot, intervention p. 565 :
Peut‑être est–il contraire aux règles du roman et déloyal par rapport au lecteur, de donner ici sur cette personne austère un détail anticipé de quelques années, mais tant pis.
De même pour commenter les actes de ses personnages :
Quel démon possède Mercadier ! Allons, lève–toi, sors imbécile… puisqu’on ne te retient plus. Eh bien, pas du tout. Il s’est redressé contre la table, il a pris les cartes, il les mêle et les remêle, et avec une voix ironique, mais enfiévrée, il dit à son vis‑à‑vis : « Maintenant, je te joue ton couteau contre un louis… » Ce qui est folie à tous les points de vue. Une pièce de vingt francs est tombée sur la table, et la lueur de l’or a semblé ranimer Angelo. (401)
De même encore, lorsque tout le monde cherche Suzanne et que Blanche commence à trouver le remords un peu lourd à porter, lorsqu’Aragon nous parle des domestiques
Les domestiques jouaient là‑dedans le rôle du chœur antique, et leurs propos pleins de mystère étaient fourrés d’allusions et de réticences où la vérité eût trouvé son compte, s’il y avait eu quelqu’un pour l’écouter. (244)
Caricatures
Raphaël Lafhail-Molino, dans un article consacré aux Beaux Quartiers (Annales n°1) a déjà souligné l’art finalement peu réaliste dans le sens traditionnel du terme, de la charge et de la caricature chez Aragon. La plume trouve encore dans Les Voyageurs le portrait de la charge, qui peut se légitimer, dans le cas de l’évocation du Lycée de Mercadier, par le regard des enfants. Ainsi est-il question, pour le surpète d’ « un vieux squelette vert sous son tube » (101). Ainsi est-il dit de Monsieur Legros, répétiteur qu’il « était tout petit avec les yeux rusés, une barbe en éventail qui le rendait plus petit encore, poivre et sel, et un toupet pour rattraper les choses. » (107). On n’est pas loin de Madame d’Ambérieux, qualifiée de « grosse grenouille » (119) à cause de « ses détentes brusques pour avancer ». On pourrait multiplier les exemples de ce type dans le roman et suivre le bestiaire étonnant du roman, où chiens et chats tiennent le haut du pavé, confrontant les félins et les cyniques… Robinel :
Robinel, nommé à Paris, qui enseignait les sciences naturelles à Janson‑de‑Sailly. Toujours apoplectique, toujours furax, avec son col qui sautait, son air d’avoir été giflé par un géant, ses pattes courtes, son genre taureau, sa moustache de chat. (475)
Douche écossaise et équivoque
L’humour aboutirait-t-il dans le roman à ce système de complicité dont une image nous semble donnée dans ce « ton d’humour » qui unit les joueurs de Monte-Carlo ? Evidemment pas. Il est (je crois) impossible de retenir de la lecture des Voyageurs de l’impériale un idée globalement humoristique et on me surprendrait fort en m’affirmant que Les Voyageurs a été pour l’un ou l’une d’entre vous l’occasion d’une franche rigolade et comme le dit Blanche à M. De Sainteville, pris d’un rire à propos du vide de leur journée, tout ceci n’est pas « rigolo rigolo » (p.156). Ceci ne tient pas tant à la présence obsédante du tragique, de la mort, ceci ne tient pas tant au contexte du déchirement politique de l’Affaire Dreyfus, ceci tient au passage constant, à l’échelle du roman, comme à celle des chapitres, des paragraphes et des phrases, de l’humour le plus cinglant au pathétique le plus noir et vice-versa. Le lecteur se retrouve véritablement pris dans l’ambiguïté de toutes les attitudes, pris dans leur mensonge et leurs douleurs dissimulées. On passe ainsi brutalement d’une série de phrases humoristiques sur les goûts musicaux de Paulette à son antisémitisme (p. 102) Une mention spéciale pour les scènes qui associent Pierre et Paulette, comme la scène de l’aveu page 70 :
Sans s’interroger, elle obéit à un réflexe féminin, à un réflexe maternel. Elle éprouva d’autant mieux peut‑être cette pitié qu’elle ne se connaissait pas pour l’homme à qui était accrochée sa vie, qu’il y entrait une certaine inquiétude personnelle à la première minute. Peu importe, elle laissa tomber sa houppe, et se précipita sur Pierre dont elle serra la tête contre ses seins.
À travers ses larmes, dans la mi‑lumière de cette grotte rose, il vit près de ses yeux, troubles et palpitants, les beaux bras blancs, nacrés : il respira le parfum de Guerlain dont elle venait de s’inonder par mégarde, il eut de petits sanglots dans sa barbe douce qu’il agita pour une caresse, près du cache‑corset. Mon Dieu, c’était peut‑être la seule minute de bonheur de toute leur vie ! Cette pensée déchirante rendait plus grand son désespoir, ce sentiment de culpabilité qui l’avait poussé chez sa femme, au sortir de sa classe… Il parla.
« Je n’ai pas pu… Ce matin, en prenant le petit déjeuner, quand j’ai ouvert le journal, les nouvelles…
– C’était donc ça que tu n’as rien mangé ? »
Un autre scène de l’aveu, triste et savoureuse, celle de l’aveu indirect de son désir d’aller retrouver Mme Pailleron :
« Laissez passer l’orage », conseillait à mi‑voix M. de Sainteville à son neveu. Mme d’Ambérieux l’entendit et retourna sa rage contre son frère : « L’orage ! L’orage ! tu prends parti pour ce monsieur et cette cocotte !
– Je vous défends d’injurier Mme Pailleron, prononça fermement Pierre à qui la moutarde montait au nez.
C’est donc vrai ? – gémit Paulette. – C’est lui qui l’a nommée ! Mon Dieu que je suis malheureuse ! » (197)
L’équivoque de la terrible scène entre Pierre et Paulette lorsque celui-ci, animé par un brusque retour de flamme, se voit brutalement congédié : vaudeville ou tragédie du couple ? Les deux points de vue se superposent, aux pages 164-165 :
Après quoi commencèrent les ténèbres. Des ténèbres étouffantes qui entraient dans les yeux, la bouche, les oreilles. Des ténèbres où vous battaient les tempes. Des ténèbres de chiffons, des ténèbres humiliantes. Les deux êtres, aussi écartés que possible, qui les peuplaient, entendaient chacun la respiration retenue de l’autre. Très vite, celle de la femme prit un caractère absurdement régulier. Lui savait qu’elle feignait de dormir. Il n’osait bouger, dans la peur qu’elle se méprît, et mortellement blessé de cette seule pensée. Il l’aurait tuée, s’il avait pu l’atteindre avant que l’ombre d’une pensée naquit en elle. Il la haïssait, il se haïssait aussi. Il voulait changer de position. Il eut une crampe dans le pied, et sacra tout bas. La respiration dans l’ombre en fut altérée. Et, cherchant à prendre son pied doucement dans sa main pour rapprocher des autres le gros orteil qui lui semblait douloureusement écarté, il forma, avec des lèvres dures et muettes, un mot silencieux que personne n’y pût lire : « La vache !… »
La nuit se prolongea entre les deux respirations ennemies.
De même encore de la scène du guéridon où le portrait des bourgeoises ridicules se mêle à l’atrocité de la mort, dans le contexte de la disparition de Suzanne. De même encore d’EUGENE, humilié par la tâche que sa femme a accepté et qui vient tout casser, répond, à sa femme qui lui demande de la battre à la maison qu’il en a « mal de rire… »
MERCADIER REPRESENTE A LUI SEUL CETTE EQUIVOQUE DE L’HUMOUR ARAGONIEN, TOUJOURS ASSOCIE A LA MELANCOLIE.
Humour et Mélancolie chez Pierre Mercadier
Pierre Mercadier est associé assez tôt à « l’humeur sombre » de son caractère (293 ; Denise l’appelle, au chapitre VI, l’ « ours » de Paulette) qui n’est pas incompatible chez lui avec une certaine forme d’humour, ce en quoi Pierre Mercadier pourrait bien nous donner image du roman tout entier. Ainsi nous est-il dit du voyageur de Venise : « Avec quel humour amer, Mercadier dans les cafés du Corso regardait la jeunesse dorée » (406). Les péripéties égyptiennes n’y changeront rien et c’est ce « triste sire » que Meyer redécouvre bien des années plus tard : « La vie est mal faite pour maintenir les gens qu’on voit chaque jour sur le plan héroïque. Le personnage romanesque que s’était formé Meyer correspondait mal à cet homme âgé et d’humeur assez sombre, qui faisait la grimace devant la nourriture monotone, se plaignait des cabinets et parlait de s’acheter un nouveau bandage herniaire (…) (492). Plus nettement encore, Mercadier est l’homme de la mélancolie, derrière lequel il ne fait sans doute pas oublier le souvenir de La Nausée de Sartre, paru en 1938: [à propos de la musique jouée par Meyer] Cela convenait à une certaine disposition mélancolique qui allait en s’aggravant chez Mercadier. » (103) Il affronte sérieusement ce que Jean-Blaise balaye avec ironie, dans sa conversation avec Mercadier : le spleen. Il est cet « esprit au long ennui » empruntant à Baudelaire mais aussi à Edgar Poe une certaine disposition pour la fantasmagorie. Il existe du reste un point de contact entre Pierre Mercadier et Yvonne, qui joue du Chopin et qui fait dire à ceux qui l’entendent : « On ne savait pas qu’on était aussi triste » ( 141)
Mais en même temps, et on voudrait dire « par suite », Mercadier est l’homme de l’humour et de la distance. Pierre, en tout cas dans le premier chapitre, accompagne le point de vue global, ce qui le rend du reste assez sympathique. Alors que l’Amiral patauge dans son évocation de la peinture, Aragon note : « Pierre sifflotait doucement » (38) et plus loin « Il tenait son thème. Pierre vit qu’il avait les yeux bleus ». On se prend alors à considérer différemment ce qu’Aragon appelle, pour décrire la qualité des relations mondaines à la roulette de Monte-Carlo, « un certain ton d’humour » qui est la « clef mystérieuse » d’un univers de complicité et de silence entre les joueurs. Dans la seconde partie du roman, il semble que ces deux faces d’un même état de spleen évoluent de concert, notamment lorsqu’il s’agit du foyer Meyer ou des Hirondelles. Pierre et Dora s’opposent naturellement sur ce point là aussi. L’humour est bien ce qui permet de détecter ou de supporter l’absurdité ou l’insupportable : « Cela [les rêveries de Dora su Pierre] la rendait étrange au milieu du décor des Hirondelles. Elle était trop prise à ce jeu pour éprouver l’humour de la situation, le comique sordide des gestes qu’ elle avait à faire, du machinal de ses journées et de l’écart de ses imaginations folles. » (688). Dire l’absence de perception humoristique, c’est dire l’absence de recul et la douleur ressentie sans qu’aucune défense naturelle de l’esprit ne vienne s’interposer. Cet état de douleur sera du reste confirmé à la fin du roman où la voix auctoriale s’interrompt au terme de la métaphore de Dora Tavernier en lionne rugissante : « Trêve de plaisanterie. Il n’y a pas le plus petit grain d’humour dans le roman de Dora, de la pathétique Dora. Mais il y a l’amour, cette chose vénérable entre toutes…. » (723). Ceci pourrait donner à Mercadier, un instant, l’avantage d’une forme de « lucidité critique » . Pierre Mercadier est donc ce personnage qui vacille, selon les cas, sur les frontières de l’humeur noire et de l’humour, sans que rien ne le sorte véritablement du désespoir vers lequel peu à peu les événements de la sa vie vont l’emporter. Cela tend à faire de son évolution intellectuelle une évolution vers la dérision systématique et l’impression qu’il vit une vie «qui avait l’absurdité d’un orchestre parodique » (p.289) Ce mélange de l’humeur noire et de l’humour atteint aussi, dans sa version désespérée, le comble du cynisme :
Il emmena un soir au bois, en fiacre, une femme vieillissante qui lui parlait de la mort, pour le plaisir de lui donner une tape sur les fesses à l’instant le plus déconcertant de ses confidences. (326)
Il jouit également du privilège de l’ironie, une fois parti :
Il apprécia cette ironie comme un raffinement du sort et s’imagina avec un luxe de détails comiques les dialogues du frère et de la sœur. L’argent là‑dedans devait jouer son rôle, son rôle souverain, merveilleux… (369)
Enfin, il est celui qui, chez Meyer sait être « poliment sarcastique ». C’est bien cette image que l’on retient volontiers de lui. Mais Mercadier meurt sous les coups d’un mécanisme semblable, l’humour et la mort se rejoignant dans son agonie :
Qu’est–ce qu’il veut ? Il se démène dans les draps, pour autant qu’il puisse se démener… Le pauvre vieux ! Qu’est–ce que tu as ? Il se tord, sa bouche a l’air d’être le siège d’un drame, l’effort fait gonfler les veines des tempes, les joues rougissent, on dirait qu’il arrache sa langue, qu’il la décroche de la gorge, qu’il la pousse vers les mots prisonniers, va–t–il enfin trouver quelque chose pour exprimer ce qui est emprisonné dans cette malheureuse tête : « Ppp‑politique… » Allons, ce n’était pas la peine, tant d’efforts pour retomber dans le même mot…
De grosses larmes se sont formées dans ses yeux, dont les paupières en quelques semaines ont déjà changé, plutôt des peaux que des paupières, incapables de revenir sur elles‑mêmes assez vite, gaufrées… (712-713)
L’exception ouah ouah ?
Les enfants jouent un rôle particulier dans l’usage de l’humour. Lieu traditionnel de la plaisanterie de transgression, l’école, où vivent des êtres qui n’entendent guère la plaisanterie, dresse le décor d’une exploration de l’humour potache. Mais celui-ci ne semble pas prisé par Pascal : « On a donc regardé la parade. Pascal ne riait plus. Il avait l’air idiot. Son père lui expliquait les plaisanteries : ‘ Tu ne comprends pas ? Il lui a dit : Tu es saoûl, Palognon…Soupe à l’oignon ! Pascal comprenait d’autant mieux que cette plaisanterie traditionnelle avait été l’objet d’une dispute à l’école. Pascal détestait les calembours. Il regardait ceux qui en riaient comme des fous. Et en l’honneur de Palognon, il avait flanqué une tripotée à un type de sixième A. » (120). La voix auctoriale, à l’égard des années potaches, se fait du reste plus tendre : « M. Mercadier, dit le pion, finissez ces va-et-vient ! » Pas sans avoir regardé grossesse et pénis. » (122). Mais l’humour pur, que Pascal goûtera un peu plus, c’est dans le contexte de l’amour fou qu’il le découvrira, en compagnie d’Yvonne et de Suzanne, inventeurs du langage ouah-ouah qui constitue, dans son invention et son expression, une parenthèse remarquable dans le roman. Parenthétique, cet humour l’est dans la mesure où il intervient, grâce à Yvonne, comme une parodie roborative de la folie mais également du cynisme, que semble étymologiquement désigner l’appellation ouah-ouah. Il est deux fois doté du pouvoir de résoudre les disputes et les tensions dans le trio des enfants : « Yvonne fait sa ouah-ouah et tout s’arrange ». De même, et précisément « on sort de toute cette mauvaise humeur par le chemin ouah-ouah.» (189). Le langage ouah ouah fait sortir de la mélancolie, jusqu’à refonder l’arbitraire du rapport de convention du mot à la chose :
Non, mais on sera en retard pour le déjeuner, et ce n’est pas poli pour ta mère. Ma mère ? Ma mère ? D’abord laisse–la tranquille, maman et puis elle n’avait qu’à venir se promener comme tout le monde. C’est son affaire, si elle a la flemme…
« Pascal, – dit Yvonne, – tu parles, comme si tu étais un bisque‑basque…
– Et qu’est–ce que c’est, un bisque‑basque ? C’est un Ouah‑Ouah mâle, voilà… »
Et on sort de toute cette mauvaise humeur par le chemin ouah‑ouah.
Le chemin ouah-ouah ne sera ni celui de Pascal ni celui de Pierre Mercadier, ni celui de Paulette, ni celui de Blanche, ni celui de Suzanne, ni celui d’Yvonne. Comme dit Blanche, ce que nous lisons n’est pas « rigolo, rigolo » et la parenthèse ouah-ouah ne dure qu’un temps ; elle se teinte de folie et de tristesse. Il s’agit du monde de l’enfance. La dénégation du rire semble du reste marquer l’entrée du Monde réel et faire un arc avec la fin des Voyageurs : ne passe-t-on pas dans les Cloches de Bâle, de « Cela ne fit rire personne quand Guy appela Monsieur Romanet papa » à « tu veux rire, l’individu ! ». Le temps du rire est bien celui de l’enfance. Celui des adultes demeurent soumis à un destin qui ne fera plus rire personne ni en 1914, ni en 1939.
L.V., octobre 2001.