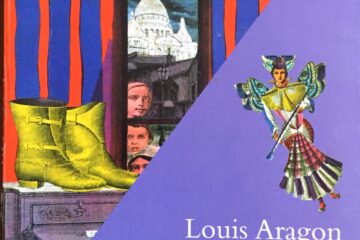Suzanne Ravis, « L’ombre de Barrès sur Les Voyageurs de l’impériale », 2006

Suzanne Ravis, L’ombre de Maurice Barrès sur Les Voyageurs de l’impériale
(Version remaniée et augmentée d’une communication présentée
à la journée des enseignants d’agrégation organisée à la Sorbonne
le 5 septembre 2001 par la Société d’Etude de la Littérature du XXème siècle)
« Les ombres qui flottent sur les couchants de l’Adriatique […]
tendent à commander des actes aux âmes qui les interrogent ».
C’est « la troupe des immortels qui mirent leur empreinte sur
ces nobles solitudes ».
Barrès, L’Appel au soldat
« …j’ai vu les grandes ombres qui chargent d’un sens riche ces
espaces plats. Elles filaient comme les nuages, mais nuages elles-mêmes, à bien examiner, elles font ici l’essentiel et le
. solide […] »
Barrès, « La mort de Venise »,
Amori et dolori sacrum
Le titre de cette communication, involontairement barrésien, voudrait signaler qu’il ne s’agit pas ici pour nous d’étudier à l’occasion de Barrès l’un de ces multiples exemples d’intertextualité qu’on découvre à chaque pas dans Les Voyageurs de l’impériale, bien qu’il soit tentant de le faire à partir de l’ensemble de chapitres intitulé « Venise » dans l’édition retouchée de1965. Dans son article de 1943 pour la revue Confluences, Auguste Anglès avait déjà noté les « résonnances [ sic] barrésiennes » du « voyage de Venise ».
Il s’agit d’une relation plus diffuse, mais importante, qui laisse percevoir quelques rencontres textuelles, mais surtout d’une interrogation sur Les Voyageurs de l’impériale où le passage par Barrès peut nous aider dans une recherche d’éclaircissement.
Si nous avons choisi d’interroger la relation éventuelle de ce roman à Barrès, dont le nom n’apparaît pourtant qu’une seule fois (p. 472), c’est en formant l’hypothèse que la passion bien connue d’Aragon pour Barrès pouvait avoir laissé une trace dans l’œuvre, d’autant plus que la période où se situe l’action du roman, 1889-1914, ou si l’on préfère 1918, correspond aux pleins feux du rayonnement barrésien, qui fut immense.[[ Voir par ex. Marius François Guyard, « Les dettes barrésiennes de la génération de 1895 », in Maurice Barrès, colloque de Nancy, 1963.]]
I-Barrès admiré et contesté : quelques rappels.
Pour Aragon, les preuves ou signes de son intérêt pour Barrès abondent, assez souvent rappelés par lui-même ou par la critique[[ Après la date de notre communication, est paru un article qui recense de façon quasi exhaustive les références à Barrès dans l’ensemble de l’œuvre d’Aragon : Nathanaël Dupré La Tour, « Aragon barrésien : une introduction », in Recherches Croisées Aragon/Elsa Triolet n° 8, Presses Universitaires de Strasbourg, 2002, p.93-116. ]]. Les plus marquants ont été rassemblés dans une communication de Reynald Lahanque au colloque du centenaire Lire Aragon, « Aragon lecteur de Barrès »[[ Lahanque, Reynald, « Aragon lecteur de Barrès », in Lire Aragon, sous la direction de Mireille Hilsum, Carine Trévisan, Maryse Vassevière. Honoré Champion éditeur, Paris, 2000, p. 221-237 (Colloque de 1997).]]. Signalons un fait moins connu : dans sa bibliothèque personnelle, Aragon avait quasiment tous les ouvrages et opuscules de Barrès, assez souvent dans l’édition originale. Ceci confirmerait ce qu’il déclarait à Dominique Arban en 1968 : « j’ai éprouvé une sorte de passion pour Barrès, lequel a joué dans mon développement intellectuel un rôle indiscutable » [[ Aragon parle avec Dominique Arban », éd. Seghers, 1968, p. 25.]]. On sait qu’il remonte, d’après l’auteur, à la première rencontre d’Aragon avec quelques beaux textes barrésiens, dans un livre de prix reçu en juillet 1909 : l’ouvrage de l’abbé Brémond paru en 1908,Vingt-cinq années de vie littéraire. Pages choisies de Maurice Barrès. « C’est là que j’ai découvert un certain nombre de choses, touchant l’écriture […] ». On se souvient qu’en1948, dans un article qui fit grand bruit, Aragon avait affirmé à propos de cette découverte, faite peu avant ses douze ans : « La lecture de ce livre fut pour moi un grand coup de soleil et il n’est pas exagéré de dire qu’elle décida de l’orientation de ma vie […] Barrès était mon Bouteiller »[[ Aragon, « S’il faut choisir, je me dirai barrésien », Les Lettres françaises, 16 décembre 1948. Article repris dans La Lumière de Stendhal et « En guise de préface » de L’Œuvre de Maurice Barrès, t. 2, Club de l’honnête homme, 1965-1969. Bouteiller est le professeur qui apporte aux jeunes Lorrains, dans Les Déracinés, la révélation de Kant et à travers lui, de la pensée philosophique.]]. Mais plus que de l’idéologie d’un maître admiré, puis contesté, Aragon y parle de « l’admirable langage barrésien », et célèbre « ce sens barrésien de la musique dans les mots ». Il semble bien en effet que le premier contact avec Barrès marqua surtout le jeune lecteur par la révélation de la littérature, comme le précise Aragon en 1950 dans sa réponse à une enquête sur les « lectures d’enfance » : « c’est ce livre-là qui m’a fait rechercher non seulement l’histoire racontée, mais le plaisir physique de la prose ».[[ Aragon, réponse à « Qu’aimaient-ils lire ? », Les Lettres françaises, n° 321, 20 juillet 1950, p. 4.]]
Avec la guerre de 1914-1918, Aragon voit d’un œil plus critique son grand maître. L’esthétique barrésienne est rejetée dans le passé au nom de la modernité : « Assez longtemps nous avons suivi nos frères aînés sur les cadavres d’autres civilisations. Voici venir le temps de la vie. Nous n’irons plus nous émouvoir à Bayreuth ou à Ravenne avec Barrès. Plus beaux nous semblent les noms de Toronto ou de Minnéapolis »[[ Aragon, « Du décor », Le Film, 1918. ]]. Pourtant, en 1921, dans le jeu des notes attribuées par Littérature, Aragon met à Barrès la note 14, Breton à peine moins, note élevée et rare dans leur échelle de valeurs.
Le procès intenté par les dadaïstes en 1921 à Barrès pour « attentat à la sûreté de l’esprit » témoigne de l’importance qu’ils lui accordent. On sait qu’Aragon y fut l’avocat de la défense, et y soutint, d’après Soupault, une défense « habile et brillante » malheureusement perdue[[ Voir Bonnet, Marguerite, L’Affaire Barrès, Corti Actual, 1987, p. 12.]]. Et si Aragon, dans les années vingt et trente, rejette la littérature de guerre où s’est déployé le lyrisme barrésien[[ Voir par exemple « Les Vampires », 1923, in Projet d’histoire littéraire contemporaine, édition établie, annotée et préfacée par Marc Dachy, Digraphe/ Gallimard, 1994. On peut se reporter à l’article de Luc Vigier, « Pour une herméneutique du témoignage dans l’œuvre de Louis Aragon », Recherches croisées Aragon/Elsa Triolet, n° 9, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, p. 42. ]], le souvenir de Barrès se prolongera de façon souterraine dans l’écriture testimoniale consacrée aux nouveaux « martyrs » de la seconde guerre et de la Résistance, comme l’a montré Luc Vigier dans sa thèse « La voix du témoin dans les œuvres en prose de Louis Aragon »[[ Doctorat nouveau régime, deux volumes dactylographiés, microfiches, Université de Provence, 2000., t. I, p. 178-183. ]].
Dans les années vingt, de fait, Barrès ne quitte pas l’horizon aragonien : une citation de L’Appel au soldat placée en exergue au livre III des Aventures de Télémaque, assez surprenante en ce lieu, et coupée de son contexte, attire d’autant plus notre attention qu’elle est extraite des pages où Barrès évoque l’état d’esprit de son personnage à Venise. Il s’agit de la dernière phrase de ce passage où le voyageur Sturel analyse son insatisfaction devant certaines œuvres de grand artiste, se demandant pourquoi il ne peut le trouver « beau et parfait » : « Mais moi-même, à quelle nécessité est-ce que je réponds ? Et que servira-t-il de me sculpter beau et parfait, si dans l’univers rien ni personne ne m’attendent pour que je me prouve comme tel ! » Arrivé à ce point, il se serait mis volontiers à parcourir les terres et les mers pour rencontrer l’occasion qui fait les héros. Le monde moderne, que ne sillonnent plus les chevaliers errants, connaît « celui qui veut agir ». Avec toute la noblesse qu’on voudra, Sturel se créait un état d’âme d’aventurier »[[ Barrès, L’Appel au soldat, in Romans et voyages, Le Roman de l’énergie nationale, éd. Robert Laffont, coll. Bouquins, éd. établie par Vital Rambaud, p. 766.]]. Cette méditation et son commentaire préfigurent curieusement certains thèmes, certaines questions lancinantes, qui hantent l’épisode italien de Mercadier (voir par exemple « Venise », chapitres II, III, VII).
Le même ouvrage Les Aventures de Télémaque inclut le manifeste dada paru dans Littérature du 15 mai 1920 : »Tout ce qui n’est pas moi est incompréhensible », qui se termine par ce questionnement moins barrésien : « Tout ce qui est moi est incompréhensible« .
En 1923, Aragon écrit deux lettres à Barrès, mélange d’insolence et d’admiration, et il lui rend une visite dont son article nécrologique de 1924 montre toute l’ambivalence (texte reproduit dans Aragon, Chroniques I, 1918-1932, édition établie par Bernard Leuilliot, Stock, 1998, p.183-186). Plus tard, la trace de Barrès se retrouvera dans la belle géorgienne Catherine des Cloches de Bâle, comme entre les lignes d’Aurélien, ne serait-ce qu’à travers le nom de Bérénice[[ Sur l’intertextualité barrésienne dans Aurélien, voir Lionel Follet, « Aurélien »: le fantasme et l’Histoire (1980 aux E.F.R. sous le titre Aragon, le fantasme et l’Histoire), Annales littéraires de l’Université de Besançon, 375, Les Belles-Lettres, 1988, p. 129-132. ]], et dans les commentaires d’Aragon sur le congrès d’Arles[[ Voir Aragon, « Le vent d’Arles », L’Œuvre poétique, vol. 3, édition en 7 volumes, Livre-Club Diderot, 1989, p. 476-479. ]] du PCF tenu en 1937 ; on la suit dans le thème si souvent répété des jardins d’Armide (thème majeur du poème écrit en 1954, « Madame Colette », ou dans Henri Matisse, roman, ainsi que dans Le Fou d’Elsa), et celui de « l’enchantement du Vendredi Saint », présent jusque dans Les Communistes[[ Les Communistes, version originale, « Mars-Mai 1940 », VI, éd. Stock, 1998, p. 593.]]. D’autres thèmes seront développés plus tardivement, notamment dans Blanche ou l’oubli (le martyre de Saint Maurice)[[ Reynald Lahanque s’est attaché à interpréter cette « reconnaissance de dette »,au colloque sur Barrès organisé en 2003 par l’Université Nancy 2. ]].
L’évolution d’Aragon et du PCF vers des prises des positions nationales et patriotiques à partir de 1934-1935, comme son éloge du roman politique chez Nizan à propos de La Conspiration, auraient pu justifier à la veille de la seconde guerre, lorsque Aragon écrit Les Voyageurs de l’impériale, une sorte de réhabilitation explicite de Barrès ; mais un tel pas est encore prématuré. Il ne sera franchi au grand jour qu’à l’occasion du célèbre article de 1948 cité plus haut, au titre provocateur à dessein : « S’il faut choisir, je me dirai barrésien »[[ On trouvera une analyse détaillée de cet article, avec son contexte, dans la communication de Reynald Lahanque citée en note 3. Voir en particulier la réhabilitation du roman politique, p. 227-228.]]. Dans ces conditions, il vaut la peine de s’interroger sur la présence visible ou cachée de Barrès dans Les Voyageurs de l’impériale.
II-Un modèle impossible
Paradoxalement, Barrès est quasi absent de la période narrée où son nom aurait pu être prononcé soit à l’occasion du déclin du boulangisme à partir de 1889, puisqu’il fut un vif partisan du général Boulanger, soit à propos du scandale du Panama dénoncé par l’écrivain dans Leurs figures, soit en relation avec l’affaire Dreyfus : on se souvient que Barrès attaqua violemment dans Le Journal du 1er février 1898 les intellectuels signataires d’un texte dénonçant les irrégularités des procès[[ Voir S.Ravis, « Responsabilité et démission des intellectuels, 1897-1939 », in Lectures d’Aragon. Les Voyageurs de l’impériale, sous la direction de Luc Vigier, Presses Universitaires de Rennes, 2001, p. 81-96.]]. Le rôle que Barrès joue dans ces occasions -sauf peut-être à propos du scandale du Panama- , et en particulier son antisémitisme affiché, font de lui, pour son admirateur littéraire, un modèle impossible. C’est ce que l’on peut inférer de l’unique mention du nom de Barrès dans Les Voyageurs de l’impériale.
La seule apparition de ce nom se situe au chapitre 3 de la seconde partie intitulée « Vingtième siècle » dans la version réorganisée en 1965 (version où l’épisode vénitien forme, avec celui de Monte-Carlo, une sorte de « parenthèse »[[ Aragon, Henri Matisse, roman, Gallimard, 1971, vol. II, p. 155. Sur la composition à effet d' »interlude » ménagée par le remaniement de la première version, voir notre commentaire dans la collection Foliothèque, « Suzanne Ravis commente » Louis Aragon, Les Voyageurs de l’impériale, Gallimard, 2001, p. 32-35 .]]). Aragon retrace en une rapide synthèse le milieu où s’est développée la légende de Mercadier pendant ses années d’absence, milieu correspondant aux artistes et intellectuels de La Revue blanche – non sans quelques traits d’ironie visant peut-être aussi, anachroniquement, le groupe surréaliste-: « Périodiquement naissaient ainsi des monstres et des héros dont la vogue atteignait les jeunes gens en quête de modèles et de sujets d’exaltation. Tous ne se satisfaisaient pas de ceux que leur donnait un Maurice Barrès. La religion de l’individu exigeait de nouvelles icônes« [[ Les Voyageurs de l’impériale, coll. Folio, 1972, p. 472. Les italiques sont de notre fait. Nous citons cette édition.]]. De façon syncrétique, le paragraphe associe la fin du dix-neuvième siècle et les premières années du vingtième, jusqu’à l’arrivée de Mercadier à Paris en 1910 : « Pierre Mercadier surgissait à point ».
Barrès avait été l’idole de La Revue blanche jusqu’en 1894 : « l’écrivain-phare de ces milieux décadents est Maurice Barrès », écrit l’historien Pascal Ory[[ Pascal Ory et Jean-François Sirinelli, Les Intellectuels en France de l’affaire Dreyfus à nos jours, Armand Colin (1986), réédition Collection U Histoire, 1992, p. 7. ]]. Vers 1892, la sympathie pour l’anarchisme, qui sera sensible en 1893 dans L’Ennemi des lois, les rapprochait. Léon Blum (« le fils Blum » dans le roman, p. 479, que le cousin Lévy décrit comme « tout farci de littérature, mais lui verse dans le socialisme », p. 476), publie dans la revue, le 15 novembre 1897, un compte rendu des Déracinés qui rend à l’auteur cet hommage enthousiaste, à peine nuancé d’un bémol : « Je ne vois pas en France d’homme vivant qui ait exercé, par la littérature, une action égale ou comparable […] [il a mis en circulation] « non pas l’armature provisoire d’un système, mais quelque chose qui tenait plus profondément à notre vie, une attitude, un mode d’esprit inconnu, une forme de sensibilité nouvelle […] Avons-nous trop de sympathie pour M. Barrès, trop d’entraînement, trop d’affection ? On l’a dit quelquefois. Ce qui est sûr, c’est que nous l’aimons ».
Mais après la violente prise de position antidreyfusiste et xénophobe de Barrès dans Le Journal du 1er février 1898, la rupture est consommée. Lucien Herr, l’un des piliers de la revue, le signifie nettement à l’écrivain dans une lettre ouverte : « Ne comptez plus sur l’adhésion des cœurs qui vous ont été indulgents dans vos moins tolérables fantaisies ».
Le texte des Voyageurs reste, on le voit, très allusif sur les « modèles » et « sujets d’exaltation » insatisfaisants offerts désormais par l’auteur d’Un homme libre. Celui-ci n’est pas pris pour cible par l’ironie s’exerçant contre l’inauthenticité de certains cercles intellectuels ; il n’est pas fait mention non plus de l’antisémitisme ni de la xénophobie que Barrès va développer à la fin du siècle, car d’autres personnages seront chargés de représenter ces tendances. Maurice Barrès reste donc, en apparence, étrangement absent de la scène historique du roman.
Les Voyageurs de l’impériale offre cependant bien des indices de convergences partielles avec les textes barrésiens, indices disséminés dans l’œuvre ou concentrés plus précisément dans les chapitres « Venise ». Au-delà de ces « résonances », et plus profondément, il convient de mettre en relation chez Aragon et Barrès les questions, essentielles pour ce roman et cruciales pour les deux écrivains, du passage de l’individu à la communauté sociale. Si le problème du lien social les préoccupe l’un et l’autre, si même certaines affinités les rapprochent, ils sont loin d’y apporter des réponses identiques.
III-Convergences partielles.
Elles jouent dans Les Voyageurs de l’impériale entre certaines caractéristiques du personnage de Mercadier, ou de son fils Pascal, et des traits appartenant à la biographie de Barrès, comme aux circonstances historiques et au cadre géographique de son enfance.
Est-ce simple hasard si Aragon attribue à Pascal une maladie d’enfance, la scarlatine, dont il manque de mourir (maladie dont mourut toute enfant une sœur de sa mère), et une typhoïde à quatorze ans qui le laisse affaibli (p. 590) ? Barrès relate dans ses souvenirs qu’il a failli mourir de la typhoïde à cinq ans, et en conserva une fragilité très protégée.
Plus fondé est le rapprochement avec l’expérience douloureuse, humiliante, de la défaite française en 1870 : « C’est qu’on n’a pas eu pour rien quinze ans en 71. La France avait son prestige à reconquérir », pense Pierre Mercadier (p. 60). L’ épreuve du jeune lorrain Barrès fut plus précoce et plus longue, puisqu’il avait huit ans lors de la débâcle des armées françaises en retraite, et que l’occupation allemande dans sa région dura jusqu’en 1873.
On connaît l’importance de l’enracinement lorrain pour Barrès. Si Aragon avait des raisons familiales mais occasionnelles, liées à la carrière de son oncle, de connaître Nancy et Commercy, il est frappant qu’il y place le dernier lieu de séjour professionnel de Pierre Mercadier : « grande ville morne, aux rues étroites, aux maisons hostiles » (p. 106). L’enracinement dans une terre, ce sera celui du jeune Pascal à Sainteville, souvenir d’enfance pour Aragon.
La rencontre avec les récits barrésiens est assez frappante dans l’évocation du collège, son cadre sans grâce, l’aridité et l’ennui des cours, le peu d’intérêt réciproque des élèves et des professeurs… »Mes maîtres. Ils n’ont rien éveillé en moi. Ils m’ont bien ennuyé pendant huit ans », écrit Barrès dans ses Cahiers, p. 14. Il ajoute : « Moi-même, étais-je pour eux quelque chose d’amusant ? ». La représentation du monde scolaire est plus appuyée, plus pathétique, chez Barrès, enfant délicat et choyé devenu interne à dix ans, tombant dans l' »enfer » chez les « Barbares » (d’après ses Mémoires et Sous l’œil des Barbares). Aragon a supprimé de son manuscrit une remarque un peu ironique disant que l’école Saint-Elme n’était pas un bagne comme on en voit dans les livres. Il ne conserve que la notation : »C’est une école comme toutes les écoles. Ecœurante à la façon des honnêtes épluchures de pommes de terre »(p. 109). Plutôt qu’une influence de Barrès, il faudrait peut-être voir une communauté d’expérience courante dans le système scolaire figé d’époques assez proches.
A l’adolescence, les mêmes lectures faites en cachette soutiennent le personnage autobiographique de Barrès et Pascal Mercadier devenu interne : Baudelaire, Flaubert, « Flaubert enfin, Flaubert prêté par un externe, qui était la revanche, l’alcool béni » (p. 593) . Barrès se souvient avec éblouissement de la lecture de Salambô.
Les deux auteurs expriment avec une sensibilité blessée le dégoût éprouvé par leurs personnages à devoir côtoyer des êtres avec lesquels on ne partage aucune affinité. A l’école, écrit Barrès, « ce sont précisément les futurs goujats qui dominent »(Sous l’œil des Barbares). Pour son héros Philippe, il faut « dégager [son] moi des alluvions qu’y rejette sans cesse le fleuve immonde des Barbares ». Dans Un homme libre, le héros, seul à Venise, parle un instant avec un jeune anglais satisfait de sa vie, dont les propos ne lui font que mesurer l’écart de sensibilité entre eux. On pense à la haine de la foule chez Pierre Mercadier, à son dédain pour l’étoffe vulgaire de M. Pailleron, comme pour les riches oisifs ignorants, à Monte-Carlo. Sans contact avec les autres, les personnages s’enivrent de solitude. A Paris, Mercadier la savoure ; à Venise, où il fait l’expérience de « sa lune de miel avec la solitude » ( p. 373), il la goûte mais en éprouve aussi le poids, « l’épreuve », » n’ayant âme qui vive à qui s’adresser » ( p.374).
Ces héros solitaires ressentent cependant un grand attrait pour les femmes, désir et besoin de tendresse mêlés, si bien que toute déception sentimentale provoque une impression douloureuse de vide : écoutons Philippe dans Un homme libre : « J’avais à propos d’elle conçu un si violent désir d’être heureux […] qu’en me retournant je me trouvai seul »[[ Le Culte du moi. Un homme libre, in Maurice Barrès, Romans et voyages, éd. établie par Vital Rambaud, coll. Bouquins, Robert Laffont, 1994, p. 172.]]. Les personnages de Barrès analysent sans fard l’ambivalence de leur vision des femmes, que partage Pierre Mercadier, comme on le voit dans le regard posé sur Francesca : l’adoration va de pair avec une forme de condescendance, ou de mépris, envers ces êtres tout d’instinct comme la petite Bérénice du jardin de Bérénice ou la jeune Marina de L’Ennemi des lois, avec « leur corps si souple, leur sourire de petit animal[[ Ibid., p. 167.]] ». L’esprit de l’époque explique en partie ces analogies.
La ressemblance des goûts artistiques rapproche plus encore de Barrès lui-même le personnage « fin de siècle » créé par Aragon, à en juger par son admiration pour Monet (chez les impressionnistes, « il n’y a que Monet », écrit Barrès dans ses Cahiers 1897-1898), et en musique, son enthousiasme pour Wagner. Ce sont également les deux artistes portés aux nues par Pierre Mercadier avant son départ pour Venise (ex. p.42 et p.104). En 1894, Barrès consacre au compositeur des lignes enflammées et sulfureuses. Il est allé plusieurs fois à Bayreuth, notamment pour un « pèlerinage » en solitaire, en 1892, et « le prophète de Bayreuth » se voit mis par l’écrivain sur un plan égal à celui des grands penseurs antiques (Platon transmettant le message de Socrate), ou chrétiens (le récit du jardin des oliviers). Si la Grèce antique et l’Evangile ont tracé deux directions par où « l’humanité se dirigea vers sa perfection », écrit Barrès dans un passage qui sera édulcoré en 1903, la pensée dont Wagner est le héraut « se substituera à ces formes usées » pour exalter « une éthique nouvelle », libérée des « dogmes » et des « codes » (texte de 1894)[[ Barrès, Romans et voyages, op.cit., p. 1342.]]. C’est bien le sens que prend le fameux texte du recueil Du sang, de la volupté et de la mort intitulé « Le regard sur la prairie », si souvent évoqué dans l’œuvre d’Aragon : « Par son sacrifice, Socrate promulgue la loi de la Cité, Jésus la loi de Dieu, l’amour. Que fondent Gundry, Tannhäuser, Tristan, héros déchirants de Wagner ? Les lois de l’individu […] Pour nous diriger dans le sens de notre perfection, nul besoin de nous conformer aux règles de la cité ni de la religion […] être un individu, voilà l’enseignement de Wagner[[ Ibid., p. 469.]] ». Ainsi le wagnérisme de Mercadier est doublement un trait d’époque, car il est lié à la question de l’individualisme encore débattue au début du vingtième siècle (par exemple dans L’Immoraliste de Gide) : « l’individualisme essentiel aux hommes d’il y a vingt ans » écrivait Aragon dans son « Introduction à 1930[[ Aragon, L’Œuvre poétique, éd. en 7 volumes, t. 2, p. 402.]] ».
Enfin le rapport à l’argent et au jeu, s’il n’est pas identique chez Barrès et Mercadier, ne manque pas de points communs : le jeune Barrès répète, dans ses livres les plus individualistes, que pour pouvoir cultiver son moi on a besoin « d’une forte indépendance matérielle[[ Barrès, Romans et voyages, op. cit., p. 257.]] »; « sans argent, plus d’ homme libre[[ Ibid., p. 173.]]« . Pour Mercadier également, l’argent seul garantit la liberté : » J’ai eu dix ans de vie à moi tout seul […] Dix ans de liberté. C’est à dire dix ans d’argent » (p. 485).
S’il ne se livre pas au jeu, Barrès comprend le joueur : « Les salles de jeu m’ont toujours ennuyé. J’ai pourtant tous les instincts du joueur […] il m’arrive, quand je souffre un peu des nerfs, de désirer avec frénésie risquer ma vie pour quelque chose, pour rien, pour l’orgueil de courir un grand risque[[ Ibid., p. 173.]] ». Mais la prudence le retient de remettre en cause son indépendance : « Celui qui se laisse empoigner par ses instincts naturels est perdu. Il redevient inconscient ; il perd la clairvoyance […] Le joueur de Monte-Carlo est là pour se fouetter un peu les nerfs, pour son plaisir. Que la chance l’abandonne, c’est un homme qui ne possède plus et qui compromet ses plaisirs de demain[[ Ibid., p. 173.]]. Mercadier, en tant que personnage de roman, reste moins sur la rive.
Si Barrès est peu nommé dans Les Voyageurs de l’impériale, on voit que bien des passages peuvent nous faire penser au Culte du moi ou à certains aspects de la biographie barrésienne. La tentation est forte de convoquer son souvenir dans l’épisode de Venise.
IV- Hauts lieux de l’égotisme : l’Italie et Venise
L’épisode italien des chapitres « Venise » des Voyageurs ne réveille pas seulement le souvenir de Barrès, mais, latentes, toutes les « ombres » qui hantent ce « cercueil flottant de tant de morts célèbres » (p. 369). Déjà, chez Barrès, l’Italie visitée par Philippe ou François Sturel rappelait tous les voyageurs, artistes, poètes, dont ces lieux ont gardé mémoire. Les textes de Barrès sur les peintres de Vénétie et de Toscane n’oublient pas l‘Histoire de la peinture en Italie de Stendhal, par exemple, et les souvenirs littéraires s’enchaînent. Aragon est plus allusif, moins développé, comme dans ce passage : « Il s’était pris au piège de la peinture monstrueuse du Titien, Véronèse et Tintoret » (p. 375). Certains monuments font rêver Pierre Mercadier, et l’arrêtent : comme le « colosse » du Coleone sculpté par Verocchio, et les « magnifiques tombeaux » de Palladio à Vicence (p. 406). Il s’agit moins d’une découverte artistique que d’une recherche de soi, et en ce sens l’Italie et Venise jouent pour Mercadier un rôle de révélateur, comme le montre la fin de la première partie (« Il avait tué le professeur Mercadier », p. 369 ).
Faut-il pour autant placer un signe d’équivalence entre l’expérience italienne du personnage aragonien et celle dont témoignent de nombreux textes de Maurice Barrès[[ Voir Emmanuel Godo, La Légende de Venise. Barrès et la tentation de l’écriture, éd. du Septentrion, 1996. Barrès parle de Venise dans Un homme libre, L’Ennemi des lois, Le Jardin de Bérénice, Du sang, de la volupté et de la mort, L’Appel au soldat, Amori et dolori sacrum, Le Mystère en pleine lumière, etc.]]? Si l’on discute de la date du premier voyage en Italie de Barrès (1886, ou plus tôt ?), on sait qu’il y fit plusieurs séjours, parfois longs, avec une prédilection pour Venise. Ses récits offrent des variations,allantdu texte un peu abstrait « Mon triomphe de Venise » dans Un homme libre (1889) à l’évocation somptueuse et « décadente » intitulée « La mort de Venise » dans Amori et dolori sacrum (1903) ; il parle encore de l’Italie après sa rencontre à Venise de l’écrivain D’Annunzio en 1916. L’ancienne cité des doges est une révélation décisive, comme il l’exprime en 1891 : « nul ami, nulle femme ne m’avaient été aussi précieux que cette dernière ville. Il me semble que j’y suis né à une conception plus large et plus somptueuse de la vie »[[ Nouvelle Revue Internationale, « Les matinées espagnoles », juin 1891.]]. En 1892, dans son « Examen des trois romans idéologiques », l’affirmation de Barrès est catégorique : « C’est à Venise que j’ai décidé toute ma vie, c’est de Venise également que je pourrais dater ces ouvrages »[[ Barrès, Romans et voyages, op. cit., p. 26.]].
L’élan qui pousse le héros d’Un homme libre à s’arracher à son quotidien pour se porter vers son « triomphe de Venise » correspond à un besoin profond comparable, sans être tout à fait identique, à celui qui précipite Pierre Mercadier vers l’Italie : « je suis venu à Venise pour m’accroître et pour me créer heureux. Voici cet instant arrivé[[ Le Culte du moi, in Romans et voyages, op. cit., p. 155.]] ». Les résonances barrésiennes s’entendent mieux encore dans l’évocation d’un monde qui se défait, à Vérone : « il avait beau […] se passionner pour les grands murs magnifiques et les fresques délabrées, il avait beau voir en ce monde étrange et luxueux d’une beauté défunte le jardin de sa propre sensibilité »… (p. 407). La Venise d’hiver, transposition de la « pluie italienne de septembre » des Poètes, est à la fois barrésienne et autobiographique. La ville pauvre, celle des cimetières, des ateliers, des couvents abandonnés, tournant le dos aux touristes (p. 373), avec « la tristesse des lagunes, l’arrière-pays fiévreux par-delà Fusine, tout hérissé de joncs, où la terre se décide difficilement à la cohérence » (p. 375), c’est celle d’Amori et dolori sacrum, en accord avec la hantise de la vase, de l’enfoncement, de l’indécis où « rien n’est plus stable, monde fuyant » (p. 403). Un profond accord unit les deux écrivains autour de certaines images de beauté désolée ou morbide. Un trait barrésien se rencontre même dans le détail inattendu des nourritures « immondes » au goût de vase (p. 384), venant troubler le concert d’une prose mélodieuse.
Dans l’ensemble des chapitres de l’ensemble intitulé « Venise », l’alliance de l’alanguissement et de l’exaltation d’une énergie auréolée de réminiscences historiques ou artistiques fait souvent penser à Barrès, même si s’impose le rapport intertextuel avec le Suarès de « Vers Venise » dans Le Voyage du condottiere [[ Noter cependant qu’Aragon, p. 378, attribue à Mercadier de l’admiration pour le mépris éprouvé par le condottiere envers le « troupeau », alors que Suarès l’en blâme. ]]. Cependant, la rêverie de puissance de Mercadier s’avère plus brutale, moins éthérée que l’apothéose barrésienne du moi. Le passage des Voyageurs de l’impériale sur la tentation de la force, le désir de puissance, pourrait avoir quelque rapport avec le ralliement de Barrès au général Boulanger dans l’article envoyé de Venise en avril 1888, « Monsieur le général Boulanger et la nouvelle génération », où il semble prêt à balayer au besoin par la violence un système parlementaire corrompu. Mais le roman d’Aragon intègre aussi les échos d’un nietzschéisme vulgarisé, et probablement les tendances fascisantes d’un G. D’Annunzio, que l’on retrouvera dans le personnage de Visconti des Communistes.
Pour Aragon comme pour une longue tradition littéraire européenne, l’Italie, Venise, sont des lieux d’exaltation de l’individu se réalisant dans un épanouissement idéalisé. Le problème rencontré par Barrès, et qui finira par se poser au personnage de Mercadier, est celui du passage de l’individu à la communauté.
V.- Comment passer – ou ne pas passer- du Moi au Nous ?
Le titre Le Culte du moi donné a posteriori aux trois « romans idéologiques » Sous l’œil des Barbares, Un homme libre, Le jardin de Bérénice, semble résumer la pensée de Barrès en une formule péremptoire. Mais de quel « moi » s’agit-il ?
Les trois ouvrages ont pour base, ou comme point de départ, la défense et la reconquête du vrai moi, assailli et recouvert par le harcèlement constant des « Barbares » formant le gros de la société, condisciples, collègues, famille, etc., que Mercadier désignera par « la tribu » : « Il n’avait jamais été de la tribu » (p. 374). Le jeune Barrès avait énoncé une sorte de « cogito », celle du sujet individuel : « Il n’y a qu’une chose que nous connaissions et qui existe réellement […] Cette seule réalité tangible, c’est le Moi »[[ « Examen des trois romans idéologiques », Romans et voyages, op. cit., p. 24.]], ce qui lui faisait conclure dans Sous l’œil des Barbares : « Attachons-nous à l’unique réalité, au Moi ».
Sur un mode moins philosophique, Mercadier revendique, lors de sa rupture et sa « fuite », les droits absolus de l’individu : « Moi, moi, rien que moi… Je ne peux pas m’imaginer que tout ceci me survive » (p. 384), et le narrateur le présente ainsi : « Lui comme individu. Sa force est pleinement dans son refus de ce qui n’est pas lui-même »(p. 406). Mais l’individualisme de Mercadier se contente d’affirmer son moi contre toute entrave, sans déboucher sur une action ; plein du « mépris des batailles contemporaines » (p. 408), il se nourrit des fantômes des « temps anciens », « comme des trompettes au lointain » (p. 408). La plus forte différence avec Barrès nous paraît tenir à l’absence de culture du Moi, de recherche menée pour se connaître et se développer, tandis que c’est l’inverse dans Un homme libre : « Le Moi, qui tout à l’heure ne savait même pas qu’il pouvait exister, voici qu’il se perfectionne et s’augmente », et dans l' »Examen des trois romans idéologiques », plus tardif : « Le Culte du Moi n’est pas de s’accepter tout entier. Cette éthique […] réclame de ses servants un constant effort. C’est une culture qui se fait par élargissements et par accroissements »[[ « Examen… », op. cit., p. 20.]]. Cultiver son Moi exige donc un double choix : le reconnaître sous la couche d’inauthenticité imposée, ce qui ne va pas sans rupture, et rejoindre ses véritables bases constitutives. Le personnage de Philippe, à Venise, par moments « se comprit comme un instant d’une chose immortelle » (ibid.); « Je ne suis qu’un instant d’un long développement de mon Etre ; de même la Venise de cette époque n’est qu’un instant de l’Ame vénitienne. Mon Etre et l’Etre vénitien sont illimités », car ils sont faits « de parcelles qui survécurent à des milliers de morts »[[ Un homme libre, Romans et voyages, op. cit., p. 159.]]. On s’achemine déjà vers une forme d’extension où le « je » devient un moment d’un « nous » transtemporel, et qui mènera à la fameuse formule barrésienne « la terre et les morts ». Un peu plus tard, le roman Les Déracinés lui donnera une dimension moins abstraite, plus sociologique, soulignée par Barrès dans la préface qu’il écrivit pour une réédition d’Un homme libre en 1904 : « Dans Les Déracinés, l’homme libre accepte et distingue son déterminisme […] Je me place dans une collectivité un peu plus longue que mon individu »[[ Op. cit., p. 93-94.]] .
Chez le personnage imaginé par Aragon, passé l’éclat spectaculaire de la « fuite », l’accent est mis sur une sorte de passivité, et le héros assiste à la perte lente de ses propres potentialités. Il tombe assez vite dans la répétition d’habitudes, et l’ersatz des sentiments va suppléer à l’aventure effective, bien que l’expérience de la solitude à Venise soit pour le héros « une grande aventure négative » (p. 376). Tandis que pour Barrès le Moi se construit aussi dans l’écriture de soi, Mercadier renonce à [s’] écrire, et la rêverie autour de Law dont son personnage s’auréole finit par se perdre dans les sables de l’inaccompli.
Dans sa préface de 1965 à la version remaniée des Voyageurs de l’impériale, Aragon déclare que ce livre « était en 1939 une entreprise de liquidation de l’individualisme »(p. 27). Nous avons essayé ailleurs d’analyser comment l’épisode italien du roman, le plus en résonance avec le « culte du moi » qui ne fut pas étranger au jeune Aragon, glisse peu à peu, aux yeux d’un lecteur attentif, de la révélation apportée par la solitude et la jouissance esthétique, à une image plus critique du protagoniste[[ Suzanne Ravis, » La mort à Venise de l’imaginaire individualiste dans Les Voyageurs de l’impériale « , in Le Dit masqué. Imaginaire et idéologie dans la littérature moderne et contemporaine, ouvrage coordonné par Anne Roche, Publications de l’Université de Provence, 2001. ]]. A ce stade du récit, la prise de conscience critique n’émane pas du personnage lui-même, tandis que chez Barrès, c’est souvent une sorte de maturation du héros qui amène sa pensée à élargir le « je » au « nous » : à partir de l’approfondissement de son individu, il s’achemine vers une éventuelle conscience du lien social.
Chez Aragon, le « nous » est déjà là dans le « moi », alors même que celui-ci croit être autonome. Le collectif baigne l’existence individuelle, comme le montre le « babil » des voix, aux énonciateurs parfois problématiques[[ Voir le très intéressant article de Franck Merger, « Ah non, Léon, tu veux rire : l’individu ! »/Enoncés individuels, discours social et critique de l’individualisme dans Les Voyageurs de l’impériale », in Lectures d’Aragon, Les Voyageurs de l’impériale, sous la direction de Luc Vigier, Presses Universitaires de Rennes, 2001.]]. La partie « Vingtième siècle » montre à la fois l’entrelacement des vies, et une amorce de changement dans la conscience du personnage. La saisie intuitive que celui-ci avait éprouvée, sur l’impériale de l’omnibus, d’un lien entre les êtres, de leur « solidarité mortelle » (p. 675), est illustrée par toute la conduite des derniers chapitres. Dans le même temps, le héros constate « que ses idées étaient le résultat non pas la cause, et quand le monde changeait, et sa situation dans ce monde, sa sécurité précaire, ces changements prenaient corps, devenaient des idées nouvelles [… ] un démenti, un soufflet à tout ce qu’il avait cru » (p. 692). Ce n’est plus la méditation d’un individu, mais la vie telle que la représente une écriture dans ses formes réalistes les plus délibérées et les plus subtiles, qui apporte un démenti à l’individualisme.
Ainsi le débat intérieur et politique qui habite chacun des deux écrivains noue par l’intermédiaire des œuvres un long dialogue, d’autant plus complexe qu’il n’est pas toujours explicité. Sur Venise plane l’ombre du premier Barrès, et la suite du roman recoupe parfois certains parcours de l’évolution barrésienne, sans en épouser l’idéologie. La déclaration fracassante de 1948 renverse certaines barrières et idées reçues, mais elle éblouit autant qu’elle éclaire. Par-delà sa ferveur et son ton péremptoire, cherchons à mettre au jour, dans une lecture rétrospective des Voyageurs, les croisements et les bifurcations de problématiques voisines, inscrites dans des solutions narratives fort différentes.