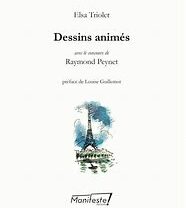Compte rendu par Geneviève Chovrelat-Péchoux de : Elsa Triolet, Dessins animés, 2021
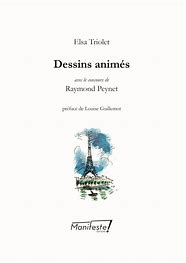
Dessins animés d’Elsa Triolet avec le concours de Raymond Peynet. Préface de Louise Guillemot, éditions Manifeste ! 2021, 119 p., 15 euros.
Aujourd’hui je jouerai de la flûte
Sur ma propre colonne vertébrale
Vladimir Maïakovski, La flûte des vertèbres
C’est une pépite rare qu’offre la jeune maison « éditions Manifeste ! » en publiant Dessins animés d’Elsa Triolet avec le concours de Raymond Peynet. Ce livre, d’un format modeste (A5), peut sans conteste être qualifié de « beau livre » : chaque page suscite la curiosité et, par les couleurs tendres de Raymond Peynet (1908-1999), nous plonge dans les verts paradis de l’enfance. Ce serait un livre pour enfants, croit-on en le feuilletant. Tels des valseurs échevelés qui marquent le tempo des lignes, les dessins colorés rythment l’espace de la page dont ils font le tour, en haut, en bas, sur les côtés, aux quatre coins, au milieu, en diagonale, en bandes et les mots les accompagnent allègrement dans un fondu enchaîné, à moins que ce ne soit l’inverse. On admire le déménageur à la casquette bleu ciel, portant l’obélisque, la diagonale des tasses blanches noires de chocolat et croissants roux, les petites mains au tricolore pâli, les amoureux perchés dans un cœur d’arbre à l’auréole amande, les trois lampadaires, au visage rose, ondulant sous les traits d’une pluie marine, l’éléphant coiffé d’un ruban céladon, le saucisson vermillon chaussé « d‘une sandale en cuir argenté avec un grand talon Louis XV », les souris presque vertes à la queue leu leu, les rouages pomme d’api et granny d’une machine à croix gammées, les robots munis d’aspirateurs gris et de balais jaunes.
Me revient alors en mémoire un extrait de Caucase (1931), livre d’André Beucler (1898-1985). Cet écrivain, né à Saint-Pétersbourg d’un père français et d’une mère russe, évoque, comme un sourire déchirant le carcan stalinien, « les livres d’enfants de Vladimir Lebedeff, artiste national, maître du merveilleux et du savoureux soviétiques, russe dans le sens le plus éthique du mot et qui porte à la perfection une façon de grouper, de proposer et de renseigner dont la Russie nouvelle a le monopole moral. »
Raymond Peynet réveille l’âme russe de la narratrice autrefois surnommée Fraise des bois, née Ella Kagan à Moscou en 1896, amie des artistes qui imprimèrent par leurs affiches leur marque à la Révolution de 1917 tant que fut accepté l’iconoclasme révolutionnaire dans l’iconographie. Tous les dessins de l’inclassable graphiste Raymond Peynet, dont l’énumération relèverait de l’extravagance d’un inventaire à la Prévert (que je laisse au plaisir de la découverte), animent une histoire apparemment sans queue ni tête comme dans un monde de fantaisie où les petits soldats sont musiciens et où la narratrice porte des ailes d’angelot. L’ange ou la fée ramènent à l’enfance heureuse qui croit à l’avenir mais la frêle midinette dévoile sa fragilité face à l’horreur qui l’entoure : la narratrice paraît nue sous le jet d’eau d’une trompe éléphantesque réjouie ou, au sortir d’un bain à la belle étoile, assise sur des toits rescapés de maisons effondrées. « Je m’assieds sur le mur… aïe ! ça coupe ! il faut qu’avant de m’asseoir j’y mette un peu de mousse de savon, ça me fait un coussin très confortable, je me sèche à la lune… »
Dans la France puritaine des années quarante, même au sortir de la guerre, Peynet ne recule pas devant l’audace d’un nu et on sent l’humour complice de l’écrivaine et du dessinateur à montrer autre chose que la légende des yeux d’Elsa dans une histoire qui aurait pu se terminer en queue de poisson… bleu. Mais quelle histoire ? Voici ce qu’en dit l’auteure elle-même en préambule à la parution de Dessins animés dans le tome 6 des Œuvres Romanesques Croisées (1965) dans une « Note pour la présente édition »:
« Ce conte fantastique a paru dans la revue Poésie 1945, dans Les Lettres Françaises, et, enfin en 1947 aux Éditions Bordas, illustré par Raymond Peynet. Écrit à l’époque des Fantômes armés, on y trouve à chaque page les thèmes mêmes de ce roman, mais il préfigure aussi L’Inspecteur des ruines, de 1948, Le Cheval roux de 1953, et même ce roman que je viens de terminer, Le grand jamais, paru en Janvier 1965.
Les Dessins animés, sous leurs faux airs de conte de fée, sont peut-être le plus amer de mes écrits.» (ORC, t. 6, p. 160)
Dans ce rêve-cauchemar, la narratrice de Dessins animés surgit pour la première fois dans cette phrase : « je dis tout à l’envers » ; ce « tout à l’envers » ne va pas sans rappeler un texte proche dans le temps et aussi insolite et peu connu que Dessins animés, à savoir Quel est cet étranger qui n’est pas d’ici ? ou Le Mythe de la baronne Mélanie, une « critique de la philosophie de l’absurde » (1943). Ce conte désopilant, qui mérite bien une publication indépendante – avis aux éditeurs !, écrit au cœur de la tourmente, porte l’espoir de la lutte contrairement aux Dessins animés dont le sous-titre « Conte du lendemain » inscrit le temps de l’énonciation, explicitement donné dans le texte, 1945, c’est-à-dire le contexte de l’après-guerre ; la romancière l’a résumé plus tard d’un mot, « désenchantement », dans le titre de sa préface des ORC à ses Fantômes armés.
Cela commence par une fête délicieuse aux parfums d’enfance russe mais à Paris, Noël, avec des bonbons, des pains d’épice, des joujoux et de « gros flocons de neige », la Seine « gelée pour ceux qui voulaient patiner ou se promener en traîneau » et aussi un banquet rue Royale « mais comme on mangeait tout le temps, l’ordre du récit n’a pas grande importance. » Des images de Noël à la Hoffmann et à la Tchaïkovski avec un merveilleux sapin lumineux et des danses et l’on danse et l’on danse : « Les Champs-Élysées étaient entièrement réservés à la danse.» Il y a foule au bal, un bal qui ressemble à ceux de la Libération, la liesse et la détresse : « Les séparés de tant d’années dansaient (avec, sous les paupières baissées, les ruines des maisons, des rêves, mais ça ne se voit pas quand c’est sous les paupières). » Les vivants et les morts s’agrippent dans un univers où les effluves mortifères du sapin étouffent le « beau Noël qui ne tient pas le coup » et ramènent la narratrice à sa table de travail, seule planche de salut. Elle écrit le mot « FIN », mais rien à faire, le stylographe ailé de Peynet ouvre la suite comme un début de page et d’histoire : « je ne pouvais faire autrement que de continuer ». Le conte s’étire tels les cheveux jacinthe de la narratrice dans les affres de la solitude et des cauchemars d’une guerre à peine finie et d’une autre démarrant froidement où, seul, un éléphant semble amical et capable de vaincre l’armée des souris porteuses de soucis et de mauvaises nouvelles. Il faut se laisser porter par le charme (au sens fort) des pérégrinations de la narratrice qui inscrit le monde réel par de vraies personnes, Jean Paulhan, Pierre Seghers et Paul Éluard.
Tous les trois suggèrent un temps de Résistance et de combat mais aussi de privation en tout. Comment ne pas entendre sous la plume d’une narratrice gelée les vers de Paul Éluard « Paris a faim Paris a froid ». La guerre, par ses privations du quotidien, a marqué les corps. « Je sentais d’étranges douleurs, mes os qui craquaient, mes membres qui s’allongeaient… Je me sentais devenir immense. » Le conte s’allonge. Géante devenue, la grande personne se repose sur Paris dont elle sent toutes les vibrations et cette géante aux fibres si sensibles rappelle un autre géant, écorché vif, dont la blouse jaune et les vers ont éclairé le Moscou de sa jeunesse, Vladimir Maïakovski. Notre auteure a traduit son recueil La Flûte des vertèbres. La géante couchée au-dessus de Paris a des délicatesses de princesse, celle au petit pois d’Andersen qui inscrit en creux les misères du temps présent sous d’autres figures, le cygne de Peynet, mais aussi les réverbères, la petite sirène. Ce conte qui n’en est pas un dit la préfacière, Louise Guillemot, se révèle pluriel : la narratrice est aussi Shéhérazade. L’écriture comme fil de vie.
Le livre s’ouvre en effet par une belle préface : Louise Guillemot donne des clés de lecture grâce à sa bonne connaissance de l’œuvre de Triolet. Elle remet en perspective historique les escapades de la narratrice de Dessins animés et joue de la concordance des temps de l’énoncé et de l’énonciation. (Un bémol concernant la datation du Cheval roux, donnée en 1972, or, c’est la date de publication par Gallimard. Il eût été plus éclairant, surtout pour renvoyer à la Guerre froide, d’indiquer la date de la première parution : 1953). La préfacière sait joliment nouer les fils qui relient ce texte de Triolet aux autres, passés et à venir. Du Noël de Juliette dans Les Amants d’Avignon, à l’héroïne des Fantômes armés, Anne-Marie, aux automates de L’Âme, Louise Guillemot dévoile avec finesse les liens subtils que tisse l’œuvre trioletienne. L’ourlet des mots et merveilles, explique-t-elle, est fait aussi des images des peintres dont la romancière fut familière. Bien sûr, Chagall s’insinue ici avec la narratrice flottant sur Paris ou sur le mont Kasbeck auquel s’accroche sa chevelure de jacinthe. Le joli titre de la préface « Féerie pour la dernière fois » est une invitation à lire « ceci n’est pas un conte » et à aller plus loin dans la découverte.
Qui lira jugera si ce texte qui ne ressemble à rien de connu est un conte ou pas. D’ailleurs, qu’importent les étiquettes ? Plaisirs du texte et du dessin garantis !
Geneviève Chovrelat-Péchoux, février 2022