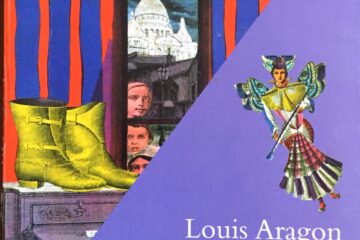Aurore Peyroles, « Les Communistes d’Aragon : roman de guerre, roman en guerre », 2 juillet 2010

« Tous les romans du Monde réel ont pour perspective ou pour fin l’apocalypse moderne, la guerre », constate Aragon dans Je n’ai jamais appris à écrire ou Les Incipit (1969 : 70). Mais, quand les volumes précédents s’y arrêtaient[[« La guerre y semble, dans le monde moderne, remplacer comme apothéose le mariage et la multiplicité des enfants à naître. Les Cloches de Bâle, Les Beaux Quartiers et Les Voyageurs de l’impériale ont 1914 pour fin, de Jaurès prédite, à Bâle en novembre 1912 dans le premier roman, à la Chambre dans le second en juillet 1913, déclarée au bout des Voyageurs, tandis qu’Aurélien, lui, s’inscrira dans l’espace entre la guerre de 14 et celle de 39, laquelle occupe entièrement le dernier roman du cycle, Les Communistes » (Aragon,1969 : 70-71).]], laissant pressentir l’horreur à venir sans la décrire, seuls Les Communistes[[Notre étude porte sur la première version du roman, et non sur sa réécriture de 1966 à l’occasion de la publication des Œuvres croisées d’Elsa Triolet et Aragon. Les modifications entre les deux versions, stylistiques et idéologiques, ont été nombreuses. Voir à ce propos l’article de Maryse Vassevière, « La réécriture des Communistes », paru dans la revue Littérature (Paris, Armand Collin, déc. 1971, pp. 79-89). Notre édition de référence est celle des Editions Stock (Paris, 1998) établie par Bernard Leuilliot. Sauf précision, tous nos renvois s’y rapportent.]] en franchissent le seuil, plongent dans « l’orgie, l’orgie de sang ». De la défaite des républicains espagnols à la débâcle de Dunkerque[[Aragon avait pour projet initial d’écrire une fresque de la France en guerre couvrant les années 1939-1945 ; seule la première « série » (« Février 1939-Juin 1940 ») fut écrite, suspendant le roman au récit de la débâcle.]], le roman est tout entier habité par la guerre, toile de fond omniprésente qui affecte l’ensemble de l’univers romanesque. Sa dernière partie surtout relève du roman de guerre, immergeant le lecteur dans la catastrophe de mai-juin 1940 et dans la violence du front.
Ce faisant, Aragon brave une sorte d’interdit auquel il avait longtemps souscrit, celui qui enjoignait de ne pas même nommer la guerre, rejetée ainsi dans les catégories de l’indicible et de l’irreprésentable : « Nous pensions que parler de la guerre, fût-ce pour la maudire, c’était encore lui faire de la réclame. Notre silence nous semblait un moyen de rayer la guerre, de l’enrayer » (1997 : 20). Silence vain. Silence paradoxal aussi puisqu’il privait le romancier d’un épisode extraordinairement révélateur – selon lui – d’une certaine forme de société et d’une certaine idéologie, puisqu’il le privait d’un genre et d’une écriture redoutablement efficaces. Car cet objet romanesque qu’est la guerre apparaît, dans Les Communistes, comme l’occasion d’engager le roman dans un autre conflit, non résolu au moment de son écriture : une guerre idéologique, qui oppose les communistes à tous les autres, la « guerre froide ». Roman d’attaque et de défense, Les Communistes sont un roman de guerre parti en guerre.
« L’œuvre d’Aragon est toujours ouverte sur l’histoire qui est en train de se faire » (Rieuneau, 1974 : 415), et elle entend même y participer. Le romancier lui-même insistera sur la nécessité de « dater [s]es écrits[[« Je ne crois pas que l’on puisse comprendre quoi que ce soit de moi si l’on omet de dater mes pensées ou mes écrits », écrit-il dans la postface à la deuxième version des Communistes.]] », soulignant l’ancrage de ses textes dans leur contexte. Publiés en 1949 et 1951, Les Communistes s’inscrivent dans une nouvelle page de l’histoire du Parti communiste. Plus que jamais, peut-être, il s’agit alors de défendre « le pays du socialisme » et sa doctrine : ratification du Pacte atlantique, lancement du plan Marshall, les antagonismes entre Est et Ouest se radicalisent, et la situation internationale évolue vers un conflit de plus en plus ouvert. La situation intérieure aussi : dès 1947, le PCF se voit exclu du gouvernement ; l’unité nationale a vécu. L’année suivante, les grèves des mineurs sont violemment réprimées par le pouvoir. La fin de la guerre ne signe donc pas la fin du combat, au contraire, et à l’écriture du passé récent se mêle l’acte politique, conjugué au présent. « Les positions exprimées par Aragon sont doublement « contemporaines », de l’époque représentée et des circonstances de sa représentation », conclut Bernard Leuilliot (V). En même temps qu’il témoigne et (ré)écrit le traumatisme des événements récents, le romancier se fait militant. Plus largement, il s’agit de convaincre. Convaincre de quoi ? Non plus de la nécessité d’un monde pacifié et pacifiste, comme c’est le cas de la majorité des romans de guerre parus après 1918, mais de la justesse du combat communiste, passé et à venir, de la nécessité donc d’une lutte toujours à mener.
Reste à démêler les stratégies du « comment convaincre ». Comment Aragon, en se lançant enfin dans la description de l’« Apocalypse », engage-t-il son roman dans un conflit nouveau, horizon du texte non décrit ? Comment, en écrivant la guerre, qui appelle une « esthétique du chaos » (Narjoux, 2007 : 213) peu propice à la démonstration, un discours s’articule-t-il, pas à pas, non seulement sur la guerre décrite mais surtout sur ce qui en est à l’origine, à savoir une organisation sociale et politique, une idéologie qu’il s’agit de combattre ? Nous restreindrons notre étude à la dernière partie du roman[[Si ce roman-fleuve ne se limite ni au front ni à ces deux mois, l’« Apocalypse » finale n’en représente pas moins l’aboutissement, à la fois logique et désastreux.]], la plus longue et la plus authentiquement « de guerre » : consacrée à la bataille de mai-juin 1940, elle utilise tous les éléments propres au genre. Conscient de l’insuffisance, esthétique et politique, du roman à thèse, Aragon réinvente les stratégies romanesques visant à convaincre, en se servant précisément d’un genre qui ne s’y prête guère. C’est en prenant l’appellation générique de « roman de guerre » au pied de la lettre, en en exacerbant les traits, qu’Aragon en fait exploser les codes et les utilise à une fin – entre autres – politique.
Des faits, rien que des faits : la chronique de la guerre
Ce qui frappe, à la lecture des Communistes, c’est leur force de persuasion ; ce qui frappe, à leur étude, c’est l’absence – voire le refus – d’un discours explicitement militant, idéologiquement cohérent et efficacement didactique. Des faits, plus que des convictions : telle en est la matière romanesque. Contrairement à ce que pourrait suggérer son titre, l’aventure du réel historique y éclipse l’ornière dogmatique et l’exposé théorique : ce roman, et en particulier sa dernière partie, se présente comme un recueil de faits, bruts et brutalement rendus. C’est là l’économie du roman de guerre, qui oscille sans cesse entre la chronique et la fiction, entre le compte rendu de l’expérience vécue et l’imagination romanesque[[Pour l’analyse du roman de guerre en tant que genre, voir Rieuneau (1974).]]. Mais s’en tenir aux faits n’est pas, sous la plume d’Aragon, résignation. Au contraire : l’affranchissement du roman par rapport à un discours idéologique, plaqué sur la fiction au détriment de la vérité historique, fonctionne comme un argument stratégique.
Témoignage
Un trait fondamental du roman de guerre est le rapport direct qu’il entretient avec l’expérience vécue de l’auteur. […] L’observation, les faits vrais, l’expérience personnelle garantissent l’authenticité de la fiction, dont les droits sont conservés (Rieuneau, 1974 : 6).
On retrouve, dans Les Communistes, cette immixtion de l’expérience dans le récit romanesque. La guerre décrite, Aragon l’a connue. Appelé sous les drapeaux dès septembre 1939, il se distinguera au front par son courage, récompensé par une croix de guerre[[Il écrit dans une lettre adressée à Elsa à la fin de juin 1940 : « Mais enfin tout est bien […] et je suis l’objet d’une deuxième distinction, si bien que tu ne reconnaîtrais pas ma poitrine. » Cité par R. Bourderon dans « Ma quarantaine en l’an quarante » (in Les Engagements d’Aragon, Paris, L’Harmattan, revue « Itinéraires et contacts de culture », 1998, p. 91).]]. C’est cette expérience qui nourrit en grande partie les épisodes de la mobilisation et du front : « C’est le plus autobiographique de mes romans », confirmera le romancier. Il affecte son personnage Barbentane à un régiment de travailleurs cantonné dans le Mulcien, très semblable à celui où lui-même fut d’abord envoyé, rassemblement d’éléments douteux,
résultat d’un tri bizarre, plus social que physique. Des mauvaises têtes, des condamnés de droit commun, des Juifs, pas mal de Juifs, des Français de fraîche date, la promotion Blum suivant l’expression du commandant Müller (335).
Attaché à un groupe sanitaire au déclenchement des hostilités, il mettra ce dernier en scène avec l’unité de Jean de Moncey. Tous les épisodes militaires, l’attente interminable de la « drôle de guerre » comme l’angoisse du front, renvoient à une expérience vécue, qui autorise la fiction et la légitime.
Ce statut de témoin de l’histoire et de la guerre, l’auteur le revendique, prenant position dans une de ses chroniques contre l’idée « éculée » de la « nécessité d’une distance romanesque », et de l’« impossibilité de traduire par un roman une réalité directement contemporaine » : « Pour bien décrire, pour dominer son sujet, il ne faudrait […] le connaître que par ouï-dire, ne pas avoir été témoin. » Aragon préfère y opposer l’exemple, littéraire, de Barrès, « écrivant immédiatement sur l’événement, avec, pour matériel, l’événement même auquel il avait été mêlé ». Sur la bande-annonce du deuxième fascicule de la version originale, Aragon, privé en 1949 de ses droits civiques pour propagation de fausses nouvelles, clamait : « On peut me priver de mes droits civiques. On ne m’empêchera pas de témoigner[[Toutes ces citations d’Aragon proviennent de la préface de notre édition de référence, écrite par Bernard Leuilliot.]]. » Être témoin, ou du moins l’avoir été, représente aux yeux du romancier une garantie contre l’affabulation et l’abstraction, un socle de vérités incontestables. Cela renvoie aussi à une certaine conception de l’acte d’écrire : la proximité avec l’événement vécu, l’immédiateté, la démarche du reportage donc, sont érigées en critères de l’écriture romanesque.
Pour moi, je suis persuadé que ce n’est pas dans les cendres du temps, mais dans les dangereuses flammes de l’événement que naissent les images valables de l’homme, dût celui qui a l’audace de les y arracher s’en brûler affreusement les mains, en être défiguré, en périr (Aragon, 1967 : 421).
Il s’agit d’être au plus près de son objet, au plus près de la réalité décrite. Cette posture de témoin n’est pas exclusive : le romancier est loin de limiter son récit à sa propre histoire. Mais elle relève d’un choix narratif revendiqué : le roman se fait le prolongement de l’expérience personnelle, le miroir de faits vécus. Or l’authenticité de ces éléments autobiographiques contamine en quelque sorte le reste de la narration, assimilée à un vaste témoignage, dépassant l’échelle individuelle, mais dont le caractère collectif n’affaiblirait pas la fiabilité. Si la fiction sert une certaine vision des événements rapportés, ce ne sera pas au détriment de ces événements.
Histoire et histoires
Et, en effet, l’ensemble des faits rapportés est vérifiable. La précision des dates, le déroulement des événements jour après jour, l’exactitude des descriptions topographiques[[Guidé par le souci de l’exactitude, Aragon est reparti dès la Libération sur les lieux de la débâcle française de 1940 pour prendre des notes sur les lieux et les gens croisés, selon le modèle du reportage.]] et des mouvements de troupes, rattachent le roman à une chronique – romanesque – des faits de guerre. Les intrigues de la fiction s’insèrent dans le cadre rigoureux de l’histoire. Cette soumission de la fiction à l’histoire est particulièrement frappante dans cette dernière partie du roman : dès lors qu’il s’agit de la guerre elle-même, et non plus des mois qui l’ont précédée, le caractère romanesque s’estompe au profit d’une description, parfois aride, des mouvements de troupes, des ordres donnés, du spectacle de la mort. Le temps est rythmé par les repères militaires « J1 », « J2 », etc. ; les dialogues se font moins nombreux, au contraire des descriptions qui s’amplifient au cours des derniers chapitres ; le point de vue s’élargit ; les noms des bataillons, de leurs commandants et de leurs mouvements saturent certaines pages. Un exemple :
Le général Billotte, à Chimay, avait rencontré Corap vers les 15 heures. Le commandant de la 9e armée promettait de faire de son mieux. On pourrait, estimait-il, amener les forces nécessaires devant Dinant avant huit heures du soir…
[…] Pendant cette conversation, au sud de l’armée Corap, chez Libaud, à Monthermé, c’est-à-dire dans le secteur tenu par la 102e division de forteresse du général Portzert, à un peu plus de quinze kilomètres au nord de Charleville, malgré le pont détruit, l’ennemi, sous le couvert de l’artillerie, a passé l’eau, s’est glissé dans les bois et il aura pris le village avant la nuit […].
Et quand on descend plus au sud, dans le secteur de la 2e armée, c’est encore bien pis (753).
Surtout, les personnages romanesques y sont comme dépouillés de leurs histoires personnelles. Le roman d’amour entre Jean et Cécile, fil narratif constant des précédentes parties, n’est évoqué que par la réception d’une lettre. Il n’est presque plus question de l’arrière, ni donc des militants clandestins. Les protagonistes, Jean, Barbentane, Raoul, que le lecteur suit depuis 700 pages, paraissent n’être plus que les ombres d’eux-mêmes, comme si leur épaisseur psychologique et humaine ne pouvait résister à l’expérience du front. Témoins effarés, et souvent impuissants, de l’horreur de la guerre, ils sont des soldats noyés parmi les autres, parmi ces
milliers et milliers d’hommes [qui] avancent dans la nuit de J2 à J3, avec des ampoules aux pieds, l’épaule qui cède au sac… ou oscillants de sommeil dans les camions, les cars civils barbouillés de camouflage, les tout-terrains, stationnement d’interminables heures à ne pouvoir ni dormir ni avancer… ou œil fixé sur la cocarde blanche du véhicule qui précède, ou dans le vacarme des chars avec l’officier de la tourelle qui, lui, sait peut-être de quoi il s’agit… (728).
Inversement, les personnalités historiques réelles occupent de plus en plus le devant de la scène. Mais elles ne sont pas traitées autrement que les personnages romanesques.
Cette proximité entre êtres fictifs et êtres réels ainsi que l’exactitude des événements décrits brouillent les frontières entre la réalité historique et la fiction romanesque, jusqu’à l’indécidable. La sphère fictive se fait le simple relais de l’écriture de l’histoire : la guerre en est l’unique centre, au détriment des intrigues romanesques. Précisons que le roman d’Aragon n’est pas rythmé par la seule histoire officielle, celle des généraux et des ministres. Les oubliés aussi y ont leur place. Dans la colonne des hommes de Libercourt et d’Oignies se mêlent des personnages fictifs et les premières victimes réelles de l’occupant allemand, dont les noms s’inscrivent dans l’espace textuel :
Je ne sais que quatre noms de ceux-là, Georges Mullen, Eugène Wasson, Aristide Olivier, employés de bureaux aux mines d’Oignies, et Alfred Stanczyk, polonais, ouvrier agricole qui travaillait au moulin d’Oignies, fils de Bolesclaw Stanczyk, abattu ce matin vers sept heures […] (949).
Le roman ne se contente pas de retranscrire en les romançant les événements de l’histoire. Il a aussi pour mission d’écrire l’histoire de la guerre, une histoire oubliée, et pourtant indispensable. Aragon transfigure ainsi ses pages de guerre en un espace de mémoire, véridique, incontestable et nécessaire. Cependant, si la dimension de témoignage et de récit historique se développe au détriment de la dimension romanesque, elle sert la dimension politique des Communistes : il s’agit d’écrire l’histoire de la guerre et de forger sa mémoire, mais d’une certaine manière.
Le saisissement des faits
Entre chronique et témoignage, le romancier semble s’en tenir aux faits. Fictifs ou réels, ces faits sont bruts et ne sont pas doublés d’un discours interprétatif. « Jamais il n’y a eu moins de place pour les idées générales », constate le narrateur en décrivant la plage de Dunkerque où s’entassent les soldats de l’armée vaincue :
Des kilomètres et des kilomètres de sable où plus de cent mille soldats à cette heure voudraient avoir l’invisibilité de ces poux qui sautent autour d’eux, leur couleur locale. […] Tout ça, fourbu, sale, chiffonné, sans couleur. Des kilomètres de plage, les types à se toucher. Une tapisserie de sueurs et de coliques (989).
La description prime sur l’exposé, et les faits sur les « idées générales ». « « Je pense, dit Criquet, qu’on se fait des idées sur la guerre… » » (804) : ces « idées », nécessairement fausses car déconnectées de l’expérience, sont bannies du roman, au profit de faits, incontestables, qui seuls peuvent donner une image juste de la réalité de la guerre. Le drame des réfugiés[[« Le spectacle était à fendre le cœur, l’épuisement, la misère, la poussière, les sanglots des gosses, le désespoir des vieillards, les scènes déchirantes dans les fossés, les malades qui suppliaient les leurs de les abandonner […] » (849).]], celui des populations civiles décimées par les bombardements[[« Tout d’un coup, cela a fait feu de partout, un chapelet d’éclatements, la terre et la fumée, trente bombes, les membres arrachés, les morceaux humains lancés par-dessus la route où une voiture de laitier se renverse, traînée par des chevaux fous, dans les cris flamands, trente bombes par bouquets successifs, la course en arrière, le recul qui s’écrase, la mort et le sang sur ces hommes mal réveillés encore, et le squelette de fer tordu, calciné, déchiré… Combien y avait-il de morts ? Une centaine de blessés fuyaient, s’aidaient, se bousculaient, hurlant. Les corps restés à terre, personne n’osait y toucher… un grand vide s’était fait autour d’eux… » (708).]], les terribles exactions des SS[[« Lié sur un fauteuil, un homme. Un homme jeune et fort, blond, sans rien sur la tête… Un officier anglais. Il est là depuis ce matin, en butte aux railleries des SS. Un officier l’a cravaché dans son fauteuil en pleine figure. Il sent cette zébrure à travers son front et sa joue. Ils l’ont arrosé d’essence, vivant, comme ils ont fait des morts dans la cour du château De Clercq tout à l’heure. Et ils viennent d’y flanquer le feu. Ils ont jeté l’essence sur cet homme comme on jette des seaux d’eau sur un ivrogne » (947).]], les décisions contradictoires des généraux français, les expéditions nocturnes de Raoul, l’errance des unités perdues : tout est décrit, et non pas analysé. Nulle vue de l’esprit ici, mais une vision extrêmement réaliste des événements, à vue de soldat.
Or ce parti pris du compte rendu factuel n’implique pas la neutralité. Les faits, anecdotiques ou historiques, fictifs ou réels, provoquent chez le lecteur, comme chez les personnages romanesques, un effet de sidération. Le déferlement de violence, l’absurdité des morts au combat font s’exclamer Oustric : « C’est fou, cette valeur humaine qui se perd comme ça… à ça ! » (805). Le lecteur ne peut que partager cette indignation. L’avalanche d’horreurs n’est jamais commentée, elle n’en est pas moins dénoncée. C’est que le compte rendu, quand les faits sont particulièrement forts, particulièrement parlants, est plus efficace que tout autre discours. Il faut alors savoir se taire. C’est ce que conseillait Claude-Edmonde Magny (1948 : 64) :
L’exemple du cinéma peut préserver le romancier, pédagogue trop consciencieux, de la tentation qui menace tout homme dès qu’il parle : celle du didactisme. Il lui montrera la valeur du raccourci, le fera rêver […] d’un art où les mots auraient acquis la valeur poignante des images et sauraient nous communiquer la même angoisse aussitôt dissipée, la même implacable et discrète émotion.
Aragon, grand adepte du septième art, fait confiance à la force des seuls faits rapportés, sans qu’il soit besoin de les expliquer ou de les expliciter. Ce sont eux qui parlent. Le roman se contente de les faire voir.
[…] un peu partout dans les casemates de la rive gauche par leurs étroites ouvertures pénètrent les petits obus des canons antichars allemands, qui éclatent à l’intérieur. Ou c’est le jet des lance-flammes… Des hommes comme des torches sortent du béton, hurlant…
[…] Ces généraux n’ont pas idée de ce que ça signifie un obus antichar ou un jet de flammes entrant dans une casemate, et Huntziger […] se fâche : « Ils n’ont qu’à tenir ! Nous avons bien tenu à Verdun ! » (756).
Ce que ne voient pas les généraux, le romancier le montre au lecteur. Le réel reprend ses droits sur les conceptions préconçues. Si « tout cela [la panique de l’armée], les observateurs le voient mal à cause de l’énorme rideau de poussière que le bombardement a soulevé pendant des heures le long de la Meuse » (754), le romancier n’est pas gêné par de tels obstacles : il décrit, inlassablement, et ce faisant, il fait comprendre.
Car les faits décrits et leur violence sont l’aboutissement de choix stratégiques et d’une politique, non d’une fatalité. Un exemple, réel ou fictif ? Devant l’avancée allemande et l’absence des renforts aériens demandés, des unités reculent. Réaction du général Huntziger:
Avec ces lâches qui se rendent ! Eh bien, en fait d’avions, qu’on leur envoie des parpaings ! L’honneur de l’armée exige qu’on fasse un exemple. On pourrait tirer sur les Allemands : l’artillerie française du bois de la Marfée tire sur ces Français démoralisés (757).
Ainsi se clôt la séquence. L’image est forte, et elle se passe de commentaire : l’identification des responsables est immédiate. À une échelle plus large, les souffrances endurées par les soldats et les civils sont sans cesse entrelacées aux décisions de l’état-major : le lien de cause à effet n’est pas énoncé, mais il est établi par le lecteur grâce au montage romanesque. « L’idée doit résulter du choc de deux éléments indépendants l’un de l’autre », écrivait Eisenstein (1976 : 102). C’est bien ce choc que crée la juxtaposition, dans le chapitre 25 par exemple, de la situation dramatique du front et de l’insouciance et l’incompétence des sphères parisiennes de commandement. Les faits rapportés parlent d’eux-mêmes, suscitant l’indignation. Mais de leur orchestration résulte une interprétation de ces faits, livrés pourtant sans médiation. À travers le roman s’élabore ainsi un discours sur la réalité historique : un discours sans mots, d’autant plus efficace qu’il reste silencieux. Et la chronique, dans sa fidélité même au réel historique, se fait dévoilement.
L’écriture du compte rendu est donc stratégique : abandonnant les apparences de la fiction engagée, Aragon fait entendre un discours dénonciateur qui semble se déduire logiquement de la fidélité au réel, seul guide apparent de son roman.
Rien n’est plus loin de ce qu’on décrit ordinairement sous le nom de « littérature de propagande » que cette sorte de roman qui ne cherche point à convaincre comme un discours, mais qui montre la vie telle qu’elle est, et qui convainc plus sûrement par là même, comme fait l’histoire qui se charge de pas mal des idées des hommes, non par la discussion, mais par le fait[[Je souligne.]] (Aragon, cité dans Garaudy, 1961 : 287).
Écrire « l’histoire » pour forger les idées de son lecteur, c’est précisément ce que fait Aragon dans Les Communistes. Il adopte la posture du chroniqueur, mais utilise cette posture pour faire résonner sa propre vision de l’histoire récente, pour articuler un discours sur la guerre décrite.
Plongée dans la « fureur inhumaine » : l’expérience de la guerre
L’écho en est d’autant plus fort qu’en renonçant à une vue d’ensemble ou à une explication des événements, Aragon annule la distance historique et narrative ; il projette son lecteur dans le cours de l’histoire comme en train de s’accomplir, imprévisible, douloureux, chaotique. Plongée dans le « monde réel », plongée plus précisément dans la réalité de la guerre. Il s’agit de faire vivre, et non plus seulement de faire voir. L’expérimentation plutôt que l’explication, l’immédiateté plutôt que la médiation : les choix narratifs d’Aragon dans Les Communistes, semblent contraires à l’énonciation d’un discours cohérent. Le lecteur, convoqué sur la scène du roman, fait l’expérience du chaos de la guerre, au même titre que les personnages romanesques : il y perd tous ses repères, géographiques, historiques, idéologiques. L’auteur, non.
L’expérience du chaos
Dans Les Communistes, Aragon invente « une écriture du désastre, à la limite parfois, et comme il convient au sujet, de l’illisibilité » (Leuilliot : XVI). L’illisible pour écrire l’incompréhensible. Le roman semble contaminé par son objet, furieusement saisi par la pagaille, débordé par le chaos[[Aragon semble considérer que la défaite est plus à même d’inspirer les romanciers que la victoire : « Il n’y a pas d’exemple d’une victoire qui ait inspiré un roman où on voie la guerre, la guerre victorieuse. La victoire russe tient bien peu de place chez Tolstoï. Ce sont les malheurs de la patrie qui l’ont d’abord et surtout inspiré […]. L’autre guerre, celle qu’on appelait la Grande, a produit un tas de romans, pendant et après : mais du Feu à Verdun, aucun ne décrit la victoire, tous sont centrés sur l’horreur de la vie des tranchées » (cité dans Rieuneau, 1974 : 414).
]]. Pour dire la débâcle, toutes les catégories romanesques éclatent, littéralement. L’espace, d’abord. Dans les chapitres de « Mai-Juin 1940 », l’unité géographique est plus forte que dans les autres parties du roman, qui sillonnaient la France du Nord au Sud. Ici, il n’est – presque – plus question que du Nord-Est, zone des combats. Mais cet apparent resserrement dissimule un éclatement plus grand encore : les noms de communes défilent, dans un sens, celui de l’avancée, puis dans l’autre, celui du repli ; les points cardinaux s’inversent dans la panique ; les unités se cherchent sans se trouver, cherchent même la ligne de front : « Y a-t-il un front continu devant nous, ou quoi ? des pointes en éventail de part et d’autre. Les armées se cherchent dans la nuit sans doute… » (721). Le temps, ensuite : nuit et jour se confondent ; les effets de simultanéité sont si nombreux que le lecteur a l’impression que le temps ne se déroule plus mais se dilate indéfiniment, se diffracte en instants isolés sans plus s’articuler en une continuité : « Pour les uns, cela débute ainsi. Pour les autres autrement » (707), et l’expérience d’un même moment ne suffit pas à gommer cette différenciation infinie. « De la traversée de Dunkerque, Jean de Moncey ne gardera que des tableaux séparés. Impossible de relier exactement ces images […] » (995) : il en sera de même pour le lecteur.
La narration elle-même finit par se perdre dans l’affolement général. De même que l’armée française est débordée par l’avancée fulgurante des Allemands, de même le narrateur semble dépassé par le cours des événements, par l’emballement panique des unités et des directives. L’effet mimétique est saisissant : les soldats ont perdu tout repère – géographique, temporel, hiérarchique –, le lecteur perd quant à lui tout repère narratif.
Et le dix mai au matin, Huntziger avait fait dire à Benedetti par le colonel Lacaille, son chef d’état-major, qu’il le chargeait d’assurer la liaison avec la 9e armée du général Corap, dont le PC était à Vervins à près de cent kilomètres au nord-ouest : il aurait à renseigner à la fois Huntziger et l’aile gauche de son armée, c’est-à-dire ou à Buzancy le général Grandsard, commandant le 10e corps d’armée, ou, au besoin à Raucourt, le général Lafontaine, commandant la 55e division d’infanterie, sur la situation des troupes voisines, la droite de Corap… mais non, vous ne trouverez pas Grandsard à Buzancy […] (709).
Avalanche de noms inconnus, de corps d’armée isolés, de grades et de localités perdues : un exemple parmi beaucoup d’autres de paragraphe où se répètent les mêmes mots et les mêmes noms dans un galimatias vertigineux : difficile de comprendre de quoi il est précisément question ou en quoi consiste la stratégie de l’état-major. Difficile aussi de savoir qui parle. L’instance narrative, déjà étonnamment mobile dans les parties précédentes, se fait radicalement instable, mêlant les points de vue et les focalisations, sautant d’un personnage à un autre, accumulant les ordres détaillés qui ne font que compliquer les choses. La narration s’embrouille, et comment ne pas ? Ainsi, lorsqu’il s’agit de décrire un bombardement, l’emballement délirant du texte ne fait-il qu’exprimer celui ressenti face à la peur :
[…] cet appareil dégringole sur toi, sur toi, avec ce sifflet soufflant, sur toi, cette folle sauvagerie entre tous les points de la terre de te chercher, toi, et la mitraille gifle l’air, le tonnerre écrase la terre, le tympan, la tête… Un autre pique, un autre encore… Ce sont des nappes de bombes, d’éclatements, et les maisons croulent, les pierres valsent, ce qui n’était plus, des toits volent, des poutres de fer parcourent des kilomètres, il se creuse des abîmes, le feu se met à des réserves de paille, à des gares, à des dépôts de munitions qui sautent, répètent à leur manière, du sol, la démence du ciel (749)…
La phrase ne semble plus pouvoir s’arrêter. Les allitérations – « sifflet soufflant, folle sauvagerie », « la terre, le tympan, la tête » –, la syntaxe qui se délite en même temps que s’écroule le monde, le texte mime ce qu’il décrit. Fragmentation du temps en instants, de l’espace en îlots, du roman en éléments disparates : vertige du lecteur entre ce foisonnement des contenus et cet éclatement chaotique des formes.
Enregistrements
Aragon entend faire voir la guerre, la « vraie », en « grand écran » (Leuilliot : VIII) : ce lexique cinématographique est révélateur d’une intention, celle non seulement de représenter, mais aussi celle de faire vivre, comme y excelle le cinéma. « Pour le romancier, il s’agissait d’immerger le lecteur dans les lieux et les moments où l’on avait pu entendre « grincer » l’histoire », juge Luc Vigier (2001 : 210). À cette fin, le récit romanesque doit se faire le plus mimétique possible, c’est-à-dire renoncer au « résumé » au profit de la « mise en scène » (Genette, 1972 : 129). Aragon, en particulier dans cette dernière partie, a recours à une écriture scénique. L’imparfait y est rare. Les événements ne sont pas condensés, ils surgissent et se déroulent dans le roman selon une durée qui ne relève en rien de l’économie narrative, qui est contraire même à l’avancée des intrigues.
Prédominance accordée à la scène, écriture des sensations aussi, qui plonge le lecteur dans le décor fictionnel « comme s’il y était ». Ce dernier devient presque le protagoniste du roman, au fur et à mesure que s’estompent les personnages romanesques : c’est à lui que s’adressent les descriptions, ce sont ses sens qui sont convoqués.
On entend arriver de l’horizon le terrible bourdon des escadrilles de bombardiers. Cela semble durer deux ou trois minutes, cela grandit, grondant, c’est comme une chape de plomb pesant sur les hommes, et les bombes précipitées sur les soldats prosternés arrivent en hurlant d’une voix géante leur clameur de mort qu’accompagne, que suit, que prolonge l’éclatement, la terre secouée, l’apocalypse sur les épaules pliées, la peur de la vague suivante, la certitude de la fuite inutile… et les incendies… les morts découverts… le cri des blessés… (748).
Lumière, matières, détails visuels et surtout sonores : la description ne se fait pas sur le mode du « il y a », elle est dynamique, s’attachant à l’expérience subjective d’un individu anonyme, point de vue, point d’audition et point de sensation. « « Montrer », ce ne peut être qu’une façon de raconter, et cette façon consiste à la fois à en dire le plus possible, et ce plus, à le dire le moins possible », résume Genette (1972 : 186). L’immédiateté des sensations en dit plus que l’intervention d’un narrateur surplombant. Le lecteur doit être impressionné, au sens propre du terme, comme une pellicule vierge.
« L’apocalypse des croyances ? » : la stratégie du ressenti
Ce choix du « faire vivre » n’est cependant pas sans risque : plonger le lecteur dans la situation des personnages, le placer dans l’embrouillamini de sensations parfois contradictoires, dans le chaos de l’histoire, c’est courir le danger qu’il soit en quelque sorte submergé. Refusant d’établir des transitions et des liens, sautant d’une situation à l’autre, la dernière partie des Communistes frôle la débâcle. Cécile Narjoux parle d’une « apocalypse des croyances », d’un « véritable brouillage énonciatif qui tend à la « démoralisation » du récit », qui « nous éloigne nettement de la droite ligne et des attendus du roman à thèse » (2007 : 208) :
Au chaos des idées qui nous éloigne considérablement de l’univocité d’une quelconque « idée générale », Aragon associe le chaos de l’écriture, et le chaos des discours rapportés. […] C’est bien cette perte générale des repères qu’Aragon tente en vérité de mettre en scène dans ce roman de la pluralité, tout constitué de « tableaux séparés » ( ibid. : 212).
Le lecteur, comme tétanisé, perd effectivement ses repères, suit pas à pas les rebondissements de l’histoire, comme s’il n’en connaissait plus la fin. Les connaissances historiques s’évanouissent devant l’imprévu découpé en séquences sans lien entre elles : « Tout est écrit, pourrait-on dire écrit d’avance, mais aussi tout peut arriver », résume Bernard Leuilliot (XVI). Le lecteur est emporté par le cours de l’histoire, à l’image des personnages.
Mais cette expérience historique de la guerre et du chaos elle-même joue un rôle politique dans la fiction romanesque. C’est elle qui est à l’origine de l’évolution idéologique de certains personnages non communistes : l’auteur fait le pari que l’expérience littéraire de la guerre aura le même effet sur le lecteur. Plus avant dans le roman, on avait pu constater ce pouvoir de persuasion exercé par l’expérience. Si Cécile « s’était mise à comprendre […] le lien existant entre ces gens qui l’entouraient et les convulsions du monde, les faits, la guerre » (664), c’est en transposant son expérience personnelle à l’échelle nationale : l’opposition entre la bassesse de son mari Fred et le courage de l’infirme Joseph prend un tour politique et social.
Cette sauvagerie de tous les Fred maintenant régnante, et les Gigoix qui payaient, les uns comme Joseph lui-même, les autres dans les prisons, pour que Fred ait raison, et que rien ne change dans ce monde où il va hériter des usines de l’oncle, de l’immense forteresse aux limites de Paris avec ses trente mille ouvriers (ibid.).
L’expérience est première, c’est elle qui ouvre la voie à une réflexion nouvelle, à une interprétation neuve, invraisemblable si elle ne renvoyait pas à un vécu et à des faits saisissants. Or la guerre en offre de terribles, et on observe dans les derniers chapitres du roman, alors que la débâcle est à son comble, un effet de convergence et de conversion idéologique. C’est d’abord Gaillard qui, face à l’absurdité de la situation, soudain, « parle un langage qu’il ne savait pas parler. Il parle comme un communiste » (790). Puis le sculpteur Jean-Blaise qui brusquement pense à son ami Lebecq, militant du Parti, et lui rend un hommage inattendu : « […] son honneur à lui, c’est de ne pas sombrer, jamais ! » (908), quand précisément le naufrage est général. Jean ne peut qu’admirer le courage infaillible du seul personnage exemplaire du roman, Raoul, tendu vers la lutte qu’il reste à mener :
Il ne pense pas à la mer comme tant d’autres, à la mer comme une fin, un sauvetage, le lieu où l’on va enfin respirer. Il pense à la mer comme à un moyen. Comme à un chemin. Il s’agit d’aller d’ici à un autre point du front (958).
Le choix de l’expérimentation prend alors tout son sens. Le chaos général bouleverse les personnages, mais émergent de leur expérience de la catastrophe des convictions et des sympathies nouvelles. Faire vivre au lecteur, par procuration, les événements qui ont convaincu les personnages, c’est lui faire faire le même cheminement. Le meilleur argument, c’est l’expérience des événements.
D’autant qu’un sens se dégage, in extremis. Il faut attendre le dernier chapitre pour que le chaos s’éclaire : à la description de la « décomposition des hommes » en cette « journée de dupes » (997), alors qu’embarquent à Dunkerque les restes d’une armée décomposée, succède la résolution de Nestor et de ses camarades, déjà engagés dans la lutte antinazie, de « publier un journal » clandestin (1003). L’apocalypse aboutit à une croyance, la seule qui lui ait résisté : la foi communiste. Elle révèle la justesse de cet engagement politique et la culpabilité des autres. C’est Barbentane qui explique :
« Est-ce que tu ne comprends pas que cette guerre, ils l’ont commencée, pris dans leurs propres contradictions, cherchant depuis vingt ans à faire une guerre à l’est, que les peuples ne leur permettaient pas de faire. […] et puis il y avait besoin de l’état de guerre pour liquider les conquêtes de Trente-six… pour faire faire machine arrière à l’histoire… […] Il leur fallait la guerre pour, à l’abri des lignes de défense modernes, pratiquer le détroussement de nous tous » (1002).
C’est presque à la dernière ligne du roman que sa thèse s’énonce : cette guerre a été déclenchée contre le peuple français, contre le sens de « l’histoire », par les forces de la réaction. Mais cette thèse apparaît comme la déduction logique et directe des faits décrits, comme l’aboutissement – le seul possible – de l’expérience du chaos. Or la lutte contre ces forces réactionnaires ne s’est pas achevée avec la défaite. À la guerre meurtrière doit en succéder une autre : « Oui, la guerre a changé de caractère. Maintenant, il s’agit seulement de créer l’enthousiasme pour la guerre nouvelle qui va commencer. Notre guerre à nous. Celle du peuple » (ibid.). Tous les morceaux du puzzle convergent finalement vers cette lutte à venir.
Dans les précédents romans du Monde réel, Aragon entendait rendre intelligible la genèse de la guerre, celle de 14-18 : il s’agissait d’étudier les mécanismes, sociaux et politiques, qui mèneraient à la boucherie mondiale. « Le sentiment d’une menace sourde et diffuse, d’une inquiétude collective » (Rieuneau, 1974 : 406), pèse sur les intrigues, mais c’est l’analyse et la démonstration qui prime :
Au lieu d’un effet de pure émotion, pathétique, tragique, héroïque ou pittoresque, [la guerre] donnait aux romans la portée d’une analyse historique infiniment riche d’enseignements pour le présent et pour l’avenir (ibid.).
Dans Les Communistes, Aragon plonge au contraire dans le « pathétique » et le « tragique » de la guerre. Il fait pour son lecteur le choix de l’expérimentation plutôt que de l’« analyse ». Mais ce choix n’exclut pas la démonstration : il l’incarne dans la fiction romanesque et dans l’expérience de la lecture. Saisi par les faits décrits, plongé dans un chaos sans nom, le lecteur adhère, au sens presque physique du terme, au discours qui s’articule autour de ces faits et de ce chaos, au sens qui s’en dégage. L’« émotion » sert l’« analyse » : cette dernière n’apparaît plus surajoutée aux faits, mais semble surgir au contraire de l’expérience du réel. Elle n’en est que plus convaincante.
De la guerre mondiale à la guerre civile : les enseignements de la guerre
Aussi l’expérience du chaos absolu est-elle riche d’enseignements. Car l’« apocalypse » de mai-juin 1940 n’est pas divine, elle est humaine, et même française ; le romancier, alors même qu’il plonge son lecteur dans une débâcle insensée, lui donne les moyens de la comprendre. Et il accuse. Au passé et au présent. « Aragon écrit l’histoire, dans ses romans, en homme qui connaît la suite et qui ne s’en cache pas » (Rieuneau, 1974 : 395). Il écrit même pour la suite, sans s’en cacher non plus.
Le procès des responsables
En même temps que l’on plonge dans la guerre, un procès est instruit, celui des responsables de la débâcle. Le narrateur, comme saisi par le spectacle qu’il décrit, se mue en accusateur public. Il a l’histoire pour lui… Ses cibles ne sont pas les militaires en général. Il rend même hommage à ces hommes qui ne partagent aucune de ses convictions, mais qui ont un certain sens de l’honneur, un certain idéal aussi. Quand on leur donne l’ordre de faire brûler drapeaux et étendards,
il y a toute la morale de leur vie en jeu. Ce sont des hommes braves, à qui leur propre mort ne fait pas plus peur que la mort des autres. Toute leur vie, leur éducation, leur idéal… ce sont des hommes capables de se signer un ordre, disant de se faire tuer sur place. Capables de se faire tuer sur place. Savoir engager froidement la vie humaine pour un résultat conforme à l’idéal appris, l’idéal incarné en eux. L’honneur (925).
Aragon ne se livre pas à un antimilitarisme caricatural : il cible les plus hauts responsables, seuls coupables du naufrage, et d’ailleurs étrangers à cette notion d’honneur. À propos de Weygand :
Vous l’entendez ? l’honneur, ce général en chef le réserve pour ses télégrammes : ici l’essentiel est de tenir en ordre un pays déshonoré. […]
On place l’honneur différemment, suivant les conceptions qu’on a dans la tête et dans le cœur. Les gens qui ont un cœur, c’est vrai (918).
Les malentendus et les incompréhensions entre les généraux de l’état-major, Huntziger, Georges, Gamelin, prennent des tours de vaudeville :
[…] vous êtes venu rendre visite à des gens, et vous tombez au milieu d’un drame intime : on parle d’autre chose, on a l’air de ne rien remarquer, mais les larmes, mais le désordre de la pièce… la vaisselle cassée… (840)
Comédie grotesque si elle n’impliquait pas les tragédies du front. Les courses-poursuites entre ces hauts personnages, leur absence de coordination, leurs rivalités ambitieuses, sont en effet directement responsables du chaos vécu par les soldats et les civils. Leurs noms reviennent sans cesse, mais on est loin de l’hommage : ces généraux sont les coupables les plus immédiats de la défaite et de toutes ses conséquences.
Et pourtant l’inconséquence des gradés paraît moins coupable que la lâcheté des dirigeants politiques. Ainsi le chapitre 21 prend-il des accents franchement pamphlétaires, ceux d’une colère qui n’a rien perdu de sa vigueur avec le temps :
Et puis Paul Reynaud sait qu’on dit de lui qu’il est léger : il ne veut pas paraître versatile, il ne veut pas qu’on dise maintenant de lui qu’il change de général en chef comme de chemise.
Et pourtant ce serait plus propre (901).
Le président du Conseil se soucie plus de sa réputation que du sort du peuple français – selon Aragon, bien sûr. Cet oubli de la nation est présenté comme la plus haute trahison. Les charognards rôdent, et les futurs collaborateurs commencent leur carrière. Visconti – député fictif – compte s’entendre avec l’ennemi. Alors qu’il se précipite chez le maréchal Pétain – « Il s’agissait d’en être » (944) –, les Allemands ont franchi la frontière française et se livrent à leurs terribles opérations de répression. C’est Vichy qui commence. Les dirigeants historiques, politiciens et militaires, sont donc confrontés à leurs actes, à leurs trahisons, sommés d’en répondre.
Aragon en profite, au cours d’un procès dont il est le seul juge instructeur, pour exonérer les accusés d’hier, les communistes, tenus pour les responsables de la défaite nationale – « l’armée minée par le communisme… tu comprends… alors ça a craqué de partout ! » (828). Il retourne l’argument du patriotisme, systématiquement utilisé par le camp des puissants au moment des événements, contre ces derniers, et entend démontrer que les véritables Français sont ceux que l’on accuse de trahir la patrie. Ses communistes se battent, heureux de servir la France. Joseph Gigoix est le seul personnage individualisé à être blessé ; et c’est un communiste. Les colonels et les généraux qui crient à la trahison patente ne paieront pas un aussi lourd tribut à la défense nationale. Même les cadres du Parti ne peuvent s’empêcher de dire « boche », et aucun militant véritable ne songe à déserter[[Aragon esquive ainsi la question posée par la désertion de Maurice Thorez, ordonnée par Moscou. Le personnage de Lucien Cesbron ne l’explique pas mais l’excuse entièrement : « Maurice Thorez n’est pas qu’un simple soldat. Il est le secrétaire général d’un parti grâce auquel il a fait renaître dans une classe, qu’on cherchait par tous les moyens à démoraliser, le sens de la patrie et de l’intérêt national, […] l’intérêt national sans interférence des grandes affaires internationales… Il fallait le dissoudre, ce parti, pour faire aux ouvriers, aux Français, la guerre qu’on ne fait pas, qu’on ne fera pas à Hitler, avec les hitlériens français » (278-79). Le gouvernement lui-même en est rendu responsable… ]]. L’internationalisme ne semble pas avoir pris sur le territoire français. Cesbron l’assure à son capitaine :
– Le départ de Maurice Thorez ne sera suivi d’aucune désertion, vous m’entendez ? Pas d’un cas. Tous les communistes qui ont à y être sont et demeurent aux armées. C’est leur place.
– Qui vous l’a dit ?
– Thorez… quand j’ai été le voir pour lui dire adieu. Il m’a dit cela comme je viens de le dire : la place des communistes est à l’armée […] (278).
Le mot d’ordre est respecté, si l’on en croit les militants fictifs : Raoul se distingue par une résistance physique et un courage sans faille. Cormeilles réclame, avec la rage des vaincus, « le droit de chanter La Marseillaise… » (900). Armand Barbentane[[Ce personnage refuse une occasion de s’enfuir et de quitter la prison où il est arbitrairement retenu : « Cela ferait de moi un déserteur » (910).]] rassemble quelques hommes, tous communistes, pour se battre jusqu’au bout : « Nous sommes peut-être le premier groupe de la nouvelle armée… celle qui les chassera de France… » (811), dit l’un d’eux. C’est bien là le but d’Aragon : annoncer le rôle prédominant des communistes dans la Résistance. La démonstration du patriotisme réel, viscéral, des militants est la meilleure façon pour le romancier d’écarter les accusations de trahison qui ont fusé à l’annonce du pacte germano-soviétique. Il esquive la période, pour le moins problématique, qui sépare la défaite française de l’entrée en guerre de l’U.R.S.S. en passant de la persécution des militants à leur engagement dans l’armée des ombres. En mettant en scène des communistes plus patriotes que les adhérents de l’Action française, il récuse les accusations, par la seule preuve – et la seule manipulation – fictive. L’écriture de la guerre devient l’occasion de faire taire tout reproche et de démontrer la justesse des choix communistes. Le parti pris est aussi flagrant que l’utilité d’une telle démonstration en 1949 : il n’y a aucune contradiction entre la fidélité à Moscou et la fidélité à la France.
Mais la guerre est le prétexte d’un autre procès, au-delà de celui qui oppose les responsables immédiats aux héros oubliés. Elle est l’occasion d’exprimer une vision critique – et transposable – de la société française tout entière, d’en démonter les mécanismes de domination : elle est un appel à la vigilance.
Révélations
Dans les conditions normales, le mensonge est si bien tissé à la vie… on ne le voit pas… […] Mais avec la guerre… […] On n’a ni le temps, ni la présence d’esprit de cacher le mensonge. Le mensonge devient cru (264),
découvre Cécile. L’état de guerre est le temps des révélations, celui où le dissimulé, le tacite, le « mensonge », s’affichent en pleine lumière ; il ne fait qu’exacerber les traits d’une société, mettant à nu les ressorts qui assurent à une minorité la domination de la majorité[[Les opinions politiques exprimées ici sont bien sûr celles d’Aragon.]]. Parfaite adéquation avec la mission de l’écrivain tel que l’entend Sartre : « [L’écrivain] est l’homme qui nomme ce qui n’a pas encore été nommé ou qui n’ose pas dire son nom » (1985 : 29). La violence sociale, par exemple, prend la force de l’évidence : l’état de guerre justifie la suspension des conquêtes de 1936 et de la semaine de 40 heures. Les manipulations médiatiques ne se dissimulent plus : la presse est ouvertement le porte-parole du gouvernement en guerre. « L’opinion publique, vous savez très bien qu’on la fait, l’opinion publique… » (135), assure un ministre à Watrin, et la presse, écrite et radiophonique, en est le moyen, relais sans faille ni critique du discours officiel.
Ce que révèle plus brutalement encore l’entrée en guerre, c’est la dépendance de la sphère politique par rapport aux grands intérêts économiques. Nulle séparation des pouvoirs dans la République française de 1939 ; les grands industriels et l’ensemble de la classe politique, à l’exception du Parti communiste, marchent main dans la main, poursuivant les mêmes intérêts et s’entraidant pour s’assurer de leur maintien. Le personnage de Wisner, que les lecteurs du Monde réel connaissent bien[[Dès Les Cloches de Bâle, le personnage joue un rôle trouble. Ce roman ne cesse de mettre en évidence l’intérêt qu’avaient les financiers et les industriels au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Wisner, lié à l’industrie de l’armement, en est le représentant le plus évident, il le reste vingt ans après. ]], sert une démonstration implacable. Alors que Paris est directement menacé, que les gens bien placés savent la défaite inévitable, « on le prévient qu’il y a dans le cabinet des gens qui songent à la destruction des grandes usines de la région parisienne » (832). Cela signifierait la fin de la fortune personnelle des Wisner : il faut trouver un argument de poids pour détourner le président du Conseil de ces mauvais avis. Quel meilleur épouvantail que celui de la possible révolte des ouvriers ? C’est le général Nullement qui parle à Falempin, le directeur de l’usine :
C’est joli de détruire des usines, mais comment réagiraient vos ouvriers ? […] Comment est le moral de vos ouvriers ? Le communisme est toujours très fort parmi eux…
Falempin protesta. Il avait cru à un désaveu de son travail, une critique ! […] Nullement coupa le directeur. Le communisme est toujours très fort parmi eux. Il ne faut pas croire à la façade. En tous cas, l’idée que le communisme est toujours fort parmi eux est de nature à faire réfléchir les ministres (832).
Voilà qui est dit. Aussitôt, la direction provoque l’agitation des travailleurs en répandant des rumeurs. Efforts récompensés : « […] il faut renoncer à faire sauter les usines. Les ouvriers ne comprendraient pas. Ce serait les jeter dans les bras des communistes » (835). Les dirigeants politiques s’empressent de prendre une décision peu propice aux intérêts nationaux : l’usine Wisner, si elle n’est pas détruite, servira la production militaire allemande. Cet épisode pointe du doigt les ressorts de cette obsession des sphères gouvernementales, manipulées par la grande industrie. Mais cette manipulation ne repose que sur une paranoïa commune : on ne peut faire tout à fait confiance à ceux que l’on exploite.
Car plus encore qu’une aggravation de l’état de paix, l’état de guerre est l’image hyperbolique d’une société française irrémédiablement divisée en deux camps : les exploiteurs et les exploités. Ce qui fonde l’alliance des grands industriels et des dirigeants politiques, c’est la haine des communistes, et plus largement une méfiance instinctive envers le peuple, inconnu et imprévisible. Alors que les Allemands sont aux portes de la capitale, Wisner peut affirmer, devant un ministre de la République qui vient de recevoir le maréchal Pétain :
Il n’en reste pas moins […] qu’au moment du péril… un jour comme aujourd’hui… c’est le communisme qui est le souci le plus grave, la menace la plus précise. L’armée de Hitler peut encore s’arrêter sur des positions… mais à Paris, le communisme est dans la place (839).
C’est aussi là l’obsession du général Weygand :
[…] faire l’armistice, pour garder une armée, afin de maintenir l’ordre. Afin de maintenir l’ordre. […] Weygand a besoin de garder une armée, non pour que l’on cesse de tuer des Français, mais pour qu’il y ait des Français capables de tirer sur d’autres Français. Faire la paix avec Hitler pour avoir les moyens de la guerre civile (902).
L’ennemi est intérieur, non extérieur, il est communiste, non nazi. La guerre est autant civile que mondiale. Le prologue du roman prend alors tout son sens : la défaite française est la conséquence de celle des républicains espagnols qui déferlent en désordre, apparaissant au seuil du roman comme ses dédicataires. La guerre mondiale n’est que la continuation, à une autre échelle, de la guerre civile espagnole, variation de celle qui déchire la France. À Dunkerque, Cormeilles retrouve Raoul qu’il avait sauvé à la frontière des Pyrénées.
Comme cette Espagne le suit ! Faut-il donc qu’ils se retrouvent aujourd’hui, tous deux ? précisément à cet autre seuil de France, à l’autre bout, avec tous les développements tragiques de la « non-intervention » jusqu’à ceci… « Nous croyions alors que c’était le sort de l’Espagne qui se jouait, quand c’était celui de la France… » (998)
« Les Communistes sont le livre du déchirement français, de cette chose en moi saignante », a écrit Aragon (dans J’abats mon jeu, cité dans Garaudy, 1961 : 417) : le déchirement d’un Français face à l’invasion allemande ; mais aussi et peut-être surtout le déchirement de la nation française, traversée par un fossé infranchissable. « Il n’y a que deux camps dans cette affaire, et si j’allais être de l’autre, de ceux qui arrêtent Yvonne, le copain ? » (381), finit par penser le jeune de Moncey. Deux camps, ceux qu’on arrête et ceux qui les arrêtent. Cet antagonisme formait la toile de fond des précédents romans du Monde réel, il se perpétue dans Les Communistes, et rien ne permet d’affirmer qu’il est en voie de disparition à l’époque de la publication du roman. L’état de guerre l’a révélé au grand jour, mais il ne relève pas de la guerre : la division de la société française en exploiteurs et en exploités persiste, la guerre civile aussi. Aussi la guerre qui fait l’objet des Communistes s’inscrit-elle dans une histoire bien plus longue, celle de la division d’une nation en classes, ou du moins en camps irréconciliables. Tout le cycle du Monde réel la décrit, l’analyse. L’ennemi est toujours le même, et il n’a pas disparu avec la Libération. La lutte non plus.
Un Raoul, toute sa vie, il a été au front. Pas toujours un front militaire. Il n’a jamais attendu de l’aube suivante une fraîcheur, un repos, la mer… mais la continuation de la lutte, mais la poursuite d’un même ennemi. Difficile à reconnaître pour d’autres. Pour lui, pas (958).
Au fil des chapitres de guerre des Communistes s’élabore un discours. Immanquablement identifiable, lisible, sensible. Si Aragon préfère l’implicite à l’explicite, esthétiquement et stratégiquement, il sait se faire entendre. Les coupables de la débâcle de mai-juin 1940 sont identifiés, les causes profondes le sont aussi. L’écriture de la conviction passe par l’écriture de la guerre et du chaos. Le vertige dans lequel est plongé le lecteur devant le chaos de la guerre n’a pas atteint le romancier. Lui ne perd jamais le fil.
Références bibliographiques
ARAGON L. (1967), postface aux Communistes, Le Livre de poche, Paris (texte établi par l’auteur pour l’édition des Œuvres romanesques croisées d’Elsa Triolet et Aragon).
ARAGON L. (1981), Je n’ai jamais appris à écrire ou Les Incipit, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1969.
ARAGON L. (1997), Anicet ou le panorama, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1921.
BERNARD J. (1984), La Permanence du surréalisme dans le cycle du « Monde réel », Paris, Corti.
EISENSTEIN S. (1976), Le Film : sa forme, son sens, Paris, Christian Bourgois Éditeur.
GARAUDY R. (1961), L’Itinéraire d’Aragon, Paris, Gallimard.
GENETTE G. (1972), Figures III, Paris, Editions du Seuil.
LAHANQUE R. (2001), « La question du « caractère de la guerre » dans Les Communistes », Recherches croisées Aragon/Elsa triolet, n°7, Besançon, Annales littéraires de l’université de Franche-Comté, pp. 164-170.
LEUILLIOT B. (1998), préface à l’édition de référence, Editions Stock, Paris, pp. I-XIX.
MAGNY C.-E. (1948), L’Âge du roman américain, Paris, Editions du Seuil.
NARJOUX C. (2007), « Énonciation et dénonciation dans Les Communistes d’Aragon ou « l’apocalypse des croyances » », Recherches croisées, n°11, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, pp. 207-220.
PIÉGAY N. (1998), L’Esthétique d’Aragon, Paris, SEDES.
RIEUNEAU M. (1974), Guerre et révolution dans le roman français 1919-1939, Slatkine, Paris.
SARTRE J.-P. (1985), Qu’est-ce que la littérature ?, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1947.
VIGIER L. (2001), « Les paravents de la mémoire », Recherches croisées Aragon/Elsa triolet, n°7, Besançon, Annales littéraires de l’université de Franche-Comté, pp. 210-215.