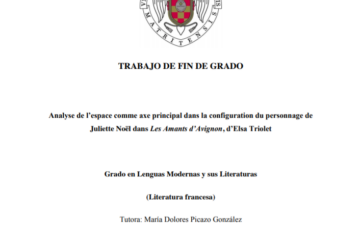Céline Cachat, «Aurélien : le kaléidoscope et le mentir-vrai »

Aurélien : le kaléidoscope et le mentir-vrai
Céline CACHAT, Université Paris 3
Article tiré d’un Mémoire de Master 1 intitulé « Aurélien d’Aragon ou le kaléidoscope des Années », soutenu sous la direction de Maryse Vassevière (mention TB)
Université Paris 3, juin 2007
Mis en ligne sur http://www.louisaragon-elsatriolet.com/
Bien que composé pendant les années troubles de la Seconde Guerre mondiale, Aurélien est un des rares romans de la littérature française à mettre en scène la vie parisienne des « années folles ». Si ce roman ne répond pas aussi fidèlement que les autres œuvres du Monde réel aux théories du réalisme socialiste, et si la datation et la chronologie du récit ne peuvent être qu’appro¬ximatives, il n’en est peut-être que plus proche du climat social et culturel de l’époque. Aragon s’attache plus à recréer les milieux artistiques, la bourgeoisie et le petit peuple parisien des années vingt qu’à ancrer à tout prix son récit dans une temporalité précise, s’accordant ainsi avec les théories de Paul Ricœur selon lesquelles le roman ne doit pas représenter le temps, mais en construire une expérience fictive. « Aurélien […] est avant tout une situation, un homme dans une certaine situation » dit Aragon à propos de son roman [[. Louis Aragon, Entretiens avec Francis Crémieux, Gallimard, 1964, p. 47.]] : ce dernier raconte en effet moins des faits précis qu’il ne décrit des expériences humaines dans le contexte historique, social et culturel de l’après Première Guerre mondiale. Ainsi les références historiques sont moins quantitatives que qualitatives : Aragon n’a pas écrit Aurélien avec le souci d’objectivité et d’exhaustivité de l’historien, il a bien plutôt cherché à recréer une ambiance, à retranscrire des émotions, des expériences passées à partir de ses connaissances et de son propre vécu.
Ses difficultés à accorder ses conceptions littéraires avec le socialisme, ses rapports houleux avec le groupe surréaliste, son expérience directe des deux guerres, tout, dans le parcours intellectuel d’Aragon, concourt à ancrer son œuvre dans l’histoire du XXe siècle. Pourtant dès avant l’élaboration de sa théorie du « réalisme socialiste », Aragon s’interrogeait déjà sur les liens unissant la littérature à l’histoire. Comme le montre Suzanne Ravis dans une de ses communications [[. Suzanne Ravis, « Le temps revisité », in Lire Aragon, dir. Mireille Hilsum, Carine Trévisan et Maryse Vassevière, Honoré Champion, 2000, p. 71 à 81.]], des débuts du surréalisme jusqu’en 1927 Aragon fut confronté à une contradiction : alors que le surréalisme prônait « la résolution future de ces deux états, en apparence contradictoires, que sont le rêve et la réalité », l’abolition des frontières temporelles, la réunion du passé et du présent « en une sorte de réalité absolue, de surréalité [[. André Breton, Manifeste du surréalisme (1924), éd. Jean-Jacques Pauvert, 1962, p. 24.]] », le socialisme, conformément aux théories marxistes, reposait sur l’idée hégélienne d’un « devenir » historique et d’un dépassement perpétuel du passé par le présent, et servait de socle au réalisme socialiste.
C’est ainsi que de nombreuses réflexions d’Aragon oscillent en perma¬nence entre la défense des droits de l’imagination et un souci de vérité histo¬rique ou de réalisme rétrospectif. En effet l’histoire et la littérature se rejoi¬gnent sur bien des points. Comme l’a montré Paul Ricœur [[. Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Le Seuil, 2003, p. 240 à 288.]], un « événement » historique n’est rien hors de la narration : l’« histoire-récit », qui tente de représenter le passé avec la plus grande fidélité possible, et l’« histoire-problème », qui s’attache plus précisément à envisager ce passé sous un angle problématique, font toutes deux appel, comme la littérature, au discours, à l’image et à la « mise en intrigue ». En outre, par son travail de reconstitution d’un passé disparu à partir de traces qui ne sont plus ce passé, l’histoire procède à une forme de mimesis qui n’est pas totalement affranchie de toute subjectivité, et se rapproche parfois malgré elle de l’écriture fictive. Ainsi, de même qu’il est possible d’opérer un « fictionnalisation du document [[. Suzanne Ravis, Temps et création romanesque dans l’œuvre d’Aragon, thèse pour le doctorat d’État, dir. Henri Mitterand, Université de Paris III, 1991, 4e partie, chapitre 2.]] », il est aussi possible de romancer l’Histoire. Or Aragon semble avoir toujours été conscient de cette connivence entre littérature et histoire. Il a ainsi pu parler de son œuvre comme d’une « photo bougée » dans Le mentir-vrai, en proclamant les droits du romancier à faire bouger la vérité historique. Suzanne Ravis a très bien montré dans sa thèse que, si Aragon reconnaissait les différences entre l’écriture fictive et l’histoire, il ne les percevait pas du tout de façon contradic¬toire.
Aurélien résout ainsi la contradiction que l’on peut percevoir au premier abord, grâce à la mise en pratique de ce qu’Aragon appelle le « mentir-vrai ». Le roman est en effet bien ancré dans l’histoire : il a par exemple la particularité de conférer une place importante aux milieux artistiques des « années folles », dont la plupart des personnages sont directement inspirés de personnes réelles, ainsi qu’à tous les rituels et les pratiques de la vie quotidienne. Les pratiques sportives, les goûts culinaires, les derniers vêtements à la mode, les pratiques langagières, les lieux de divertissement fréquentés par les artistes ou les élites qui veulent être vus, mais aussi certains phénomènes de mentalité propres à cette époque encore traumatisée par la Grande Guerre, tout cela tend à recréer, de façon rétrospective, une image reflétant la réalité sociale et culturelle des années vingt. Aurélien est aussi une accumulation de détails qui proviennent aussi bien de l’expérience de l’auteur lui-même, qui fut l’un des acteurs de la vie culturelle et artistique des années folles, que de souvenirs historiques de la Belle Époque, voire de l’Empire. C’est pourquoi Aurélien retranscrit la réalité sociale et culturelle des années vingt à la manière d’un kaléidoscope : tous les éléments sont présents et reconnaissables, bien que déformés par la fiction, par le poids de l’histoire littéraire, par l’expérience d’Aragon lui-même, et assemblés dans un ordre qui s’affranchit de toute frontière temporelle. Ces détails réalistes venus de plusieurs horizons culturels forment comme une mosaïque dont les morceaux sont agencés par l’art subtil du narrateur. L’esthétique d’Aurélien est une esthétique du détail à valeur référentielle.
Nous proposons donc d’étudier la résolution de cette contradiction apparente entre fiction et réalité historique, grâce au « mentir-vrai », au travers de quelques exemples tirés d’Aurélien. Outre l’invention d’une histoire d’amour en partie fictive, deux phénomènes concourent donc à la mise en fiction d’éléments réels : l’influence de mythes et de topoï littéraires du XIXe siècle, mais aussi l’expérience personnelle d’Aragon viennent souvent se greffer sur le réalisme auquel tendent aussi bien la description de la société que la description de la capitale et des pratiques culturelles. Par ailleurs le roman ne se limite pas à l’évocation d’une seule époque, mais opère un télescopage de plusieurs périodes historiques : la Belle Époque est présente en filigrane, grâce à quelques détails qui parcourent l’œuvre, de même que d’autres éléments, inexistants dans les années vingt, ou seulement à l’état embryon¬naire, annoncent la réalité sociale et culturelle de l’après Seconde Guerre mondiale.
Une géographie parisienne entre mythologie, héritages littéraires et réalisme moderne
L’histoire de la littérature n’a pas attendu Aurélien pour voir se développer une mythologie de Paris : dès le XVIe siècle – la Renaissance est associée à l’essor des villes – certains écrivains ont choisi la capitale comme décor pour leurs romans, jusqu’à parfois en faire un personnage à part entière.
Aurélien se situe à la croisée de plusieurs chemins. Ce roman hérite autant de la vision du Paris-mystère que de la ville haussmannienne qui a pris son relais dès la seconde moitié du XIXe siècle. Aurélien s’inscrit encore dans la filiation directe de Baudelaire, pour qui la ville moderne, « la fourmillante cité […] pleine de rêves [[. Baudelaire, Les Fleurs du mal, « Les sept vieillards », poème XC, v. 1.]] », n’a d’intérêt que parce qu’elle permet des rencontres insolites. Cette dernière perspective croise enfin celle des surréa¬listes qui projetaient leurs désirs inconscients sur la cité et ont élaboré un mythe féminin indissociable de leurs pérégrinations à travers la capitale.
C’est en effet au cours du XIXe siècle que disparaît de la littérature le centre traditionnel de Paris, le Paris lié à la religion avec Notre-Dame, celui des salons et du « Monde » avec les salons de Saint-Germain, celui des centres du pouvoir avec le Louvre, et enfin celui des institutions culturelles avec le Quartier Latin. La rive droite et ses quartiers d’affaires, de journaux et le Nord populaire de Paris l’emportent désormais largement sur la rive gauche. C’est pourquoi le Paris d’Aragon, et des surréalistes en général, se réduit à quelques quartiers, le plus souvent situés sur la rive droite, des grands boulevards jusqu’à Montmartre, en passant par les Buttes-Chaumont, les portes Saint-Martin et Saint-Denis, et quelques vieux quartiers comme le Palais Royal, la Cité et l’île Saint-Louis : il s’agit pour une bonne partie du Paris remodelé par le Baron Haussmann dans les années 1860, dont les surréalistes tentent de s’approprier les derniers recoins secrets tels que les passages, également créés à la fin du XIXe siècle, mais dont l’existence est finalement menacée par la percée des grands boulevards.
Cette topographie parisienne typiquement surréaliste est donc celle qui sert de cadre à Aurélien : à l’exception de la piscine de la rue Oberkampf et des logements des Barbentane, d’Aurélien et de Zamora, respectivement situés dans le XVIe, le IVe et à la limite du XVe et du VIIe arrondissements, les différents lieux mentionnés dans le roman permettent au lecteur de sillonner tout le quartier allant du Palais Royal jusqu’à la place Blanche, au pied de la colline de Montmartre. Le IXe arrondissement, quartier de prédilection des surréalistes, est particulièrement bien représenté : les lieux de divertissement sont concentrés dans le quartier de la place Blanche, dans les ruelles qui mènent à la place Pigalle ainsi que dans la rue Fontaine avec la rue Notre-Dame de Lorette dans son prolongement. Les affaires d’Edmond Barbentane nous permettent de parcourir le quartier de la rue Lafayette – la rue Pillet Will lui est transversale – et de la rue Saint-Georges. Enfin la place de l’Opéra, la Madeleine, et la rue Boissy d’Anglas qui mènent à la Concorde viennent parfaire ce panorama presque complet de cette partie de la rive droite, privilégiée par Aragon et ses amis qui refusaient de fréquenter les quartiers à la mode comme Montparnasse ou les lieux académiques de la rive gauche.
Le roman y ajoute cependant une caractéristique aragonienne, qui consiste à priviligier les lieux intimistes, non l’agitation urbaine : il passe ainsi d’un café à l’autre, d’un restaurant à l’autre où les personnages ont rendez-vous, ce qui tend à atténuer l’image du Paris moderne à l’urbanisation galopante. Cette tendance n’est pas étonnante selon Marie-Claire Bancquart : « Aragon marque une préférence pour les actions furtives et les lieux clandestins qui, mieux que d’autres, impliquent la conscience du passage, de l’entre-deux [[. Marie-Claire Bancquart, Paris des surréalistes, éd. de la Différence, Les Essais, 2004, p. 179.]] ».
Ainsi dans la « mythologie moderne » (Le Paysan de Paris) que propose Aragon, la ville n’est plus perçue dans son ensemble et donne lieu au contraire à une vision disloquée, puisque l’attention ne se porte plus que sur certains lieux privilégiés, voire certains détails, tels que le décor de tel ou tel lieu de rendez-vous dans Aurélien. C’est aussi ce qui confère une tonalité mystérieuse ou du moins intimiste au roman, et c’est aussi ce qui annonce cette esthétique du détail qui caractérise Aurélien.
Cette tendance correspond aussi sans doute à une caractéristique des surréalistes en général qui, certes, aimaient les lieux passants et populaires, mais rejetaient par ailleurs le Paris d’Haussmann dont ils jugeaient les physionomies trop lisibles et dépourvues de recoins assez mystérieux pour faire travailler l’imagination. Le café est un lieu surréaliste incontournable : il est autant un lieu d’observation qu’un lieu de rencontre, il est donc propice à l’activité créatrice. La topographie d’Aurélien a donc une symbolique double : elle permet de renvoyer le texte autant à un mythe de Paris antérieur au XIXe siècle qu’au mythe de la ville surréaliste, beaucoup plus récent.
Le roman est également sous l’influence de la littérature et des romans sur Paris écrits au XIXe siècle et au tout début du XXe siècle. Le chapitre XVI, que l’on aurait pu intituler « Le piéton de Paris » en référence aux chroniques de Léon-Paul Fargue, évoque ainsi autant les pérégrinations de Breton, à la recherche d’un idéal féminin incarné par Nadja, que le mythe de « la parisienne » repris par Baudelaire dans « À une passante », dans Les Fleurs du mal. Aurélien s’amuse en effet à suivre « la première femme un peu possible qu’on a rencontrée », et adopte la méthode de Breton pour qui la vie n’est valable « que dans la mesure même où elle est livrée aux hasards » et dont tout le cheminement est déterminé par « le hasard de [ses] pas [[. André Breton, Nadja, Gallimard, 1998, p. 19 et 70.]] ». De la même façon, Aurélien suit le trajet d’une femme inconnue, avant d’en rencontrer une deuxième qu’il suit à son tour, puis une troisième, selon des règles définies arbitrairement… Les deux personnages projettent ainsi leurs désirs sur la ville, ou plus exactement sur ses habitants, au hasard des rencontres : la ville devient le lieu d’une quête qui doit répondre à des désirs mystérieux ou inassouvis. Le petit jeu d’Aurélien devient aussi l’occasion de dresser le portrait de « parisiennes » qui doivent beaucoup à la « passante » de Baudelaire. Toutes les femmes qu’il rencontre sont assimilées à des types, eux-mêmes réductibles à « une image centrale, fuyante et présente à la fois » qui pourrait être « la fugitive beauté [[. Aurélien, chapitre XVI, p. 116 ; Baudelaire, Les Fleurs du mal, « A une passante », v. 9.]] » dont parle Baudelaire : la « passante » du poème, comme les femmes du roman, sont traitées moins comme de véritables rencontres que comme des visions ou des apparitions furtives, sur le mode du croquis qui tente de saisir une silhouette. En outre certaines scènes sont décrites de telle sorte qu’il en ressort une image du Paris Second Empire ou du Paris « fin de siècle », presque similaire à celles que l’on trouve dans les romans de Balzac et de Proust, à cela près qu’Aurélien leur ajoute une tonalité clairement parodique. Des tonalités balzaciennes animent ainsi le texte, notamment certaines descriptions de Paris. Au début du roman, celle de la vue qu’offre la terrasse d’Edmond Barbentane, nouveau Rastignac [[. Ils partagent tous deux le même teint méridional, les mêmes cheveux bruns, les mêmes yeux bleus (Le père Goriot, Gallimard, 1971, chapitre I, p. 37 ; Aurélien, chapitre XVII, p. 118.) ]], rappelle curieusement la dernière évocation de Paris dans Le père Goriot, quand Rastignac lance son défi mondain à la capitale depuis le haut du Cimetière du Père-Lachaise. Les deux descriptions sont celles d’un regard en surplomb qui domine la Seine et aboutit, après un survol de la capitale, au dôme doré des Invalides. La description d’Aurélien se distingue toutefois de l’autre par une touche d’inspiration surréaliste transformant la ville en mariée vêtue de blanc, opérant ainsi un réel décalage par rapport au texte de Balzac : l’union intéressée que Rastignac espère réaliser un jour avec une femme de la grande bourgeoisie a bien eu lieu pour Edmond, d’abord célébrée par l’apparition incongrue de cette mariée blanche dominant Paris, puis aussitôt supprimée par la perspective dorée des Invalides.
On observe aussi qu’une grande partie des personnages résident dans les beaux quartiers de l’ouest parisien, sur la rive droite, entre le seizième arrondissement, l’Étoile et les Champs-Élysées. Cette topographie a des points communs avec celle que l’on trouve dans À la recherche du temps perdu, et certains lieux, fréquentés par la grande bourgeoisie et la noblesse, servent de cadre à des scènes similaires dans les deux romans : la promenade de Blanchette et Bérénice dans le chapitre X s’inscrit dans la lignée des promenades du narrateur de La Recherche dans l’avenue du Bois (l’actuelle avenue Foch). Elle sert aussi de prétexte à une observation sociologique qui est celle d’un regard acerbe. « L’écume frissonnante des promeneurs » sur des pelouses bordées de « cavernes blanches pour troglodytes millionnaires », les « chevaux » et autres « montures, dont chacune portait une fortune ou une ruine sur son dos » (X, p. 75) ancrent d’emblée cette scène d’Aurélien dans une ambiance fin de siècle correspondant exactement à l’époque de Proust, à la fois par la proximité du style de la description, parcourue de métaphores à la tonalité satirique, que par le réalisme sociologique des deux romans. Tout comme la promenade du narrateur qui vient épier Mme Swann, celle de Blanchette et Bérénice se soumet « aux règles du protocole [[. Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleur, Gallimard, Folio, 1954, première partie, p. 256.]] » qui semblent ne pas avoir changé depuis l’avant-guerre : les « lois de la promenade », véritable « cérémonial » (X, p. 76), fixent l’événement à midi précisément, le dimanche. Dans l’un et l’autre roman il s’agit d’une parade mondaine, d’un rendez-vous incon¬tournable de la bonne société parisienne venant y afficher ses dernières toilettes à la mode, qui font rêver le narrateur dans l’œuvre de Proust, puis Bérénice après lui. Le regard naïf de cette dernière, bien différent de celui, acerbe, du narrateur de La Recherche, donne lieu à une réécriture parodique du roman proustien. Il s’agit aussi dans Aurélien d’un véritable retour en arrière car, comme l’indique le Paris-Guide de 1925 [[. Cité par Evelyne Cohen, Paris dans l’imaginaire national de l’entre-deux-guerres, publications de la Sorbonne, 1999, 2ème partie « Paris et le monde », chapitre IV « La ville-lumière s’expose aux regards du monde », « Les attributs de Paris », p. 140-162.]], la sociologie des promeneurs de l’avenue du Bois a eu le temps de changer entre l’époque de Proust et le début des années 1920 :
« Jadis, je veux dire il y a quinze ans, on ne rencontrait […] que des gens élégants dont tout le souci était de plaire. On se promenait. Aujourd’hui le peuple est roi. Des milliers de midinettes, d’employés, de rustres envahissent les trottoirs de leur laideur, de leur tumulte et de leur vulgarité. Et le dimanche ! Ne parlons pas du dimanche, des bourgeois en famille […]. Ce n’est que vers dix-sept heures du soir, sur le côté droit, à la sortie des dancings, qu’on risque encore de rencontrer quelque femme élégante. »
Les réminiscences littéraires d’Aragon aboutissent ainsi dans certains chapitres à un réalisme décalé, qui applique aux années vingt des réalités sociales de l’avant-guerre, quand, à l’inverse, d’autres chapitres sont uni¬quement consacrés à des quartiers modernes à la mode dans l’entre-deux-guerres, tels que le boulevard qui mène de la place Blanche jusqu’à la place Clichy avec ses rues adjacentes, nouveau quartier des plaisirs dans le Paris du XXe siècle, auquel il faut ajouter la rue Oberkampf et ses environs. Le réalisme topographique d’Aurélien est un assemblage de lieux saisis à des époques différentes : c’est un premier aspect du kaléidoscope que forme le roman.
Le « mentir-vrai », entre réalisme et écriture poétique : l’île Saint-Louis, une réalité symbolique
Le statut de l’île Saint-Louis est défini dans le roman par une série de paradoxes, sur le plan du réalisme topographique et social, et sur le plan symbolique au sein de l’œuvre, les deux dimensions étant bien évidemment liées : les paradoxes de la fonction référentielle de l’île entraînent à leur tour des paradoxes dans sa fonction poétique. L’exemple du statut de l’île dans le roman nous montre ainsi comment peuvent s’articuler écriture réaliste et écriture poétique. Cette articulation est une des caractéristiques du « mentir-vrai ».
Sa localisation et sa fonction confèrent d’emblée à l’île un statut problé¬matique : elle est exactement le centre géographique de la capitale avec l’île de la Cité, et pourtant, contrairement à sa voisine, elle est dépourvue de toute fonction au sein de la ville. On remarque que l’île Saint-Louis, où les premières constructions d’habitation n’ont été réalisées qu’à partir du XVIIe siècle, n’est dotée d’aucune des fonctions traditionnelles censées caractériser toute société : en effet, la fonction religieuse est monopolisée par l’île de la Cité, qui eut aussi la fonction politique avant que cette dernière ne passe sur la rive droite à la fin du XIIe siècle, avec la construction des premières enceintes du Louvre sous Philippe Auguste, puis indistinctement sur la rive droite et la rive gauche avec la construction de l’Assemblée nationale comme symétrique de la place de la Concorde par rapport à la Seine et l’implantation de ministères et d’institutions dans de vieux palais de la rive gauche, comme le Sénat au Palais du Luxembourg ; la fonction économique et financière est, depuis le XIXe siècle, plutôt le fait de la rive droite, où sont implantés les sièges des grandes banques, la bourse de Paris, etc… ; quant à la fonction culturelle, elle est surtout détenue par le vieux quartier latin de la rive gauche, auquel se sont ajoutés quelques endroits emblématiques comme Montmartre et Montparnasse, lieux de prédilection des avant-gardes dès la fin du XIXe siècle. Ainsi l’île Saint-Louis fait figure d’exception dans le schéma d’organisation de la capitale : elle est située, comme l’île de la Cité, au cœur de la capitale, mais elle la redouble inutilement, elle n’en est qu’un pâle reflet, qu’une pâle imitation, n’ayant en son sein aucune fonction vitale pour la ville. C’est peut-être pourquoi l’île Saint-Louis est une réalité figée, qui a très peu changé au cours des siècles :
« C’est un des grands charmes de Paris que ses quartiers déchus […]. Dans l’île, où peu de maisons ont été bâties depuis les jours de son faste, l’isolement du fleuve a dans une grande mesure préservé ce vaisseau de pierre des dégradations commerciales. Ils sont nombreux qui sont ainsi tombés de la noblesse au commerce, aux logements du petit peuple, en gardant les frontons, les portes, les cours, les escaliers de leur grandeur nostalgique »
(XXVII, p. 176).
Le roman insiste sur cette position de retrait de l’île par rapport au reste de la capitale en vouant ce lieu non pas à l’activité humaine, mais à l’observation et à la contemplation. L’élément le plus important est sans doute la fenêtre d’Aurélien, d’où l’on peut voir, puisque l’appartement est situé à l’extrémité de la pointe ouest de l’île, la Cité avec Notre-Dame, « tellement plus belle du côté de l’abside que du côté du parvis », la rive droite « jusqu’à cette aile blanche du Sacré-Cœur », la rive gauche avec la Montagne Sainte-Geneviève et le Panthéon, et « les ponts, jouant à une marelle curieuse, d’arche en arche entre les îles » (IX, p. 71). L’île Saint-Louis ne vaut pas pour elle-même, mais pour la perspective qu’elle offre sur toute la capitale au centre de laquelle elle se trouve, qu’elle ne fait toutefois que refléter au lieu de rayonner sur elle.
Le réalisme sociologique de l’île est lui aussi soumis à une série de para¬doxes. L’endroit n’est décrit assez précisément – mais toujours de façon rapide – qu’aux chapitres IX, XXVII et XXXIV du roman : il est présenté comme un reflet déformé de la réalité parisienne. L’île apparaît comme un microcosme, comme une ville dans la ville, puisqu’elle concentre toutes les catégories sociales et professionnelles, et acquiert un statut métonymique par rapport à l’ensemble de la capitale : dans la rue Saint-Louis-en-l’Île « demeurent les boutiquiers, les gens de métiers, le peuple » alors que « les quais […] sont presque entièrement constitués de vieux hôtels encore habités par des familles tombées mais dignes, une bourgeoisie qui a le mirage secret de l’aristocratie, des artistes, des hommes de loi, des Américains amenés par le cours du dollar » (XXVII, p. 177). Cette stratification sociale horizontale correspond exactement à celle de la capitale dans son ensemble, où les quartiers centraux sont plutôt populaires, tandis que les gens aisés résident à cette époque plutôt dans le XVIe arrondissement – comme les Barbentane –, sur les Champs-Élysées, dans le XVIIe arrondissement, tous ces quartiers étant situés en périphérie. Ce microcosme est évoqué une deuxième fois à plus petite échelle, au restaurant Les Mariniers : lorsque Bérénice pénètre dans la salle de restaurant, elle est en effet surprise par le « bariolage du public, fait de gens qui travaillent par là, des hommes en casquette, et d’Anglais artistes, genre Oxford, et de couples trop bien habillés pour l’ensemble, et des célibataires à l’aise, des employés » (XXXIX, p. 221-222). Toutefois la réalité parisienne reflétée par l’île est déformée, figée dans un présent d’une autre époque. L’île est un retour dans un passé révolu, dans le faste du XVIIe siècle, qui s’est peu à peu étiolé, effacé au fil des siècles : ce microcosme invite donc à la nostalgie et à la rêverie, et non à regarder vers l’avenir. L’île est un décor plus propice à la contemplation et à la méditation qu’au bouillonnement de la vie urbaine. L’image qu’elle reflète est en outre bien plus floue que son modèle. Les descriptions de l’île sont rares et peu exhaustives : seuls les chapitres XXVII et XXXIV l’évoquent dans son ensemble, mais de façon très concise, et les descriptions mentionnent de préférence les choses par synecdoque, en fondant le tout dans un détail qui prend sa place. Ainsi les clients des Mariniers, qui se trouvent être représen¬tatifs de la population de l’île, sont très vite remplacés par la présence envahis¬sante des anciens compagnons de guerre d’Aurélien, Fuchs et Lemoutard, décrits jusque dans les moindres détails. Puis ces deux personnages ne sont à leur tour plus désignés que par leur voix et leurs paroles intempestives résumés par le terme « brouhaha » (XXXV, p. 229). L’île Saint-Louis est à la fois vivante et figée dans une temporalité suspendue : c’est pourquoi ce microcosme, reflet à la fois concentré et estompé de la réalité parisienne, est désigné par la métaphore du bateau. Ce « vaisseau de pierre » (XXVII, p. 176) semble avancer, et pourtant il est bien ancré dans le fleuve et dans le passé.
Le statut de la fonction référentielle de l’île est ainsi bien paradoxal : sa topographie en fait un lieu central et en même temps à l’écart du reste de la capitale, sa sociologie en fait un reflet à la fois concentré et dégradé de la capitale. Ces deux paradoxes aboutissent cependant au même effet – ils donnent une vision figée de l’île – et ils se répercutent de surcroît dans la fonction poétique et symbolique de l’île dans le roman.
En effet le mode de description anthropomorphe de la capitale, si fréquente depuis que la ville est devenue un objet littéraire, sert également pour la description de l’île Saint-Louis : elle acquiert ainsi à son tour une fonction poétique, qui subit elle aussi les procédés déjà observés de concentration (ou de réduction) et d’estompage (ou dégradation). Ainsi, quand Paris dans la nuit est décrit comme l’organe vital de l’être humain – « tout d’un coup tout s’éteignit, la nuit devint épaisse, et dans la nuit battit comme un cœur » – l’île est alors « Paris vu de son cœur » (IX, p. 71), le cœur du cœur. Mais cette analogie assez valorisante, qui opère par réduction, est relayée par une autre métaphore beaucoup moins flatteuse, qui répond, quant à elle, au phénomène de dégradation. Alors que Paris, la capitale, est assimilée à la tête, autrement dit à une partie noble du corps humain, c’est la métaphore de l’ « intestin » qui sert à désigner l’île : « le village de l’île, pour ainsi dire, les boutiques nécessaires à sa vie, se sont cantonnées à sa rue centrale, la rue Saint-Louis-en-l’île, qui, étroite et cachée, a l’air honteux d’un intestin traversant un corps noble ». Cette métaphore anthropomorphe fait écho au « ventre de Paris » de Zola, c’est pourquoi Aragon ajoute aussitôt : « Là demeurent les boutiques, les gens de métier, le peuple » (IX, p. 71). Car c’est bien au « peuple » qu’il faut associer ce « ventre », peuple dont la conscience née de la Révolution s’est progressivement éveillée tout au long du XIXe, et a surgi tant dans les débats politiques que dans la littérature. Cette métaphore confère ainsi à l’île un statut poétique, à la fois parce qu’elle répond au procédé de miroir déformant, et parce qu’elle s’inscrit dans une tradition de la littérature sur Paris.
Enfin, on peut conclure sur la fonction poétique de l’île et sur son anthro¬pomorphisme en disant que son rôle discret au sein de l’œuvre, son éva¬nescence due à son caractère vivant et en même temps extrêmement figé dans le temps et dans l’espace, et enfin l’image estompée qu’elle donne de la capitale sur le mode de la réduction, en font une réalité présente-absente. L’île Saint-Louis est elle aussi un masque aux yeux fermés, parce qu’elle dissimule en partie la réalité, mais pour mieux la révéler. C’est un objet baroque, une perle irrégulière au milieu de la capitale, un monde miniature et hétéroclite qui donne l’impression de vivre avec son temps alors qu’il se nourrit encore du prestige du passé, une réalité en trompe-l’œil qui fait mine d’avancer sur le fleuve alors qu’elle reste immobile.
La mise en scène d’une élite : un réalisme aragonien
La diversité des arts représentés dans le roman est significative de la vitalité retrouvée des milieux artistiques au lendemain de la guerre, notamment grâce aux apports étrangers toujours très attirés par la capitale dans les années vingt. Aux côtés d’un Picasso, d’un Zamora, tous deux d’origine espagnole, d’un Monet et d’un Blaise Ambérieux, représentants de la peinture dans le roman, il faut aussi compter la comédienne Rose Melrose, les écrivains Cocteau, Paul Denis, Ménestrel, Tristan Tzara, le directeur des Ballets russes Diaghilev, le musicien Jean-Frédéric Sicre, le collectionneur et mécène Jacques Doucet, le couturier Poiret, les galeristes Bernheim et Kahnweiler, ainsi que de nombreux autres artistes présents en filigrane derrière leurs œuvres : la grande maison de mode Chanel, le décorateur Paul Iribe, le musicien russe Stravinsky, le néerlandais Van Dongen qui a fait le portrait de Mary de Perseval qui trône dans son salon, le peintre japonais Fujita, Marie Laurencin faisaient eux aussi partie de l’avant-garde culturelle parisienne, même s’ils n’interviennent qu’en arrière-plan dans le roman. Le foisonnement culturel des années vingt est ainsi incarné par tous ces personnages artistes, qu’ils soient très présents tout au long du roman ou simplement évoqués au travers de leurs œuvres.
De surcroît Aragon a opéré un marquage autobiographique évident en s’inspirant largement de ses propres expériences et connaissances : les éléments autobiographiques apportent ainsi un incontestable effet de réel à la fiction. Plusieurs travaux se sont déjà attachés à montrer les rapprochements possibles entre certains personnages fictifs et leurs modèles réels : Suzanne Ravis[[. Op. cit.]] a notamment montré que, si les ressemblances sont très nombreuses, elles ne sont toutefois pas opérées de façon systématique ni toujours selon le même principe, ce qui interdit d’assimiler Aurélien à un roman à clefs. Certains personnages sont reconnaissables suivant le principe de l’analogie. On devine ainsi Breton dans le physique et les attitudes de Ménestrel : ils brandissent tous deux la même canne arrogante (chapitre LVIII), on dénonce l’autoritarisme du personnage fictif [[. Aurélien, chapitre LXIII, p. 403 : « Il se mit à parler de Ménestrel […]. Un personnage cérémonieux, pédant, insupportable. Qui exploite ses amis. En était jaloux. Un roitelet avec une cour, et des intrigues de tous ces gens entre eux, à qui serait bien vu du potentat. » ]] comme on avait dénoncé celui de son modèle, et les démêlés de Ménestrel avec Fuchs et le peintre Zamora au sujet de la mort de Paul Denis rappellent ceux de Breton avec les journalistes puis avec Picabia (chapitre LXXIV)… La figure du couturier-collectionneur Roussel est ouvertement inspirée du célèbre Jacques Doucet, suivant le même procédé de l’analogie[[. Voir Maryse Vassevière, « Aragon, Doucet et l’histoire littéraire » in La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet : archive de la modernité », sous la direction de Michel Collot, Yves Peyré et Maryse Vassevière, Éditions des Cendres/Presses Sorbonne Nouvelle, 2007. ]]. Ils partagent en effet le même physique et la même curiosité presque malsaine pour Paul Denis/Aragon. Cet « homme de soixante ans, la barbe en collier, les cheveux blancs, […] soigné comme un caniche et habillé avec une recherche qui frisait le mauvais goût à force de distinction » (XXVIII, p. 185) accepte, à la fin de la première de Cocteau au Théâtre-Montmartre (chapitre LVIII), d’aider financièrement Paul Denis s’il lui donne en échange des conseils pour enrichir sa bibliothèque et s’il lui confie ses problèmes personnels, ce qui arrive effectivement lors d’une deuxième rencontre à Giverny[[. Ibid., chapitre LX, p. 387 : « Tout de même, il lui devait une fière chandelle à Roussel : mille francs par mois, ça ne se trouve pas sous le pied d’un cheval. Et puis de but en blanc, comme ça. Simplement parce qu’il lui avait dit : « Je suis amoureux, nous voulons nous cacher quelque part à la campagne. » Au fond, il avait été très chic ce vieux bonhomme, avec tous ses ridicules, ses façons de… Les gens rigolaient de lui : combien en auraient fait autant ? Moyennant une correspondance littéraire pour sa bibliothèque. » Plus loin Paul Denis dénonce le « faux air de discrétion » de ce « vieillard fouineur ». ]] : on sait qu’Aragon, dans sa correspondance avec Jacques Doucet, chez qui Breton l’a introduit, fait plusieurs fois confidence au mécène de ses aventures amoureuses, qu’il fait suivre régulièrement de demandes financières[[. Aragon, De Dada au surréalisme. Papiers inédits (1917-1931), édition établie et annotée par Lionel Follet et Édouard Ruiz, Cahiers de la NFR, Gallimard, 2000.]]. Suzanne Ravis rapproche également le poète Paul Denis d’Aragon, pour la révolte intellectuelle, et de René Crevel, pour sa fin tragique[[. Michel Carassou, René Crevel, Fayard, 1989.]] (le suicide, qui se produit juste avant la publication du manifeste de Breton, bouleverse le groupe surréaliste dans le roman comme dans la réalité et donne lieu à des controverses avec la presse qui accuse la pression morale du groupe) ; le peintre Blaise Ambérieux de Félix Fénéon ; le médecin Decœur du cinéaste Delluc dont il partage la jalousie amoureuse ; Rose Melrose d’Eve Francis ; Bérénice de Denise, la cousine de Simone Kahn, et d’une amie de Drieu la Rochelle nommée Elizabeth de Lanux, qui fait connaître à Aragon les mêmes déboires amoureux que Bérénice à Aurélien, etc… Zamora est quant à lui très proche de Picabia par son style de peinture. Tous ces personnages ne sont que semi référentiels puisque, même s’ils ont une place importante dans le roman, ils ne sont pas entièrement fidèles à leurs modèles – et donc pas toujours reconnaissables par les lecteurs. Pourtant leur fonction référentielle l’emporte : dans un roman comme Aurélien où l’intrigue est peu soutenue et distendue, les personnages servent moins à assurer la cohérence des actions dans l’intrigue [[. Il s’agit de la fonction dynamique du personnage sur laquelle insistent les formalistes comme Tomachevski : le personnage joue le rôle d’un fil conducteur permettant de s’orienter dans l’amoncellement des motifs, d’un moyen auxiliaire destiné à classer et à ordonner les motifs particuliers. Cette analyse du personnage permet notamment de se défaire d’un psychologisme abusif et de rester fidèles à la conception aristotélicienne du personnage « actant ».]] qu’à ancrer la fiction dans la réalité des années vingt.
Cette fonction référentielle est accentuée de surcroît par la présence de personnages réels dans la fiction, comme le général Mangin de la bataille de Verdun, la vedette de l’époque Mistinguett, le grand couturier Poiret, ou encore Cocteau et Picasso. Ces derniers ne font que de rapides apparitions lors d’événements eux-mêmes directement tirés de la réalité. Ils sont en effet présents lors de la représentation de la pièce de Cocteau au Théâtre Montmartre, interprétée par Rose Melrose, dont le modèle est la soirée du 18 juin 1921 au Théâtre des Champs-Élysées, où les dadaïstes ont chahuté la première représentation des Mariés de la Tour Eiffel de Cocteau. Ils sont aussi présents lors du grand vernissage Zamora, inspiré du vernissage Picabia du 9 décembre 1920 à minuit, à la galerie de La Cible. L’atmosphère de la scène du roman est certes parfaitement fidèle à celle des grands événements mondains de l’époque :
« Au lieu de la soirée à esclandre dont les échotiers parisiens s’apprêtaient à faire des gorges chaudes, Picabia offrit à ses amis et ennemis la parfaite caricature d’un de ces vernissages mondains où le Tout-Paris s’écrase dans quelque galerie exiguë pour s’abreuver de whisky et de potins, sans trop se préoccuper des toiles, d’ailleurs inaccessibles, qui s’étalent sur les cimaises [[. Marie de la Hire, écrivain ayant assisté au vernissage et réalisé la brochure de l’exposition pour l’éditeur Povolozky, citée par Michel Sanouillet, DADA à Paris, CNRS Éditions, 2005, p. 200.]]. »
Toutefois les personnages réels insérés dans la fiction contribuent à accentuer l’effet de réel de l’ensemble et la fonction référentielle des autres personnages moins marqués par leur modèle. Picasso, du simple fait de sa présence, accrédite le réalisme de la scène où l’on identifie alors d’autres célébrités de l’époque dans les autres personnages.
Le personnage de Zamora est peut être celui qui résume le mieux les procédés de mise en scène réaliste de l’élite parisienne. Son mode de vie – il habite chez une américaine installée à Paris – et son style de peinture l’identifient clairement à Picabia qui vivait chez Germaine Everling et dont les œuvres surréalistes jouaient beaucoup sur la provocation (procédé de l’analogie). Mais ce personnage est aussi analysable en fonction des connaissances et des expériences personnelles d’Aragon. Le nom du peintre est sans doute inspiré de José de Zamora, nom du maquettiste du grand couturier Paul Poiret, qu’Aragon connaissait [[. André Sallée et Philippe Chauveau, Music-hall et café-concert, Bordas, 1955, p. 73.]]. En outre l’atelier de Zamora semble avoir pour modèle l’atelier de Picasso, qu’Aragon a vu plusieurs fois en rendant visite au peintre. Jacques Baron fait ainsi le récit d’une visite lors de laquelle il a accompagné Aragon :
« Nous passâmes dans l’atelier en traversant une salle à manger ou un salon avec de beaux meubles, et d’autres avachis, disposés d’une façon très désordonnée comme si le ménage n’était pas fait […]. Dans le salon ou la salle à manger, il y avait un jouet d’enfant qui remplissait tout l’espace, un chemin de fer […].
[…] Ce n’était ni désordre, ni sublime, c’était le chaos : toiles achevées et inachevées de toutes dimensions, beaucoup tournées contre le mur, chaises ou fauteuils dépenaillés, pinceaux, tubes de couleur, pots de peinture cela va de soi, mais leur rapprochement ou leur éloignement était singulier, journaux et revues à l’abandon, du fil de fer et toute sorte de ferraille, de la boîte de conserve vide à la tôle ondulée […].
À l’époque, Picasso était bien sage par rapport à lui-même, ce qui inquiétait Aragon et Breton. Il peignait des dames avec des enfants sur les genoux. Les dames étaient plus grosses que nature mais les enfants étaient normaux [[. Jacques Baron, L’an I du surréalisme, Denoël, 1969, « Promenades avec Aragon », p. 58-59.]]. »
La description de l’appartement de Mrs. Goodman (XXVIII, p. 184 à 186), où habite Zamora, reprend tous les éléments de l’atelier de Picasso : « les sièges cannés genre Trianon, les bergères couvertes de soie rayée vert et blanc, la console d’époque, la table de marbre » correspondent aux « beaux meubles » remarqués par Jacques Baron ; Zamora est venu « camper là-dedans » avec « ses toiles entassées dans un coin par terre, son chevalet, ses pinceaux, des cartons, des crayons, des pots de couleur » ; les deux enfants de Mrs. Goodman avec leur nourrice, « une grosse négresse coiffée d’un madras noué vert à pois rouges », sont en chair et en os les sujets représentés par Picasso dans ses tableaux ; enfin même le train encombrant est là puisque le petit garçon de Mrs. Goodman « se traînait par terre, dans les pieds de tout le monde, avec une locomotive couleur boîte de sardines ».
Pour la plupart semi référentiels ou réels, et souvent inspirés de l’expé¬rience d’Aragon, les personnages d’Aurélien contribuent tous à former un tableau réaliste de l’élite parisienne des années vingt, dont ils respectent la sociologie et les mœurs.
Le télescopage des époques : Monet au milieu des cubistes
La peinture est omniprésente dans le roman qui fait intervenir plusieurs artistes des milieux des avant-gardes cubiste, surréaliste, expressionniste, dont les œuvres sont très souvent décrites. Les chapitres situés à Giverny, où se trouve la propriété de Monet, font donc figure d’intrusion au milieu de cette modernité affichée, d’autant plus que Monet ne fait aucune apparition, et que sa peinture est bien différente de celle des avant-gardes de l’après-guerre. Comme le fait en effet remarquer Lucien Victor au sujet d’Aurélien, « sauf pour le Van Dongen […], quand la narration s’intéresse aux tableaux de l’époque, elle s’attarde peu sur les couleurs », puisqu’au contraire « les tableaux décrits le sont pour leurs sujets, leurs lignes, certains détails de leur dessin sans jamais une mention de couleur [[. Lucien Victor, « La couleur d’Aurélien », in Écrire et voir. Aragon, Elsa Triolet et les arts visuels, Centre aixois de recherches sur Aragon, Publications de l’Université de Provence, 1991, p. 261-262. ]] ». Monet apparaît donc en contrepoint dans cet univers dominé par les avant-gardes : alors que les tableaux de Picabia mettent l’accent sur les lignes, les formes – « Les couleurs, une superstition », dit Zamora par provocation –, la peinture de Monet reste insensible à tous les courants modernes, fauves, pointillistes, nabis, cubistes, et annonce la peinture contemporaine abstraite en faisant disparaître l’objet au profit de la couleur dans les jeux d’ombre et de lumière. C’est peut-être pourquoi aucun tableau de Monet n’est explicitement décrit, de même que le peintre lui-même n’est pas un personnage à part entière.
Giverny apparaît donc comme une réminiscence aux contours très flous, dont les divers éléments ont plus une portée poétique et symbolique qu’ils ne servent de cadre à une action structurée. L’épisode de Giverny fait certes partie intégrante de l’intrigue, puisqu’il permet la fuite et l’idylle de Paul Denis avec Bérénice, et surtout la dernière rencontre entre Aurélien et Bérénice, due à un étrange concours de circonstances. Mais il est surtout à comprendre dans une triple fonction, indépendante de l’intrigue : l’épisode de Giverny a tout d’abord une fonction autobiographique, clairement mise en évidence par le décalage temporel opéré dans le roman par Aragon en 1966 ; il a aussi une valeur poétique puisqu’il reprend tous les symboles dispersés ailleurs dans le roman, comme pour en faire un concentré au moment même où l’action est à son apogée dramatique ; enfin Giverny résonne sans aucun doute comme un hommage à Claude Monet : bien que son œuvre ne soit pas explicitement évoquée dans le roman, il est clair qu’elle exerce une influence esthétique et stylistique sur les chapitres à Giverny.
On sait que la réécriture d’Aurélien en 1966 a principalement consisté pour Aragon à opérer un décalage chronologique par rapport à la première version, située entre l’hiver 1921 et le printemps 1923. Plusieurs hypothèses sont venues étayer ce décalage : la plus convaincante est sans doute celle selon laquelle Aragon a voulu donner un ancrage autobiographique à son roman, puisqu’il se souvenait avoir lui-même rendu visite à Claude Monet au printemps 1924 (en réalité il y était allé en 1923, conformément à la première version du roman [[. Suzanne Ravis, op. cit., p. 34.]]). C’est en effet en avril 1923 qu’Aragon démissionne de Paris-Journal dont le directeur Hébertot lui avait confié les pages de critique littéraire : il reçoit alors une aide mensuelle de 1000 francs du mécène Jacques Doucet, qui lui permet aussi de se retirer à Giverny [[. François Chapon, Mystères et splendeurs de Jacques Doucet 1853-1929, J.-C. Lattès, 1984, chapitre 9 « Mes jeunes tigres… ».]] . C’est là-bas qu’Aragon se met à la rédaction de La Défense de l’Infini, de même que Paul Denis y écrit lui aussi des manuscrits dans le roman. Ce décalage n’est pas sans incidence sur le reste du roman puisqu’il cause des incohérences historiques entre l’œuvre et ses référents réels : il devait donc avoir, aux yeux d’Aragon, une importance symbolique suffisamment grande pour être pleinement justifié. Giverny représente en effet pour Aragon un lieu chargé de significations : c’est aussi là qu’il s’est retiré après deux rencontres amoureuses malheureuses. La première fut celle d’Elizabeth de Lanux à l’été 1922 : Aragon a fui un amour impossible avec cette amie proche de Drieu la Rochelle en s’enfuyant dans le Tyrol, puis à Berlin. Il a ensuite fait la connaissance, à la fin de la même année, de la cousine de Simone Kahn, la femme de Breton. Aragon fut à nouveau contraint de fuir cette aventure malheureuse avec Denise Lévy, en se rendant à Giverny grâce aux bons soins de Jacques Doucet. Giverny est donc à bien des égards un souvenir douloureux pour lui.
C’est sans doute aussi pourquoi l’épisode de Giverny n’est pas un hasard dans Aurélien. On pourrait croire à première vue qu’il n’est qu’une parenthèse dans l’ensemble du roman, qu’un rajout après coup. Cependant une analyse plus détaillée montre que cet épisode chapeaute l’ensemble du roman puisqu’il en contient tous les éléments symboliques structurants, comme une sorte de matrice. L’intrigue très lâche du roman est en effet compensée ou consolidée par une série d’images qui servent de fils directeurs, telles que la Seine, l’eau, à la fois symbole du temps et de la mort. Bérénice a cru fuir à Giverny, pourtant tout lui rappelle Aurélien. Le fleuve résume de façon symbolique les grandes caractéristiques de la vie d’Aurélien. Il coule implacablement, en suivant son cours que le hasard a fixé, tout comme lui se laisse porter, incapable de prendre la moindre décision, « flott[e] d’une résolution à l’autre » et « sombr[e] d’abîme en abîme » (LXX, p. 445) : le thème de l’eau dans la métaphore assimile les pensées d’Aurélien aux mouvements du liquide, ce qui montre le manque de consistance de ses résolutions, le manque de fermeté de ses décisions. L’« attente sans objet et l’absence de perspective » sont pour lui le lot du quotidien : sa passivité inhérente, son incapacité à entreprendre quoi que ce soit font qu’il vit dans une sorte de présent infini. De même que le fleuve est à la fois mobile et immobile, qu’il coule sans jamais changer, Aurélien passe le temps et se laisse porter par les événements sans jamais s’engager : les jours passent et il n’en ressort pas modifié. Cette immobilité dans les pensées et dans les actes du personnage créent une sorte de malaise morbide : c’est pourquoi sans doute le fleuve est aussi associé à la mort. Comme on l’a vu la Seine à Paris tracte les cadavres, symbolisés par le masque de l’Inconnue, et elle ressemble d’après Aurélien à ce « M veineux » que les philosophes haïs par la vie tranchent dans leur baignoire. À Giverny, le fleuve est décrit avec ses « branches mortes » et ses « épaves » comme un piège qui conduit droit à la noyade. La fuite incontrôlée du temps, l’arbitraire du destin, le caractère morbide de l’eau, tous ces éléments symbolisés par la Seine sont présents à Paris dans les pensées d’Aurélien et à Giverny dans les pensées de Bérénice : le rapprochement entre les deux lieux du roman se trouve par là même justifié, d’autant plus que Giverny est chargé de tout un passé douloureux dans les souvenirs d’Aragon qui s’en sert pour donner une touche autobiographique à son roman.
Enfin l’épisode de Giverny n’est pas qu’une simple parenthèse puisqu’il évoque implicitement les œuvres de Monet, dont l’esthétique parcourt par ailleurs l’ensemble du roman. Monet n’apparaît pas en tant que personnage dans le roman : il est simplement mentionné deux fois à la fin du chapitre LXVIII qui le désigne aussi comme « ce grand vieillard aux yeux voilés », expression presque homérique qui évoque plus un sage antique qu’un peintre moderne. Toutefois les descriptions de Giverny sont des réécritures évidentes de ses tableaux, et le désignent ainsi de façon métonymique. Le chapitre LX, qui ouvre l’épisode de Giverny, est placé sous le signe de l’impressionniste, et la description utilise l’esthétique du grand peintre :
« Il faisait une manière de soleil, et il y avait des couleurs tendres dans les champs, un piquetis d’herbe pâle sur les velours labourés beiges, blancs, bruns et roses ; les premières fleurs blanches aux arbres fruitiers. Le paysage s’adossait aux coteaux voisins, couronnés de buissons et coupés de carrières, avec un petit chemin de fer à sable. Puis la route, les champs, et le fouillis qui cachait la Seine. Tout cela s’étendait à plat sur des kilomètres. De l’autre côté de la vallée, tout s’estompait, on devinait des plateaux, un pays qui continue. »
(LX, p. 387)
Cette description estompe les lignes et les formes au profit des couleurs. L’expression « une manière de » montre bien qu’il n’est pas question d’un tableau aux contours nets et précis, mais bien d’une vision, d’une impres¬sion… Certains termes renvoient d’ailleurs directement à l’impressionnisme : le « piquetis », le « fouillis » contribuent à « estomper » les lignes et les formes.
L’évocation du jardin de Monet à la fin du chapitre LXIII constitue une retranscription fidèle de l’œuvre du peintre selon le procédé de l’ekphrasis, et en particulier de la série des nymphéas et des ponts japonais :
« Quand elle fut devant le beau jardin que partageait le chemin, elle s’arrêta et regarda à gauche le pont, l’eau, les arbres légers, la tendresse des bourgeons, les plantes aquatiques. Puis se tourna du côté de la maison qu’habitait ce grand vieillard qu’elle avait souvent vu de loin, et dont tout le pays parlait. Celui qui ne pouvait voir les fleurs fanées. Elle vit les fleurs bleues. À leur pied, la terre fraîchement remuée. Des fleurs bleues partout. La petite allée vers la maison. Le gazon clair et d’autres fleurs bleues. […]
La lumière était si belle sur les fleurs… Qu’est-ce que c’était ces fleurs ? On dit qu’il n’y a pas de vraies fleurs bleues. Pourtant… Qui sait s’il les voyait bleues, le grand vieillard, là-dedans. On disait que ces yeux étaient malades. Il pouvait devenir aveugle. Terrible à penser. Un homme dont toute la vie était dans les yeux. Il avait quatre-vingts ans passés. S’il devenait aveugle… On pouvait l’imaginer exigeant encore qu’on arrachât les fleurs avant qu’elles fussent fanées, ces fleurs que de toute façon il ne verrait plus… Les fleurs bleues feraient place à des roses. Puis il y en aurait de blanches. Chaque fois, d’un coup, c’était comme si on repeignait le jardin »
(LXIII, p. 408)
La description évoque quelques détails divers qui disparaissent presque sous la quantité de fleurs que comporte le jardin. L’incertitude sur les couleurs de ces fleurs est ici attribuée à la vision défectueuse du peintre, mais en réalité elle reproduit exactement les effets de ses tableaux, où les couleurs sont tellement entremêlées qu’il devient presque impossible de les distinguer. Aragon rend ainsi hommage à Monet, et inscrit son texte dans une tradition instaurée par Proust, qui avait déjà rendu un hommage implicite au peintre dans sa description des jardins de nymphéas sur les bords de la Vivonne :
L’épisode de Giverny est donc loin de la romance bucolique. Son intensité dramatique et sa portée symbolique dans le roman en font un épisode clef qui, tout en renvoyant à un passé réellement vécu par Aragon, rend aussi hommage au grand peintre que fut Monet et à son œuvre qui, dès la fin du XIXe siècle, a annoncé la modernité en peinture.
Kaléidoscope et « mentir-vrai »
Simone ou le Paris nocturne du XIXe siècle
Plusieurs personnages du roman sont les héritiers de grands types sociaux du XIXe siècle. Simone est la figure croisée de l’entremetteuse, de la confidente, de l’entraîneuse : personnage central du Lulli’s, elle est l’héritière de toute la gent féminine des cafés, des débits, des cabarets parisiens du XIXe siècle. Les bars chics comme le Lulli’s, mais aussi et surtout les dancings, les cafés et les bars populaires possédaient tous leurs habituées au comptoir, mi-clientes mi-employées. Les jeunes filles en situation de précarité étaient alors nombreuses à Paris, et beaucoup d’entre elles proposaient leurs services dans les débits de boisson où bien souvent leur misère empirait[[. Henry-Melchior de Langle, Le petit monde des cafés et des débits parisiens au XIXe siècle, PUF, 1990, chapitre 2, p. 134-148.]].
Leur rôle est ambigu : comme Simone, qui se trouve là à chaque fois qu’Aurélien va au Lulli’s, elles font partie du décor sans être de vraies clientes. Toutefois le patron, s’il ne les emploie pas comme serveuses, les tolère parce ce qu’elles mettent de l’animation dans le bar en faisant la conversation aux clients assis au comptoir, ou en dansant avec d’autres qui n’ont pas de partenaire sur la piste… Simone est ainsi devenue la confidente d’Aurélien dans le roman : elle accepte d’écouter ses malheurs, au point qu’elle en oublie de faire attention aux siens, qui, comme le laissent deviner de nombreuses anecdotes, doivent être nombreux et autrement difficiles…
Le premier mal auquel elles sont confrontées est l’alcoolisme : elles ne peuvent pas en effet refuser les invitations des clients qui font partie des habitués et qui leur offrent un verre à boire chaque fois qu’elles les servent. L’alcoolisme et le cancer de l’estomac sont ainsi les premières causes de mortalité chez ces jeunes filles qui doivent faire bonne figure devant les clients, et dont l’espérance de vie dépasse rarement les trente ans[[. Ibidem.]]. On comprend qu’elles détruisent peu à peu leur santé par la boisson si l’on songe qu’elles doivent passer chacune de leur soirée dans un bar ou un café de ce type : elles gagnent leur vie, et la détruisent en même temps… Simone en a bien conscience elle-même lorsqu’elle ose faire une remarque à Aurélien et à Decœur, peut-être parce qu’elle connaît bien le premier et parce qu’elle a appris que le second est médecin :
« … Et quand je viens le soir ici, achever une soirée, oublier un peu les gens… nous passons toujours un moment ensemble… je lui paye un verre…
Un seul, – dit Simone sérieuse. – Vous comprenez, docteur, c’est mauvais pour l’estomac tout ce qu’on avale ici… Oh, je ne veux pas dire… non ! Mais nous autres, de dix heures du soir à cinq heures du matin, il faut bien prendre quelque chose de temps en temps, et puis, si peu qu’on avale de champagne… il faut bien… les clients… »
(XI, p. 83)
Elles passent ainsi leur temps dans cette atmosphère enfumée, à satisfaire les moindres désirs des clients… La plupart d’entre elles sont obligées de se prostituer pour vivre, et les clients du bar sont aussi des clients potentiels qu’elles guettent assises au comptoir. La prostitution est officielle dans ce genre de lieu, mais pas toujours permise à l’intérieur, comme on le voit grâce à une remarque de Simone :
« Il n’y a pas à dire… Ils sont soûls, mais ils sont beaux, ces types-là… ça, ils sont beaux… Le malheur, ils ne savent pas se tenir… Sans ça… Tu comprends, Lulli, lui, la tenue… Si on lève un de ces oiseaux-là, tout de suite ça se voit… et tu sais qu’il ne plaisante pas, Lulli… Une fois sorties, tout ce qu’on veut… Mais dans la maison, pas de retape… J’ai eu quinze jours de mise à pied l’autre mois… Tu parles si j’ai envie de recommencer ! »
(XI, p. 81)
La prostitution et le racolage étant interdits par la loi, les patrons de débits savent bien quels risques ils encourent en accueillant les « poules » du quartier, qui doivent bien trouver des clients pour survivre plutôt que pour vivre… L’anecdote de la nouvelle robe de Simone nous fait bien comprendre en effet qu’elle gagne tout juste de quoi vivre, et qu’elle est souvent obligée de compter sur des amis ou sur la générosité des clients du Lulli’s pour gagner son pain. Dans le chapitre XXVI, elle propose à Aurélien de passer la nuit avec lui non pas en échange d’argent, mais simplement s’il lui paye à manger, dans un bistrot qu’elle connaît et qui est surtout moins cher que le Lulli’s : l’alcool qu’elle ingurgite pour le bon plaisir des clients ne fait pas taire leur estomac qui crie famine… Enfin la nouvelle robe que Simone arbore, toujours dans le même chapitre, avec le « bleu Patou » à la mode, qu’un client lui a offerte après l’avoir achetée bon marché dans la rue de Clichy : on sait grâce à André Warnod que le quartier du Lulli’s est plein de petites boutiques qui proposent des imitations de modèles à la mode pour celles qui n’ont pas les moyens de se ruiner pendant leurs soirées :
« Voici, rue Fontaine, les marchandes de lingerie : aux vitrines s’étale, disposée en éventail, ou arrangée en savant échafaudage, toute la séduction des dessous enrubannées de couleurs vives, cherchant à imiter les lingeries, les plus luxueuses. Pour quatre francs quatre-vingt-quinze, vous pouvez avoir une chemise toute ajourée et ornée de beaux rubans roses ; la dentelle, il est vrai, est un peu grosse et les dessins n’en sont pas du travail le plus fin ; mais tout ce luxe de pacotille convient si bien aux petites femmes qui l’admirent et l’achètent pour s’en parer ! » [[. André Warnod, Bals, cafés et cabarets, éditions Figuière et Cie, 1913, p. 5.]]
On devine ainsi que chaque petite nécessité de la vie quotidienne, vivre, manger, s’habiller, est une difficulté pour Simone comme pour toutes les filles de bars. Cette figure de la serveuse, qui joue aussi le rôle de la confidente ou de l’entremetteuse, quand elle n’est pas elle-même une de ces « poules » qui font presque partie du décor, a tendance a se faire plus rare dans l’entre-deux-guerres avec l’instauration de lois sociales et surtout la répression de plus en plus systématique de la prostitution.
Adrien ou la montée des « cols blancs »
La Belle Époque marque la promotion sociale de la bourgeoisie qui vient côtoyer de près la noblesse en déclin, et même la mettre en péril : comme l’a montré Proust, les salons bourgeois remplacent peu à peu les salons de la noblesse à Paris et dans les grandes villes. Aurélien, comme on l’a déjà vu, met bien en scène cette transition. Cependant il va plus loin encore en annonçant un phénomène social déjà réel dans l’entre-deux-guerres, mais surtout perceptible après la Seconde Guerre mondiale : il s’agit de la montée des « cols blancs », auxquels la bourgeoisie ne s’identifie pas tout à fait. Adrien Arnaud est dans le roman la figure qui incarne ce phénomène.
Le parcours professionnel d’Adrien Arnaud résume à lui seul, à l’échelle d’une vie, celui des classes moyennes émergentes qui s’est effectué sur plusieurs générations. Ancien camarade de jeux d’Edmond, originaire comme lui de Sérianne-le-Vieux dans le Midi, Adrien est sorti comme beaucoup de la guerre sans situation précise, sans qualification, et ruiné par la faillite de son père. C’est grâce à l’aide d’Edmond qu’il a pu se réinsérer dans la société :
« Il avait tout fait en trois ans à l’Immobilière-Taxis. Edmond l’avait mis à toutes les sauces. Qu’est-ce qu’il serait devenu d’ailleurs, après la faillite des magasins paternels, riche de ses galons de lieutenant de réserve, et de ses trois palmes, une fois démobilisé ? Il faut reconnaître qu’Edmond avait voulu qu’il connût la boîte de haut en bas. Et non seulement la boîte, puisqu’il avait fait le taxi, été surveillant de garage, travaillé à l’atelier des réparations. Puis à l’Immobilière… »
(XVIII, p. 124)
Adrien, après avoir monté tous les échelons de l’entreprise d’Edmond, est finalement devenu son conseiller personnel. Cette petite ascension sociale est due aux relations étroites qui l’unissent à Edmond, mais aussi à son mérite, puisqu’à chaque étape il a su faire preuve de ses capacités. Adrien n’est pas l’employé de type ancien comme Simoneau, qui travaille depuis trente ans en tant que secrétaire pour l’entreprise familiale des Barbentane, mais bien un employé d’un type nouveau : Adrien arrive à trente ans à peine « avec les dents longues ». L « amertume » qu’il ressent lorsqu’il songe à la carrière d’Edmond est bien compréhensible : son camarade d’enfance, « au fond bien moins brillant que lui », a eu plus de chance, et il a su également saisir les occasions qui se sont présentées à lui grâce à ses relations. Son ambition est donc claire : il cherche à monter encore dans la hiérarchie, à obtenir à son tour des responsabilités, « à se faire la place d’avenir que le patron, son ancien camarade d’enfance, lui permettait de se tailler [[. Ibid., chapitre XLV, p. 413 et chapitre XVIII, p. 123.]] ». C’est effectivement ce qu’il réussit à faire à la fin du roman lorsqu’Edmond lui propose la gestion des affaires pour la création de l’Institut Melrose : Adrien est progressivement passé du statut d’ouvrier, à celui d’employé ou de petit salarié, puis à celui de « cadre » – le terme n’apparaît toutefois qu’au début des années trente pour désigner le personnel d’encadrement d’une entreprise [[. Dominique Borne, Histoire de la société française depuis 1945, Armand Colin, 2000, p. 114.]]. Ainsi l’exemple d’Adrien anticipe sur la modernité sociale de l’après Seconde Guerre mondiale, marquée par l’augmentation rapide du nombre de salariés et de cadres, grâce à la nouvelle législation sociale qui leur assure une sécurité de l’emploi : ce sont eux que l’on appelle les « cols blancs » dès les années 1950, et dont Adrien est déjà un modèle.
Sans aller jusqu’au second vingtième siècle, Adrien peut aussi être considéré comme un élément anticipateur car il possède de nombreuses caractéristiques des catégories sociales séduites par le fascisme dans les années trente. La faillite paternelle ne lui a rien épargné en effet, et les conséquences économiques de la guerre l’ont encore affaibli : Adrien cultive un sentiment d’injustice profond, une « amertume » face à un sort qu’il estime n’avoir pas mérité. Pour lui, comme pour beaucoup d’autres, la société se divise entre la catégorie des nantis, à qui la chance a souri, et les autres qui, comme lui, doivent lutter pour la moindre chose. Cette haine du système, cet activisme – « il avait de l’ambition, mais il n’était pas un aventurier » – ce désir de renverser une bourgeoisie jugée responsable de la guerre et de la crise économique par son incapacité politique – « il prévoyait dans les embêtements du patron une secrète revanche » – et enfin le militarisme et le goût de l’ordre et de l’égalitarisme – « il serait bien resté dans l’armée, mais pour se voir la route fermée par ceux qui avaient passé par Saint-Cyr, non » – sont les arguments types de ceux que le fascisme a séduits dans les années trente [[. Aurélien, chapitre LXV.]]. Outre son attitude aigrie, qui peut inspirer en lui un désir de changement brutal et radical, quelques indices annoncent chez lui une propension nette au fascisme, comme par exemple la mention du groupe Pro Patria, qu’il a fondé pour encadrer la jeunesse de Sérianne sur le modèle des groupes paramilitaires en vogue dans les années trente.
Adrien est un personnage secondaire dans le roman, cependant il est riche de significations : il anticipe à la fois la montée de la nouvelle catégorie sociale des « cols blancs », qui sera visible surtout à partir du second vingtième siècle, et la propension des couches moyennes de la société des années trente à se laisser tenter par le fascisme, qui semble s’offrir à elle comme la solution de tous les problèmes, qu’ils soient économiques, politiques ou sociaux.
Si Aragon parle longuement de sa conception du « mentir-vrai » dans ses ouvrages, il semblait nécessaire de l’illustrer de façon concrète afin de mieux la comprendre, ce que l’on a tenté de faire ici dans cet article. Cette théorie consiste principalement, comme on l’a vu, à construire la fiction et l’intrigue à partir d’éléments réalistes et de détails historiques, tirés pour la plupart d’expériences et de connaissances de l’auteur, et parfois complètement affranchis de toute chronologie puisque les époques incarnées par ces détails se côtoient au sein du roman. Cette esthétique du détail à valeur référentielle et ce télescopage des époques confèrent au roman les mêmes vertus qu’un kaléidoscope.
Référence de l’article : «Aurélien : le kaléidoscope et le mentir-vrai«
par Céline CACHAT, Université Paris 3, 2007
— > Article tiré d’un Mémoire de Master 1 intitulé « Aurélien d’Aragon ou le kaléidoscope des Années », soutenu sous la direction de Maryse Vassevière (mention TB)
Université Paris 3, juin 2007
Mis en ligne sur https://louisaragon-elsatriolet.fr/ (17 février 2010)