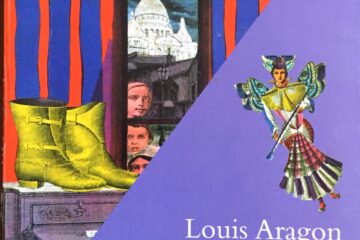Hervé Bismuth, « Aragon, Triolet, Les Lettres françaises et l’accueil en France du premier roman de Soljenitsyne » (2006).

(Cette contribution est une version longue, développée en direction d’un public d’aragoniens, d’un article paru dans La Chronique littéraire 1920-1970, Éditions Universitaires de Dijon, 2006, sous le titre : « Les Lettres françaises et la parution en France d’Une journée d’Ivan Denissovitch.)
Aragon, Triolet, Les Lettres françaises et l’accueil en France du premier roman de Soljenitsyne
Il est nécessaire de parler encore, jusqu’à ce qu’on l’entende, du rôle qu’ont joué Elsa Triolet, Aragon et l’équipe des Lettres françaises dans la traduction, l’accueil et la diffusion du premier récit de Soljenitsyne en France, Une journée d’Ivan Denissovitch. Ce rôle a été effacé et est à présent ignoré de bien des gens, y compris de bien des lecteurs de Soljenitsyne ou même d’Aragon. Cet oubli, cet effacement, tiennent à trois facteurs : la façon dont, quelque quinze ans après l’effondrement du communisme européen, l’Histoire et surtout notre idéologie historienne se sont simplifiées en gommant les paradoxes marginaux de notre passé ; la notoriété internationale acquise par Soljenitsyne à partir du début des années soixante-dix ; les rééditions de ce récit en France depuis 1975 : depuis cette date, les lecteurs français reçoivent à propos des conditions de sa première parution en France des affirmations calomnieuses, on y reviendra. Ces dernières semblent jusqu’à présent aller de soi dans la mesure où elles s’appuient sur une vision historienne simpliste des conditions de cette parution.
Il est difficile de parler des conditions de l’accueil du récit en France entre 1962 et 1963 sans parler de celles, peu habituelles dans l’histoire des publications littéraires « à scandale » dans les pays de l’Est, qui ont présidé au succès de ce roman dans son pays d’origine.
Une journée d’Ivan Denissovitch en URSS
Ce récit n’est pas le premier de Soljenitsyne : on apprendra plus tard qu’il avait produit d’autres écrits, notamment Le Premier Cercle, qui sont restés dans ses tiroirs jusqu’à ce que la notoriété l’encourage à les publier. Mais c’est le premier qui sera publié, immédiatement accueilli avec enthousiasme en URSS au moment de sa sortie en novembre 1962 : il fera immédiatement de son auteur une célébrité mondiale dans l’univers littéraire et politique des années soixante.
Le roman dans l’univers littéraire soviétique
Le terme générique de « récit » utilisé par l’édition française désigne un court roman, ou une longue nouvelle (un peu plus de 160 pages au format poche) conforme par bien des traits à l’esthétique dominante et quasi-obligatoire de l’époque, celle du réalisme socialiste. Il ne se présente en rien comme une écriture du « moi » ou une auto-fiction, mais comme un roman écrit au passé de narration, œuvre de fiction écrite à la troisième personne, racontant la vie quotidienne dans un camp de travail sibérien, à partir d’une synecdoque, celle d’une journée parmi tant d’autres d’un prisonnier parmi tant d’autres, Ivan Denissovitch Choukov. Comme tout récit réaliste, il est construit à partir d’une précision documentaire détaillée : il s’attache avec un soin minutieux à reproduire les parlures des personnages, notamment les argots des prisonniers et les idiolectes de leurs pays d’origine, et il cultive le détail. Il se distingue pourtant de l’esthétique du roman réaliste socialiste sur deux points majeurs : il décrit d’une part un univers dans lequel n’existe pas de héros positif – ce type de héros porteur à la fois d’une énergie combative et de valeurs « justes », notamment idéologiques ; d’autre part le récit ne propose pas de fin optimiste. Comme le dira plus tard son premier préfacier français Pierre Daix dans une formule qu’Aragon rendra célèbre, du moins pour les lecteurs du Fou d’Elsa : « L’enfer d’Ivan Denissovitch, c’est que le futur n’existe plus[[Le Fou d’Elsa, Gallimard, 1963, p. 329 (p. 387 dans l’édition « Poésie/Gallimard », 2002).]] ».
C’est pourtant aussi bien ce qui dans ce récit est conforme à l’esthétique réaliste que ce en quoi il y échappe qui assurera en URSS son succès : cette « journée » appartient à un hier révolu, dont il s’agit alors de faire table rase, et met en scène des personnages qui sont tous les victimes d’un passé historique récent de l’URSS, un passé qu’en URSS on dénonce, on accuse, avec force appels à témoignages : la « journée » d’Ivan Choukov est une journée de 1951, vécue par un prisonnier interné en 1941 pour « trahison » ou « espionnage », ce qui,sur le front russo-allemand, était le lot des soldats qui avaient été faits prisonniers et qui étaient parvenus, libérés ou évadés, à rejoindre leur camp. Si les détenus, aussi bien les simples prisonniers que les kapos qui les encadrent, se comportent tous plus ou moins comme des bandits, des tricheurs, à l’école de la ruse et de la dissimulation, c’est bien parce qu’ils sont victimes du système injuste qui les a placés dans ces conditions corruptrices, ce système injuste que le pouvoir soviétique dénonce en 1962 : telle est la portée du livre l’année de sa sortie. Le livre lui-même ne dit rien, ne dénonce rien, n’est ni une plainte ni un réquisitoire et se contente simplement de montrer, de façon à la fois modeste et impitoyable : il n’en est, aux yeux du pouvoir et des lecteurs soviétiques, qu’un témoignage plus honnête, plus probant.
Khrouchtchev et la critique du stalinisme en 1962
Depuis le rapport secret présenté par Khrouchtchev aux délégués du XXe congrès du PCUS en février 1956, la critique du stalinisme en URSS est devenue une critique ouverte, publique, en particulier depuis le XXIIe congrès, en octobre 1961. Il existe certes des différences idéologiques non négligeables entre cette nouvelle période et la précédente (coexistence pacifique, voie d’accès non violente au socialisme, etc.) ; mais la critique du régime précédent recouvre également un enjeu énorme : il s’agit de réhabiliter, à l’intérieur comme à l’extérieur, la société socialiste soviétique en la désolidarisant officiellement des crimes de Staline. Khrouchtchev s’y emploie, en faisant le grand écart entre d’une part la dénonciation du régime stalinien, avec l’ouverture de la liberté d’expression, politique, littéraire et artistique, et d’autre part la rétention voire la censure de tout ce qui pourrait être une mise en cause de la société socialiste elle-même, notamment les « dérives bourgeoises » dans ces mêmes domaines. L’époque où paraît en URSS le récit de Soljenitsyne en est le moment culminant, et le dernier, avant le retour à la normalisation. Novembre 1962, date de publication du roman, est le mois où une grande campagne officielle se forme contre les héritiers de Staline, où le secrétaire général des Jeunesses communistes accuse Staline devant le Comité central d’avoir voulu que le mouvement forme des « spécialistes de la dénonciation[[Le Monde, n° 5553 du 24 novembre 1962.]] ». Autour de la « journée d’Ivan Denissovitch », la Pravda publie des poèmes antistaliniens et des épigones du roman de Soljenitsyne paraissent jusque dans les autres pays d’URSS. Un large accueil est fait aux nouveaux écrivains post-staliniens tels Nekrassov et Ehrenbourg. Mais cette ouverture est fragile et provisoire, et n’en a plus que pour quelques mois. Le grand écart pratiqué par Khrouchtchev dans cette période touche toutes les formes d’expression : l’accueil à Moscou d’une exposition Fernand Léger prévue pour janvier 63 est rééquilibré la même année par la dénonciation en décembre 1962 de la peinture moderne « décadente » à l’occasion de l’Exposition d’art moderne soviétique et les insultes adressées publiquement par Khrouchtchev aux peintres abstraits. L’ouverture qui était culminante à l’automne 1962 est définitivement refermée en mars 1963, mois au cours duquel paraît en France le récit de Soljenitsyne. Au cours de ce mois-ci, Khrouchtchev réhabilite partiellement en public la mémoire de Staline. Ehrenbourg est attaqué par le monde littéraire soviétique officiel, ; les jeunes poètes soviétiques, au nombre desquels Evtouchenko, sont officiellement critiqués par l’Union des Ecrivains Soviétiques. L’écrivain Nekrassov sera exclu du PCUS l’été suivant. Surtout : le poète Alexandre Tvardovski, le secrétaire de l’Union des Ecrivains soviétiques et le très novateur directeur de la revue littéraire Novy Mir (« monde nouveau »), est démis de ses fonctions. C’était à son initiative et à la volonté de Khrouchtchev qu’était due la sortie d’Une journée d’Ivan Denissovitch.
La parution d’Une journée d’Ivan Denissovitch
C’est à cause du XXIIe congrès d’octobre 1961 et de la réhabilitation officielle des prisonniers politiques soviétiques qui s’en est suivie que l’écrivain Soljenitsyne qui jusque-là n’écrivait que pour ses tiroirs s’enhardit à proposer son récit, en novembre 61[[Soljenitsyne, Le Chêne et le veau, Seuil, 1975.]]. La version officielle[[Celle dont fera état Lili Brik dans sa lettre du 21 novembre 1962 à Elsa Triolet, voir infra dans cet article.]] construira l’image d’un écrivain qui avait rédigé ce récit « pour lui » et l’aurait « lu à un de ses amis, qui l’a apporté à Novy Mir sans le lui dire ». Le récit a alors pour titre Ch-854, matricule du prisonnier Choukov. Le texte arrive jusqu’à Tvardovski, et la revue Novy Mir propose à l’auteur quelques coupes prudentes qui sont des corrections minimes, ainsi que le titre même de la nouvelle. Par prudence, Tvardovski contourne avant publication le comité de censure et s’en remet directement au conseiller personnel de Khrouchtchev pour les questions culturelles, Vladimir Lébédiev[[Jean Cathala, préface à la réédition française de 1976 d’Une journée d’Ivan Denissovitch.]]. Lébédiev propose lui aussi quelques remaniements légers et transmet le récit à Khrouchtchev, qui l’emporte avec lui sur son lieu de vacances en Crimée, au bord de la Mer noire. Le président du Soviet suprême s’enthousiasme[[Selon une source officieuse, il aurait alors demandé à Tvardovski qu’il le rejoigne en Crimée pour élaborer avec lui dès cet été la parution du récit.]], le diffuse auprès de ses collaborateurs directs dès la rentrée du mois de septembre et leur demande leur aide dans la campagne qu’il va lancer pour promouvoir le récit. La décision de le publier est prise majoritairement après un vote du praesidium du comité central du Parti communiste d’URSS. En octobre 1962, Tvardovski est sommé par Khrouchtchev de publier Soljenitsyne de toute urgence, dans le prochain numéro de Novy Mir, en même temps que s’organise déjà la campagne de diffusion de la nouvelle. Avant même sa parution en novembre, les journaux soviétiques ont déjà reçu des extraits d’Une journée d’Ivan Denissovitch, et le jour même où paraît la revue, le récit est déjà connu, commenté comme un événement politique majeur, le numéro est déjà épuisé, les presses soviétique et étrangère s’en emparent dans l’urgence et le pouvoir soviétique s’emploie très vite à la diffusion et à la traduction du livre à l’étranger. L’événement politique met provisoirement sous le boisseau un fait, relevé par les critiques littéraires soviétiques : Une journée d’Ivan Denissovitch est un texte d’une « haute tenue littéraire[[Michel Tatu, Le Monde n° 5552 du 23 novembre 1962.]] ».
Accueil en France
L’accueil en France de l’ouvrage donnera la priorité à ce que le récit peut avoir d’importance politique, et du coup laissera, hélas, dans l’ombre l’événement littéraire qu’il représente, en dépit des efforts de quelques-uns, Elsa Triolet au premier rang.
Dans la presse française
L’annonce par la presse française de la parution soviétique est presque immédiate : le numéro 11 de Novy Mir sort dans les kiosques soviétiques le 20 novembre ; le 22 Le Figaro (dans un encart hors rubrique) et Le Monde (édition du 23, article daté du 22, dans les pages consacrées à la politique soviétique) font état de la parution de la nouvelle, en citent des extraits, fournissent des informations provenant vraisemblablement du dossier de presse officiel : l’auteur, un « inconnu âgé d’une cinquantaine d’années » enseignant « les mathématiques » (Le Monde) « semble bien être lui-même un rescapé des bagnes » (Le Figaro). Les deux quotidiens envisagent les conditions et les conséquences possibles de cette parution :
Il est clair que l’autorisation de publier un tel texte ne pouvait être donnée qu’en très haut lieu (Le Monde).
On n’exclut pas la possibilité que cette publication suscite l’apparition, dans la presse soviétique, de lettres de lecteurs exigeant que les auteurs des forfaits commis dans les camps répondent « devant le peuple » de leurs crimes (Le Figaro).
Dans les deux quotidiens, le compte rendu officiel est prolongé par une longue note en italiques rappelant une polémique française remontant à douze années auparavant, celle de l’existence des camps de concentration soviétiques à l’occasion de laquelle la revue Les Lettres françaises (citée dans la clausule de l’article du Monde) avait joué un rôle. Je reviendrai plus loin sur cette polémique. Le Figaro ajoute, pour finir :
On est curieux de savoir comment [nos communistes] présenteront aux lecteurs de L’Humanité l’article de la revue Novy Mir. Mais peut-être le passeront-ils tout simplement sous silence.
L’Humanité ne l’a certes pas passé sous silence,et mentionnera la sortie de l’ouvrage dans ses pages culturelles. Mais le journal français le plus lié à la presse soviétique est aussi celui qui aura le plus tardé à rendre compte de l’événement : le compte rendu, « de Moscou, de notre envoyé spécial permanent Max Léon », paraît le… 5 décembre, soit treize jours après celui de la presse française bourgeoise, à la fin d’un article intitulé « Du nouveau dans la vie culturelle en Union Soviétique », après un long développement sur les novations culturelles entreprises en URSS à la suite des XX et XXIIe congrès. Il est bien évidemment plus que vraisemblable que le correspondant permanent de L’Humanité à Moscou a publié son compte rendu après l’aval de la direction du PCF. Une journée d’Ivan Denissovitch est résolument présenté par L’Humanité non comme un événement pouvant poser un problème politique, mais à l’inverse comme une grande victoire supplémentaire du socialisme soviétique :
Ivan Denissovitch, c’est le peuple soviétique qui saura briser les contraintes, révéler la vérité et la justice. Avec Soljenitsine [sic], la revue « Novy Mir » et le Parti Communiste portent plus loin que jamais la lutte pour le triomphe de l’humanisme léniniste. « Une journée d’Ivan Denissovitch », qui suscite en U.R.S.S. des discussions passionnées, aura un retentissement considérable à l’étranger où il paraîtra prochainement en plusieurs langues.
C’est également la démarche que semble avoir suivie l’hebdomadaire Les Lettres françaises, qui n’annonce la sortie du roman que dans le numéro du 7 décembre, alors qu’elle avait largement les moyens de le faire dans le numéro précédent, celui du 30 novembre. Les Lettres françaises n’est plus officiellement un organe de presse du Parti Communiste Français depuis février 1953, date à laquelle la revue est devenue un hebdomadaire indépendant placé sous la direction personnelle d’Aragon. Mais elle est toujours, presque dix ans après, sous la dépendance idéologique et financière du PCF, ainsi que l’a rappelé l’affaire du portrait de Staline par Picasso, survenue un mois après l’indépendance officielle du journal. Jusqu’en 1962, en-dehors de cet accident, la seule prise de distance de la revue avec le Parti sera le silence prudent observé par l’hebdomadaire lors de l’invasion de la Hongrie par l’URSS en 1956 : la revue se « contenta » alors de faire paraître un communiqué signalant que l’événement ne serait pas commenté dans le journal en raison d’un manque de position unanime de ses journalistes. Cette distance est certes inédite jusque-là dans la presse communiste, ainsi que l’a récemment rappelé Pierre Daix[[Les Lettres françaises. Jalons pour l’histoire d’un journal, 1941-1972, Tallandier, 2004, p. 216.]] ; toujours est-il que le communiqué n’en est pas moins un refus de se désolidariser de la position des communistes français, qui ne condamnent pas l’entrée des chars dans Budapest.
Aragon et Triolet en novembre 62
Si la revue Les Lettres françaises semble attendre, sur la question de l’annonce de la parution du récit russe, sinon un feu vert du moins une position officielle du PCF ou tout au moins un échange entre son directeur, membre du Comité central et le noyau dirigeant du Parti, il n’en va pas de même pour Aragon et Triolet qui s’attaquent très vite, à titre personnel, à cette question. L’article de L’Humanité du 5 décembre annonçait, depuis Moscou, la parution imminente du récit en français « aux Editions Julliard au début de janvier prochain dans une traduction de Jean Cathala ». Celui des Lettres françaises du 7 décembre annonce, lui, cette parution « au début de l’année prochaine aux éditions René Julliard, dans une traduction de Maurice Descaillaux [sic] et avec une préface de Pierre Daix ». En fait , le couple a réagi avant même l’annonce officielle de la parution russe du récit et, on le verra, dans l’ombre. Il est facile de reconstruire dans les grandes lignes les étapes de cette réaction, en confrontant la correspondance échangée entre Lili Brik[[Sœur d’Elsa Triolet, ancienne compagne du poète Vladimir Maïakovski ; elle a vécu à Moscou jusqu’à sa mort.]] et Elsa Triolet[[Lili Brik-Elsa Triolet, Correspondance 1921-1970, sous la direction de Léon Robel, Gallimard, 2000. Les extraits cités proviennent des pages 1009 à 1019.]], les témoignages écrits de Pierre Daix et ceux, très récents, de Maurice Décaillot et de Léon Robel[[Le témoignage de Maurice Décaillot est inédit à l’heure actuelle ; celui de Léon Robel provient d’un entretien daté du 29 janvier 2001, paru dans Recherches croisées Aragon Elsa Triolet n° 9, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, p. 182 à 202.]], les traducteurs successifs de la version définitive française.
De l’annonce à l’intervention dans Les Lettres françaises
Novembre 1962 est un mois au cours duquel les deux sœurs correspondent régulièrement : il nous en reste, sans compter les coups de fil et les télégrammes, cinq lettres de Lili Brik, trois lettres d’Elsa Triolet, qui se croisent sur des sujets divers, dont le roman en cours d’Elsa Triolet, L’Âme, troisième volet de sa trilogie « L’Âge de nylon », la rédaction par Aragon de l’Histoire de l’URSS, et le roman de Soljenitsyne. Lili avait déjà signalé (31 octobre) à sa sœur la parution à venir d’un numéro exceptionnel de Novy Mir :
Il y aura dans le n° 11 de Novy Mir une nouvelle remarquable, ne la manquez pas !
Avant même la sortie de Novy Mir, un exemplaire de ce numéro 11 est déjà envoyé aux Aragon, le 17 novembre. C’est Simonov, écrivain communiste notoire et influent, ancien rédacteur en chef de la revue Litteratournaïa gazeta, qui en enlève un exemplaire à la rédaction du journal et qui le fait envoyer par sa femme à Saint-Arnoult. Au moment où Lili découvre la nouvelle, le 20 novembre, les Aragon sont censés déjà la connaître :
Que pensez-vous de la nouvelle de Soljenitsyne ? Elle m’a bouleversée. Hier, j’ai pleuré la moitié de la journée [21 novembre].
A cette date, les Aragon n’ont peut-être pas encore fini de la lire mais réagissent tout de suite, et essaient avant tout de s’imposer comme relais entre la nouvelle et sa traduction en France. Le 23, Elsa écrit à sa sœur :
Julliard a été plus rapide que nous pour s’arranger avec Novy Mir ! Mais Aragocha a eu l’idée de faire faire une préface par Pierre Daix… Tout cela sans avoir vu le texte, puisque personne n’a lu le récit de Soljenitsyne. Mais Julliard a des correspondants rapides ; et comme nous, nous ne savions rien de l’œuvre, lorsque Julliard s’est adressé à l’Agence[[Il s’agit très certainement de l’Agence Littéraire et Artistique Parisienne, proche du Parti Communiste Français, alors dirigée par Georges Soria., qui fera par la suite appel à Maurice Décaillot. Sa fonction était « de promouvoir en France les traductions de livres soviétiques, mais aussi d’organiser les tournées de troupes telles que les Chœurs de l’Armée Rouge ou les Ballets du Bolchoï » (Maurice Décaillot).]], il a obtenu son accord… C’est trop bête.
Le 26, Lili pose à sa sœur la question de la traduction du récit, comme si elle s’attendait déjà au type d’intervention que s’apprêtent à faire les écrivains français :
Que penses-tu de la nouvelle de Soljenitsyne ? La faites-vous traduire ? Par qui ? La tâche est rude.
Elsa Triolet répond le 28 à sa sœur, en lui donnant la température de l’effet produit par l’ouvrage sur elle et sur Aragon :
J’ai le cœur en capilotade, comme après un accident de voiture ce ne sont qu’ecchymoses et plaies ouvertes […]. Nous sommes coupables devant Ivan Denissovitch de nous être montrés trop confiants ; ce n’est pas nous les faux-monnayeurs, mais nous avons tout de même mis les fausses pièces en circulation, par ignorance.
– et fait le point sur leur action en France :
Je vous ai déjà raconté comment le Soljenitsyne nous a filé entre les doigts. Le livre paraîtra chez Julliard […], mais Aragon a pu obtenir que la préface soit faite par Pierre Daix – pour éviter un avant-propos qui mettrait l’auteur (et nous-mêmes) dans une situation très délicate. Je voulais me charger de la traduction, mais je crois que c’est au-dessus de mes forces. Au moins, Daix pourra aider le traducteur, car il faut trouver des équivalents (que je ne connais pas) à la langue des camps.
Cet échange appelle quelques commentaires. Tout d’abord sur le regret de la rapidité de Julliard à avoir obtenu les droits pour la traduction. Il n’était pas incongru que Julliard intervienne pour traduire Soljenitsyne, dans la mesure où il était déjà l’éditeur des traductions de Simonov ; on peut toutefois envisager qu’il était probable que les Aragon auraient préféré faire paraître la traduction chez Gallimard, leur éditeur, chez qui Aragon interviendra personnellement en 1968 pour qu’y paraisse la traduction française de La Plaisanterie de Kundera. Quant au choix par Julliard de Jean Cathala, il était naturel dans la mesure où c’est Cathala lui-même qui avait informé Julliard, au début du mois de novembre, de la sortie imminente du récit et de son contenu, deux semaines avant qu’il paraisse dans Novy Mir. Cathala est alors le correspondant, membre du PCF, de France-Nouvelle à Moscou, ayant lui-même une « expérience personnelle des camps soviétiques[[« Note de l’éditeur » Julliard à la nouvelle traduction française de 1976. On ne connaîtra pas les conditions de cette « expérience personnelle », Jean Cathala étant mort depuis longtemps.]] ». Les précautions que prennent pourtant dans l’urgence les Aragon sur la diffusion en France de l’ouvrage ont des motivations suffisamment partagées par Lili Brik pour qu’elles restent implicites dans cette correspondance. Elles sont d’ordre littéraire et politique à la fois.
Littéraire : il semble évident pour Lili Brik que les Aragon ont à se charger de la traduction. Elsa Triolet s’en serait chargée si elle n’avait pas été à ce moment-là plongée dans son travail sur son roman L’Âme (outre ses chroniques dans Les Lettres françaises et ses responsabilités au CNE). On connaîtra d’elle, en fait de traduction, les extraits qu’elle citera en français dans son article du 7 décembre dans Les Lettres françaises, sur lequel je reviendrai.
Politique : en URSS, d’abord. On prendra au sérieux ce qu’Elsa Triolet écrit très rapidement : leur intervention pour intercepter la parution de l’œuvre, y intervenir, et à défaut proposer une préface de Pierre Daix consiste à « éviter un avant-propos qui mettrait l’auteur et nous-mêmes dans une situation très délicate ».
« Nous-mêmes » :
Il s’agit au moins des auteurs de cette correspondance, et au-delà, des communistes qui se proposent de diffuser ce texte en France, d’en prendre la défense, de s’en faire les champions, et qui savent déjà qu’ils ont à se défendre, aussi bien contre leur propre camp que contre celui de leurs adversaires, de toute accusation de « dérive droitière ». Mais il s’agit aussi de l’équipe des Lettres françaises, et des trois acteurs de premier plan que sont Aragon, Triolet et Daix : treize ans après les procès Khravtchenko (j’y reviendrai), il aurait été gênant que ces défenseurs de Soljenitsyne ne montent pas officiellement au créneau et se voient accuser par la droite (ce dont menace déjà Le Figaro) de rester silencieux à l’occasion de la sortie d’un tel témoignage.
« L’auteur » :
Elsa Triolet prévoit les conséquences politiques éventuelles de cette diffusion, y compris du point de vue du drame humain que représenterait pour l’auteur une publicité qui se retournerait contre l’idéal socialiste et le pouvoir soviétique (punition, répression, etc.).
Le choix de Pierre Daix
Le choix de Pierre Daix comme préfacier du récit de Soljenitsyne correspond à un choix stratégique, celui qui fait de Daix le préfacier nécessaire à un tel roman, dans le contexte où Elsa Triolet et Aragon voulaient le faire connaître : donner un coup de pouce au « dégel » organisé par Khrouchtchev, dans un pays, la France, où la période stalinienne était bien moins critiquée à l’intérieur du PCF qu’elle l’était alors en Union soviétique, et où un tel ouvrage était pain bénit pour les adversaires des communistes.
Daix est le rédacteur en chef des Lettres françaises, la plus grande revue littéraire et artistique française d’alors, celle dont le sérieux et l’honnêteté intellectuelle des auteurs, également membres du PCF, étaient à la fois un gage de clarté du combat intellectuel des communistes adressé en direction des non communistes, et pour le PCF, un gage de fidélité aux idées communistes et au camp des pays socialistes.
Daix est également le vrai créateur français du premier récit du genre auquel se rattache Ivan Denissovitch : il est l’auteur de La Dernière Forteresse (1950), fiction sur la vie des camps écrite par un véritable témoin (Daix avait été interné à Mauthausen), une fiction dont bien des détails de la vie quotidienne dans les camps sont communs à ceux décrits douze ans après par Soljenitsyne. Et bien des propos d’Aragon dans sa préface au livre, « La Dernière Forteresse est un livre pour vous », auraient pu s’appliquer à Ivan Denissovitch.
Mais Pierre Daix est surtout l’ancien déporté qui s’était illustré, à la fois en tant que membre du PCF et rédacteur en chef des Lettres françaises, dans les deux procès intentés contre la revue à propos de l’existence des camps soviétiques, en 1949. En 1946, un transfuge de l’URSS, haut fonctionnaire travaillant aux USA et ayant rejoint ce pays en 1944, Viktor Kravtchenko, avait fait paraître un témoignage, J’ai choisi la liberté, faisant état de camps de concentration soviétiques. La traduction française du livre sort en 1947. Les Lettres françaises accuse alors publiquement Khravtchenko de mensonge (l’accusant du même coup d’être un agent de la CIA) et perd deux ans plus tard le procès en diffamation intenté par le transfuge soviétique. A la fin 1949, l’ancien déporté David Rousset relance le débat sur la question des camps de concentration en URSS. Rousset, alors directement attaqué par Pierre Daix à la fois dans Les Lettres françaises et dans Ce soir, lui répond par un long procès en diffamation qui, comme le précédent, donne aux deux parties l’occasion d’un long défilé de témoins appartenant à l’un et l’autre bord, se traitant mutuellement de menteurs et de manipulateurs. La préface de Pierre Daix à Soljenitsyne est pour Aragon et Elsa Triolet l’occasion à la fois de placer de nouveau Pierre Daix en démocrate spécialiste de la question de l’internement concentrationnaire ainsi qu’en défenseur de la vérité et de reconnaître implicitement les erreurs du camp communiste et des Lettres françaises lors des deux procès Khravtchenko et Rousset. Implicitement : celui qui écrit dans cette préface « il n’y a pas pour moi de différence entre le camp d’Ivan Denissovitch et un camp nazi moyen » ne citera jamais au cours de cette campagne pour la diffusion du récit ni les noms de Khravtchenko et de Rousset, ni les procès de 1949, non plus que Les Lettres françaises. La seule référence à l’attitude des communistes français d’alors, devenue rétrospectivement insoutenable depuis le rapport Khrouchtchev de 1956, sera la suivante :
[Le récit] nous arrive dans une France […] où […] le débat sur l’existence des camps de concentration en Union soviétique a pris une particulière acuité.
Je ne peux, bien sûr, parler qu’au nom de ceux qui refusèrent de croire qu’au pays de Stalingrad, au pays qui versa le sang de tant de millions des siens pour anéantir l’hitlérisme, il pouvait exister des camps de concentration. Sans doute étions-nous victimes des mensonges politiques qu’impliqua le stalinisme, mais, aussi, nous refusions de voir certaines choses en face, et avec la même sorte d’aveuglement que nous devions retrouver, par la suite, chez ceux de nos camarades de résistance qui refusèrent de croire à la torture en Algérie […]. Nous avons payé très cher, les uns et les autres, pour savoir que rien n’est jamais acquis à l’homme une fois pour toutes, qu’il n’y a pas de conquête, pas d’expérience qui ne puissent lui être reprises, être retournées contre lui.
Le lancement du livre
De novembre 1962 à la parution le 4 mars 1963 chez Julliard de la version française du récit, les efforts de Triolet, Aragon et Les Lettres françaises pour la diffusion de l’œuvre se concentrent sur deux points : la traduction et la publicité, soit encore une fois : l’événement littéraire et l’événement politique.
La question de la traduction
La traduction d’Une journée d’Ivan Denissovitch en France est déjà en soi un roman, dont les péripéties laisseront quelques blessures bien des années après la parution. Initialement, depuis l’échange de lettres entre Elsa Triolet et sa sœur, il est question de donner à faire le travail à un traducteur choisi par les Aragon, assisté de Pierre Daix pour la question du choix du lexique français équivalant à l’argot des camps. Le nouveau traducteur, celui à qui Julliard attribuera officiellement la traduction, Maurice Décaillot, est un des traducteurs des Editions de Moscou, devenu par la suite. un économiste du PCF. Pierre Daix revendiquera longtemps sa part dans la traduction de l’ouvrage, et même un peu plus que sa part, se présentant en 1973[[Ce que je sais de Soljenitsyne, Seuil, 1973, p. 11-15.]] comme le principal artisan de cette traduction, puis en 1976[[J’ai cru au matin, Robert Laffont, 1976, p. 387.]] comme le seul traducteur de l’ouvrage. En fait, plusieurs traducteurs auront participé successivement à cette parution, placée par Elsa Triolet sous les impératifs contradictoires à la fois de la qualité littéraire et de l’urgence. Le refus par Elsa de Cathala est, si l’on en croit Daix, une exigence d’ordre littéraire. Pour Elsa, la valeur du texte de Soljenitsyne dépassait largement celle du simple témoignage, fût-il percutant. C’est immédiatement après s’être fait communiquer par Julliard le texte de la traduction appelée alors à paraître, celle de Cathala, qu’elle convoque Pierre Daix chez elle, « début décembre 1962 », selon Daix[[Ce que je sais de Soljenitsyne, p. 11.]]. Daix rapporte les premiers commentaires qu’Elsa lui fait sur le texte :
ET : C’est Proust et Flaubert. […] C’est la grande prose russe […] Un véritable classique. C’est extraordinaire. Ajoutez-y Céline pour le langage populaire. C’est d’une richesse… C’est proprement intraduisible.
PD : Mais tout le monde parle d’un témoignage, presque d’un reportage…
ET : Parce que ce sont des gens incultes, qui ne l’ont peut-être même pas lu, qui sont chargés de le faire publier. Ils en parlent en récitant leur leçon. Ils tremblent qu’on n’aille pas assez vite. Ils sont prêts à jurer que n’importe quel étudiant en russe peut en venir à bout. Nous n’avons pas le droit d’accepter cet assassinat littéraire. Alors, voilà à quoi j’ai pensé…
Ce à quoi Elsa a pensé est bien entendu de convaincre Julliard de lui faire confiance sur le choix d’un autre traducteur. Même si Daix s’attribue la première étape du travail, notamment celle d’avoir choisi de traduire le prétérit russe par le présent de narration[[Ce que je sais de Soljenitsyne, p. 14. Ce que ne fait pas le texte de Cathala, si l’on en juge d’après la version donnée à Julliard en 1975.]], le seul traducteur reconnu par Julliard sera Décaillot. Daix explique ne pas avoir voulu être officiellement responsable de la traduction à cause du retard pris dans ce travail de traduction, bien plus difficile que prévu, et par le désir que l’on n’attribue pas ce retard à une mauvaise volonté de la part de l’homme qui reniait il y a peu l’existence des camps en Union soviétique :
[…] le retard que nous avions pris frisait le scandale international. Je vis le moment où on le mettrait sur le compte de mon attitude passée… Ce fut d’ailleurs ce qui me poussa à ne pas être cosignataire de la traduction, afin d’éviter toute polémique sur la version française.[[Ce que je sais de Soljenitsyne, p. 15.]]
On notera que si Daix affirme avoir « pass[é] plus de deux mois à travailler douze ou quatorze heures par jour » sur cette traduction, en aucun cas son travail de traducteur ne pouvait lui permettre d’être « cosignataire de la traduction », les traducteurs de ce récit ayant l’un comme l’autre ignoré l’éventualité d’un tel travail. Car cette version française a bien connu deux traductions. Lorsque Maurice Décaillot, traducteur officiel du récit, remet – vraisemblablement au mois de janvier 1963 – son travail achevé, il ignore non seulement l’éventualité d’une intervention de Pierre Daix, mais également le rôle joué par Aragon et Elsa Triolet auprès des éditions Julliard : son travail lui est commandé par l’intermédiaire de l’Agence Littéraire et Artistique Parisienne (ALAP)[[Voir note 12 de cet article.]]. Il est vrai que le numéro du 7 décembre des Lettres françaises annonçait cette parution pour le « début de l’année » suivante, « dans une traduction de Maurice Descaillaux [sic] et avec une préface de Pierre Daix ».
`Toujours est-il que le texte définitif remis à Julliard à la fin février n’est pas plus celui de Cathala que celui de Daix ou de Décaillot. Un nouveau travail de traduction a été mis en chantier – vraisemblablement entre janvier et la fin février 1963 – par l’équipe formée par Andrée et Léon Robel, et pour les questions de lexique spécialisé, l’argot des camps, par un soviétique travaillant au siège de l’UNESCO à Paris, du nom d’Annissenko[[Témoignage de Léon Robel.]]. Les éditions successives de la traduction française se ressentent de cette urgence. La première édition, l’originale, porte le nom de Décaillot seul, alors que le même texte portera dans les réimpressions à venir celui de Décaillot associé à Robel. Pourquoi une seconde équipe ? Vraisemblablement parce que le travail, pourtant terminé par Décaillot, n’avait pas été jugé littérairement satisfaisant aux yeux d’Elsa Triolet : sur ce point, le témoignage de Robel recoupe celui de Décaillot qui reconnaît que le style de cette nouvelle traduction était assez différent du sien. L’urgence est alors telle que Robel travaillera sans contrat avec Julliard et ne touchera aucun droit sur les rééditions. Selon lui, des coursiers se présentaient régulièrement chez lui pour lui arracher les feuillets au fur et à mesure qu’il les traduisait. Combien de temps dure le travail de cette seconde équipe[[Léon Robel dit ne pas se souvenir des dates.]] ? Moins de six semaines, certainement. La succession des traducteurs mentionnés par les différentes éditions du roman témoigne en tout cas du désordre causé par l’urgence de ces quelque trois mois : première édition Julliard (28 février 1963) et réédition 1968 : « Récit traduit par M. Décaillot » ; édition 10/18 (Christian Bourgois), 1970 : traduction de Maurice Décaillot, et Léon et Andrée Robel ; édition Rombaldi sans mention de nom du traducteur[[Il semble qu’il s’agit du même texte français, mais j’ai pu me tromper…]] ; édition Club pour vous Hachette, 1974 : traduction de Maurice Décaillot, et Léon et Andrée Robel.
On notera quoi qu’il en soit que si Léon Robel appartenait à l’équipe des russisants groupés autour des Aragon, Maurice Décaillot ne les connaissait pas et n’a jamais été mis en contact avec eux. L’hypothèse selon laquelle l’ALAP ou les éditions Julliard auraient choisi Décaillot sans le consentement d’Aragon semble peu probable : à quoi bon récuser un traducteur, Cathala, ayant déjà fait le travail, pour au bout du compte accepter une traduction sans aucune garantie ? On notera en tout cas la volonté d’Aragon de rester officiellement dans l’ombre de ce travail de traduction comme de la campagne pour l’accueil du roman en France. J’y reviendrai.
La campagne des Lettres françaises
Le coup d’envoi de cette campagne est lancé, je l’ai dit, quelques semaines après la parution du roman en Union soviétique, mais d’une façon jusque-là inédite dans la presse communiste française, même officieuse. C’est Elsa Triolet qui se charge en personne d’ouvrir le feu : son activité aux Lettres françaises se limitait jusque-là à des chroniques théâtrales et aux travaux du Comité National des Ecrivains créé pendant la Résistance, dont elle est alors la secrétaire générale depuis 1948.
Le numéro 955 du 7 décembre 1962 des Lettres françaises est tout entier placé sous le signe de la littérature soviétique (le numéro est coiffé d’un sur-titre : « Quoi de nouveau dans la littérature soviétique ? »), et en particulier l’article d’Elsa Triolet qui s’étend sur six colonnes en une, et qui se prolonge en quatrième page. L’article se place dans un combat principalement politique, dont la couleur est annoncée dès le titre : « Pour l’amour de l’avenir ». On imagine mal à présent les risques politiques pris par cet article, sur lesquels je ne reviens pas : Daix à longuement commenté cet article dans un ouvrage récent[[Daix, Les Lettres françaises, jalons pour l’histoire d’un journal, 1941-1972, p. 220-223.]]. On remarquera en tout cas la lucidité avec laquelle Triolet prévoit les suites immédiates de l’événement, en URSS, comme en France :
La publication d’Une journée d’Ivan Denissovitch provoquera certainement en URSS un déluge d’œuvres sur des sujets analogues. Il y a déjà toutes celles que les écrivains gardaient dans leurs tiroirs sans songer à leur publication. Puis il y aura celles écrites en toute hâte sur les traces du succès. Alors l’envahissement deviendra rapidement intolérable, et l’irritation fera que les œuvres respectables seront piétinées avec les autres. C’est ce qui est arrivé chez nous avec les écrits sur la résistance, les camps, la guerre d’Algérie… Fallait-il pour cela ne pas les écrire ? (p. 4)
Il existe […] divers points de vue quant à l’opportunité de revenir sur le grand désastre que l’Union soviétique a vécu pendant bien un quart de siècle. Ne parlons pas du point de vue de ces individus dangereux[[Elsa Triolet sait que ces « individus dangereux » sont encore au pouvoir en URSS et le poids qu’ils ont dans l’appareil du Parti Communiste d’Union Soviétique. Ce sont précisément ceux qui évinceront Khrouchtchev en octobre 1964.]] pour qui ce malheur a été un bonheur […].
D’autres, et surtout parmi les jeunes, ne veulent plus entendre parler de « politique » […].
D’autres encore, probablement les plus nombreux, considèreront que plus vite ces temps maudits seront oubliés, mieux il vaudra ; le souvenir de cette aberration collective leur est intolérable […] ; ils préfèreraient que l’on continuât à se taire, que deux cents millions d’hommes et de femmes gardent leur secret, comme, d’un accord tacite, ils l’avaient fait toutes ces interminables années. […] ils disent, ouvrir les dossiers, avouer, fait le jeu de l’ennemi et risque de démobiliser les amis ; […] ils disent, à force de penser aux crimes passés, on oublie ce qui a été en même temps construit, le chemin parcouru… (p. 1)
Cette troisième catégorie de récepteurs à cette publication, sur laquelle Elsa Triolet s’attarde amicalement et en usant d’euphémismes, est bien entendu celle d’une large part des militants et de l’appareil du PCF, ce que la suite démontrera.
La revue fait une seconde intervention pendant que s’écrit la traduction, dans le numéro 964 du 7 février 1963, un numéro qui porte en sur-titre : « Un étonnant document à propos de Soljenitsyne[[NB : Les graphies, variables à l’époque, du nom de l’écrivain ont toutes été harmonisées ici, dans la norme précisée plus tard par les éditeurs et à leur suite les journalistes puis les dictionnaires.]] ». Ce numéro se place d’une part « sous la protection », dirons-nous, de la presse et des autorités soviétiques, en reproduisant la lettre d’un « ancien voleur », G. Minaev, contribution au dossier sur l’internement dans les camps, parue le 22 janvier dans la Litteratournaïa Gazeta, et enfonce le clou avec un compte rendu d’une réunion-débat qu’anima Elsa Triolet avec des étudiants, communistes et non inscrits, et quelques intellectuels, suivi d’une lettre signée par les participants à ce débat et adressée à Alexandre Soljenitsyne[[La lettre finit par : « nous déclarons vouloir nous inspirer dans notre conduite de l’exemple de courage et de lucidité que vous nous avez donné ». Au nombre des signataires : « Guillevic (poète) », « Macha Méril (comédienne) ».]]. Le tout est couronné d’un article d’Elsa Triolet en première page, placé à côté du témoignage de Minaev et de l’annonce du compte rendu en page 9, un article qui ne porte que sur la création par le TNP de La Vie de Galilée de Brecht, mais dont le titre, citation provenant de la pièce, prend dans ce contexte une résonance particulière : « Malheureux le pays qui a besoin de héros », citation qu’Elsa Triolet reproduit plusieurs fois dans le corps de l’article, et prolonge de la façon suivante :
Malheureux le pays qui a besoin de héros. Jours noirs que ceux où les héros sont nécessaires à un pays pour maintenir sa vérité !
[…] Il avait trop d’imagination, Galilée. Brecht semble insinuer que s’il avait tenu bon, on ne l’aurait pas torturé, qu’on l’avait eu par la peur. Aujourd’hui, on est tenté de croire qu’il aurait bel et bien été torturé, et que sa peur était fondée. (p. 8).
La parution de la traduction et les prises de position en France
La parution de la version française ne donnera pas lieu aux polémiques de l’année 1949 ni à celles qui suivront lorsque moins de dix ans plus tard la figure de Soljenitsyne sera devenue celle d’un dissident notoire autour de laquelle se cristalliseront les prises de position sur le régime concentrationnaire et policier de l’URSS et des pays de l’Est. Soljenitsyne n’est d’abord en rien un dissident en 1962-63, il est tout simplement depuis le début de cette aventure un écrivain humble, déjà heureux de n’avoir pas été jeté, après avoir fait lire son récit, entre les mains du KGB, ainsi qu’il le dira lui-même plus tard[[Le Chêne et le veau, op.cit., p. 30.]]. La raison en sera la relative marginalité des Lettres françaises entre d’une part les positions de la droite française, en l’occurrence celle qui s’exprime dans Le Figaro, et d’autre part ce qu’il faut bien appeler un silence au moins timoré de la part du principal concerné par cette traduction, le PCF.
Les Lettres françaises en mars 1963
Le journal revient de façon récurrente sur le récit de Soljenitsyne au cours de ce mois de mars. Le numéro 967 du 28 février reproduit dans son intégralité la préface de Pierre Daix datée du 8 février 1963, et annonce la sortie du roman chez Julliard le 4 mars. Le numéro 970 du 21 mars (en sur-titre, notamment : « Quatre jours avec Soljenitsyne ») produit un reportage du correspondant des Lettres françaises, Victor Boukhanov, écrit à la suite de son séjour chez l’écrivain, devenu une vedette en URSS. Un encart publicitaire de Julliard présente l’œuvre sous le parrainage consensuel d’Elsa Triolet (« […] L’importance de ce récit est double : politique et littéraire […] ») et de Claude Roy (« […] un chef-d’œuvre de la littérature, un livre à placer sur le même rayon que les Souvenirs de la maison des morts de Dostoïevsky[[Sic pour la graphie de Dostoïevski, qui était alors la graphie courante. Claude Roy avait rompu avec le PCF en 1957, à la suite de l’insurrection hongroise et de sa répression par l’Union soviétique.]] ». Le compte rendu de lecture est reporté, sans doute intentionnellement, sur la semaine suivante (rubrique « Le feuilleton littéraire », article rédigé par Anne Villelaur).
Dans Le Monde et dans Le Figaro
C’est la valeur politique du récit que Le Monde retient dans ses pages. La première mention – qui sera la seule dans les semaines de la sortie du livre chez Julliard – de la traduction française est l’article tardif de Bernard Fréron, qui ne fait aucun commentaire d’ordre littéraire, glissé le 30 mars (n° 5561) en première page entre deux manchettes consacrées à l’Union soviétique. Le premier encart publicitaire des éditions Julliard dans Le Monde à faire mention d’Ivan Denissovitch n’apparaîtra que le 8 mai 1963, date à laquelle les débats concernant l’œuvre sont déjà pratiquement clos.
L’événement a autrement plus d’importance aux yeux du Figaro qui se place en véritable contradicteur des Lettres françaises, tout en partageant l’avis d’Aragon sur la double importance de l’événement. Si la publication soviétique avait été annoncée dans les pages d’actualité générale le 23 novembre (n° 5669), c’est à travers les pages de la revue hebdomadaire Le Figaro littéraire que le journal va lancer immédiatement sa propre campagne, seul écho de celle des Lettres françaises au cours de l’automne-hiver 1962-1963. Le numéro 869 du 15 décembre est l’occasion pour la revue de poser, notamment à propos de la sortie de ce récit, la question de l’existence d’une « révolution littéraire en URSS », et les révélations lancées par Novy Mir lui donnent l’occasion de revenir sur les procès de 1949 et de faire s’exprimer à nouveau David Rousset qui, dans l’édition du 5 janvier, lance un « appel aux rescapés des camps de concentration staliniens ». Pierre Daix y donne son droit de réponse la semaine suivante, sous la forme d’une lettre écrite au rédacteur en chef de la revue, Michel Droit[[A ma connaissance, Daix ne mentionne nulle part dans ses différents témoignages cette lettre. Les Lettres françaises ne signaleront ni la campagne du Figaro littéraire, ni l’intervention de Daix, ni la réplique de Rousset.]], en réponse à David Rousset, dans laquelle il explique que c’est bien l’URSS elle-même qui a permis au monde entier d’avoir les preuves de l’existence des camps staliniens. A droite de cette réponse figure déjà celle de David Rousset au rédacteur des Lettres françaises, une réponse dont l’argument principal, rappelé en chapeau à l’article, est : « Vous ne lisez pas les auteurs que vous préfacez ». La revue publie également pendant deux semaines des témoignages de soutien à l’initiative de Rousset, au nombre desquels celui de Germaine Tillion, vice-présidente de l’Association des femmes déportées de la Résistance française, et femme de Charles Tillion, cadre communiste déchu par son Parti en 1952, ainsi que celui d’un ancien accusateur de Rousset au procès de 1949.
En avril, Le Figaro littéraire accueillera la traduction française de Soljenitsyne[[N° 885 du 6 avril 1963, p. 5. Les pages 1 et 7 sont consacrées à un long article de David Rousset sur les menaces qui pèsent alors sur le sort du poète soviétique Evtouchenko.]], en saluant un livre « d’une immense pudeur », et en présentant la préface de Daix comme une « amende honorable » du rédacteur en chef des Lettres françaises.
La presse communiste
Entre la parution soviétique et la parution française du livre, la presse communiste a observé, il est vrai, un grand silence, remarquable si l’on tient compte du bruit que faisaient alors tant Les Lettres françaises que Le Figaro littéraire, et aucune mention n’est faite dans L’Humanité du débat mené avec les étudiants à l’initiative d’Elsa Triolet. La revue étudiante communiste Clarté annonce dans le sommaire de son numéro de mars (n° 49) un « Ivan Denissovitch et nous » à la page 18. Le texte annoncé laisse la place (p. 18-19) au discours adressé par Waldeck Rochet au VIe congrès de l’Union des Etudiants Communistes. Il est vrai que ce discours et ce congrès revêtent alors une importance politique particulière ; vrai également qu’il était certainement inadéquat, dans le contexte tendu qui était alors celui des relations entre le PCF et sa jeunesse étudiante[[Voir sur cette question, dans cet ouvrage, la communication de Suzanne Ravis, « “Capitulez, cher camarade”, lectures de la voix politique d’Aragon en 1963 ».]], que Clarté prenne des initiatives sur une pareille question là où la presse communiste était restée silencieuse.
Les éditions du 7 et d u 28 février de L’Humanité se contentent de signaler, dans des encarts non signés, les numéros des Lettres françaises qui sortent en kiosque le même jour, et respectivement« l’étonnant document » qu’est la lettre du voleur Minaev et la préface de Daix à la traduction française de Soljenitsyne.
La seule prise de parole officielle de L’Humanité sur le récit sera le compte rendu littéraire du romancier André Stil à la page 2 de l’édition du 21 mars (n° 5774)[[Rubrique « Les livres et la vie », sous le titre « La “Journée” d’A. Soljenitsyne ».]], exprimant des sentiments de même nature que ceux d’Elsa Triolet, et soucieux également de rassurer les militants :
Ce livre va vous glacer, vous tordre le cœur. Pour beaucoup d’entre vous, jamais un livre ne vous aura à ce point fait souffrir […] Soljenitsyne n’eût-il aucun talent […].
Mais en même temps, vous n’empêcherez pas de naître en vous, mêlée à la douleur, une fierté, plus grande elle aussi que le livre : ce livre est nôtre ; surtout, il est la preuve de notre combat pour la liquidation totale du culte de la personnalité et de ses conséquences.
Ce mois de mars est celui de la vente du livre marxiste et de la publicité faite des nouvelles parutions vedettes dans les feuilles de L’Humanité, qui ne dit rien de l’éventuelle présence du livre à cette Vente. Le seul journal communiste qui reviendra sur le livre sera Clarté qui rattrapera son mutisme dans les numéros suivants : en avril 63 un entretien de Bernard Kouchner et Georges Voguet avec Elsa Triolet à propos de la sortie de L’Âme, amènera une partie de la discussion sur le roman de Soljenitsyne ; au mois de mai suivant, un éditorial de Pierre Kahn, « Les étudiants communistes et la démocratie », renvoie à une note de bas de page, à propos de « la parution dans Novy Mir du récit d’un détenu dans un camp soviétique » :
Je vous conseille à ce sujet la lecture de l’article d’Elsa Triolet dans Les Lettres françaises du 6 décembre 1962.
Le moins qu’on puisse dire est que l’accueil de Soljenitsyne en France a été contradictoire auprès des militants du PCF, et peu encouragé, voire dénigré par ses cadres, du moins officieusement. L’amertume dont fait état Pierre Daix dans son autobiographie de 1976 est à la mesure de cet accueil :
L’accueil fait en France à Une journée d’Ivan Denissovitch fut provincial et dérisoire.[…] Le Parti confia le compte rendu à Stil. Certes, il tenait le feuilleton dans L’Humanité et cela assurait une certaine promotion au livre, mais on pouvait compter sur lui pour récupérer le contenu au profit du confort politique. Ma préface ne fut signalée que dans la note indiquant l’éditeur. En somme, les militants recevaient l’autorisation de lire ce récit, mais on les laissait se débrouiller avec.
Léon Mauvais, alors dirigeant de la CGT, donna libre cours à son indignation. Il clama à qui voulait l’entendre que la classe ouvrière avait « autant besoin de ça que d’une bonne chaude-pisse… » Dans « ça », il y avait évidemment ma préface. Thorez s’arrangea pour me faire savoir privément son soutien. Et il me témoigna des attentions publiques à la Vente du Livre marxiste de 1963 où j’ai signé, sur son ordre, Une journée d’Ivan Denissovitch avec mes propres livres.[[Léon Robel reste prudent quant à l’appréciation par Pierre Daix de l’accueil fait à Soljenitsyne : « Bien sûr, ces textes-là [les écrits de Soljenitsyne […] ont fait l’objet de différends dans certains milieux communistes. Mais je n’ai pas entendu parler de tentatives d’empêcher la diffusion. Mais j’ai pu ne pas le savoir. » (Le Rêve de Grenade, Actes du colloque de Grenade sur Le Fou d’Elsa, op. cit., page 325). En 2004, Daix présentera une autre version des « attentions » témoignées par Thorez lors de la Vente : « J’étais le seul à savoir que ces félicitations n’allaient pas à ma préface, mais à une anthologie du Moyen Âge que je vendais également. C’était du Thorez tout craché. Deux fers au feu, le lancement de signaux ambivalents à la façon de son maître Staline, et la possibilité de la défausse comme expédient au cas où les choses tourneraient autrement que prévu. » (Daix 2004, p. 227).]]
Aragon
Les derniers feux de ce qui aurait pu être un débat dans le monde politique sont éteints depuis des mois lorsque le nom de Soljenitsyne revient, en novembre 1963, sous la plume d’Aragon, comme en un rappel insistant au milieu d’un silence rapidement installé. Ce rappel se fait sous la forme d’une épigraphe, un des trois textes collés en exergue de la section « La grotte » du Fou d’Elsa. L’épigraphe est extraite de la préface de Daix :
L’enfer d’Ivan Denissovitch, c’est que le futur n’existe plus
Il est vrai que le texte de l’épigraphe recoupe certains propos du Fou d’Elsa, en particulier ceux de la partie qu’elle introduit. Mais au-delà de l’effet intertextuel propre à ce type particulier de citation, cette épigraphe a des enjeux politiques à l’extérieur comme à l’intérieur de l’œuvre. Depuis quelque dix ans que la critique littéraire s’intéresse au Fou d’Elsa, on a rappelé[[Voir en particulier Maryse Vassevière, « La métaphore de Grenade […] » et Léon Robel, « Les éléments russes du Fou d’Elsa », respectivement p. 113-149 et 101-110, in le Rêve de Grenade, Actes du colloque de Grenade de 1994, Publications de l’Université de Provence, 1996. ]] combien la Grenade du Fou d’Elsa à la veille de 1492, cette citadelle assiégée de l’extérieur et minée de l’intérieur, avait de traits communs avec l’URSS, et la citation de Daix est un des signaux sciemment donnés par le poète de cette parenté. Mais la présence de cette épigraphe traduit également l’attitude qui est celle d’Aragon à l’époque dans le PCF : Aragon est, en particulier dans cette période et autour de la publication d’Une journée d’Ivan Denissovitch, un témoin officiellement muet. Il a en effet dissimulé son intervention auprès des Editions Julliard au point que Décaillot lui-même aura ignoré son rôle dans la tâche de traducteur qui lui a été confiée ; au point qu’il semble s’être volontairement abstenu de signaler aux Editions Julliard le rôle de Léon Robel dans la traduction du récit au moment de sa première publication en France. Il n’est jamais intervenu à titre personnel dans le débat. Il n’a pourtant jamais mâché ses mots en privé, ainsi que plusieurs témoins le confirment encore. Il a pris toutefois le parti… poétique de glisser au bon entendeur qu’est censé être le lecteur du Fou d’Elsa une nouvelle sorte de littérature « de contrebande », ici, en… 329e page du poème, une « contrebande » que l’on retrouvera dans les romans postérieurs au Fou d’Elsa, ceux des années soixante.
La critique littéraire
La critique littéraire française ne s’intéressera pour ainsi dire pas à Ivan Denissovitch, récit dont la littérarité s’est retrouvée prise au piège de sa popularité politique, et ce depuis le début.On mentionnera toutefois les quelques lignes de la préface de Léon Robel à la traduction de La Maison de Matriona[[Traduction de Léon et Andrée Robel, Julliard, 1965.]] :
Les circonstances dans lesquelles on a connu en occident Une journée d’Ivan Denissovitch ont pu masquer la grandeur littéraire de l’auteur. C’était tellement « sensationnel » que les journalistes ont réduit cette œuvre majeure de notre siècle à la valeur de témoignage ; de témoignage frappant, extraordinaire, mais de témoignage seulement. Et la hâte de vendre du papier à tout prix a conduit à ces condensés, à ces re-writings des magazines à grand tirage où l’œuvre perdait son visage.
Soljenitsyne n’est pas un journaliste avide de sensation. Soljenitsyne n’est pas non plus un témoin à la barre du tribunal de l’Histoire.
Soljenitsyne est un grand écrivain de Russie et de notre temps et donc une grande conscience.
Le premier écrit critique d’importance sur Soljenitsyne ne sera pas français et sera publié bien plus tard : il s’agit du Soljenitsyne de Georg Lukács (1970), un écrit dont le premier chapitre, consacré au roman de 1962, le présente comme le nouveau visage du réalisme socialiste.
Ce qu’il en reste…
Les conditions de la sortie d’Une journée d’Ivan Denissovitch en Union soviétique comme en Europe occidentale auront occulté longtemps, en dépit des efforts faits par quelques-uns (en France, principalement Elsa Triolet), ce que le livre aura pu représenter en tant qu’événement littéraire. Soljenitsyne le paiera à sa façon au moins jusqu’au début des années 1970, période où il sera enfin reconnu unanimement à la fois comme dissident soviétique et comme grand écrivain. De fait, toutes les cartes étaient brouillées au moment de la sortie de ce roman :
le fait que cette sortie ait été en quelque sorte un « coup monté » par Khrouchtchev ;
le fait qu’il ait été publicisé et défendu en France, et par des communistes peu, mal, voire pas du tout soutenus par leur propre parti, et par un journal anti-communiste ;
le fait surtout que le silence du PCF aura servi d’éteignoir aux initiatives des Lettres françaises.
La revue Les Lettres françaises se battra une nouvelle fois six ans plus tard pour accueillir le premier roman de Milan Kundera, La Plaisanterie. C’est Aragon cette fois qui montera au créneau, en préfaçant la traduction française de Marcel Aymonin et en insistant pour la faire accepter par les éditions Gallimard[[Je ne peux en fournir de preuve tangible, Gallimard refusant de communiquer les archives de la parution de La Plaisanterie, dans la mesure où « des personnes concernées sont encore vivantes ». Mais il est vrai pourtant que si Aragon a présenté l’ouvrage traduit par Marcel Aymonin à Gallimard, l’ouvrage a été refusé en première lecture et n’a été finalement accepté qu’après l’insistance d’Aragon.]]. Les initiatives prises en 1962-63 par Aragon, Triolet, Daix et l’équipe des Lettres françaises se retourneront bien plus tard contre eux. Voici la présentation tendancieuse et calomnieuse qui introduit depuis plus de vingt-cinq ans la version française par Jean Cathala d’Une journée d’Ivan Denissovitch :
Note de l’éditeur
1976
[…]
Un groupe de gens de lettres monopolisait alors la diffusion de la littérature soviétique, et le parti auquel ils étaient liés tenait à ce que cette première peinture d’un bagne stalinien parût sous leur contrôle. Bien que le choix des Editions Julliard se fût porté sur Jean Cathala […], elles se trouvèrent contraintes d’accepter une traduction faite en équipe et présentée à des fins d’opération politique […][[Cette note accompagne désormais toutes les éditions de la traduction réalisée par Jean Cathala à partir de la version définitive de l’auteur parue en russe en 1973. Soljenitsyne, qui ne connaissait pas le français, n’a émis aucune critique, ni positive ni négative, sur la traduction de 1963, ni sur les initiatives du couple Triolet-Aragon. « Ça le faisait même rire » qu’en France ce soient précisément des communistes qui aient contribué à défendre et à publiciser son roman (Témoignage oral de Claude Durand, actuel président des éditions Fayard, représentant de Soljenitsyne en France).]].
N.B. : Elsa Triolet, comme chacun sait (sauf chez Julliard ?), n’a jamais été membre du PCF. Jean Cathala si, en revanche.