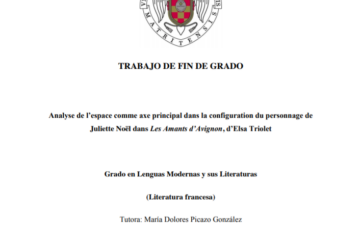Garance Sallé de Chou, Raison et déraison dans Le Paysan de Paris et La Défense de l’infini…

UNIVERSITÉ PARIS III-SORBONNE NOUVELLE
UFR DE LITTÉRATURE ET LINGUISTIQUE FRANCAISES ET LATINES
2003-2004
Raison et déraison
dans Le Paysan de Paris
et La Défense de l’infini
de Louis Aragon
et Le Chiendent
de Raymond Queneau
Mémoire de maîtrise de Lettres Modernes
Réalisé par Garance Sallé de Chou,
sous la direction de Madame Maryse Vassevière
INTRODUCTION
La contestation du positivisme et des formes de la pensée logique en littérature a été formulée de façon exigeante par le surréalisme au début du vingtième siècle. Le mouvement qui marqua la jeunesse de beaucoup d’écrivains français fut cependant traversé par de nombreuses ruptures et autres phénomènes de dissidence tirant leur origine de conflits à la fois idéologiques – concernant la nature de l’engagement au service de la révolution et surtout le rôle de la poésie dans cette question – et esthétiques par rapport à des préceptes jugés trop systématiques ou autoritaires. Ces derniers conflits portent en particulier sur le roman qui incarnait pour Breton et ses disciples l’emblème du « péché » de littérature. Le roman est d’abord critiqué car il relève d’une ambition de promotion sociale que n’ont cessé de dénoncer les surréalistes. Il l’est ensuite parce qu’il se fait l’expression d’une forme de positivisme et de pensée rationnelle que Breton rejette au profit du surréalisme défini comme cet « Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée[[ndré Breton, Manifeste du surréalisme, Paris, Gallimard, 1924 ; repris dans Manifestes du surréalisme, Paris, Jean-Jacques Pauvert éditeur, 1962, Société Nouvelle des Éditions Pauvert, 1979 ; Paris, Gallimard, « Folio », « essais », 1985, p. 36.
]]. » Les surréalistes condamnent enfin ce genre car il reflète un ordre des choses imposé par une société bourgeoise qu’ils veulent avant tout subvertir. Toute activité romanesque leur est donc suspecte.
Louis Aragon et Raymond Queneau ont tous deux participé aux activités du groupe durant leur jeunesse. Leur carrière d’écrivain prend racine dans cette expérience fondatrice, tant par les dettes qu’ils ont conservées à son égard que par le rejet de certains de ses principes. Ils dépassent tous deux le double interdit surréaliste concernant la « littérature » et le roman. En devenant romanciers, ils renouvellent toutefois le genre traditionnel non sans intégrer à leur pratique les griefs que les surréalistes entretenaient à son égard. Ces destins parallèles ne doivent pas masquer les divergences fondamentales qui les opposent dans leur approche de l’écriture et du roman. Non seulement, Aragon fut avec Breton et Soupault, un membre fondateur du surréalisme qui lui doit certaines contributions essentielles, quand la participation de Queneau fut en comparaison beaucoup plus minime, mais le surréalisme a influencé toute la carrière d’Aragon tandis que l’esthétique de Queneau s’est fondée majoritairement en opposition ouverte avec le surréalisme. On peut dès lors tenter de s’interroger sur ce qui dès les années 1920-1930 oppose ou rapproche les esthétiques d’Aragon et de Queneau à travers l’étude du Paysan de Paris et de La Défense de l’infini du premier et du Chiendent du second.
Aragon commence l’écriture du Paysan de Paris à la fin de 1923 à Paris. Il achève celle de la « Préface à une mythologie moderne » et du « Passage de l’Opéra » à l’été 1924, puis entreprend la rédaction du « Sentiment de la nature » qu’il termine entre l’hiver 1924 et le printemps 1925. « Le Songe du Paysan » est conçu entre l’hiver 1925 et le printemps 1926. Une première édition complète rassemblant les quatre textes paraît en octobre 1926. Aragon commence La Défense de l’infini en mai 1923 à Giverny, où il s’était réfugié pour échapper à diverses pressions de sa famille et du groupe surréaliste ressenties comme des entraves à sa liberté. Devant l’anathème jeté par le groupe sur le roman, il travaille à La Défense dans une atmosphère semi-clandestine : il ne cache pas son projet à ses amis, mais en minimise la portée. Il déchire et brûle une grande partie du manuscrit à Madrid vers la fin de 1927. Cet « autodafé » semble marquer l’abandon du projet : hormis la publication éparse de fragments du manuscrit, le projet ne sera jamais achevé. L’auteur garde le silence sur cette entreprise jusqu’en 1964, date à partir de laquelle il recommence à en parler lors d’interviews ou dans des ouvrages critiques. Les pièces ayant survécu à la destruction seront progressivement redécouvertes par plusieurs critiques et rassemblées en trois éditions successives : celle d’Edouard Ruiz en 1986 qui réunit pour la première fois des textes publiés par Aragon, avec ou sans sa signature, et des textes inédits, auxquels l’éditeur donne des titres de son cru, celle de Daniel Bougnoux en 1997 dans le premier volume des Œuvres romanesques complètes, et celle de Lionel Follet en 1997 chez Gallimard, aux « Cahiers de la nrf ». Cette dernière édition enrichit sensiblement le corpus par l’insertion de dix-neuf chapitres inédits exhumés par l’éditeur au Humanities Research Center d’Austin[[. Une description plus précise du Paysan de Paris et du manuscrit de la Défense de l’infini, ainsi que de l’histoire de ces deux textes, sera donnée dans la première partie de cette étude.
]]. À l’époque du Paysan de Paris et de La Défense de l’infini, Aragon a déjà à son actif deux recueils poétiques : Feu de joie (1920) et Le Mouvement perpétuel (1925), et trois textes en prose dont deux récits : Anicet ou le Panorama, roman (1921), et Les Aventures de Télémaque, (1922), réécriture d’inspiration dadaïste de l’œuvre éponyme de Fénelon, et un recueil de nouvelles : Le Libertinage (1924) qui préfigure les techniques d’écriture de La Défense de l’infini. En 1924, il donne dans Une Vague de rêves forme théorique à sa conception du surréalisme et du « surréel », en concurrence avec le Manifeste du surréalisme de Breton qui paraît la même année. Aragon entretient cependant une distance vis-à-vis des activités du groupe. Il est en effet absent de Paris au moment où celui-ci se livre à ses expériences les plus fondamentales : l’écriture automatique, par la rédaction conjointe des Champs magnétiques par André Breton et Philippe Soupault en 1919, et les « sommeils » en 1922. Sur le plan esthétique, il manifeste également une certaine réserve. Il a très peu pratiqué l’écriture automatique et comme le souligne Alain Trouvé, « À la différence de Breton, il semble refuser que les mots puissent échapper au contrôle de l’écrivain […][[. Alain Trouvé, Le Lecteur et le livre fantôme, Paris, Editions Kimé, 2000, p. 35. ]] ». Ces divergences théoriques s’expriment en particulier dans Le Traité du style qu’Aragon publie en 1928. Breton pour qui le surréalisme est cette « Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale[[. André Breton, Manifeste du surréalisme, dans Manifestes du surréalisme, op. cit., p. 36. ]] » remet en cause la notion de travail poétique : « le surréalisme est à la portée de tous les inconscients[[. Texte d’un papillon surréaliste, cité par Maurice Nadeau, Histoire du Surréalisme, Paris, Seuil, « Points », « Essais », 1964, p. 56. ]]. » Aragon critique cette conception en déclarant : « Si vous écrivez, suivant une méthode surréaliste, de tristes imbécillités, ce sont de tristes imbécillités[[. Aragon, Traité du style, Paris, Gallimard, 1928 ; « L’imaginaire », 1980, p. 192. ]]. » Le groupe se montre méfiant vis-à-vis des activités « romanesques » d’Aragon. Sans en être véritablement un, Le Paysan de Paris flirte avec le roman, en particulier par l’accumulation des descriptions. Aragon cherche à découvrir la surréalité à partir d’une description minutieuse du réel, et dans sa conception du « surréalisme », le terme de « réalisme » résonne avant tout. Quand il lit au groupe les premières pages du livre au début de 1924, il déclenche la consternation[[. Il rapporte cet épisode dans Je n’ai jamais appris à écrire ou les Incipit, Genève, Skira, 1969 ; Paris, Flammarion, « Champs », 1980, p. 54.]]. Avec La Défense de l’infini, Aragon a bien l’intention d’écrire un roman, même s’il subvertit les règles du genre, en y intégrant de grands morceaux lyriques, et même s’il a l’impression de l’avoir « réinventé[[. Aragon, « Avant-Lire », Œuvres romanesques croisées d’Elsa Triolet et Louis Aragon, Robert Laffont, tome II, 1964. ]] ». La publication du « Cahier noir », présenté comme un « extrait » du roman en février-mars 1926, fait scandale chez les surréalistes qui lors d’une réunion tenue le 23 novembre 1926 lui reprochent l’ampleur d’un projet – six volumes prévus – susceptible selon Breton de « distraire un temps qui pourrait être consacré à une action révolutionnaire[[. Adhérer au Parti communiste ?, Archives du surréalisme, 3, présenté par Margueritte Bonnet, Paris, Gallimard, 1992, p. 26-27.]]. » La période d’écriture du Paysan de Paris et de La Défense de l’infini est aussi mouvementée sur le plan amoureux. Il est utile de rappeler brièvement ce contexte car l’écho de la vie amoureuse de l’auteur traverse les deux œuvres en profondeur. En 1922, Aragon tombe amoureux d’Elisabeth de Lanux, dite Eyre. Dessinatrice et peintre, d’origine Américaine, elle était mariée au diplomate Pierre de Lanux. C’est d’abord une femme « interdite » à Aragon car elle est la maîtresse de son ami Pierre Drieu La Rochelle. Eyre est le pilotis de la « Dame des Buttes-Chaumont » chantée à la fin du « Sentiment de la nature » et de la femme aimée du « Songe du Paysan ». Ce dernier texte relate les circonstances de cette histoire : « c’est dans ce désordre réel qu’[il rencontra] une autre femme » (p. 240), Denise Lévy, qui l’aida à conjurer cet échec amoureux. Née Kahn, Denise était la cousine de Simone Kahn-Breton et avait épousé Georges Lévy en 1921, dont elle divorça pour se marier avec Pierre Naville en 1928. Elle servit de pilotis à la Blanche du « Cahier Noir », à la destinataire du chapitre 3 du Con d’Irène, et à la fameuse Bérénice d’Aurélien. Le Paysan affirme l’avoir « bien aimée sans mentir, d’un amour qui ne s’est effacé que devant l’amour même » (p. 240-241). Il fait ici allusion à un épisode situé entre janvier et mars 1925 quand Eyre, sans doute délaissée par Drieu, « fit cette chose extraordinaire, de [l’]appeler à elle » (Paysan, p. 241). « Le songe du Paysan » raconte encore cette « soirée éclipse » marquant le début d’une relation passionnée qui dura jusqu’à l’été 1925. En 1926, Aragon fait la connaissance de Nancy Cunard, petite fille du fondateur de la Cunard Line, compagnie de navigation maritime et vit avec elle un amour heureux jusqu’en 1927. Nancy Cunard l’entraîne dans de nombreux voyages qui lui permettent une plus grande liberté par rapport au groupe. Durant l’été 1927, Aragon séjourne avec Nancy à Varengeville-sur-Mer et rédige Le Traité du style, alors que Breton non loin de là écrit Nadja au Manoir d’Ango. Il traverse alors une « double crise amoureuse et littéraire[[. Maryse Vassevière en a analysé les enjeux dans « Œuvres croisées : Aragon, Breton, et le mystère du manoir d’Ango », Recherches croisées Aragon / Elsa Triolet, n°2, Presses Universitaires franc-comtoises, 1989.
]] ». Breton qui, lui semble-t-il, déprécie son travail, a sans doute eu une aventure avec Nancy Cunard. Aragon aurait donc été trahi et par son ami et par sa maîtresse. En octobre 1927, il part avec Nancy pour l’Espagne. C’est à Madrid qu’il procédera à la destruction de son manuscrit en présence de sa maîtresse. En septembre de l’année suivante, il tente de se suicider à Venise. Plusieurs causes d’ordre différent peuvent expliquer ce double geste autodestructeur : crises esthétique, amoureuse, politique, etc. On en examinera les enjeux afin de tenter d’expliquer l’échec de La Défense de l’infini.
Dès 1927, Aragon adhère au parti communiste. En 1932, à la suite de ce qu’on a appelé « l’Affaire Aragon[[. En 1932, Aragon est inculpé pour propagande anarchiste à la suite de la publication de son poème Front Rouge en 1931, dans lequel il appelle à l’assassinat des dirigeants du régime et à celui des « ours savants de la social-démocratie ».]] », l’auteur rompt avec les surréalistes et son ami Breton, et s’engage plus avant dans la cause socialiste. La même année, il se rend en URSS avec Elsa Triolet, rencontrée en 1928. En 1933, il devient journaliste à L’Humanité et découvre le réalisme socialiste. C’est alors qu’il commence le cycle du « Monde réel », inauguré par la publication des Cloches de Bâle en 1934.
De 1924 à 1929, Raymond Queneau fréquente le groupe surréaliste. En 1924, il rencontre Gérard Rosenthal, Michel Leiris, Philippe Soupault et Pierre Naville qui le présentera à André Breton. À la fin de l’année, il participe aux activités du Bureau central de recherches surréalistes. Début 1925, il termine ses études de philosophie et cherche du travail. Dès janvier, sa signature apparaît au bas des divers tracts et déclarations surréalistes. Il publie un récit de rêve dans La Révolution surréaliste d’avril 1925, puis un « Texte surréaliste » dans le n° 5 et un poème, « Le tour de l’ivoire » dans le n° 9-10. Le n° 11 fait paraître sa critique de l’exposition Chirico et fait aussi état de sa participation aux recherches sur la sexualité. En 1927, Queneau adresse à Breton un manuscrit de textes automatiques. Ce dernier manifeste un vif intérêt pour ce manuscrit et projette d’en publier des extraits, mais il l’égare. De 1925 à 1927, Queneau effectue son service militaire au Maroc pendant la Guerre du Rif, ce qui l’éloignera assez longtemps du groupe. En mai 1927, il est employé au Comptoir national d’escompte de Paris. Le personnage d’Etienne dans Le Chiendent travaille au « Comptoir des comptes » et rappelle cette situation. À la même époque, il fréquente le groupe « dissident » de la rue du Château où évoluent les frères Prévert, Yves Tanguy, Marcel Duhamel. Le 6 juin 1929, il se brouille avec Breton et en janvier 1930, paraît le tract, Un cadavre, dirigé contre ce dernier, dont le titre fait écho au pamphlet éponyme conçu par les surréalistes en 1924 à l’occasion de la mort d’Anatole France. Queneau y rédige la partie « Dédé », sorte de poème scatologique où Breton pactise avec le diable. En 1950, lors de ses entretiens avec Georges Ribemont-Dessaignes, il dit s’être « fâché avec Breton pour des raisons strictement personnelles et non pour des raisons idéologiques[[. « Conversation avec Georges Ribemont-Dessaignes », Bâtons, chiffres et lettres, Paris, Gallimard, 1965 ; « Folio », « essais », 1994, p. 36. ]]. » En 1928, Queneau avait en effet épousé Janine Kahn, sœur de Simone, la première femme de Breton. Après son divorce, Breton refuse que ses amis revoient Simone et Queneau prend le parti de sa belle-sœur. Mais ces motifs « strictement personnels » masquent mal des désaccords d’ordre théorique et idéologique. Queneau se fera un critique acharné du surréalisme. Beaucoup d’articles, rassemblés notamment dans Le Voyage en Grèce, font valoir une conception classique de l’art opposée à celle de ses anciens amis. On peut lire une violente satire du mouvement et de Breton en particulier dans Odile, roman d’inspiration autobiographique qui paraît en 1937. La rupture est suivie d’une période d’échecs et d’isolement. Il ne trouvera pas d’éditeur pour ses recherches sur les fous littéraires auxquelles il donnera finalement la forme d’un roman, Les Enfants du Limon, publié en 1938. La rédaction du Chiendent commence en Grèce à l’été 1932 et s’y effectue pour les trois quarts. Durant ce voyage, Queneau s’aperçoit que les Grecs parlent deux langues. Cette découverte sera à l’origine des théories du « néo-français », énoncées dans les articles du recueil Bâtons, chiffres et lettres. Il a aussi selon Henri Godard, « la révélation qu’il était possible de concilier une œuvre soumise au temps et aux impulsions incontrôlées qui font partie de la condition humaine, avec un ordre fondé sur les nombres, consciemment médité et, s’il parvient à un certain degré de perfection, aussi immuable que la nature[[. Henri Godard, « Notice » du Chiendent, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2002, p. 1444.]]. » Le Chiendent parait chez Gallimard le 20 mai 1933 sans grand retentissement. Une double intention a pu, selon les divers commentaires de l’auteur[[. Ces commentaires, que nous ne pouvons retracer dans leur entier, ont sensiblement varié selon les différentes périodes de la vie de l’auteur en fonction de ses préoccupations. Il convient donc de les manier avec circonspection.]], présider à l’écriture du Chiendent : la perspective du néo-français, que Queneau avait l’intention d’utiliser pour traduire Le Discours de la méthode de Descartes, et la volonté de construire un récit sur des bases formelles rigoureuses et rythmiques. La période qui est celle de l’écriture du roman est marquée par un militantisme de gauche et un intérêt pour la cause marxiste. Parallèlement, après avoir renoncé au catholicisme, Queneau s’intéresse à la métaphysique orientale à travers ses premières lectures de René Guénon en 1921, qu’il ne cessera de lire avec plus ou moins d’intensité selon les différentes époques de sa vie.
En prenant pour point de départ et pour présupposé deux méthodes d’écriture divergentes voire opposées, on tentera de s’interroger sur les rapports entre raison et déraison dans les trois œuvres. Aragon accorde une fonction exploratoire et créatrice au hasard et à l’abandon aux puissances « irrationnelles » : sensibilité, imagination, fantaisie, inconscient, etc. Dans Je n’ai jamais appris à écrire ou les Incipit, il a expliqué comment pour lui, l’écriture romanesque naissait de l’impulsion offerte par la première phrase du roman dans un processus quasi automatique. Il affirme avoir écrit ses romans dans la position d’un « lecteur qui fait la connaissance d’un paysage ou de personnages dont il découvre le caractère, la biographie, la destinée[[. Aragon, Je n’ai jamais appris à écrire ou les Incipit, op. cit., p. 10.]]. » Cette conception de l’auteur en lecteur signifie l’absence de plan préalable et une écriture qui semble s’effectuer comme hors du contrôle de l’écrivain. Dans Le Paysan de Paris, Aragon fait confiance aux royaumes de l’irrationnel et de ce qu’il nomme à la suite de Descartes l’« erreur ». Il définit le surréalisme par « l’emploi déréglé et passionnel du stupéfiant image » (Paysan, p. 82). Dans « Technique du roman », Queneau expose sa « technique consciente du roman[[. Queneau « Technique du roman », Bâtons, chiffres et lettres, op. cit., p. 28.]] ». Cette dernière consiste à s’imposer des contraintes a priori et manifeste une volonté de structurer et de fournir des règles et un rythme à un genre qui a depuis toujours « échappé à toute loi[[. Ibid., p. 27. ]] ». Queneau valorise une forme de pensée et d’écriture maîtrisée qui refuse le rôle dévolu par les surréalistes au hasard. Il faut tout d’abord tenter de décliner les aspects des deux termes du sujet. Nous entendons par le terme de « raison », ce qui a trait à la pensée rationnelle, logique et cartésienne, consciente et maîtrisée. La raison est la « Norme absolue de la pensée humaine[[. Paul Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique, Paris, Presses Universitaires de France, 1962, p. 603.]] ». C’est aussi la « faculté des principes (soit qu’elle consiste dans le pouvoir de les former, soit qu’elle ne soit pas autre chose qu’un système de principes)[[. Ibid., p. 604. ]]. » La raison est toute entière lois : elle organise le réel selon ses propres lois ou principes. Nous placerons donc de son côté tout ce qui se rapporte à la règle : les règles de la pensée, du langage, du discours, etc. Nous employons le terme de « déraison », non comme synonyme de « folie », ce qu’il est en vérité, mais dans une acception formelle, car, par sa morphologie, par le privatif, il implique une négation et un écart par rapport à un terme qui fonctionne comme référence. Nous lui associons donc tout ce qui s’oppose ou entre en conflit avec la « raison » : la sensibilité, le moi, l’irrationnel, l’imagination, l’inconscient, la valorisation du hasard et d’une forme de pensée non logique, ainsi qu’un rapport conflictuel à la règle. Nous plaçons donc d’emblée et de manière un peu naïve, Aragon plutôt du côté de la déraison et Queneau, plutôt du côté de la raison. Mais il ne s’agira pas d’en rester à ce stade de manichéisme un peu simpliste. En effet, malgré le rôle qu’il accorde au hasard, Aragon affirme dans le Traité du style : « […] dans le surréalisme tout est rigueur. Rigueur inévitable[[. Aragon, Traité du style, op. cit., p. 190. ]]. » Dans une première lecture de l’œuvre de Queneau, c’est peut-être son aspect tout fantaisiste qui frappe le lecteur davantage qu’une construction qui peut lui échapper. Les romans de Queneau dégagent une impression de loufoquerie, voire de « délire » ou de « folie » du langage. On s’interrogera donc sur la dialectique du hasard et de la maîtrise dans les deux œuvres : le hasard est-il synonyme de relâchement et d’abdication de toute volonté ou peut-il être l’enjeu de la définition d’un nouveau savoir et peut-il représenter pour l’écrivain le moyen de s’assurer une maîtrise de sa pratique, de soi et du monde ? On examinera également la dialectique qui peut s’établir entre soumission à la règle et liberté : la contrainte autorise-t-elle une certaine forme de liberté permettant à l’imagination et à la fantaisie de prendre leur essor ? Enfin on tentera de voir comment par des voies différentes, les deux auteurs parviennent à une distanciation critique sur leur propre travail. On analysera en particulier les points suivants : d’abord la problématique de la logique et de la cohérence par l’étude de la structure et de l’écriture des trois œuvres, notamment à travers la notion de genre littéraire. Aragon semble récuser toute forme de logique au sens traditionnel par un refus des règles à la fois génériques et discursives. Queneau au contraire semble vouloir donner une forme de logique a priori à ses œuvres en leur imposant des règles et un rythme d’ordre poétique. On se posera aussi la question du réel et du réalisme. Les deux auteurs s’interrogent sur les rapports du sujet au réel par une valorisation de l’irrationnel chez Aragon (le « surréel » et le « concret ») et par un questionnement sur le fonctionnement de l’esprit et du langage chez Queneau. Ce problème justifie qu’on se penche ensuite sur celui de la mimésis, c’est-à-dire la représentation du réel et sa mise en mots. On tâchera d’explorer enfin la relation de l’écriture au moi et au monde. La raison étant par définition ce qui fait abstraction du sujet émotionnel, qu’en est-il des liens entre l’écriture et le moi ? L’œuvre de Queneau est dominée par un principe d’effacement tandis qu’Aragon semble avoir du mal à se distancier de l’œuvre. Mais l’écriture est-elle chez les deux auteurs, l’enjeu d’une prise de possession de soi et d’une mainmise du sujet sur le monde ? Dans le prolongement de ces réflexions, on étudiera dans des œuvres qui présentent un intertexte philosophique important les liens qui s’établissent entre philosophie et littérature. On tentera donc de confronter les aspects formels et thématiques des œuvres avec leurs partis pris esthétiques et philosophiques. Leurs aspects formels et stylistiques et leurs enjeux esthétiques sont-ils sous-tendus par des exigences philosophiques, voire métaphysiques, clairement repérables ? En particulier, quels rapports du sujet au réel et de l’écriture au réel, la forme des œuvres et leur méthode d’écriture manifestent-elles ? Nous chercherons des réponses en traitant d’abord séparément les deux auteurs, dans une première partie sur Le Paysan de Paris et La Défense de l’infini, puis une seconde consacrée au Chiendent, avant de conclure par une synthèse finale où les deux esthétiques seront confrontées. À l’intérieur des deux grandes parties, on tentera de suivre une démarche analogue, en étudiant successivement les points que nous avons relevés ci-dessus, même si le plan ne peut jamais être totalement identique. En ce qui concerne la première partie sur Aragon, on se penchera d’abord sur le thème de la logique à travers l’analyse de la structure et de l’écriture des deux œuvres. On s’interrogera ensuite sur les rapports du sujet au réel par l’examen des notions du « surréel » et de « concret ». On achèvera cette partie en se demandant quelle dialectique s’établit chez Aragon entre hasard et maîtrise. Dans la seconde partie sur Queneau, le premier point sera le même que celui de la première partie. Le second portera sur le rapport de la raison au réel, le troisième sur la question du réalisme et le dernier point sur les rapports entre l’écriture, le moi et le monde.
En ce qui concerne le corpus d’étude de La Défense de l’infini, nous en donnerons d’abord une description d’ensemble avant de nous focaliser sur ce que Lionel Follet a appelé « Le Projet de 1926 », sans exclure des références ponctuelles au reste du manuscrit. Les numéros de pages renvoient pour Le Paysan de Paris à l’édition Folio, Gallimard (1926, renouvelée en 1953), pour La Défense de l’infini, à l’édition de Lionel Follet aux « Cahiers de la N.R.F » (1997). Les références du Chiendent renvoient au tome II des Œuvres complètes, paru chez Gallimard, dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (2002).
CONCLUSION
Un premier constat s’impose : Aragon valorise un type de pensée non logique au contraire de Queneau qui privilégie une pensée consciente et contrôlée. Cette différence s’explique tout d’abord par les rapports qu’ils entretiennent avec la connaissance. Aragon veut définir un autre type de connaissance basé sur l’irrationnel, l’« erreur », alors que Queneau reste davantage dans la raison et une forme de pensée « classique » et cartésienne. La pensée d’Aragon tire son origine d’un abandon aux sens et au hasard dont il reconnaît les vertus révélatrices. Pour lui, le hasard possède une fonction heuristique orientée vers la production d’une nouvelle connaissance à laquelle une pensée contrôlée ne pourrait parvenir. Quand le paysan dans « La Préface à une mythologie moderne » prend, en quelque sorte, le contre-pied de Descartes, Queneau, lui, brosse le portrait d’un personnage – Etienne – qui retrouve à sa manière la méthode et les hypothèses de Descartes : la nécessité d’un doute préliminaire, les pensées dirigées, etc. Queneau se méfie non seulement des apparences, mais aussi et surtout du hasard et du déchaînement des puissances de l’irrationnel. Ces deux méthodes de pensée divergentes justifient naturellement deux méthodes d’écriture opposées. Pour Aragon, le roman naît par l’incipit d’un procédé d’automatisme et toute sa pratique accorde une vertu créatrice au hasard, et au jeu même des mots. Queneau au contraire déteste l’automatisme et dénonce l’équivalence souvent faite entre hasard et liberté. L’abandon au hasard et à l’inconscient est pour lui synonyme de relâchement et d’esclavage : le poète doit œuvrer consciemment en respectant un certain nombre de règles qu’il choisit. Qu’on se rapporte à sa conception de l’image poétique : si les associations d’idées qu’elle engendre sont dues au hasard, on risque d’aboutir à l’arbitraire. Pour Aragon au contraire, le hasard est libérateur, puisqu’il permet de s’affranchir de l’emprise négative de la raison et de la logique qui asservissent l’imagination et ramènent sans cesse l’esprit dans du connu. Le hasard autorise la découverte de nouvelles perspectives romanesques. Il n’est donc pas à mettre au compte d’une absence totale de contrôle car il permet à l’écrivain de prendre progressivement possession de l’inconnu que signifient pour lui la recherche philosophique ou l’entrée initiale dans le monde de l’écriture. Ainsi les deux auteurs ont une pratique opposée de l’écriture qui se justifie du point de vue philosophique.
De cette valorisation du hasard ou de la pensée consciente, dérivent deux méthodes d’écriture opposées. Chez Aragon, l’écriture romanesque ne vient pas traduire un projet préalable mais c’est le jeu même des mots qui donne naissance au roman, notamment par l’impulsion initiale de l’incipit. Chez Queneau, une intention préalable précède toujours l’écriture. Dans le cas du Chiendent, ce peut être la traduction du Discours de la méthode en français parlé. Mais, ce sont surtout les contraintes que s’impose l’auteur afin de donner une armature a priori à son roman. Chez Aragon, à partir de l’incipit, c’est tout le roman qui se déroule comme indépendamment du contrôle de l’auteur, et les ingrédients du récit – les chapitres, leur nombre, leur contenu, les personnages, l’espace, le temps – naissent du flux même de l’écriture. Chez Queneau, rien n’apparaît au hasard : tous les éléments du récit sont pensés en fonction de règles strictes destinées à fournir un rythme au récit. Queneau veut tout contrôler, tout penser. Cette particularité découle de sa conception de l’écriture comme artisanat, et de l’art au sens étymologique, comme métier, technique : pour lui, être écrivain, c’est maîtriser un savoir-faire. Cette dernière idée peut rendre compte de priorités différentes chez les deux auteurs. Chez Aragon, priorité est donnée à la recherche, au phénomène d’écriture en cours : ses deux œuvres retransmettent le mouvement d’une quête, d’une démarche et d’une écriture. Or, Queneau dénonce le principe de la supériorité de la recherche sur l’œuvre aboutie. Pour lui, c’est moins la recherche que l’œuvre finie qui compte. Il peut être intéressant de noter la manière dont Queneau critique le goût des lecteurs et des critiques pour les œuvres inachevées :
[…] l’un des exemples de cette faveur accordée au « moins », c’est le goût pour les esquisses, approches, essais, tentatives, c’est la précellence donnée à l’inachevé. […] Encore une fois, ce qui compte, c’est l’œuvre, car elle seule est vivante. […] Ce qui compte, c’est l’œuvre, car elle seule est achevée, et non les déchets ; ce qui compte, c’est le meuble et non les copeaux, le tableau et non les esquisses, la maison et non les échafaudages[[. Queneau, « Le plus et le moins », Volontés, n°8, 1Er août 1938, Le Voyage en Grèce, op. cit., p. 123-125.
]].
Nous avons vu que le rôle dévolu par Aragon au hasard dans le processus de création n’excluait pas des phénomènes de retours conscients. Nous avons vu également qu’Aragon refusait le pur automatisme valorisé par Breton. La reprise métonymique à laquelle donne lieu l’incipit l’exclut. Aragon impose des rythmes divers à son écriture et fait davantage confiance à une investigation hasardeuse qui, si elle donne l’initiative au hasard et à la fantaisie, n’exclut pas tout contrôle. Le hasard est tout entier méthode puisqu’il est orienté vers un but. C’est bien la volonté de l’écrivain qui domine et oriente la création. Les règles que s’impose Queneau ne dérivent pas d’un pur formalisme. Ce sont essentiellement des aides à la création qui peuvent disparaître ou se modifier selon les besoins du moment ou la tendance des personnages à prendre leur autonomie. Dans ses entretiens avec Georges Ribemont-Dessaignes, Queneau affirme :
[…] quand j’ai commencé à écrire ce qui devait devenir le Chiendent, […] je voulais simplement faire un petit essai de traduction du Discours de la Méthode en français moderne. Bientôt je me suis aperçu que j’étais tombé dans le bain romanesque. Alors, sous l’influence de Joyce et de Faulkner (qui n’était pas encore traduit), pour d’autres raisons aussi, j’ai donné une forme, un rythme à ce que j’étais en train d’écrire[[. « Conversation avec Georges Ribemont-Dessaignes », Bâtons, chiffres et lettres, op. cit., p. 41. ]].
Queneau souligne ici un écart entre le projet initial – la traduction – et ce qu’il est devenu – un roman. Il y a donc bien une part de hasard et rien n’est jamais décidé a priori. L’auteur suggère aussi ceci, que les états successifs du texte, brouillons et dactylogrammes, confirment : certains aspects formels du roman sont parfois venus après l’écriture elle-même comme par un souci de renforcer la structuration du texte. La décision d’imprimer les treizièmes sections en italique et de marquer la dernière du chiffre XCI provient de corrections manuscrites du dactylogramme. C’est donc toujours l’écriture elle-même qui donne naissance au roman. Tout n’est finalement chez les deux auteurs qu’une question de point de vue et de point de départ, de méthode en somme : Aragon privilégie le hasard et Queneau les contraintes et la structuration, mais le hasard chez Aragon n’exclut pas maîtrise et conscience, les contraintes et le contrôle chez Queneau n’excluent pas des phénomènes de hasard. Chez les deux auteurs, une méthode voulue, réfléchie, doit être au point de départ de la création. Ils refusent l’absence de contrôle total revendiqué par Breton : il y a un équilibre à trouver entre hasard et contrôle, fantaisie et conscience. Cette volonté d’œuvrer consciemment est peut-être ce qui les a fait tous deux s’éloigner du surréalisme. Car, au-delà de leurs divergences, ce sont aussi la revendication d’une liberté individuelle et le refus de tout esprit de système, face à une orthodoxie de groupe jugée aliénante, qui les rapprochent.
L’autre point fondamental qui permet de résoudre les divergences est le suivant : la création naît toujours de la contrainte que l’écrivain s’impose comme point de départ de l’invention. La contrainte est le terreau qui permet à l’imagination, à la fantaisie et à la liberté de prendre leur essor. Nous avions vu en effet que l’incipit chez Aragon, malgré le hasard et l’absence de contrôle dont il témoigne, est bien une contrainte qui donne l’impulsion à l’invention. Il remplit donc la même fonction que les règles numériques et les différentes contraintes formelles chez Queneau. Savoir suivant quelles modalités s’énonce cette contrainte – est-t-elle choisie consciemment ou relève-t-elle de l’automatisme ? – n’est encore qu’une question de point de vue sur l’origine de la création. Le refus de la notion d’inspiration et la valorisation de la rigueur et du travail poétique contre Breton caractérisent également les deux auteurs. Chez Aragon, l’écriture a pour tâche de motiver l’incipit, de donner consistance aux personnages et de déterminer l’histoire. L’incipit et le hasard fonctionnent donc bien comme contraintes et non comme laisser-aller. Chez Aragon comme chez Queneau, la liberté du créateur vient de ce qu’il parvient à vaincre les difficultés par son travail. De même, ils redonnent tous les deux, contre les principes énoncés dans le Manifeste du surréalisme, une légitimité au jugement critique et esthétique en appréciant la valeur de la création poétique selon des critères stylistiques et formels et non, comme Breton le voudrait, en fonction de la seule authenticité de la « pensée pure ».
C’est du point de vue formel, de l’écriture et de la structure surtout, que se manifestent essentiellement les méthodes d’écriture divergentes des deux auteurs. Avec le processus de fragmentation générique, Aragon privilégie la pluralité sur l’unité, l’hétérogénéité des formes du discours sur l’homogénéité de la structure, et la discontinuité sur la linéarité de l’écriture. Par l’éclectisme et l’insertion dans le texte de fragments autonomes et de différentes formes de collage, Aragon cherche à produire des effets de rupture. Queneau au contraire par différentes techniques – structure numérique et circulaire, unité des chapitres et des sections, répartition des personnages et des formes de discours, effets de rythme et de symétrie – privilégie la structuration et l’unité du discours. Les règles de nature numérique instaurent des phénomènes de répétitions, de récurrence et de symétrie. Tout est pensé en fonction d’un rythme régulier et bien réglé qui doit renforcer l’homogénéité du récit. Lyrisme et narratif participent chez Aragon de deux dynamiques opposées qui font éclater la linéarité du texte. Ce sont les forces centrifuges qui l’emportent chez lui, alors que chez Queneau, le rythme régulier procède d’une force centripète destinée à faire du roman une œuvre polie et cohérente.
Cependant, l’alternance générique est inscrite dans les deux esthétiques et par-delà les deux dynamiques contraires qui les régissent – force centrifuge vs force centripète – la composition en fragments des deux œuvres d’Aragon et leur pluralité générique créent un procédé de récurrence musicale qui n’est finalement pas si éloigné de ce que fait Queneau. De plus, Le Chiendent donne aussi lieu à des effets de rupture et de contraste : l’apparition de l’utopie à la fin du récit qui vient rompre la logique « réaliste » des chapitres précédents, et la place à part des treizièmes sections qui font apparaître des formes de discours différentes : récits de rêve, coupures de journaux, etc, et intègrent au texte une dimension onirique, participent de ces effets de rupture. Le mélange de réalisme et d’onirisme ou de fantastique est en effet un aspect qui rapproche Queneau et Aragon. Ces effets de contraste visent chez eux à choquer les habitudes du lecteur en créant la surprise, et à subvertir des frontières entre les genres trop bien établies.
Les différences soulignées plus haut se retrouvent au niveau de la diégèse. Les deux auteurs usent d’effets de digression mais chez Queneau, il y a toujours une intrigue qui fait figure de force centripète : c’est un ressort qui polarise les ingrédients du récit. Chez Aragon, malgré la quête du surréel et des mythes qui structure Le Paysan, on a l’impression que l’œuvre entière est faite de digressions. Dans La Défense de l’infini, la pluralité des personnages et l’absence de communication des lignes diégétiques fait que sont privilégiées la juxtaposition et la discontinuité sur la coordination des intrigues. Dans Le Chiendent au contraire, il y a un nombre restreint de personnages qui entre dans un système pensé a priori. Il s’agit d’un système de coïncidences, mécanisme bien réglé qui conduit l’action des personnages à converger en une intrigue homogène. L’ordre d’apparition des personnages n’est pas livré au hasard alors que chez Aragon, par l’incipit, c’est l’écriture elle-même, le hasard qui donnent naissance aux personnages et déterminent leurs aventures. Ce sont donc toujours les forces centrifuges qui dominent chez Aragon : inflation descriptive et digressions dans Le Paysan, esthétique de la touche et de l’esquisse, juxtaposition des lignes diégétiques, fragmentation et éclatement de la diégèse, alors que Queneau recherche l’unité et la convergence de la structure. L’écriture d’Aragon se développe sur le modèle de la flânerie et de la déambulation ou de l’errance tandis que Queneau choisit le modèle classique d’un polissage de la structure par la suppression de tout élément superflu. Mais la fragmentation chez Aragon et l’unité chez Queneau ne naissent pas seulement de la méthode formelle de l’écriture mais de toute une conception philosophique de la création et de la pensée : Aragon rejette l’idée de logique en général quand Queneau donne la priorité à l’idée d’ordre.
Point de convergence, les deux auteurs reprennent le schéma du roman traditionnel tout en y portant atteinte. La Défense de l’infini et Le Chiendent mettent en jeu une temporalité romanesque qui introduit des modifications dans l’intrigue et le destin des personnages, mais ils la mettent aussi à mal. On a vu qu’Aragon faisait usage du présent discursif pour manifester la conscience en acte. La structure circulaire du Chiendent annule le récit en instituant dans l’œuvre une sorte de présent perpétuel, forme de répétition qui supprime le temps. Il y a donc annulation du récit par le présent chez les deux auteurs, mais il ne s’agit pas du même présent : présent de l’immédiateté de la psyché chez l’un, présent perpétuel chez l’autre. L’annulation du récit n’a donc pas la même fonction : Aragon conteste sa rationalité en niant l’intelligibilité de la psyché et du monde ; Queneau a une conception pessimiste de l’histoire et de la destinée humaine qui rend nécessaire l’annulation du temps.
Un autre aspect contribuant à rapprocher les deux auteurs est la manière dont ils s’efforcent de réconcilier roman et poésie. Mais c’est d’abord en fonction de conceptions radicalement différentes qui peuvent rendre compte de l’opposition entre unité et divergence, que ce rapprochement se fait. C’est essentiellement la présence du lyrisme et d’une écriture de l’image qui permet la fusion du roman et de la poésie chez Aragon tandis que Queneau refuse lyrisme et métaphores. Sa conception de la poésie, classique, implique structuration, rythme et achèvement. L’esthétique d’Aragon se développe sur le versant dionysiaque de l’art sur le modèle du « bordel » ou de l’orgie. Ce sont les idées de désordre et de démesure, d’illimitation, de confusion des règles et d’abolition des limites qui l’illustrent. Queneau trouve au contraire son inspiration dans l’art grec et apollinien, dans les idées d’ordre, de mesure, d’équilibre et d’harmonie. En contestant la frontière qui sépare le roman de la poésie et le roman du lyrisme, Aragon veut réaliser « le comble et la négation du roman[[. Aragon, Je n’ai jamais appris à écrire ou les Incipit, op. cit., p. 49. ]] » par la confusion du modèle et la subversion de ses règles. En rapprochant le roman du modèle de la poésie à forme fixe, Queneau veut renforcer et fournir des règles strictes à un genre qu’il considère « relâché ». Les règles figent pour Aragon, elles donnent consistance pour Queneau. L’œuvre d’Aragon est ouverte à l’infini, elle accueille tout ce qui lui est étranger et refuse toute forme fixe. Queneau au contraire veut parvenir à un texte-objet érigé en totalité close, achevée et parfaite au sens étymologique. Cette conception classique et artisanale de l’art le conduira à faire du balai son « objet-fétiche[[. Emmanuël Souchier, Raymond Queneau, op. cit., p. 212. ]] ». La recherche de la perfection conduit à beaucoup corriger, éliminer, « littératurer ».
Cependant, les deux auteurs ont une même volonté de faire du roman une sorte de poème en superposant à la simple contiguïté romanesque un principe poétique et métaphorique de circularité fondé sur la répétition. Cette intention commune se vérifie tant sur le plan de la structure que de l’écriture. Chez Aragon, une continuité d’ordre thématique compense la fragmentation du texte et se signale par des phénomènes d’échos entre les personnages, et de variations sur des thèmes récurrents : l’amour, la mort, la révolte, etc. Queneau veut instituer le principe de répétition dans son roman par des rimes de situations, de lieux et de personnages, et par la circularité que lui fournissent les divers points de symétrie tant macrostructuraux – effet de bouclage par la répétition de la même phrase à l’incipit et à l’excipit – que microstructuraux[[. Cf. les divers points de symétrie que nous avons signalés dans le paragraphe « Roman et formes fixes », p. 137.
]].
La circularité fonctionne aussi sur le plan de l’écriture. Queneau et Aragon jouent sur des phénomènes d’analogies et d’équivalences à la fois sémantiques et phoniques. On note l’importance des répétitions, des anaphores, des rimes, des allitérations et des assonances, destinées à donner un rythme proprement poétique au récit. L’aspect circulaire de l’écriture rompt avec le développement linéaire de la prose, le principe de répétition se substitue au principe de succession. De même, les deux écrivains insistent sur la matérialité de la langue. Ils redonnent une importance aux signifiants contre une écriture qui ne fait parler que les seuls signifiés. Tous deux revalorisent les pouvoirs de la langue en cherchant à la faire signifier dans sa matérialité même. Ils se signalent par une même exigence de consistance poétique de l’écriture et de la langue, en opposition avec le roman du dix-neuvième siècle qui tentait de faire disparaître les marques du style et du travail de l’auteur. On peut donc dire que par-delà les différences qui les opposent, les deux auteurs contribuent bien à rapprocher roman et poésie en quoi ils ne voient pas de différences essentielles.
Un autre des points communs aux esthétiques d’Aragon et de Queneau est la distance critique qu’ils entretiennent vis-à-vis des modèles traditionnels et vis-à-vis de leur propre pratique. Ils refusent tout académisme et entendent ne se laisser circonscrire par aucunes règles imposées de l’extérieur, qu’elles soient édictées par la tradition ou bien par le groupe surréaliste. Ce refus des lois est, chez Aragon, plus généralisé que chez Queneau en vertu d’une esthétique de l’infini dont nous avons analysé les enjeux. Mais les deux auteurs rejettent, de la même façon, les règles quand elles sont appliquées par conventions.
Il y a chez les deux auteurs des effets similaires de transgression de la logique de l’écriture ou du discours. La rupture de la logique du propos peut passer, par exemple, par une perversion de la logique comparative qui n’illustre pas le propos mais est utilisée pour elle-même à des fins comiques ou comme ouverture à de nouveaux rapports insolites. Elle se traduit aussi par un usage très large de toutes sortes de digressions et par des effets d’éclectisme et de pluralité : mélange des genres et des styles chez Aragon ; mélange des styles, des niveaux de langue et des tonalités chez Queneau. On note aussi la fréquence d’une tonalité humoristique, ironique ou parodique. Tous ces procédés ont pour effet de détruire une idée de l’unité, de la linéarité et de la logique du discours qui irait de soi. La critique par Aragon de la notion de logique en général est absente chez Queneau qui cherche davantage à accroître la conscience que l’écrivain possède de sa propre pratique, mais chez les deux auteurs, ces effets de violation de la logique du propos ont pour conséquence d’introduire une distance critique constante par rapport à un premier degré d’écriture et par rapport à leur propre esthétique.
La distanciation se manifeste aussi chez les deux écrivains par la forte présence du métatexte ainsi que par la remise en cause de certains codes propres aux genres traditionnels. Ils mettent parfois en question, voire contestent leur propre esthétique par différents procédés : autodérision, autodépréciation, ironie, etc. Parfois aussi, ils tendent à annuler un énoncé ou une esthétique mise en place, ou soulignent l’insignifiance d’un élément introduit. Ces phénomènes passent souvent directement par le narrateur chez Aragon, alors qu’ils sont souvent mis à distance par l’auteur lui-même qui les met dans la bouche des personnages chez Queneau[[. Cf. p. 157. ]]. Chez la premier, le narrateur doute souvent lui-même de la validité de sa démarche. C’est le propre d’une écriture en cours qui contient des moments d’hésitation, d’interrogation. Cette dimension n’existe pas chez Queneau. La mise en question de sa propre esthétique est donc plus forte chez Aragon. Néanmoins, les ruptures introduites par les commentaires à valeur métatextuelle participent chez les deux auteurs d’une interrogation sur leur pratique. La contestation des codes du roman traditionnel s’exprime chez eux par une perméabilité des frontières entre énoncé et énonciation. Le narrateur est souvent présenté sous les traits d’un personnage ou inversement, et les personnages tendent à prendre leur autonomie. Aragon et Queneau remettent donc en cause un principe de cohérence propre au roman traditionnel, même si cet aspect est plus fort chez Aragon. Le refus des frontières stables procède chez lui d’une négation de la rationalité du roman, du monde et de la psychologie qu’il n’y a pas chez Queneau qui dénonce plutôt toute forme de règle qui n’est pas choisie consciemment. Ce refus des frontières participe davantage d’un jeu et d’une réflexion générale sur le roman et ses codes.
Mais c’est bien finalement cet aspect de jeu avec les modèles qui rapproche les deux auteurs. Par toutes sortes de phénomènes qui produisent ruptures et surprise, ils subvertissent les modèles traditionnels pour créer du nouveau et de l’insolite tout en s’inscrivant dans la tradition. L’aspect très intertextuel de leur écriture les identifie et permet d’affirmer qu’Aragon n’est pas si éloigné de l’exigence de « classicisme » revendiquée par Queneau.
L’esthétique des deux auteurs se caractérise aussi par le dévoilement dans le cours même de l’écriture des rouages de la création. Ceci a pour effet de dévoiler l’illusion référentielle et de montrer que le roman est toujours l’objet d’un travail propre, qu’il est soumis à l’écrivain comme instance organisatrice et comme instance écrivante. Les auteurs s’inscrivent contre une écriture mimétique qui chercherait à effacer les marques de la présence du scripteur pour donner l’illusion que c’est le réel sans médiation qui apparaît dans le texte. Tous ces procédés consistant à exhiber les ressorts de l’écriture introduisent une distance constante dans le texte qui instaure un dépassement du premier degré d’écriture, celui de l’aspect référentiel, au profit d’un second degré qui est celui de l’énonciation et du travail d’élaboration scripturale. On peut confronter de ce point de vue la pratique de l’incipit chez les deux auteurs. Par une réduction métonymique de l’homme à sa silhouette, Queneau subvertit une pratique propre aux romanciers traditionnels. Chez Aragon, par l’incipit, on est en présence d’une phrase « donnée » sans préméditation, « automatiquement » (au sens surréaliste), alors qu’au contraire chez Queneau, il y a détournement conscient d’une technique d’écriture dans une distance ironique. Mais chez les deux auteurs, ce sont les mots qui donnent naissance au personnage qui au départ n’est qu’une « silhouette », c’est-à-dire aussi un mot auquel l’écriture devra donner consistance et vie. Il y a donc chez les deux auteurs une même volonté de déjouer les techniques systématiques par lesquelles un écrivain construit son univers comme par application d’une suite de recettes : l’écriture doit être réfléchie et naître de la volonté de l’auteur qui s’assure ainsi la maîtrise de sa propre pratique. En ceci, ils opposent une pratique vivante de l’écriture à une pratique figée qui ne pose pas question. L’ultime conséquence de ce que nous avons analysé est la dénonciation d’une lecture passive de pure consommation. En déjouant les lieux communs littéraires, Aragon et Queneau veulent surprendre et déstabiliser les attentes du lecteur et lui donner une part plus active dans la lecture en lui permettant d’entretenir une distance par rapport au texte.
Du point de vue philosophique, les deux auteurs s’interrogent sur la relation du sujet au réel. Aragon s’inscrit dans une critique générale de la raison et de la logique. Par le surréel, il veut montrer comment un autre rapport au réel et à la connaissance peut se fonder sur l’irrationnel. Queneau a, au contraire, une attitude doublement rationnelle faite de critique et de distanciation sur le fonctionnement de la raison. Tous deux soulignent le fait que le rapport de l’esprit au réel n’est pas un rapport en soi, mais que la perception agit toujours comme un filtre qui donne forme au réel. Il s’agit toujours d’une question de langage. Par diverses techniques : hyperréalisme, collages, surréel chez Aragon, humour, jeux sur le langage chez Queneau, ils manifestent un conflit entre le réel et son énonciation et dévoilent comment l’esprit et le langage travaillent nécessairement le réel. En conséquence, ils réfléchissent à la possibilité d’une mimesis et aux techniques qui sous-tendent la représentation. Il y a cependant chez Aragon, un conflit entre la conscience que le réel résiste nécessairement à toute énonciation et une volonté utopique de saisir tout de même l’infini du réel. Cette volonté n’existe pas chez Queneau qui entend faire du roman un monde autonome dégagé de tout impératif mimétique.
Chez les deux auteurs, il y a déformation et métamorphose du « réel » par l’imagination. Toute l’esthétique du surréel est fondée là-dessus. Chez Queneau, cet aspect passe par le prisme délirant de la subjectivité des personnages. Cette déformation du réel manifeste les désirs et les fantasmes, du sujet qui perçoit dans Le Paysan, des personnages dans La Défense et Le Chiendent. Chez Queneau comme chez Aragon, il y a là une mise en abyme du processus de création. Mais chez Queneau, la création, toute entière fabulation, s’éloigne du réel avec lequel elle n’a pas nécessairement de communication, alors que le surréel d’Aragon tire sa spécificité d’un ancrage profond dans le réel lui-même.
Les esthétiques d’Aragon et de Queneau s’illustrent par toutes sortes de jeux sur le langage. Tous deux veulent restaurer au langage quotidien et convenu sa puissance concrète et subversive. On note des effets similaires de transgression de la logique du langage par un jeu sur les catégories logiques, les registres du concret et de l’abstrait, les lieux communs. Les deux auteurs tentent d’exploiter le pouvoir des mots dans toutes ses dimensions, en jouant sur leur potentiel doublement sémantique et matériel, sonore et visuel : jeux sur l’homophonie, la polysémie, etc. Le langage est ainsi envisagé sous un jour nouveau afin de le faire signifier autrement. Les mots recèlent un pouvoir dynamique de métamorphoses qu’il appartient au poète de révéler. Chez Aragon, ce potentiel permet d’accéder au surréel. Chez Queneau, il faut voir là quelques réminiscences de son expérience surréaliste. En tentant d’élargir les limites assignées au langage, ils cherchent à créer l’insolite et à perturber notre vision.
Les deux auteurs recherchent en effet le dépaysement de la vision qui peut passer par un détournement de la fonction des objets : l’exemple des bains, des éponges dans Le Paysan, celui du bilboquet dans Le Chiendent le prouvent. Mais cela se traduit surtout par un usage déviant du langage, par une esthétique de l’image comme bouleversement des catégories logiques et rapprochement de réalités éloignées qui transforme par là notre façon de voir. Tout le surréalisme d’Aragon se base sur cette définition de l’image comme bouleversement de la conception du monde. Mais l’image possède pour lui un caractère incontrôlé et lyrique[[. Cf. « Discours de l’imagination » : « l’emploi déréglé et passionnel du stupéfiant image », Paysan de Paris, p. 82.
]] que rejette Queneau pour son arbitraire. Chez Aragon, l’image sera d’autant plus forte qu’elle s’éloignera du terme de départ. Elle possède de plus un rapport avec l’infini qu’aurait certainement récusé Queneau. Ce dernier retrouve tout de même une esthétique similaire, mais pour lui, le rapport des deux termes doit être motivé et voulu. L’image est élaborée consciemment et possède une dimension moins lyrique, plus humoristique et distanciée que chez Aragon. On peut, de même, rapprocher tous les procédés par lesquels, outre l’image, les deux auteurs tentent une défamiliarisation de notre perception du réel banal. Par le détail descriptif, le collage, Aragon déconstruit notre manière de voir par le grossissement, la métamorphose, la décontextualisation, etc. Queneau tente de subvertir nos mécanismes intellectuels d’identification par la mise en valeur d’un mode sensible d’appréhension du réel. Chez eux, il s’agit de voir autrement afin de déceler les aspects insolites, merveilleux ou incongrus contenus à l’état latent dans le réel banal. Le langage véhicule une vision figée du réel quand il est envisagé sous son aspect abstrait, mais si l’on change de point de vue sur son usage quotidien, il a aussi la capacité de transformer notre regard.
Chez les deux auteurs, il y a une critique des lieux communs et des automatismes de pensée qui participe d’une forme de critique sociale par laquelle ils condamnent l’absence de perspective critique. La société est insensible au mystère ou à l’insolite car elle rapporte tout à du connu. Les deux écrivains fustigent une vision figée du monde qui consiste à appréhender la réalité à travers des cadres. Ils dénoncent, de même, un certain réalisme, synonyme de rationnel pour Aragon, orienté vers la reproduction d’un réel de conventions. Ce refus des conventions et des lieux communs procède chez Aragon, en vertu d’une esthétique de l’infini, d’une critique plus générale de la raison et des concepts qui figent le concret du réel en le ramenant à de l’abstrait. Queneau en revanche ne critique pas la raison en tant que telle, mais son usage dégradé. Il s’agit pour lui de garder constamment une forme de distance critique et consciente et d’être capable d’exercer son libre-arbitre. Cette critique du réalisme passe aussi chez les deux auteurs par le rejet d’une forme de représentation liée à un système idéologique de valeurs.
Chez Queneau et Aragon, le roman possède une dimension polémique qui consiste à démystifier et subvertir une vision figée du monde véhiculée par l’idéologie et la classe dominantes. Même si cet aspect est plus fort chez Aragon, le roman a bien pour fonction chez les deux de nous faire envisager autrement la réalité, débarrassée des valeurs bourgeoises. Mais, chez Aragon, il s’agit de fonder une autre forme de réalisme qui manifeste l’irrationnel et les désirs qu’occulte le roman traditionnel. Queneau se méfie de l’irrationnel et des désirs et son attitude est doublement rationnelle et critique.
Si les deux auteurs se rapprochent du point de vue philosophique en ce qui concerne les rapports du sujet au réel, ils s’opposent dans leur pensée de la réalité sensible et des apparences. Queneau s’inscrit tout d’abord dans une tradition philosophique classique qui s’inspire de Platon et de Descartes tandis qu’Aragon en prend le contre-pied. Aragon nie l’opposition séculaire entre réalité sensible et réalité intelligible. Toute la réflexion de Queneau est basée au contraire sur cette opposition entre le réel et les apparences sensibles. Ces dernières sont trompeuses et nos sens risquent de nous fourvoyer. Il retrouve l’hypothèse platonicienne d’une réalité cachée derrière les apparences. Queneau et son personnage, Etienne, cherchent à se mettre à l’abri de l’erreur. Le faux, l’apparence, l’illusion, l’erreur ne sont pas réels mais synonymes de néant. Il faut voir derrière les apparences, mais derrière elles, il risque de n’y avoir rien. Pour Aragon, les apparences sont signifiantes. Par le surréel, il veut parvenir à dépasser l’opposition logique entre le subjectif et l’objectif. Pour Queneau, en revanche, tout rapport subjectif est illusoire : il souhaite dans une perspective plus classique atteindre le réel en soi.
Ces conceptions peuvent rendre compte du traitement différent chez les deux auteurs du thème des métamorphoses et de la déformation du réel. Toute l’esthétique surréaliste d’Aragon, en particulier dans Le Paysan de Paris, est fondée là-dessus. Une dimension comparable est à l’œuvre dans Le Chiendent. Nous avons étudié en effet, ce que nous avons appelé « le prisme délirant des personnages » et nous avons vu aussi que le roman nous confrontait à tout un jeu d’avatars. Pour Aragon, le surréel a une connotation positive puisqu’il révèle l’homme à lui-même. Pour Queneau, au contraire, cette dimension est négative. La déformation du réel par les personnages s’incarne dans la porte du père Taupe qui concentre tous les fantasmes des protagonistes. Or ces fantasmes sont néant, car derrière la porte, il n’y a rien. L’imagination des personnages s’exerce à vide. De même, le jeu de métamorphoses qui est à l’œuvre dans Le Chiendent est négatif car il met en péril la consistance du monde romanesque et l’identité des personnages, et symbolise l’absence de réalité stable derrière les apparences. Il y a cependant une dimension analogue chez Aragon, car comme nous l’avons vu, l’esthétique du surréel poussée à l’extrême, met aussi à mal la stabilité du monde et l’identité des personnages, en particulier dans La Défense de l’infini.
La mythologie d’Aragon manifeste un certain optimisme tandis que la pensée du néant qu’on trouve chez Queneau reflète un pessimisme certain. Pour Queneau, il n’y a aucune transcendance, le monde est vide de signification. Aragon retrouve une pensée de la divinité et du sens qui a son origine dans l’homme lui-même. Pour Aragon, le mythe permet une communication entre le réel et la psyché. Il naît de la fusion de la pensée inconsciente et du monde contemporain. Pour Queneau, au contraire, il n’y a aucune communication entre le monde et la psyché. De ce point de vue, Aragon demeure plus idéaliste que Queneau puisque pour lui, le sujet, son inconscient peut être à l’origine du monde.
Cependant, nous avons vu que chez Aragon, affleurait par endroits un conflit entre le subjectif et l’objectif qui peut être rapproché du conflit entre le réel et les apparences chez Queneau. Chez Aragon ce conflit prend racine dans le fait que le sujet ne peut s’extraire des structures cognitives par lesquelles il appréhende nécessairement le réel. Or dans Le Chiendent, Etienne accède à l’existence quand le réel cesse d’être en harmonie avec sa perception et qu’il commence à faire question. Chez Aragon comme chez Queneau, la pensée platonicienne sert naturellement de base à ce conflit.
Aragon et Queneau s’opposent aussi dans leur conception du temps et de l’histoire, de la réalité changeante et mouvante. Pour Aragon, la perception du temps s’identifie au merveilleux tandis que pour Queneau, elle est synonyme d’apparences, de néant et de malheur. Pour Aragon, la pensée rationnelle et logique fige l’infini et le concret du réel. Par la pensée mythique, il veut parvenir à penser le mouvement, le réel historique dans toute sa concrétude éphémère. Pour Queneau, au contraire, la création, sa circularité et la répétition, visent à annuler le temps. La réalité mouvante que valorise Aragon est perçue comme un défaut par Queneau qui tente plutôt de retrouver une réalité éternelle et hors temps qui se cache derrière le monde du devenir et des apparences. La pensée mythique d’Aragon s’oppose à une pensée des essences stables, de la substance et de la permanence chez Queneau pour qui il existe un monde figé, parfait, de nature mathématique, plus vrai et plus beau que le monde historique et sensible.
Ces divergences de pensée peuvent rendre compte de l’opposition entre une pensée de l’infini, et une pensée de l’individuation. Michel dans La Défense de l’infini recherche la néantisation de sa propre identité et de sa conscience, tandis qu’Etienne dans Le Chiendent passe de l’anonymat à l’être, prend consistance, accède à l’existence d’homme pensant et prend possession de son identité. Aragon valorise une forme d’illimitation quand Queneau voit l’être et la permanence comme idéaux.
De même, dans Le Paysan, Aragon cherche à saisir la spécificité de son époque. Le sens mythique s’identifie pour lui à un sens inconscient de l’existence historique et éphémère. Dans Le Chiendent en revanche, l’utopie historique de la fin du roman annule le temps en établissant une équivalence entre les époques. Elle fait valoir que l’histoire n’est jamais que la répétition d’elle-même, et cette répétition qui va de pair avec la violence des passions humaines est synonyme de malheurs. Queneau et Aragon sont hégéliens, mais Aragon garde à l’esprit la notion de « progrès » car pour lui, l’imagination tend à se concrétiser de plus en plus, tandis que Queneau ne voit aucun progrès, mais seulement un temps cyclique dont il aspire à sortir. Nous avons souligné de plus, le caractère très romanesque du Paysan de Paris dont la progression aboutit à la maîtrise du Concret et à la « promesse » du matérialisme dialectique. La circularité du Chiendent et le retour au point de départ dont elle témoigne est au contraire une entrave au romanesque et manifeste une vision pessimiste de l’histoire.
On trouve une pensée du chaos du monde et de l’histoire chez les deux auteurs. Or Aragon critique la raison et la métaphysique traditionnelle qui cherchent à ordonner le désordre. En définissant une « métaphysique du concret », il veut parvenir à penser le désordre, impensable par la pensée logique ou essentielle. Pour Queneau au contraire, il faut retrouver par la pensée ou la création l’ordre latent qui se cache derrière le désordre apparent du monde. Il y a bien chez les deux écrivains l’idée d’une autre forme de pensée, de nature métaphysique, qui doit nous amener à penser le « réel », mais ce réel s’identifie au concret, au désordre pour Aragon et il transcende notre raison, il s’identifie à l’ordre, à un autre monde de nature rationnel et mathématique qui transcende nos sens chez Queneau.
Ces conceptions divergentes justifient les regards différents que les deux auteurs posent sur la nature du désir. Même s’il valorise l’amour de la même manière qu’Aragon, Queneau considère les instincts humains sous un angle beaucoup plus négatif. Nous avions vu qu’un certain manichéisme était à l’œuvre dans Le Chiendent, hérité des conceptions gnostiques et des lectures de Renée Guénon faites par Queneau. Il y a dans le roman un antagonisme entre l’ombre et la lumière, entre les puissances du bien et celles du mal. Cet aspect rappelle en quelque sorte le jeu d’ombre et de lumière, symbole des fantasmes humains dans Le Paysan de Paris. Or cette question du mal, des mauvais désirs et des mauvais instincts, qui trouvent leur expression dans des personnages comme Madame Cloche ou Bébé Toutout, est envisagée sous un angle négatif par Queneau, car c’est dans la guerre, dans l’histoire et son chaos, destinés à être vaincus, qu’ils prospèrent.
Il y a par-delà ces discordances, une pensée chez les deux auteurs de la femme et de la poésie salvatrices. L’absence d’amour est synonyme de solitude, de malheur et d’absence de perspective métaphysique. Chez Aragon, la femme sauve de l’enfermement abstrait en soi, ainsi que des puissances dissolutives de l’infini. La femme et la poésie incarnent la notion et sont des voies d’accès au concret. La femme et l’amour chez Queneau permettent de donner un sens à la vie et de dépasser l’absurde et le vide. Le monde poétique, créé, confère une forme de positivité à l’imaginaire et rend possible la métaphysique par-delà le néant du monde réel. Cette valorisation de l’amour et de la poésie, est sans doute un des enseignements positifs que les deux auteurs tirent de leur expérience surréaliste.
Par ailleurs, avec le néo-français et la nécessité de définir de nouvelles règles à la langue, Queneau retrouve des exigences analogues à celles d’Aragon : il faut se conformer au mouvement, à la réalité vivante de la langue, et ne pas se laisser enfermer par les dogmes et les tournures sclérosées du français classique qui ne peuvent manquer de figer la pensée. Tous deux entretiennent un lien très fort entre la langue et la pensée. Il est intéressant de noter que Queneau, dans différents commentaires, a souligné le rôle d’Aragon dans l’élaboration d’une nouvelle littérature usant d’un registre de langue « parlé » :
N’empêche que [Le Voyage au bout de la nuit de Céline] est le premier livre important où l’usage du français parlé ne soit pas limité au dialogue, mais aussi au narré ; on ne trouve cela que dans quelques nouvelles du Libertinage : l’influence d’Aragon, et du surréalisme en général, sur Céline est incontestable[[. Queneau, « On cause », Bâtons, chiffres et lettres, op. cit., p. 53.
]].
Il y a de même chez les deux auteurs, bien que sous des formes assez différentes, une certaine forme de critique de l’abstraction et du concept. Pour Aragon, la pensée conceptuelle fige le réel en ramenant tout à de l’abstrait. Queneau tente de déconstruire notre mode intellectuel de voir au profit d’un mode sensible qui se rapproche de la réalité concrète. Aragon parvient à quelque chose de comparable avec la notion et l’image qui s’identifient au langage concret, incarné, déconceptualisé. Le concret s’apparente à une forme de pensée en mouvement, du mouvement. Même si Queneau ne cherche pas à se défaire de la raison, il critique une forme de raison dégradée, sclérosée, qui fige le réel en représentations arrêtées, pour parvenir à une pensée en mouvement.
Mais ce qui contribue surtout à rapprocher les deux auteurs est le rapport particulier qu’ils instituent entre philosophie et littérature. Ils tentent tous les deux de redonner une dimension concrète à la philosophie en l’introduisant dans le récit et en la soumettant au temps. On note aussi un traitement burlesque des énoncés philosophiques qui vise à les déstabiliser. Il y a les mêmes phénomènes de subversion des énoncés philosophiques qui passent souvent par un décalage entre la théorie abstraite et l’exemple utilisé, c’est-à-dire les objets ou les situations auxquels elle s’applique. Chez Aragon, la philosophie est mêlée au discours de l’image, et chez Queneau, la réflexion philosophique devient souvent prétexte à la création d’images subjectives. Chez les deux auteurs, l’humour est un moyen d’introduire une distance au sein d’une réflexion qui ne peut être, dans le contexte où ils écrivent, autosuffisante. Tous deux réconcilient donc le langage abstrait de la philosophie et le langage concret de la poésie et de la littérature. Mais cette similitude ne doit pas masquer des enjeux qui demeurent néanmoins différents. La réflexion philosophique est fondamentale et essentielle au Paysan de Paris, tandis que dans Le Chiendent, elle est présente uniquement à titre de points de repère, de suggestions. De plus, Aragon rejette l’abstraction et fait l’apologie du concret, c’est-à-dire qu’en instituant l’imagination en instrument de connaissance, il définit une voie alternative à la connaissance et cherche à faire une véritable synthèse, un véritable dépassement de l’opposition entre philosophie et poésie. Rien de tel chez Queneau : sa démarche découle plutôt d’un changement de point de vue et d’une reprise rieuse qui suggèrent que l’humour peut être la voie vers une autre forme de sagesse.
Les œuvres d’Aragon et de Queneau s’opposent aussi en ce qui concerne le rapport de l’écriture au moi. Aragon entretient l’ambiguïté entre la fiction et l’autobiographie. Les narrateurs du Paysan et de La Défense tout comme les personnages de La Défense s’identifient par beaucoup d’aspects à l’auteur lui-même. Le roman de Queneau est dominé au contraire par un principe d’effacement. L’auteur s’efforce d’effacer toute marque de sa subjectivité ou tout élément autobiographique ostensible. Au contraire d’Aragon qui dissimule volontairement mal les motifs autobiographiques, Queneau s’exprime par des moyens détournés et invisibles comme la formule numérique. Le narrateur aragonien refuse d’être réduit à une fonction abstraite, et apparaît souvent dans sa densité humaine. Quand Queneau se manifeste dans le texte, c’est uniquement en tant que créateur ou narrateur, organisateur de la parade. Chez Aragon, la distanciation de l’auteur à l’œuvre est difficile. Il n’y a pas de différence entre l’art et la vie. Pour Queneau, ce qui compte avant tout, c’est l’œuvre. Il tente donc de couper le plus possible les liens qui la relient à son auteur afin d’en faire un monde autonome, dominé par un principe d’objectivité.
Ces aspects justifient le traitement différent du rapport des personnages et de l’auteur chez les deux écrivains. Chez Aragon, il y a un rapport de sympathie et de ressemblance très étroit entre l’auteur et ses personnages qui sont beaucoup plus valorisés et approuvés que chez Queneau qui brosse le portrait d’antihéros dont il souligne allègrement la médiocrité ou la grossièreté. L’œuvre de ce dernier est dominée par un principe dysphorique qui fait tout pour éviter une identification trop directe au personnage. Au contraire d’Aragon, Queneau recherche avant tout la distanciation et pratique un détachement du moi émotionnel.
L’écriture devient cependant chez les deux auteurs le substrat d’une quête d’identité qui s’exprime de manière analogue. Dans La Défense de l’infini et Le Chiendent, la multiplication des personnages et des points de vue entraîne l’éparpillement des motifs autobiographiques et la dispersion de l’auteur en figures multiples, toutes participant de lui sans lui être réductibles. Nous avons analysé les enjeux du mentir-vrai chez Aragon. Or chez Queneau aussi, il y a une certaine forme de mentir-vrai qui passe notamment par le thème du masque. Chez les deux auteurs, la quête de soi revêt un aspect dialectique : il s’agit de se dire par le travestissement, en passant par l’autre, le personnage pour se saisir soi-même. Mais la dispersion de la figure de l’auteur a aussi des enjeux et des conséquences différents. Nous avons déjà souligné que l’autonomie laissée aux personnages dans La Défense marquait une tendance à laisser affleurer dans le texte une forme de première personne qui réapparaît sans cesse sous des formes diverses et fluctuantes. Chez Queneau au contraire, la multiplication des points de vue a pour rôle d’empêcher l’expression d’une voix subjective. Le brouillage de l’énonciation chez Aragon aboutit à la valorisation de la parole lyrique, tandis que Queneau la refuse. Chez Aragon, il y a errance d’une voix unique sans forme propre qui s’incarne au hasard de la narration dans les différents personnages tandis que chez Queneau, la dissémination et la pluralisation visent à l’objectivation des motifs personnels. Il faut dépasser le stade du subjectivisme pour créer un texte-objet, autonome, ayant une vie propre en dehors de son créateur.
On peut néanmoins affirmer qu’il y a aussi chez Aragon, comme chez Queneau, une quête d’objectivité. On a vu en effet, que dans « Le Sentiment de la nature », l’auteur tendait à se défaire du subjectif individuel pour se tourner vers la troisième personne et la saisie d’une forme de subjectif collectif. Cette tendance qui n’est pas totalement réalisée dans Le Paysan de Paris se confirme dans La Défense de l’infini qui consacre le passage du roman de la première personne au roman collectif annonçant le roman social. Comme Queneau, Aragon refuse l’expansion du seul « je » individuel en faveur du collectif. Cependant l’objectivité revêt chez Aragon une dimension sociale et historique qu’elle n’a pas chez Queneau où elle est davantage esthétique : il faut ériger le roman en monde autonome.
Il nous reste à examiner les rapports qu’entretiennent les trois œuvres au réel. Elles donnent toutes trois lieu à une critique sociale. Leur ancrage profond dans la réalité de leur temps reflète l’attirance de leurs auteurs pour le marxisme dialectique, leur condamnation du capitalisme et de certains aspects de la société bourgeoise. Il y a dans Le Paysan de Paris comme dans Le Chiendent un même réalisme historique qui se signale d’abord par l’espace-temps : la ville de Paris au milieu des années 1920 pour le premier, au début des années 1930 pour le second. L’accent est mis sur la réalité quotidienne : la vie des commerçants, des prostituées, chez Aragon, les transports en commun, le travail chez Queneau. Le réalisme socioculturel est très présent aussi chez les deux auteurs notamment par la mise en valeur des inégalités constitutives de la société. La prise de partie en faveur des petits commerçants dans « Le Passage de l’Opéra » rappelle la critique de la vie quotidienne imposée aux « petits » dans Le Chiendent. Aragon et Queneau portent une même attention à la condition des femmes. Le premier décrit le train de vie des prostituées du passage de l’Opéra, il se déclare en faveur de la libération du désir féminin dans La Défense de l’infini et Queneau montre les conditions de vie particulièrement difficiles de personnages comme Alberte ou Ernestine. Sur le plan politique, on trouve une même condamnation du discours de propagande utilisé en temps de guerre. L’asservissement des individus aux raisons d’Etat et les valeurs qui servent de justification aux conflits sont remis en cause. De même, l’absence de perspective d’une société régie par des stéréotypes est dénoncée. La routine, le travail et le temps social asservissent les individus, les restreignent et les transforment en machines. Pour Aragon, les lois et les institutions sont des cadres qui limitent les individus. Sans avoir ce degré de contestation violente, il y a une conscience chez Queneau que l’horizon des individus est bloqué. Mais la conception de la limite n’est pas la même chez les deux auteurs. Par leur aspiration à l’infini, les personnages de La Défense cherchent à se laisser informer par le hasard, alors que pour Queneau, il faut, dans une société qui rend anonyme, parvenir à se définir librement soi-même, à devenir un individu capable de libre-arbitre. Ces différentes conceptions s’expliquent en fonction d’enjeux philosophiques que nous avons analysés précédemment. Par ailleurs, chez les deux auteurs, les valeurs sociales occultent le désir. Mais tandis qu’Aragon en prône la libération, Queneau en dévoile les aspects négatifs par la dénonciation des valeurs fausses qui justifient les guerres et qui sont en fait motivées par les instincts violents et cruels qui gisent au fond de la nature humaine.
Chez Aragon, la violence de la contestation par la subversion et la révolte qu’elle prescrit, confère à la critique une dimension de démesure qui n’existe pas chez Queneau. On note chez ce dernier une esthétique dysphorique du cadre et de la limite qui s’oppose chez Aragon à l’esthétique de l’infini par explosion des cadres. On peut par là rendre compte du traitement différent du rapport aux personnages chez les deux auteurs. Chez Aragon, il y a une adéquation entre éthique, esthétique et thématique de l’infini. Il met en scène des personnages en révolte qui possèdent en quelque sorte des aspirations similaires aux siennes et qui tentent de s’extraire des limitations imposées par la société. Chez Queneau, la critique passe davantage par l’humour, l’ironie et la distanciation. Elle possède une dimension détournée qui se traduit par l’insistance et la caricature, la mise en exergue des défauts des personnages, de la banalité et de la grossièreté, ainsi que de l’absence de perspective qui a trait dans la société.
De même qu’il possède une dimension critique, le roman autorise la compréhension et, éventuellement, la transformation du monde chez les deux auteurs. Chez Aragon, le roman n’est pas un miroir orienté vers la traduction d’une réalité préexistante mais un espace d’investigation qui permet d’appréhender l’infini du réel, dans sa double acception psychique et sociale, débarrassé de l’idéologie dominante. Contrairement à ce que pensaient les surréalistes, le roman n’est pas pour lui contradictoire avec l’exigence de transformation du monde. Pour Queneau de même, le romancier doit produire un savoir, se placer dans le sens de l’avenir et préfigurer le monde de demain. En outre, chez Aragon, on explore la réalité par l’écart, en la mentant. Chez Queneau, il y a quelque chose de similaire car il ne s’agit pas de la restituer telle quelle mais d’en effectuer une transposition poétique.
Une double dimension rapproche donc Queneau d’Aragon : ils revalorisent contre le surréalisme la notion de création littéraire en fonction de critères propres, et ils font de leurs œuvres l’enjeu d’une critique de la société. Mais il y a un aspect de leur esthétique qui les oppose irréfutablement. Pour Aragon, l’art tire ses racines d’une confrontation avec le monde réel tandis que Queneau veut couper les liens qui les relient. Ce dernier rejette en les renvoyant dos-à-dos réalisme et surréalisme comme une même tentative de pénétrer la réalité. Le roman ne doit pas tirer sa valeur ou son essence d’exigences mimétiques, mais il doit s’ériger en pure forme que rien d’extérieur ne motive. Queneau met souvent en abyme dans le texte même le fait que tout est imaginaire, artificiel. En revanche, et c’est ce qui permet de souligner la continuité de son œuvre, le surréalisme d’Aragon est avant tout un réalisme qui entend montrer les liens indissolubles qui existent entre le réel et l’imaginaire, entre le réel et l’irréel. On a donc chez Aragon, en particulier dans Le Paysan de Paris, une réelle volonté de saisir le réel en tant que tel, notamment par la description. Cette volonté prend une dimension parfois proprement documentaire à travers des tableaux qui rappellent les descriptions des romans réalistes. Queneau, lui, préfère en passer par la transposition poétique des données du réel. Il y a en outre un rapport conflictuel entre l’art et le réel chez Aragon car la réalité est infinie et résiste à toute mise en mots. Ce conflit cesse d’être chez Queneau, car il se détache volontairement du réel pour créer un monde imaginaire autonome. On trouve chez les deux auteurs une même critique du roman traditionnel basé sur l’analyse psychologique et/ou sociologique, mais elle dérive d’enjeux fondamentalement différents. Les personnages de Queneau sont dénués de psychologie, car ils ne sont pas construits sur le modèle d’individus réels, mais sont des êtres fictifs, des êtres de papiers, vides, sans consistance propre. Considérant que la psyché ou la société sont inassignables à aucun système d’explication rationnelle, Aragon veut les manifester sans les rendre intelligibles. Queneau critique le réalisme traditionnel car pour lui, le roman doit se construire en fonction de critères formels d’harmonie interne fondés sur des contraintes qui n’ont aucun rapport avec la réalité. Aragon, lui, veut fonder une nouvelle forme de réalisme qui ne soit pas synonyme de rationnel mais qui englobe la réalité dans toutes ses dimensions, y compris celles qui concernent l’irrationnel et le désir. Compte tenu de ces conceptions différentes et des évolutions ultérieures des deux auteurs, Aragon se consacrera au réalisme social, tandis que Queneau prônera le désengagement, moyen privilégié pour porter un regard critique sur le monde d’un œil désintéressé. Queneau condamne la littérature engagée car elle mise sur le seul discours au détriment de la forme. Or, dès les œuvres de notre corpus, la forme est pour Aragon, essentiellement solidaire du contenu. Un lien fondamental relie la forme et le fond chez les deux auteurs, mais en fonction d’enjeux philosophiques différents.
Nous avons souligné que chez les deux auteurs, il y avait une conception du chaos du monde et de l’histoire. La forme se fait chez eux l’écho d’une exigence par rapport à ce désordre qui peut rendre compte des divergences formelles que nous avons mises en valeur : forces centrifuges, illimitation et bordel du roman chez Aragon, achèvement, ordre et perfection chez Queneau. Le collage correspond chez Aragon à la tentation de jouer avec les limites de l’écriture en introduisant le réel lui-même dans l’œuvre. L’œuvre aragonienne cherche à se laisser traverser par le réel, à se conformer à son désordre, son infini, son « bordel », d’où l’éclatement de la linéarité du texte. Le désordre du roman, la simultanéité et l’entrecroisement des histoires répondent au désordre du monde et de la société. Queneau qui tente au contraire de faire une œuvre autonome, indépendante du monde réel, se donne des règles afin d’imposer une forme a priori à la matière romanesque. Pour lui, il faut couper les liens qui relient l’œuvre avec autre chose qu’elle-même – la mimesis, le moi de l’auteur – pour en faire une totalité close, autosuffisante et parfaite qui possède son harmonie interne, artificielle. À l’inverse, une force d’anéantissement traverse les œuvres d’Aragon en raison d’une difficulté de l’auteur à laisser exister son texte comme objet autonome. Le texte-objet de Queneau s’oppose à l’illimitation dionysiaque de l’œuvre chez Aragon : le roman est sans limites, traversé par des forces qui le transcendent : le réel, le moi, l’auteur, etc. Cependant, comme nous l’avons vu avec Le Paysan de Paris, c’est bien à une forme d’achèvement et de particularisation de l’infini qu’on aboutit, synonyme d’une création dominée et d’une possibilité de maîtrise du texte et des forces qui le parcourent.
Les deux auteurs tentent par l’écriture de s’assurer une mainmise sur le monde pour maîtriser son chaos, mais cette exigence a des enjeux opposés. En se faisant démiurges, ils s’efforcent de battre les cartes et de se rendre maîtres d’un univers. Mais Aragon recherche cette emprise en se conformant au désordre du monde, en le manifestant sans pour autant le réduire. L’illimitation des œuvres, de La Défense de l’infini surtout, leur bordel, et leur non-finitude sont à mettre en rapport avec la « défense » de l’infini à laquelle se livre l’auteur et avec sa conception du monde comme désordre. Queneau au contraire, en fonction d’enjeux philosophiques que nous avons analysés précédemment, veut s’assurer une emprise sur le chaos du monde en retrouvant derrière le désordre apparent, un ordre caché. L’harmonie dont se réclame son roman n’est pas seulement formelle mais aussi métaphysique : par une forme basée sur la répétition et sur un ordre qui dérive de rapports de nombres, il s’agit de retrouver une architecture cachée de l’univers qui nous permette d’échapper au chaos et à la violence de l’histoire. Le désordre et l’ordre, l’illimitation et l’harmonie, le dionysiaque et l’apollinien offrent chez Queneau et Aragon des points fondamentaux de divergence formelle. Mais il demeure un point commun indéniable : chez Aragon comme chez Queneau, les formes ne sont pas vides. Queneau n’est pas adepte de la structuration contre Aragon qui serait adepte de l’informe : pour l’un comme pour l’autre, la forme est solidaire d’une conception philosophique du monde et d’une exigence métaphysique.
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION 1
PREMIÈRE PARTIE : ARAGON 10
I. STRUCTURE ET ÉCRITURE : RAISON ET LOGIQUE 10
A. LOGIQUE DE LA STRUCTURE 11
1. La composition d’ensemble des deux œuvres : une esthétique de la fragmentation 11
2. Logique de la diégèse 17
Le Paysan de Paris 18
· « Le Passage de l’Opéra » 18
· « Le Sentiment de la nature aux Buttes-Chaumont » 21
La Défense de l’infini 25
· La Multiplication des lignes diégétiques 25
· Diégèse et continuité 28
3. Une continuité d’ordre thématique 32
B. LOGIQUE DE L’ÉCRITURE 35
1. La question du genre 35
La fragmentation stylistique et les forces centrifuges 35
Contrastes stylistiques et énonciatifs 39
· Le Paysan de Paris 39
· La Défense de l’infini : un roman-poème ? 42
Linéarité de la prose et circularité poétique 42
Instabilité de l’instance narratrice 47
2. Instabilité du système narratif : les temps, l’énonciation et les personnages 50
Le Paysan de Paris 50
b) Instabilité de la frontière entre monde de la fiction et monde du narrateur dans La Défense de l’infini 51
· Autonomie laissée aux personnages 51
· Le narrateur s’adresse aux personnages 52
· Le brouillage des voix 53
3. Transgression de la logique de l’écriture : la question de la cohérence du propos avec lui-même 55
a) L’impossible adéquation au propos 55
b) La subversion du discours philosophique 56
c) Rupture et métatextualité 57
4. Narration et effet de direct 59
II. DU RÉEL AU SURRÉEL ; DU RÉEL AU CONCRET 63
A. CRITIQUE DE LA PENSÉE CLASSIQUE 63
1. Réalité sensible et réalité intelligible : réhabilitation de la sensibilité 63
2. Abandon au hasard de la perception sensible comme méthode de pensée 65
B. LE SURRÉEL COMME FUSION DU RÉEL ET DE L’« IRRÉEL » 67
1. Critique et limites de la représentation réaliste 69
2. La transfiguration du réel par l’imaginaire et le désir 71
3. Latence du surréel dans le langage : exploitation du pouvoir subversif des mots 74
4. Dépayser la vision 75
C. LE SENS MYTHIQUE 77
D. LE CONFLIT ENTRE LE MOI ET LE MONDE 83
E. UNE ESTHÉTIQUE DE L’INFINI : IMPLICATIONS PHILOSOPHIQUES, THÉMATIQUES ET SÉMANTIQUES DU MOTIF DE L’INFINI 86
1. Implications philosophiques 86
2. Thèmes et réseau lexical de l’infini 91
F. MÉTAPHYSIQUE DU CONCRET 96
1. Logique et métaphysique 96
2. L’amour comme voie de connaissance 100
3. L’image comme voie de connaissance 101
III. DIALECTIQUE DU HASARD ET DE LA MAÎTRISE 104
A. LA THÉORIE DE L’INCIPIT 104
B. L’ÉCRITURE COMME CONSTRUCTION EN COURS 109
C. LES SIGNES DE LA MAÎTRISE DE L’ÉCRITURE. 114
D. LA CRITIQUE SOCIALE ET L’ÉCRITURE COMME POSSIBILITÉ D’UNE MAINMISE SUR LE RÉEL 116
E. L’ÉCRITURE ET LE MOI : ENTRE POSSESSION ET DÉPOSSESSION DE SOI 124
F. L’ŒUVRE ET L’INFINI 127
DEUXIÈME PARTIE : QUENEAU 133
I. STRUCTURE ET ÉCRITURE : RAISON ET LOGIQUE 133
A. LOGIQUE DE LA STRUCTURE ET DU GENRE : LE CHIENDENT, UN ROMAN-POÈME ? 133
1. Critique du réalisme et du surréalisme 133
2. Roman et formes fixes 137
3. Maîtrise consciente de la fantaisie et de l’irrationnel 144
B. LOGIQUE DU LANGAGE ET DE L’ÉCRITURE 145
1. La transgression des règles du langage à l’échelle du mot ou de la phrase 146
a) Violation des codes du « bon »français et néo-français 146
b) Transgression des règles du langage et l’écriture comme jeu 149
2. Une écriture de type poétique : le rythme, les rimes, la répétition 155
3. Violation de la logique du langage au niveau du récit : la question de la cohérence du propos ou du discours 156
a) Mélange des niveaux de langue 156
b) Effets d’inadéquation au propos et de distanciation 157
II. LA RAISON ET LE REEL 159
A. LE RÉEL ET LE LANGAGE 159
B. LA CRITIQUE DES LIEUX COMMUNS 162
C. UNE ORGANISATION IDÉOLOGIQUE DU MONDE : LA QUESTION DES CONVENTIONS 164
III. LA QUESTION DU REALISME 166
A. LE RÉALISME DU CHIENDENT 166
B. UN ANTI-RÉALISME QUENIEN 170
1. Dévoilement des procédés traditionnels de construction du roman et déconstruction de l’illusion mimétique 170
2. L’écriture est l’objet d’un travail 171
3. « Délire » de l’écriture et « délire » des personnages : dévoilement du caractère essentiellement fictionnel de l’écriture 172
a) Les indices métatextuels qui soulignent la fiction 172
b) La question de la vraisemblance 173
· L’invraisemblance des situations 173
· Humour et déformation du « réel » : la ronde des points de vue ou le prisme délirant des personnages 173
4. Négation de la dimension référentielle au seul profit de l’invention verbale et de la jouissance qu’elle provoque 174
5. Jeu sur les automatismes de lecture et d’écriture 175
IV. L’ECRITURE ET LE MOI 177
A. ATMOSPHÈRE DYSPHORIQUE DU RÉCIT ET DISTANCIATION 177
B. LITTERATURE ET PHILOSOPHIE 179
1. Intertexte et enjeux philosophiques 179
2. La dimension concrète de la philosophie dans l’œuvre 187
3. Mise à distance parodique de la réflexion philosophique 187
4. Subversion de la méthode philosophique, rapport subjectif au texte et principe de plaisir 188
C. L’ÉCRITURE : ENTRE QUÊTE DE SOI ET OBJECTIVITÉ 189
1. S’exprimer par des moyens indirects : la formule numérique du Chiendent 189
2. Le thème du masque et la dispersion des motifs autobiographiques 190
D. L’ÉCRITURE ET LE MONDE 191
CONCLUSION 198
BIBLIOGRAPHIE 220